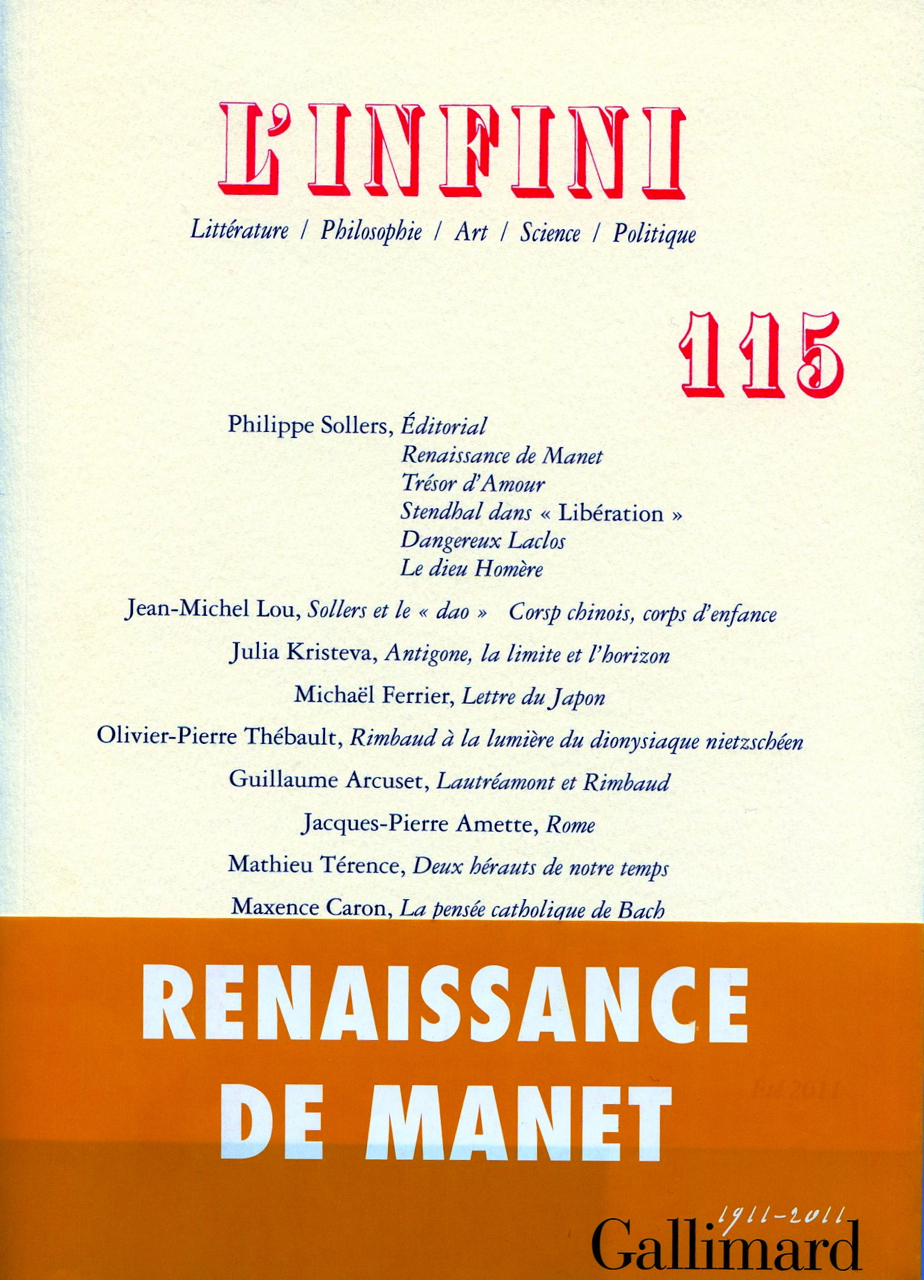|
Julia Kristeva Antigone, la limite et l’horizon
1. Qui êtes-vous, Antigone ? Un
enfant (pais, néais), une fille (korê), un rejeton (gennêmo) d’Œdipe, une fiancé (nymphê),
une vierge (parthenos), ainsi nommée
seulement à l’état de cadavre désiré par Hémon, votre cousin, le fils de votre
ennemi Créon ? Ce dernier vous
soupçonne même d’être un homme : « Ce n’est plus moi, c’est elle
qui est l’homme », s’écrie votre
oncle maternel, ce tyran à la raison duquel vous vous opposez en bravant son
édit : l’interdiction d’enterrer votre frère Polynice, ce qui fait de vous
une hors-la loi, une criminelle. Rebelle
assurément, vous n’êtes certainement pas une guerrière : aucun rapport
avec Jeanne d’Arc, ni même avec une héroïne de devoir, à la Corneille. Vous
êtes une résistante farouche à la tyrannie, dans laquelle bascule
immanquablement la logique d’Etat, et peut-être même la pensée politique en général,
lorsqu’elles ignorent cette « individualité
absolue » dans laquelle vous campez, et que vous revendiquez pour
votre frère. C’est là votre sacré, paré de l’indestructible désir à mort dont l’ « utilisation divine »
ne vous échappe pas.
Seriez-vous une irréductible
solitaire ? Une impavide ? Froide, rigide,
frigide, si l’on en croit votre adversaire Créon – toujours lui –
qui, décidément, vous déteste (mais il finira par céder, et s’effondrera dans une sorte de chiasme piteux, double
inversé de votre anéantissement : attendons la fin du spectacle).
« Et sache bien (il menace Hémon qui voulait vous épouser, drôle d’idée, vous,
la vierge fiancée avec la mort !),
que c’est une étreinte glacée que celle que vous offre au logis une épouse
méchante », une fille qui « dégoûte », tout juste bonne à aller « chercher
un époux dans les enfers » (v. 650 sq.)
A moins que vous soyez, au
contraire, une personne secourable
qui vient en aide (ophelein) aux
morts eux-mêmes (v. 559-560) ?
Pas à tous, on ne l’a que trop dit. Vous avez votre préféré, un de vos frères,
c’est bien naturel, descendants que vous êtes des incestueux Œdipe et Jocaste :
ce sera Polynice, comme par hasard, Poluneikes, celui qui « abonde en discordes » comme
son nom l’indique, qui se plaît à attaquer sa propre cité, sa patrie-matrie, et
pour parler franchement un anarchiste qui veut détruire les siens. Bon, cela
n’empêche pas que vous soyez une personne secourable, à votre manière, une
Ophélie, si l’on entend bien le mot grec (« ophelein ») en pensant à Shakespeare. Et follement tournée, comme
elle, vers la mort, vingt siècles avant que s’en éprenne Hamlet.
Noir Eros comprimé en flashes, imeros enargés, « désir
rayonnant » qui enchante les vieillards du Chœur séduit par les
« regards de la vierge promise au lit de son époux » (v. 795) ? Côtoyant toutefois une psychorigide qui
se défend des liens incestueux si prisés dans la famille des Labdacides ? La
« fille intraitable du père intraitable » (v. 472), du « fer cuit et recuit » qui
« se fend et éclate plus aisément » (v. 475) que quiconque et de raison ? Une « pauvre
rebelle aux ordres du roi » » (v. 375-385), une « petite
Antigone coupable » ? Pis,
vous seriez rétive à toute civilisation, crue - omos - (v. 471), autant dire sauvage, inhumaine ? Et si cruelle avec Ismène
pour commencer, votre sœur prudente, « celle qui sait », elle, puisque
c’est ainsi que votre père l’a nommée en la destinant à la sagesse. Assez
d’aveuglement dans la famille…
Non ? Peut-être pas, en
effet. Vous ne pensez qu’à Polynice, mais puisque vous être dédoublée -
tiraillée (je dirais clivée) entre
la cité et Hadès, le monde de Créon et celui de la mort, la logique
politique et celle de votre sang, si et seulement s’il est un sang d’insurgé,
de séditieux, de fauteur de transgressions (dont la plus active est évidemment
le meurtre), et donc s’il est le sang de Polynice qui a déclenché une guerre
civile - eh bien ! dans un de
ces oxymorons dont vous avez le génie avec Sophocle, vous vous définissez comme
une sœur « saintement criminelle », désirant tout simplement reposer
près de son frère, « chère à qui m’est cher », pureté des noces post-mortem. A Créon qui
prend votre pitié mortuaire pour une variante de la haine et une absence d’ami,
vous rétorquez avec une autre définition de vous-même qui surprendra ceux qui
ne vous comprennent pas : « Je ne suis pas de ceux qui haïssent, je
suis née pour aimer avec (symphilein) »
(v. 523). Et on ne comptera plus les romantiques qui pleureront, dans les siècles des siècles, votre anti-mariage mystique :
poètes, féministes, âmes mélancoliques !
A commencer par le Garde, dans votre
pièce, qui vous surprend à votre deuxième action criminelle, lavant
et couvrant de poussière le cadavre
de Polynice pour le protéger du soleil, des oiseaux et des chiens. Le brave
serviteur ne peut s’empêcher de
compatir, peut-être même de jouir, malgré l’édit de Créon : « J’en ai
plaisir et peine ensemble » (v. 430-440). Ses sensations qui sont en
réalité les vôtres au moment de l’acte d’amour funéraire, le Chœur lui-même les
partage, c’est clair, puisqu’il est le porte-voix de Dionysos lui-même :
de telle sorte que ce premier kommos de
la tragédie qui porte votre nom, entraîne le public tout entier dans votre
émotion, où douleur et exaltation s’allient et s’annulent. Créon, lui, n’aura
pas droit à cette empathie dans le kommos qui lui est consacré à la fin du spectacle. Le vainqueur, c’est vous, Antigone,
et nous nous demandons encore ce que cela peut bien vouloir dire.
Personnage incernable, indéfinissable, sans identité fixe dans votre
authenticité même, vous vous
échappez, Antigone. Je comprends que vous préfériez l’obscurité d’en bas, vous
n’êtes pas de ce monde. Pourtant, rien d’indécis dans cette dérobade :
vous vous faites la loi (nomos) toute
seule ! Dans votre insolente autonomie de fille d’Œdipe le transgresseur, vous
savez d’avance que vous vous excluez de la justice politique, voire des normes
humaines. Mais votre savoir (qui témoigne tout de même que vous « en êtes
», de ce monde social, en partie du moins), ne vous gêne guère. Au contraire,
vous persistez dans votre obstinée, invincible, sublime certitude. « Rien
ne la démonte /…/ Elle ne nie rien. »; « J’avoue, je l’ai fait, je ne
nie rien. ». Et à Créon, qui n’en
revient pas qu’on ose défier la loi sans l’ignorer, pour ainsi aller à la mort en
pleine conscience : « Connaissais-tu la défense que j’avais fait
proclamer ? » Antigone : « Oui, je la connaissais :
pouvais-je l’ignorer ? Elle était des plus claires. » (v. 445, sq.)
Pas folle, la petite Antigone. Ou alors d’une folie qui révèle
une logique supérieure et limpide, intrinsèque, qui se révélera contagieuse, peut-être
éternelle, universelle ?
2. Antigone est-elle comme elle est parce qu’elle est le
fruit de l’inceste ? Et qu’elle en subit les conséquences ? Et qu’elle
les conduit à leur acmé et à leur terme tragique, avant que les usages de la
cité viennent recadrer ces confuses
passions claniques, et que des Lois de Platon établissent en toute lucidité un ordre familial et politique qui préfigure déjà le nôtre ? Un vestige du passé, tout
juste bon pour les archives des psys ?
Ou bien Antigone est-elle Antigone parce qu’elle est une femme ? Sa solitude minérale, son désir
cadavérique, son endurance dans le « non » qu’elle lance au bon sens,
révèlent-ils des traits spécifiquement féminins, qui agiraient comme une corrosion
permanente du lien social ? Bien plus dangereuse que l’ « éternelle
ironie de la communauté », que diagnostiqua Hegel ?
Mais alors, ce « non »
qu’elle oppose aux lois de Créon (à
ses abus totalitaire ou au bon sens politique ? vaste sujet que les
démocrates spécialisés dans les droits de l’homme n’ont pas encore tiré au
clair), est-il un « non » dynamique, prospectif, faustien,
dialectique ? Ou plutôt, en visant cette limite où l’humain se
déborde lui-même et que le sacré affectionne, le défi d’Antigone se condamne-t-il
à prouver l’existence de l’intraitable pulsion de mort, que Freud nous a léguée
sans autres précisions ni précautions?
La pulsion de mort n’est pas
cette agressivité virile propre aux deux sexes, qui érotise les luttes à morts sous couvert de désirs, et
qui détaille le supplice érotique sous la plume d’un marquis de Sade, par
exemple, comme ultime astuce de l’Etre suprême, surtout quand ça bute sur l’insensible dureté des victimes.
Non, Antigone met au jour une énergie placide
qui coupe les liens, une dé-liaison précisément, qui annule les identités et les différences, pour installer le sujet, par delà la perte, la
dépression et la souffrance, dans le pathos
du dépassionnement. Le laisser-faire suicidaire ne se distingue pas ici de
l’endurance, l’indifférence peut étinceler en soins, et l’abjection de la vie se
perpétuer en désobéissance insensée régénératrice du lien social. Psychose
blanche ? Ou triomphe de la sublimation au bord du refoulement originaire,
aux frontières du vivant, que l’individu parlant perçoit comme une sortie hors de soi,
états limites d’une impartageable identité. Mature, souveraine.
3. Parce qu’il est tissé de liens et de
recoupements incestueux et incestuels, le monde des Labdacides est dominé par
la quête obsédante du auto- et du homo- (Nicole Loraux). Mais il ne semble
pas connaître l’autre, si ce n’est
comme étranger, meurtrier ou fauteur de guerres civiles. Union auto-enfantante
entre la mère-épouse et le fils-époux, auto-engendrement, auto-affection, automutilation :
ça appartient à, ça se passe dans, ça dépend de la même famille, de la même matrice, de la même main. La mêmeté circule en boucle avec le même
sang, et ne se réfléchit qu’en réciprocité, en miroir, par parenté réversible
entre les issus des mêmes entrailles, et qui partagent une improbable identité (autos) mobile, problématique, virtuelle. Apte à s’approfondir cependant dans l’autodécouvrement
du propre soi-même, de la permanence de soi, comme le fait Antigone en poussant
l’autoconnaissance (autognotos, v. 875) jusqu’à cette métallique certitude de
soi que lui envie/reproche Créon. La souveraineté ainsi conquise par
l’exclusion (anti-) est prompte à
s’abolir aussitôt dans l’annulation de soi, mais dans l’acte tragique
seulement, comme Antigone ne manque pas de le faire en se mourant à elle-même, à proprement parler. Comme si elle
assassinait - depuis toujours déjà et en elle-même - le parent/ les parents auquel/ls elle
s’identifiait fatalement, et qu’elle ne saurait rejoindre pour de bon que dans
la tombe nuptiale (Authentês, le
meurtrier, aurait été d’abord celui qui commet l’acte – le meurtre étant
l’acte par excellence – sur un parent, le double de soi-même, rappelle N.
Loraux avec L. Gernet). Mais enfin, lequel des siens rejoint-elle, avec et à
travers Polynice et ses chevauchements identitaires ?
Dans ce labyrinthe d’identification-désidentification,
pertes et retrouvailles du même dans la clôture de la « mêmeté », homo- insiste sur la similitude davantage que sur l’identité propre (auto-), et creuse le sillon des parentés
réversibles. Sur ce versant, Antigone s’homologue précisément à son frère Polynice, lequel est homologué à son
père Œdipe (tous deux étant fils de Jocaste) ; mais aussi à l’homme dans sa virilité, puisqu’en se réfléchissant dans le miroir que lui tend Polynice,
elle capte le trait mâle que lui
reprochera son oncle Créon, un frère lui aussi, mais de la mère d’Antigone :
le frère de Jocaste.
Nous y sommes :
Jocaste ! L’unique, la seule innommée, imprononçable foyer autour
duquel tourne l’infernale poursuite
de auto- et homo-.
Point de mire de l’imagerie tragique de la pièce, jamais désignée explicitement, mais toujours
allusivement évoquée : « Il /Polynice/ est mon sang, d’une seule mère et du même père ». Comprenons : la mère Jocaste est la seule qui persiste dans son identité
propre, car elle est la mère de tous, Œdipe y compris ; tandis que le père
Œdipe est lui-même aussi l’enfant de cette mère-là, mais il n’est pas le seul puisqu’il
n’est pas le père de Jocaste.
Curieusement, Antigone ne veut pas se
rappeler que cette Mère Universelle n’est pas moins l’amante du fils/père, Sa
Seule Rivale, tout autant qu’elle est La Seule Mère. Antigone censure le
désir/plaisir de Jocaste, pour ne penser qu’à Jocaste la génitrice : au
sang fécond de la matrice, au seul et même sang maternel qui se prête comme
réalité et métaphore engendrant (au propre et au figuré) les identités fluides des consanguins.
Des identités amoureuses et/ou assassines, parce que, comme le sang,
elles sont vouées à la procréation et au carnage, jamais l’une sans l’autre. Identités
confondues et confuses des frères du « même sang » (homaimos), fratrie incestuelle qui ne
peut manifester son autonomie dans la similitude qu’en se répandant en guerres
sanguinaires avec elle-même. A
moins qu’un terme ne soit mise à la fécondité ?
Et ainsi seulement à sa doublure, la guerre ?
Héroïne de l’autoanalyse, vous
découvrez, Antigone, les secrets de la tragédie. Mais sans le dire, rien qu’en
vous tenant obstinément dans la déliaison.
Etranglés par la clôture de la famille incestuelle, les « mêmes » dans
leur imbrication auto- et homo- sont condamnés à la génération et à la tuerie : la famille engendreuse est tueuse. Pis,
suicidaire, car tuer un seul corps du même sang dans le labyrinthe consanguin des
équivoques, ricochets et réflexions équivaut - pour cette famille-ci - à suicider sa « mêmeté », à se suicider : les morts de/dans la famille sont des suicidés
de la famille. Les guerres intestines intrafamiliales et interfamiliales
s’éternisent, de surcroît, sous la forme de conflits politiques continus :
vos frères Polynice et Etéocle s’affrontant en guerre civile, Hémon leur
cousin payant de sa vie cet inexorable engrenage de générations mortifères, de sang
matriciel… Aujourd’hui encore, les guerres entre « communautés »
nationales et religieuses, relèvent
de la même logique tragique à menace suicidaire, dissimulée dans leur
« mêmeté » prétendument symbolique.
4. Ce constat implicite qui tisse la trame tragique d’Antigone devait conduire immanquablement
quelqu’un, forcément une femme, une descendante de Jocaste, à couper le fil
dans l’inextricable descendance du auto- et du homo-, précisément. Telle sera
en effet la solution d’Anti-gone (anti-engendrement), face à la mort qui
perdure, le Chœur est là pour le rappeler, comme la seule et unique situation
contre laquelle l’espèce humaine, pourtant habile en astuces, manifeste sa
fatale impuissante (v. 360-364). En vous opposant à la gonê, en répudiant la
descendance, vous trouvez un
« truc »/charme/remède : vous apprivoiser la mort. Pas de
blasphème à l’endroit de la maternité, pas de matricide non plus, c’est
bon pour Oreste. Vous-vous contentez de répudier (anti- = contre) la maternité et, « à sa place » (autre
sens d’anti-), d’imposer une certaine
ressemblance réflexive avec elle, selon la même logique de auto- et de homo- dont
elle est le fruit. Mais dans un autre
monde, qui n’est plus « de ce monde » vivant à force de matrice.
Vous voyez bien, fixée dans votre univers souterrain aux bords de
l’Achéron, vous perpétuez quand même le désir de maternité. Ignoriez-vous que vous la laissiez
entendre, cette vocation maternelle ? Mais si. Rappelez-vous ce soin
funéraire prodigué à votre frère/père/fils, lavé/langé de poussière,
purifié/protégé dans sa chair morte : ne trahit-il pas une sollicitude
maternelle ? Ou encore : « Si j’étais mère… » (v. 905) : ces mots vous ont-ils échappés ? Les
gémissements que vous poussez devant le cadavre dépouillé de votre Polynice : ne sont-ils pas des
« cris perçants de l’oiseau qui se désole à la vue du nid vide où manquent
ses petits » (v. 420-425) ? Et votre mort enfin, Antigone
« pendue par le cou,
qu’enserre un lacet fait de son linon épais »
(v. 1120-1222), réplique de la pendaison de Jocaste ?
A ceci près qu’Antigone ne se pend
pas sur scène, seul le messager témoigne d’une « elle », troisième
personne impersonnelle, une non-personne : de quoi donner du fil çà
retordre aux commentateurs. Qui l’a pendue ? Elle-même ? De ses
propres mains ? Ou pas ? Je préfère penser, quant à moi, que cette
vision du messager n’était qu’une figure rhétorique de Sophocle pour dire qu’« elle »,
Antigone dans sa froideur opaque et absolue, était depuis toujours une
vengeance muette, comprimée, contre la mère sans interdits, la Seule Mère, la
Mère Toute. Une mère à tuer et qui, dans le flux toxique des « mêmetés », vous cadavérise à sa
place.
Il était donc nécessaire que le désir
de rejoindre les siens dans la mort, annoncé d’entrée de jeu (v. 74-75), soit
déjà inscrit dans le prénom de l’héroïne : contre La Mère et/ou dans sa place même.
Pour essayer d’être libre, ou du moins autonome, vous-vous consacrez, Antigone,
à incarner la mort du désir de vie, la doublure d’Eros. Et bien que cette logique vous conduise
à être une de ces suicidés de la famille incestuelle dont il a été question
plus haut, cette mort du désir de vie n’est ni un soleil noir de la mélancolie,
ni une théologie du néant. Rien à voir avec la plainte du ténébreux
Nerval ; ni avec l’apologie du
non-être chère à la langue coupée d’une Angèle de Foligno (que votre style
lapidaire rappelle pourtant irrésistiblement) ; ni avec le bonheur d’un
moine zen dont vous ignorerez à jamais le jardin méticuleux.
Antigone triomphe sur Jocaste en lui
prenant son fils, dans lequel elle ne retrouve pas le sage aveuglé à Colone,
mais le discordant Œdipe, enfin apaisé en bébé mort. A cette condition
seulement, l’ombre de l’objet mélancolique n’a nul besoin de tomber sur elle,
mais se cristallise en l’endurance de la
pulsion de mort. Je dis bien : la pulsion de mort au sens fort que
Freud lui donnera dans la deuxième topique, à ne pas confondre avec
l’érotisation de l’agressivité et de la souffrance qu’on appelle désormais sadomasochisme.
Rien à voir. Chez Antigone,
Thanatos a coupé les liens, forcément érotique, avec les vivants, nous l’avons
vu. Ne visant qu’à dépasser la limite (Atè) de l’humain, la fille de Jocaste et d’Œdipe se tient comme aspirée par et dans la
limite même : atroce (Lacan), en effet, dans l’ « entre deux »
de la pulsion de mort.
En deçà du narcissisme, plus loin que
l’autoérotisme, dans la déliaison radicale. Au lieu de la déprime
névrotique, aux abords de la père-version masochique dont jouit à mort l’objet
supplicié - jusqu’à devenir
insensible au pacte lui-même entre le maître et l’esclave. Antigone s’est
échappée de l’humanité névrotique. Divine Antigone ? Le Chœur en avance
l’hypothèse dans une antistrophe que la recluse, offensée, récuse violemment.
Car elle sait que sa souveraineté est
simplement humaine, mais pleinement humaine, exceptionnellement humaine. A la
place de la mère, Antigone enfante un univers imaginaire : elle répare la
perte des siens en recréant le monde virtuel d’une vie possible sur la
frontière, dans l’Atè même. Ceux qui
dépassent ce seuil sombrent dans le délire, perdent leurs contours humains, et
trépassent. Antigone, elle, triomphe dans sa construction cadavérique parce
qu’elle y trouve le bénéfice de consommer l’amour avec son frère en tendres soins,
en gestes maternels. Il lui faut accepter de mourir à soi et à son corps (et
Créon se fera le complice involontaire de ce désir antigonien qui précède son
édit), pour accomplir non la gestation d’un enfant, mais la vocation maternelle de tendresse et de soins : la
sublimation inhérente à la vocation maternelle. C’est le bénéfice de son
sacrifice. Antigone ne le sait pas, car le monde tragique n’a pas inventé l’enfant sujet (il faudra attendre la Bible
et les Evangiles). Elle se débat dans l’inextricable tressage d’Eros avec
Thanatos, et s’en défend, pétrifiée dans l’amour hors temps d’un frère mort
et d’une sœur prête à mourir pour
sauver leur autonomie et leur homologation.
5.
En
ce lieu, si l’on ne devient pas fou, si l’on ne perd pas les limites du langage
dans la confusion mentale, c’est le pathos de la solitude qui pétrifie le
vivant/la vivante. Il/elle est ailleurs, en deçà ou au delà, inaccessible Soi, indestructible
diamant. Mais son narcissisme
mortifié, sûr de lui-même et triomphant, peut se rendre disponible aussi, ce qui
lui confère cet énigmatique rayonnement perçu par le Choeur. Une disponibilité recueillie et glacée,
celle de la sainte, parfois de l’infirmière hyper-performante, Ophélie renée
des eaux et soignante. Aucune souffrance, pitié, compassion. Elle ne sent
rien : « Mourir devant eux, je le dis bien haut, pour moi, c’est
tout profit. /…/ Subir la mort, pour moi n’est pas une souffrance. /…/ C’en eut
été une, au contraire, si j’avais toléré que le corps d’un fils de ma mère
n’eût pas, après sa mort, obtenu un tombeau. » (v. 465, sq). La mort à
soi, comme apothéose du auto- enfin
délivré du poids des liens reproductifs vivants et enserrés dans le lierre de
la connaissance de ses limites, de La Limite : serait-ce donc le suprême
« profit » ?
Profit de la psychose
maniacodépressive, aurais-je dit s’il fallait se contenter du diagnostic psy
qui, pour être insuffisant, n’en est pas moins réel. Mais qui n’explique pas comment
le pathos d’Antigone non seulement ne devient pas pathologique, mais, réverbéré
sur Créon, lui fait endosser à lui
le costume du névrosé plaintif : « Je ne suis rien de plus qu’un
néant désormais » (v. 1325). Pendant ce temps, Antigone désormais invisible, pendue hors
scène, ne cesse de grandir dans l’esprit des spectateurs et lecteurs présents et à venir, comme la
seule héroïne de la pièce éponyme.
La magistrale solitude d’Antigone atteint
un sommet lorsque son auto-analyse de la cohabitation avec
la pulsion de mort se revendique rebelle, non seulement à l’esprit politique (de Créon), mais
aussi à celui des dieux eux-mêmes.
Lacan avait raison : ce n’est pas à Créon qu’Antigone ne reconnaît pas le droit de
se reconnaître dans Zeus ; c’est elle-même qui se désolidarise et de Zeus (« Car nullement Zeus était celui qui a proclamé ces choses à
moi », v. 450), et de la Dikè des
dieux. Sa déliaison ne relève pas de
leurs « lois » puisque celles-ci « ne sont pas des lois écrites »,
mais une sorte de trace sans représentation qu’un humain ne puisse transgresser.
Moins ou plus que la dikè des
dieux, il s’agirait seulement d’un horizon (oros) qu’Antigone s’autorise à viser jusqu’à se l’approprier dans
le rayonnement de son identité souveraine. Une région qui l’absorbe, parce
qu’elle n’est pensable que comme transversale au langage, aux règles et aux
lois, bien que délimitée/fixée par eux : horizon du temps sensible, de l’affect, de la pulsion à la croisé de
la biologie et du sens.
Certaine d’aspirer à la limite du
vivant et d’être aspiré par elle, mais toujours habitée par le désir –
oedipien lui aussi –, de connaître la vérité que lui ont léguée ses
parents par leur faute et sa révélation même, Antigone est sûre de son
expérience. Lui fait-elle connaître la puissance de la « mort programmée »
dont les biologistes nous disent aujourd’hui qu’elle est à l’œuvre dans la
vie dès qu’il y a vie ? Lisons ainsi son débat avec Créon sur la Dikè : seule dans l’aperception de
cette onde porteuse de la pulsion de vie qu’est la pulsion de mort, Antigone se
tient dans cette doublure aveuglante, illisible, des lois que seraient les lois
non-écrites des dieux : là où ça ne prescrit ni n’interdit, mais ça se
sent, ça s’éprouve, ça se vit et ça se meurt. A la limite de la folie, peut
s’ouvrir l’horizon de la souveraineté psychique.
7. Le Chœur, pourtant dionysiaque, semble
sidéré par tant de prétention. Et rappelle que les humains piégés par la mort ne font que « fuir dans la maladie » (v. 360-364) Je propose ici, en reprenant et en prolongeant la lecture
de Lacan, une interprétation nouvelle du texte grec, qui rompt avec les
traductions habituelles : en effet, Sophocle parle d’une fuite dans la maladie (νόσων
δ' ἀμηχάνων
φυγὰς
ξυμπέφρασται) et non
d’une fuite de la maladie, et ceci de
façon telle que cette “maladie” serait, en définitive, impossible (ἀμηχάνων).
Une lecture déjà psychanalytique de la maladie comme du texte grec, à laquelle
ne pouvaient pas accéder le bon sens des divers traducteurs (avant Lacan) qui comprennent
toujours de travers que les humains
ne peuvent que « fuir devant la
maladie ». Justement, ce qui frappe le chœur dans leur compréhension
dionysiaque de l’héroïne, c’est que, contrairement aux humains ordinaires, Antigone ne fuit pas dans la maladie. Plus encore,
ce que le « bon sens » considère comme une maladie est pour elle plus
qu’une défense : il s’agirait d’une pseudo maladie, “un sacré truc” (αμηχάνων), renchérit Lacan, comme
le symptôme d’une révolte inconsciente ou d’un insupportable désir, par lequel
la fille d’Œdipe se sauve des lois
humaines et divines. Elle
n’est pas malade du tout, son pathos en éclat de diamant n’a rien de pathologique !
La confusion du Garde lui-même, par delà la peur de se faire massacrer parce
que porteur de mauvaises nouvelles, est peut-être elle aussi due à cette énigme qu’est une fille pas
folle du tout, dans son inquiétante et pourtant si familière étrangeté. Comment
serait-ce possible ?
8. Supposons d’abord que la vérité d’Antigone,
qu’elle clame du fond de sa tombe nuptiale, n’est qu’une vérité historiquement
datée : celle de l’avènement tragique
de l’individu dans les rets étouffants de la famille incestuelle qui n’a
pas encore trouvé ses règles pour mater l’interdit de l’inceste. L’histoire du
vocabulaire indo-européen démontre que l’identité du Soi propre, fondement de
l’Individu libre, n’a pu se
constituer qu’en dehors des liens de
parenté, dans les seules alliances externes aux attaches consanguines. Ainsi, la
racine sanscrite « swe »
qui donne SOI (en français), SELF (en anglais), SVOY (en russe), etc., se
retrouve en grec dans « allié » (étes)
et dans « éthique » (éthos)
(Benveniste). Lente et incertaine émergence de la subjectivité libre… Quelles
qu’aient pu être les lois de la société politique qui devaient encadrer et
remplacer les usages incestuels des clans familiaux, elles n’avaient pas le
pouvoir de trancher dans les enchevêtrements tragiques à travers
desquels l’identité cherchait à s’auto-construire, toute seule. N’était-ce pas cela, le tragique,
précisément ? Et sa délicieuse séduction.
Ce sera la puissance du Dieu Créateur
du monothéisme, qui remplacera le sacrifice et l’autosacrifice par des interdits séparateurs (alimentaires,
sexuels, moraux), garantissant
ainsi l’émergence du sujet dans
l’homme. Le texte de la Bible juive et la rigueur rituelle de son peuple consacreront cette mutation historiale par l’« élection », qui ne fixe le soi-même que face à l’Autre, cet Un à poser et à
entendre dans tous les autres ; et simultanément par l’impératif de la génération - à poursuivre à l’infini des nombres,
afin de garantir la perpétuation de l’altérité. Adonaï et Yahvé coupent court à
la confusion des mêmes dans la mêmeté sanguine
de la famille plus ou moins matriarcale du paganisme, en prohibant de verser le
sang (« Tu ne tueras pas ! ») forcément impur : celui des tueries comme aussi celui des menstrues ; tout
en incitant - via les mères - à la perpétuation de la lignée des fils de leurs pères : identités
nominales dans la suite des
ensembles élus.
Et c’est avec le Christ que non
seulement le meurtre (oedipien) du père sera avoué, comme le découvre
Freud en passant par Moïse; mais que l’exploration par Antigone de la pulsion
de mort sera reprise, elle aussi reconnue et métamorphosée - ce que Freud omet de
rappeler.
Posé comme point focal de
l’imaginaire, le désir à mort/le désir de mort du sujet Fils/Père battu à mort
ne se réduit pas à la mise à mort d’une victime par le tribunal de la religion
rivale. Une expérience de la mortalité se fait reconnaître, qui ne serait pas la fin de la vie, mais
une cohabitation permanente de la mort dans la temporalité du vivant. De ce fait, et par-delà l’expérience
sadomasochique de la mort et de la souffrance, voire de la passivation féminine
dans laquelle excelle la passion sur la croix, s’ajoute l’anéantissement (kénose) du Fils/Père mourant aux enfers,
évoquant ainsi l’aventure tombale d’Antigone, emmurée à la suite de son désir
de rejoindre Polynice, son frèré/père au-delà de l’Atè.
Quant à Antigone-mère à la place de
la génitrice, Marie la Vierge en
réalise spectaculairement l’éternel retour et culmine dans la Pietà qui la fixe
à Jésus, telle une jeune femme descendante de la Sulamite qui aurait rêvé d’Antigone.
A ceci près, et la différence est
radicale, que la fable des retrouvailles dans la mort sera traversée par celle
de la résurrection, dans laquelle l’amour incestueux pour et du Fils/Père,
s’autorise enfin, réhabilité au prix de la sublimation. Antigone la sublime
n’ignorait pas l’œuvre absolue de la pulsion qui change de but (ce sera l’amour
à mort en lieu et place des liens érotiques), mais elle ne pouvait pas se douter
qu’il était possible de la dire/peintre/musiquer, au lieu de se mourir vivante dans un cachot tombal.
Au tragique bu jusqu’à la lie le jour de la Passion christique, succèdera le dépassement
de la dimension tragique cependant incluse dans le corps du Fils-Père, qui ne
devient cadavre que pour être sublimé, corps glorieux assis à la droite de son Père.
Le Christ et Marie, différemment et
conjointement, reconnaissent en somme la lucidité souveraine
d’Antigone, mais ils l’arrachent à la tragédie pour fonder, à la place et tout contre
le monde reproductif, le mythe de l’amour possible : au-delà, à l’infini. Et ils invitent toutes les femmes, mères
naturelles de l’espèce, pas vraiment à stopper le flux des grossesses, mais à
se retrouver avec eux (le Christ,
Marie) à l’un des carrefours possibles des mémoires grecque et juive.
Cette aventure n’a que trop souvent
mis une croix sur le corps féminin. Elle n’en a pas moins encouragé le développement spirituel ou sublimatoire
des femmes qui accompagnent l’histoire de la chrétienté (du monachisme féminin,
en passant par les conteuses, épistolières, écrivaines, sorcières, guerrières
et autres révolutionnaires, jusqu’aux féministes et présidentes en tout genre).
L’extase de Thérèse d’Avila et ses écrits jubilatoires sont inséparable de la
mort à soi, dans les poignantes épreuves de la clôture et dans l’identification aussi passionnée
qu’abandonnée au Fils/Père battu à mort. Le fantasme incestuel ainsi avoué, se sublime et se soulage enfin
dans cette nouvelle promesse judéo-chrétienne que le monde grec ignorait :
l’Amour de l’Autre qui élit et pardonne. Dès lors, la pulsion de mort n’est plus
seulement tragique, elle insère le tragique comme l’autre face de l’amour.
9. Vous proposerai-je enfin une autre hypothèse ? Loin
d’être une survivance du passé, l’universalité d’Antigone résonne dans la vie psychique des femmes aujourd’hui.
Par delà la famille dite « classique » qui respecte bon gré mal gré
l’interdit de l’inceste, que la sécularisation éloigne des dogmes juifs et
chrétien, et qui ne cesse de se recomposer sous la pression des techniques
procréatives, de l’émancipation du « deuxième sexe » et du métissage
des diverses traditions religieuses et culturelles (Judith Butler), la
dimension anthropologiquement universelle de la solitude féminine confrontée
à la pulsion de déliaison s’impose
aussi bien à l’observation clinique que dans les comportements sociaux. Solitude
et déliaison qui ne rejettent pas nécessairement la maternité, mais la
réclament et l’accompagnent. Les dépressions féminines et jusqu’aux diverses
criminalités maternelles en témoignent. Elles ne sauraient pourtant faire
oublier la nouvelle solidité de celles qui ont la chance et la capacité d’en
produire une connaissance, un art ou un mode de vie/survie : conséquence remarquable
de l’émancipation féminine toujours en cours.
En effet, l’Œdipe prime, qui attache la petite fille à sa mère dans les liens
précoces mère-bébé, marque la psychosexualité de la femme d’une homosexualité
primaire endogène « non écrite », parce que pré-linguistique,
sensorielle, quasi impartageable. L’Œdipe
bis, qui la transfère au père, installe le sujet femme dans le monde du
langage, de l’idéal et du surmoi social, sans pour autant résorber la dépendance
antérieure. Formé dans cet Œdipe biface, le deuil inconsolable de l’Œdipe prime
et l’achèvement improbable de l’Œdipe bis font d’une femme une éternelle étrangère
de la communauté politique, une inexorable exilée de l’osmose initiale avec sa génitrice.
L’homosexualité offrira l’occasion de
revivre les délices et les discordes du continent perdu. La maternité sera une
chance pour sortir de Soi-même afin
d’aimer enfin - comme soi-même -, quelqu’un d’autre : l’enfant d’un
tiers, le père. Miracle de la vocation
maternelle, mais combien menacé par la folie
maternelle, ce récurrent pathos de
la « mêmeté » autoérotique,
narcissique, dans la permanence de l’Œdipe. Miracle aussi de la maternité
symbolique qui renonce au cycle de la reproduction des corps et se forge, comme
Antigone, à la limite de l’humain et du langage. Mais qui, contrairement à
Antigone, en cherche le sens, pour éclairer la pulsion de mort dans le
dépassionnement de la sublimation.
Il y a une Antigone dans toute mère
qui réussit à libérer ses enfants d’elle-même. J’ai laissé ma peau comme
Antigone dans toute œuvre qui me dépasse. Car avec ou sans l’expérience de la
maternité, mais surtout à partir des efforts actuels de construire un discours
moderne sur la passion maternelle au présent, il devient peut-être possible aux
femmes d’aborder les limites du vivant auxquelles les confrontent les
ambiguïtés de leurs expériences oedipiennes. Limites de leur identité sexuelle
à elle (la bisexualité psychique endogène de la femme) ; de la vie de
leurs enfants : toujours fragile et objet de sollicitude ; de la vie
de la planète menacée de nouveaux cataclysmes ; des nouvelles techniques
de reproduction de la vie qui se jouent sans précautions suffisantes de la vie
et la mort.
Les faits-divers apocalyptiques et
jusqu’aux actes des mères infanticides n’effacent pas le nombre croissant de
femmes qui affrontent avec l’indestructible sérénité d’Antigone les états
limites de l’expérience humaine. Et qui se révèlent comme un horizon - pour le
meilleur et pour le pire. A partir duquel les lois elles-mêmes, puisqu’il en
faut dans l’ordre social, sont susceptibles de muer, mais d’abord dans la
profondeur des psychismes, avant d’être consacrées, éventuellement, par la
justice politique.
A condition de développer le langage,
la pensée, l’interprétation de notre solidité solitaire dans la cohabitation
avec la pulsion de mort. Sinon, c’est la barbarie des embryons congelés, des
enfants violés ou vendus pour le trafic d’organes, des maternités stérilisées
ou bafouées, des femmes réprimées ou niées.
10. Antigone « à la place »
de la mère ? Au cœur de la mère joyeuse de Winnicott gît une Antigone.
Elle a coupé les liens, elle a traversé son auto- et homo-, elle s’est
dépassionnée : une certaine annulation. Qu’est-ce qu’une bonne
mère ? Elle sait que l’« autre » surgit de la
limite où s’éclipse son ambition identitaire à elle, et que s’ouvre l’horizon
des altérités possibles, des véritables singularités. Contre le pathos de la
mère et à sa place : l’amour maternel, état limite et inaccessible horizon.
Vous en avez pratiqué, Antigone, les
conditions d’avènement en en prenant les risques. Vestale de la pulsion de mort
qui jouxte le crime, mais qui s’épure aussi dans l’affranchissement identitaire
inhérent à l’œuvre d’art et à cette œuvre d’art qu’est l’insoutenable
dépassionnement du souci maternel. Aussi votre expérience est-elle insaisissable
et cependant concise, défiant le bon sens mais d’une rigueur absolue et d’une
évidence mystérieuse. Nécessité des silences et justesse de la voix, elle
scande la mort de soi, ponctue l’éclosion de l’autre chez l’enfant, laisse en suspens, et libère les
interprétations : ouvertes, personnelles, tracées parce que pressenties
mais imprescriptibles. Comme ces non lois non écrites des dieux. Une portée
musicale. Sublime.
Julia Kristeva
Août 2008
Bibliographie
Le texte d’Antigone de Sophocle est cité dans la traduction de Nicole Loraux, édition bilingue, Classiques en poche, Les Belles lettres, 2006.
Hegel, La phénoménologie de l’Esprit, trad. fr. Jean Hyppolite, Aubier, 1941, t. II, p. 14 sq ; et L’Esthétique, t.II, Livre de poche, 1997, p. 687.
Hölderlin, L’Antigone de Sophocle, trad. de Ph. Lacoue-Labarthe, Ed. Christian
Bourgois, 1978.
Jacques Lacan, Le Séminaire, livre VII. L’éthique de la psychanalyse (1859-1960), texte établi par J.A.Miller, Seuil, 1986.
Nicole Loraux, « La main d’Antigone » (1985-2006), « Postface » in Sophocle, Antigone, op.cit.
Judith Butler, Antigone : la parenté entre vie et mort (2000), tr. Fr. EPEL, 2003.
Julia Kristeva, Histoires d’amour, Denoël, 1983. Sens et non-sens de la révolte, Fayard, 1996. Seule une femme, Ed. de l’Aube, 2007. Cet incroyable besoin de croire, Bayard, 2007.
Traduction
anglaise in Feminist readings of Antigone, edited by Fanny Söderbäck, Suny Press, 2010, USA
|