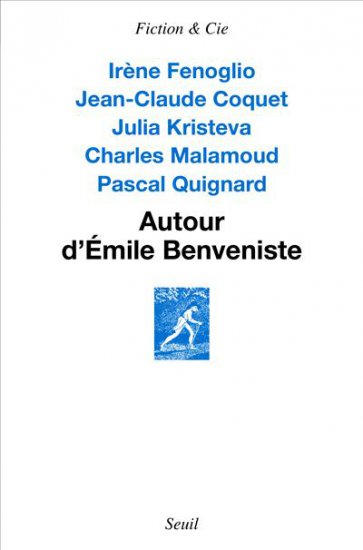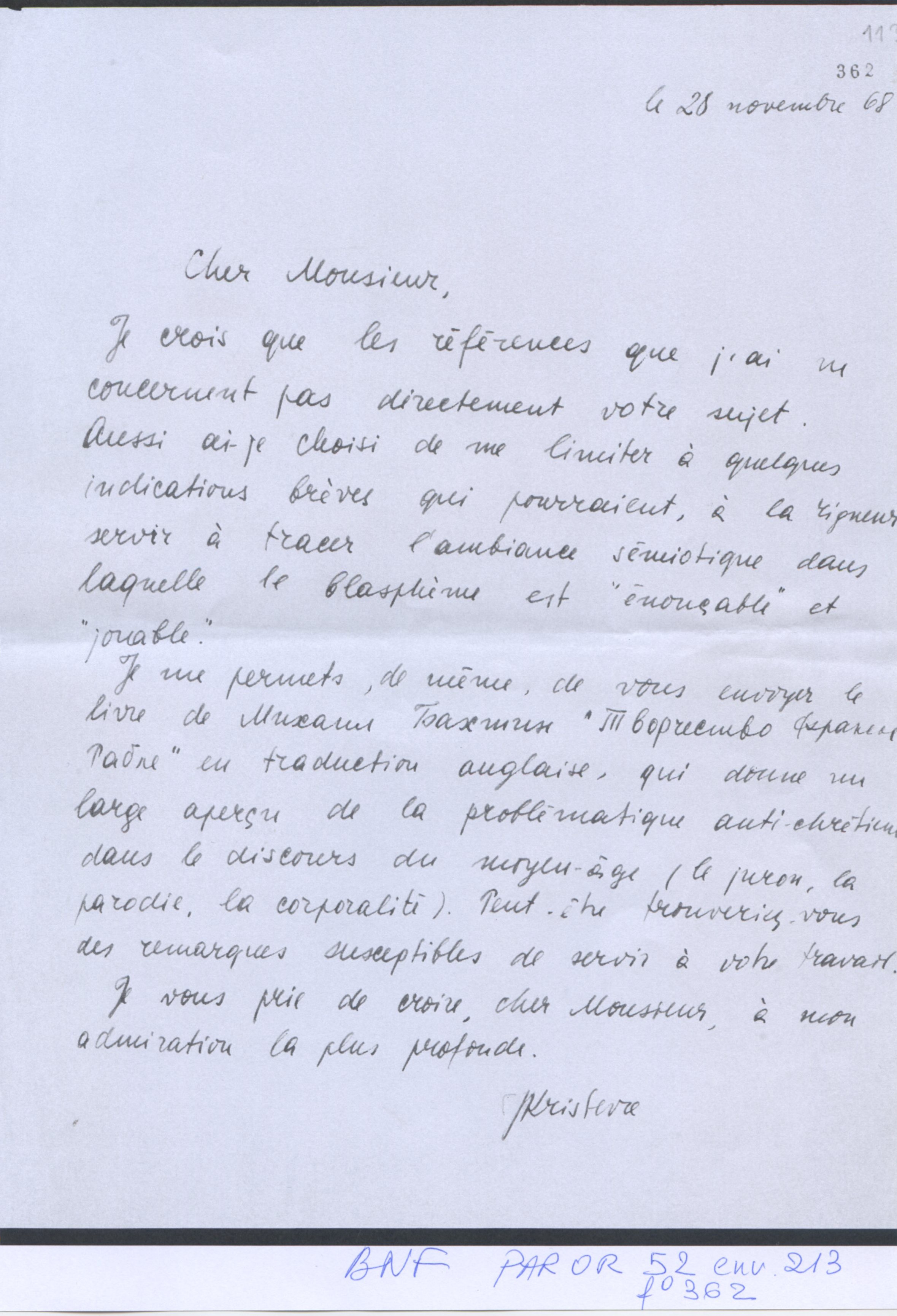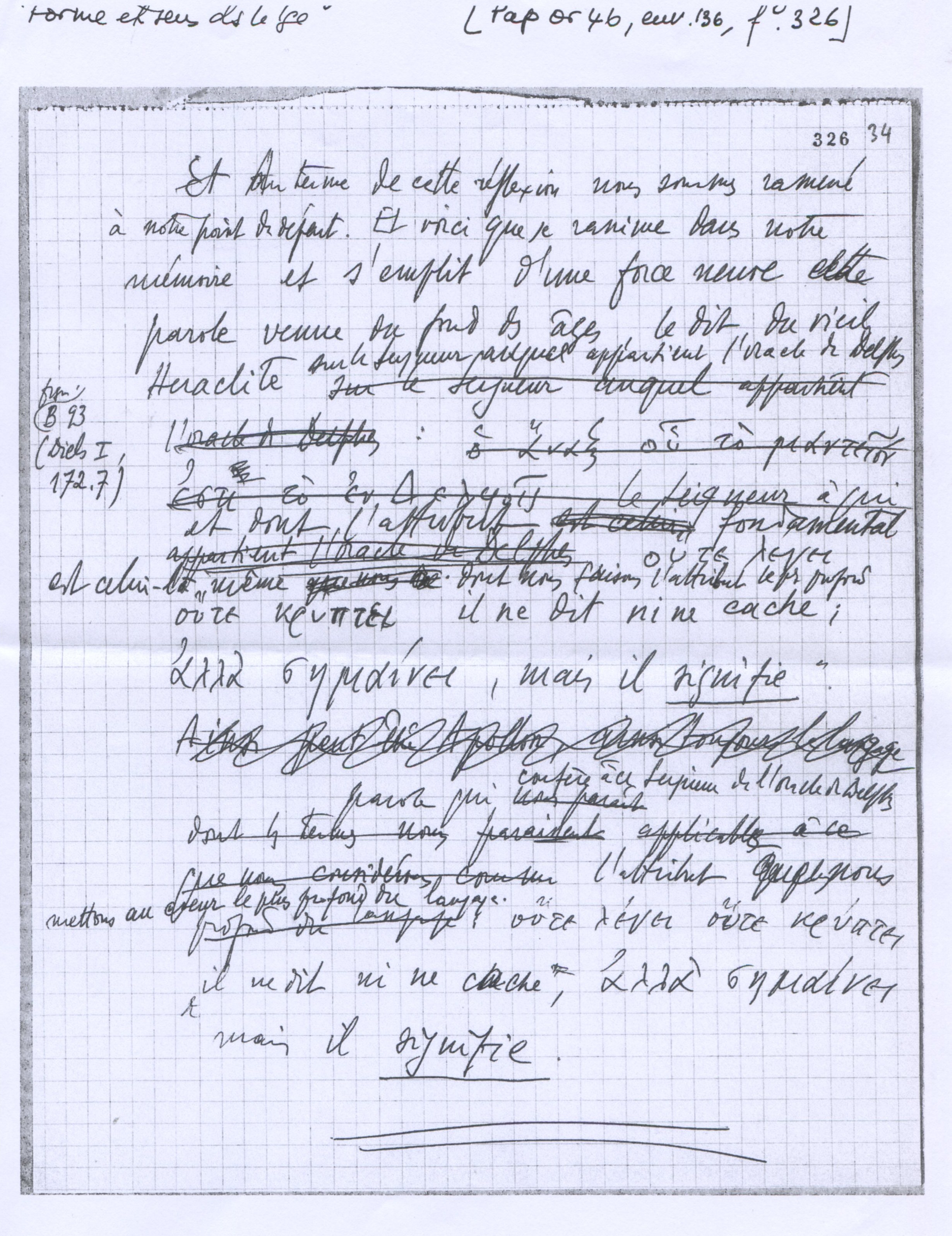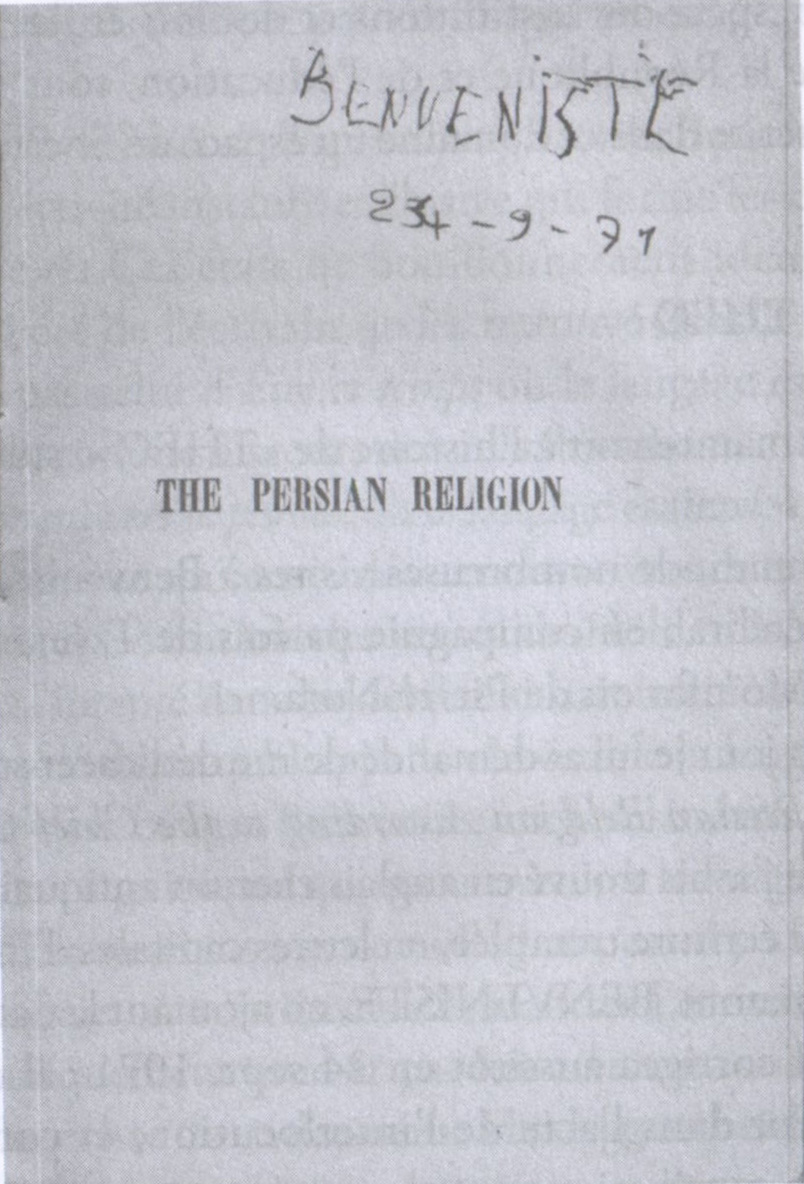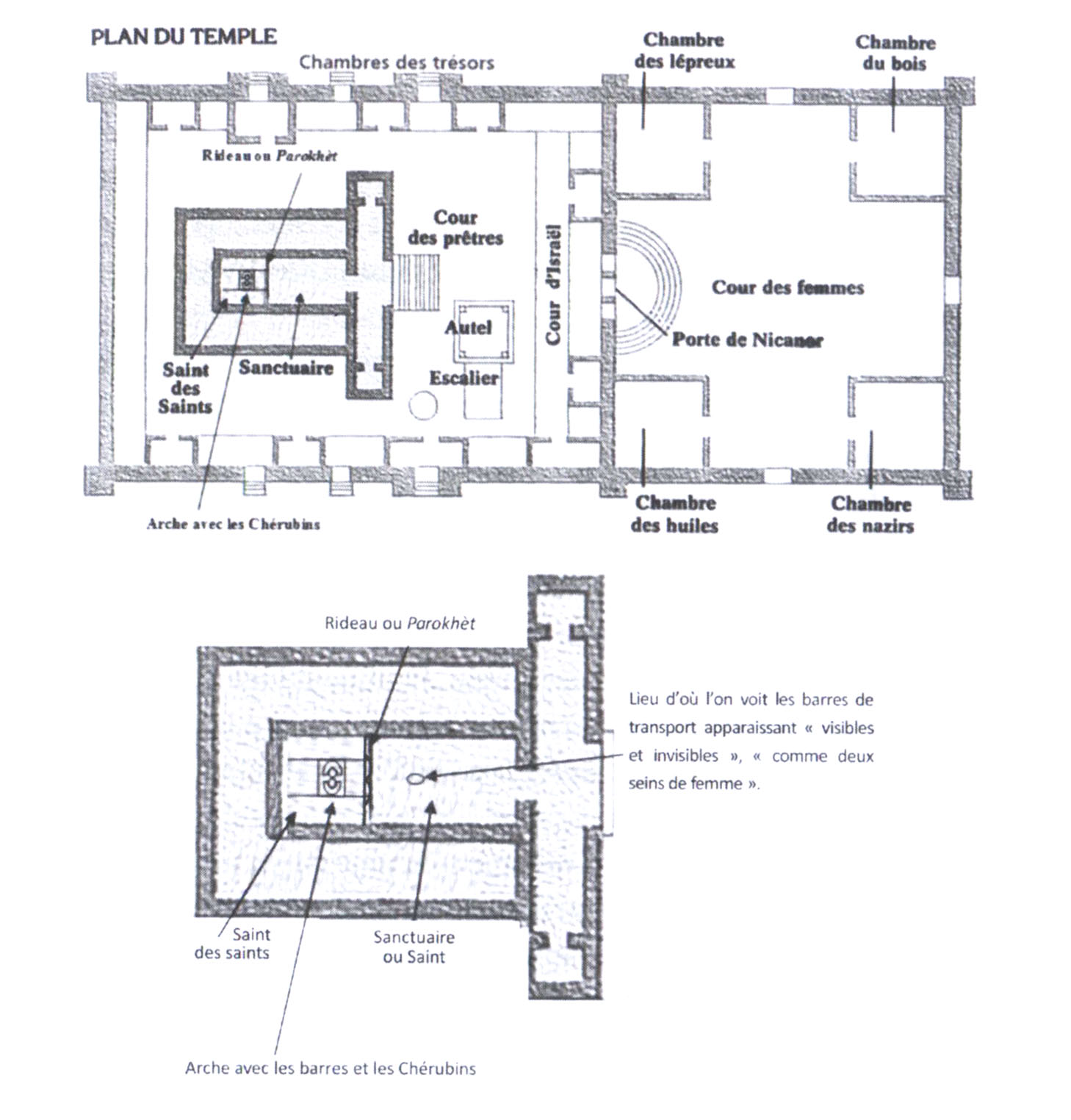|
|
La
linguistique, l’universel, et le « pauvre linguiste »
Je vais essayer
de résumer certaines idées que j’avance dans la Préface que j’ai écrite pour la
publication des Dernières leçons en
les développant, en leur donnant un éclairage qui, pourrait susciter des questions
et des prolongations.
Je soutiens
qu’il existe un style de pensée dans les Dernières
leçons que résume la phrase d’Héraclite citée par Benveniste :
« La langue ne dit ni ne cache, elle signifie. » Deux définitions se
dégagent, me semble-t-il, de ce signifier que Benveniste va tenter – dans ces Dernières leçons, mais aussi tout au long de son œuvre – de préciser.
La première est
que signifier n’est pas communiquer, ce
n’est pas « vouloir dire », ce n’est pas transmettre un message ou
une vérité mais, je le cite, c’est « un principe interne à la
langue » qui transcende toutes ses utilisations et nullement une réalité
externe, une transcendance qui serait hors du langage. Ceci est très important
car on verra comment toute la réflexion de Benveniste sur ce signifier va le confronter à la
philosophie d’une part, et à la religion de l’autre, pour lesquelles le signifier et le sens lui-même seraient externes – « vérité » à chercher
pour les philosophes, « au-delà » à cultiver pour la religion.
La deuxième
définition, c’est que la langue, en tant qu’ayant un principe interne qui
serait celui de signifier, est un « organisme signifiant ». Benveniste
emprunte cette expression à Aristote qu’il cite dans la leçon 12 des Dernières leçons, « organisme signifiant »
renvoyant à organon, c’est-à-dire
instrument, mais aussi, étymologiquement, à org,
mouvement, tempérament, caractère, passion, colère, ardeur, sève – d’où orgasme.
Une dernière signification de ce signifier se dégage dans le texte des Dernières leçons,
mais aussi dans les manuscrits sur le discours poétique, texte en ébauche sur Baudelaire :
la langue comme organisme vivant, générateur et autogénérateur – une expérience,
dira-t-il. Je m’arrêterai sur cette notion et sur cette phrase du second tome des Problèmes de linguistique générale :
« bien avant de servir à communiquer, le langage sert à vivre ».
Je me propose de
naviguer à travers ces différents textes de Benveniste pour entrer dans les
détails de ces deux versants du signifier ;
à la fois, donc, principe interne à la langue et organisme signifiant. Cela me mènera
à la petite anecdote – déjà mentionnée dans ma Préface mais
sur laquelle j’ai approfondi ma réflexion – qui se situe à la fin de la vie du
linguiste lorsque sur mon chemisier il écrivit le mot « THEO ». Je
tenterai donc de vous conduire dans cette réflexion en quelques étapes. En
préambule, j’évoquerai quelques éléments biographiques, ma rencontre avec
Benveniste et la relation qui s’ensuivit pendant les années 1967, 1968 et 1969,
jusqu’à celles qui succédèrent à son accident cérébral, pendant lesquelles je
me suis efforcée de l’accompagner sans y parvenir comme je l’aurais souhaité,
jusqu’à sa mort en 1976. Je m’attarderai ensuite sur signifier et sa double signification, en me référant aux Dernières leçons mais aussi au second
tome des Problèmes de linguistique
générale. Dans un troisième temps, j’aborderai l’écriture telle qu’il
l’entend dans ses Dernières leçons ;
puis, dans un quatrième, le langage intérieur, plus proche de l’organisme. Je
terminerai par l’anecdote évoquée plus haut.
Il me paraît
nécessaire d’évoquer l’arrière-plan historique et biographique au sein duquel
Benveniste poursuivit sa réflexion de linguiste car, si celle-ci reposait sur
une immense culture, une grande connaissance du passé, elle s’inscrivait
naturellement dans son temps et portait en elle une discrète mais réelle
position politique, toujours d’actualité. L’œuvre de Benveniste « n’est
pas achevée » en ceci, me semble-t-il, que la théorie générale du langage
telle qu’il s’est efforcé de la formuler, notamment à partir de la publication
des Dernières leçons, dépasse
largement le cadre de la linguistique. Il n’est pas nécessaire d’étudier cette
discipline pour y trouver un grand intérêt interdisciplinaire, et je crois que
sa réflexion doit être communiquée aux jeunes qui le connaissent peu, si ce
n’est pas du tout.
Notre
Mai 68
Aujourd’hui,
vous le savez, tout le monde croit qu’on vit dans un bain de langage. C’est
sans doute vrai, mais ceux qui ne voient que la surface de la toile
hyperconnectée ne semblent pas percevoir la consistance et toute l’étendue du
langage. A la fin des années soixante, l’idée chez les jeunes intellectuels
était acquise que l’être humain ne se définit pas uniquement par sa place dans
la production (marxisme) ou par la reproduction (psychanalyse), mais qu’il est
défini par son expérience du langage. Ce qu’on appelle le structuralisme
n’était pas seulement un formalisme ou une didactique scolaire ou universitaire,
mais une manière d’être au monde, et c’est ainsi que la sémiologie est devenue synonyme
de liberté de pensée, notamment dans les pays de l’Est. C’est dans cet esprit
que fut fondée l’Association internationale de sémiologie, regroupant autour des
figures de Benveniste, Barthes, Greimas et Seboek, de jeunes sémiologues
polonais, tchèques ou bulgares. J’en devins la secrétaire générale, chargée des
travaux de publication aux côtés de Josette Rey-Debove, linguiste chevronnée et
un des piliers du dictionnaire Robert. Nous sommes devenues les rédactrices de Recherches sémiotiques, une section de
la revue Social Science Information,
précurseur de Semiotica, que Sebiock
allait fonder à Indiana.
J’ai rencontré Benveniste
dans ce contexte des années 1967-1968. Je me rendais chez lui, rue Monticelli.
Après avoir expédié les affaires courantes, nous nous entretenions à bâtons
rompus, il me lisait le Rig-Veda en
français, me demandait si je croyais comme Aragon que la femme est l’avenir de
l’homme, ou m’interrogeait sur mon travail. Je me rappelle notamment lui
avoir dit qu’infra- et supra-linguistique ne me suffisaient pas, et lui avoir
demandé si le terme « translinguistique » lui paraissait convenir
pour parler des textes où se déploient une expérience psycho-somatique,
conduissant au transformation des codes, règles linguistiques : au
« style », à cette productivité que je venais de découvrir en commentant les textes extravagants de Raymond
Roussel. Un autre souvenir se rapporte à la notion de spho_a que Jackobson m’avait indiquée : dans l’ancienne
linguistique » indienne, elle désigne à
la fois et une activité qui implique déjà la subjectivité parlante. C’étaient
des débats extrêmement passionnants. Benveniste s’intéressait également à ce
qui se passait à Saint-Germain-des-Prés, à la revue Tel Quel en particulier ; il suivait ces vibrations avec beaucoup
d’affinité en insistant sur le multilinguisme, sur l’importance de connaître de
nombreuses langues. A ce propos je me souviens lui avoir entendu dire un
jour : « Mais vous vous rendez compte, madame, on fait une linguistique
générale alors qu’on ne connaît que l’anglais ! », reproche qu’il
réitéra par la suite, je crois, en s’adressant à Harris et Chomsky. C’étaient
des réflexions qui m’intéressaient beaucoup et qui m’impressionnaient. Avec la
modestie qui le caractérisait, il disait aussi qu’il ne s’intéressait qu’aux
petites choses, par exemple le verbe être, me conseillant de lire tout ce qui s’y réfère dans une revue linguistico-philosophique
de langue anglaise, Foundations and Language. On parlait aussi de
phénoménologie – dans l’Avant-propos aux Dernières
leçons, Jean-Claude Coquet et Irène Fenoglio ont montré combien la
phénoménologie est dans l’ordre de sa pensée. A ce moment-là, je commençais à
lire Husserl. Benveniste était un connaisseur assez profond de Husserl me
semblait-il, mais pas de Heidegger, que, pour ma part, je connaissais à peine,
en tout cas nous n’en avons jamais parlé. Je l’évoque toutefois, car en parlant
du « langage intérieur » il m’a semblé entendre, chez Benveniste, des
échos aux avancées heideggeriennes qu’il reprend à sa façon, et qu’à mon sens
il corrige.
Au mois d’août
1968 nous nous sommes rendus à Varsovie.
[1]
Un peu plus loin, c’était le printemps de Prague, où j’avais des amis, mais il
n’était pas question de faire de la politique, il s’agissait simplement d’encourager
ce monde des pays de l’Est à s’ouvrir à la liberté de vivre et de réfléchir. J’avais
emporté avec moi un livre, Les lettres de
Rodez d’Artaud, dont Benveniste s’empara alors que j’y étais plongée et
qu’il lut ensuite avec avidité. En retournant quarante ans plus tard entre ces
pages, je comprends pourquoi ce texte suscita son intérêt. Certes le texte
d’Artaud touche au langage, mais, il y avait autre chose que je vais tenter
d’appréhender en citant des passages du livre.
Prenons la
première lettre, adressée à Henri Parisot, l’éditeur d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Artaud s’y insurge
contre « Jabberwocky
[2]
»,
un autre texte de Lewis Carroll, dans lequel il voit l’œuvre d’un snob qui fait des jeux de mots gratuits
sans parler avec son corps:
« Je n’ai jamais aimé ce poème qui m’a toujours
paru d’un infantilisme affecté ; j'aime les poèmes jaillis et non les langages
cherchés. Je veux, quand j’écris ou que je lis, sentir bander mon âme comme
dans La Charogne, Une martyre ou Le Voyage à Cythère, de Baudelaire. Je n’aime pas les poèmes ou les
langages de surface et qui respirent d’heureux loisirs et des réussites de
l’intellect, celui-ci s’appuyât-il sur l’anus mais sans y mettre de l’âme ou du
cœur. […]
Tout ce qui n’est pas un tétanos de l’âme ou ne
vient pas d’un tétanos de l’âme comme les poèmes de Baudelaire et d’Edgar Poe
n’est pas vrai et ne peut pas être reçu dans la poésie […].
On peut inventer sa langue et faire parler la langue
pure avec un sens hors grammatical mais il faut que ce sens soit valable en
soi, c’est-à-dire qu’il vienne d’affres […] de l’être, et
ne supporte pas qu’on l'oublie. […]
Quand on creuse le caca de l’être et de son langage,
il faut que le poème sente mauvais.
[…] maintenir dans
l’être utérin de la souffrance où tout grand poète a trempé et où, s’accouchant,
il sent mauvais. »
Je ne
développerai pas cette insistance d’Artaud sur l’expression langagière et sur
l’analité. Je me la suis rappelée pourtant, quand Benveniste était hospitalisé,
dans une salle commune aux relents malsains, où le linguiste qu’il avait été ne
pouvait pas parler mais conservait une langue en soi… J’aimerais seulement
attirer votre attention sur un texte de Freud de 1925 : Die Verneinnzing (La négativité, La négation). Le fondateur de la
psychanalyse relit la violence de l’enfant, ses cris et ses excrétions, tout ce
qui est repoussé hors du corps, et l’apparition des premiers signes
linguistiques qui seraient les signes du « non » : des
transpositions de la négativité, et de ce fait précurseurs du langage. Les
psychanalystes après Freud se sont souvent penchés (en particulier Melanie
Klein, Ivan Fonagy et moi-même) sur ce sujet. C’est vous dire que l’apparente
obsession d’Artaud révèle une violence infra-linguistique pulsionnelle, sur
laquelle Benveniste va faire allusion dans ses notes sur le langage intérieur.
Mais à Varsovie, donc, voilà ce qu’il lit :
« J'aime les poèmes des affamés, des malades,
des parias, des empoisonnés : François Villon, Charles Baudelaire, Edgar
Poe, Gérard de Nerval, et les poèmes des suppliciés du langage qui sont en
perte dans leurs écrits, et non de ceux qui s'affectent perdus pour mieux
étaler leur conscience et leur science et de la perte et de l’écrit […].
Abandonner le langage et ses lois pour les tordre et
dénuder la chair sexuelle de la glotte d’où sortent les âcretés séminales de
l’âme et les plaintes de l’inconscient est très bien, mais à condition que le sexe
se sente comme un orgasme d’insurgé éperdu, nu, utérin, piteux aussi, naïf,
étonné […] et qu’il n’apparaisse
pas, ce travail, comme la réussite d’un manque où le style pue à chaque angle
de ses discordances les relents d’un esprit repu, consomption, consommation
interne de la langue, […] ce n’était pas
le français, mais tout le monde pouvait lire, à quelque nationalité qu’il
appartînt
[3]
. »
Vous entendez une traversée de la langue
nationale et une entrée dans le corps où émerge le langage. Il ne serait pas
inintéressant de relire cela plus attentivement et de revenir à Artaud lorsqu’on
travaille la genèse des manuscrits de Benveniste, mais d’Artaud aussi.
J’avais lu
aussi, avant de partir à Varsovie, le désormais fameux mais à l’époque plus
confidentiel Manifeste publié en 1925 dans La
Révolution surréaliste, texte d’une violence politique extraordinaire, rédigé
au moment de la guerre du Rif au Maroc. J’en reprends ici la fin :
« Nous sommes la révolte de l’esprit ; nous considérons la Révolution
sanglante comme la vengeance inéluctable de l’esprit humilié par vos œuvres.
Nous ne sommes pas des utopistes : cette Révolution nous ne la concevons que
sous sa forme sociale. »
Il s’agit ni plus ni moins que d’un
appel à la révolte. Parmi les signataires de ce brûlot figurent Henri Lefebvre,
Georges Politzer, Louis Aragon, Antonin Artaud, André Breton, René Crevel,
Robert Desnos, Paul Éluard, Max Ernst, Michel Leiris, et Philippe Soupault.
Mais également celui auprès de qui je me trouvais, le doux Emile Benveniste.
Je dus pourtant, à ma grande confusion, reconnaître que, publiquement
du moins, le Professeur ne souhaitait plus assumer cet ancien fait d’armes.
Peut-être sa lecture d’Artaud m’avait-elle enhardie, j’avais du moins cru qu’il
ne se verrait pas rappeler ce compagnonnage avec déplaisir, mais alors que
j’évoquai auprès d’autres intervenants le Manifeste et la signature qu’il y avait posée, lui qui s’était toujours montré chaleureux
à mon égard me répliqua vertement : « Mais, madame, c’est une fâcheuse
coïncidence. » Sans doute du reste regretta-t-il la sécheresse de sa
réponse et la quasi-terreur, la honte, qu’elle avait produites sur moi, car un
peu plus tard il me prit à part et me dit d’un ton de nouveau amical : « C’est moi, mais il ne faut pas le dire, maintenant je suis
au Collège de France. » Un peu plus tard, de retour à Paris, il tint à me
mener à la Closerie des Lilas, où les signataires du Manifeste se réunissaient.
Il me dit : « Vous comprenez, ici on se retrouvaient et le sang
coulait. Ce n’est pas une métaphore, le sang coulait ; c’était très
violent, je ne pouvais pas rester, je les ai donc abandonnés mais je n’oublie
pas ça. »
Je n’ai pas
déduit de ces paroles que Benveniste s’était échappé de ce cercle par peur du
danger, ou refus théorique de la révolution. C’était un retrait qu’il avait
choisi de prendre, parce que, d’une part, il n’était pas dans son tempérament
de casser les murs ou allumer des feux ; et, d’autre part, c’est au sein
de l’université du discours théorique, qu’il lui revenait d’essayer de relier
une certaine expérience des corps vivants avec le langage explosif du
surréalisme et jusqu’à Artaud : c’est du moins ce que l’évolution de sa
pensée linguistique prouve, me semble-t-il, jusqu’à la fin de sa vie. Pour en
finir avec ce côté plus événementiel et biographique, je rappellerai quelques
éléments de la biographie d’Emile Benveniste, en m’appuyant sur un certain
nombre d’éléments que Françoise Bader a réunis concernant son adolescence et sa
jeunesse.
Bref
rappel biographique
Ezra Benveniste (il
ne prendra le prénom d’Emile que plus tard) est né en Syrie, en 1902, dans une
famille juive et polyglotte. Ces origines le rapprochent des grands linguistes
français de l’époque que sont les frères Darmesteter, Sylvain Lévi ou Salomon Reinach,
tous polyglottes de par leur ascendance juive, car connaisseurs dès l’enfance
de plusieurs langues. Sa mère, Marie – Myriam probablement –, était née à Vilna,
aujourd’hui en Lituanie. Elle enseignait l’hébreu, le français et le russe à
l’école de l’Alliance israélite universelle à Samokov, en Bulgarie. Benveniste
me disait que je lui faisais penser à sa mère, j’imaginais qu’il s’agissait
d’une ressemblance physique, mais il ne me parlait jamais de sa famille, ni de
ses origines juives, ni du fait que sa mère avait enseigné dans mon pays natal.
Son père, Matthias Benveniste, était né à Smyrne, il parlait ladino et, de par
l’environnement linguistique de sa petite enfance, connaissait le turc, l’arabe, le grec moderne et les
langues slaves. Alors qu’il n’était âgé que de 11 ans, le jeune Ezra fut envoyé
en France, où il intégra le petit séminaire de l’école rabbinique de la rue
Vauquelin. Celui-ci formait des rabbins destinés à s’établir auprès de communautés juives en Orient et en
Afrique, comme on formait les instituteurs de la République. Benveniste y
apprit le latin, le grec, l’hébreu, l’allemand et bien sûr, avec un soin tout
particulier, le français. D’Europe de l’Est, Myriam suivait autant que possible
la scolarité de son fils, comme atteste une lettre adressée par elle en 1918 à
l’école rabbinique par laquelle on apprend qu’elle souhaite voir Emile quitter
la rue Vauquelin. Les dons de son fils pour les langues ont en effet été
repérés, à l’occasion du remplacement d’un professeur absent, par l’indologue
Sylvain Lévi (à moins qu’il ne s’agisse de Salomon Reinach). Benveniste
quittera donc, conformément au souhait de sa mère, l’école rabbinique pour
entamer des études supérieures. Après une agrégation de grammaire, il deviendra
l’élève d’Antoine Meillet à l’Ecole pratique des hautes études, pour ensuite y
enseigner. Il intégrera ensuite le prestigieux Collège de France.
L’influence de
l’enseignement talmudique qu’il reçut durant sept ans n’est pas explicite dans
son œuvre, mais il va de soi qu’il ne put oublier sa judéité – l’aurait-il
souhaité que les circonstances historiques ne lui en auraient pas laissé
l’opportunité. Fait prisonnier en 1940, il parvint à s’échapper en Suisse, à Fribourg,
où résidaient également Balthus, Alberto Giacometti, Pierre Emmanuel et Pierre
Jean Jouve, qu’il a probablement rencontrés. A Paris son appartement fut pillé,
son frère Henri fut arrêté puis déporté à Auschwitz en 1942. Et, ce que l’on
ignore souvent, Benveniste fut signataire en 1942 d’une lettre rédigée par Marc
Bloch
[4]
adressée à l’UGIF, l’Union générale des Israélites de France créée par Vichy
sous la pression des Allemands pour contrôler la population juive. Cette lettre
attire l’attention sur la politique de Vichy qui faisait des Juifs une
catégorie à part, prélude à la déportation. Les signataires y affirmaient
notamment : « … il faut maintenir entre nos frères français et nous
une union aussi étroite que possible et ne rien tenter qui puisse nous isoler
moralement de la communauté nationale à laquelle, même frappés par la loi, nous
restons fidèles ». Cette cohésion avec la France, son pays d’accueil,
atteste bien sûr d’un souci de protéger le peuple juif et de dénoncer la
ségrégation dont il est victime, mais surtout révèle à mes yeux ce qui va être
le fil conducteur de la pensée de Benveniste, c’est-à-dire une adhésion aux
idéaux de la République, à un humanisme laïque dont il se sent l’enfant endetté
et dont, avec les armes de la
linguistique et de la philosophie , il s’efforcera tout au long de sa vie
de défendre les valeurs contre toute forme d’exclusion. Cet attachement à la
laïcité explique probablement pourquoi, ses références au judaïsme n’étant
jamais explicites, Benveniste est semblable en ceci aux « Israélites
agnostiques », comme on les appelait à l’époque, tel Raymond Aron. Cette
position le conduit à une réserve vis-à-vis de toute référence au judaïsme
mais, si l’on le lit attentivement, des éléments transparaissent qui démontrent
la mémoire de l’hébreu et de tradition juive.
Dans ce contexte
et avec l’arrière-plan philosophique représenté par la devise d’Héraclite – « La
langue ne dit ni ne cache, elle signifie. » –, le lecteur de
Benveniste est frappé par la pluralité de ses références intellectuelles :
structuralisme, syntaxe chomskyenne, phénoménologie, surréalisme, psychanalyse,
littérature…- ces composantes polyphoniques sont constitutives du style de
pensée de Benveniste. Il ne s’agit pas de les cacher, il s’agit de recueillir
les germes de tout ce qui bouge autour de la langue et avec elle, pour sonder ses
mécanismes sans proposer un système fixe, un « modèle » définitif.
Parmi les tâches
que Benveniste semble s’assigner aussi, on peut penser qu’il vise aussi un
certain évitement de l’esthétique : faire du beau à partir du vrai plutôt
que l’inverse, et cet évitement me paraît aussi très important dans sa vie. Par
exemple, alors qu’il baigne dans ce bouillonnement intellectuel du surréalisme,
il écrit un texte littéraire, « L’eau virile », publié l’année même
de la parution du Manifeste évoqué
plus haut. En écho à Rilke, ce texte est un aveu condensé et allusif qui exprime la nostalgie
du jeune linguiste pour la poésie et… pour
la figure
maternelle. Rappelons-nous qu’il a quitté sa mère à l’âge de 11 ans, et qu’elle est morte sans
qu’il l’ait revue lorsqu’il n’en a que 17. L’eau virile évoque un océan, dans des termes qui le rapproche d’une image
maternelle, mais dotée d’une « violence
latente virile », « superficiellement féminine » : il
s’agit d’un maternel vigoureux, « robuste comme un homme », qui associe Homère, le « Vieux de la mer », à
Lautréamont, « Vieil Océan, ô grand célibataire ! ». La figure
de cet océan à la fois maternel et viril serait l’objet érotique d’un célibataire,
fantasme dans lequel le jeune Benveniste se reconnaît. Cette
tentation poétique, il va la laisser de côté : à ma connaissance il n’y a pas dans ses archives d’autre texte écrit par lui dans cette veine. En revanche –
j’y reviendrai –, ses notes, contemporaines des Dernières leçons, sur la poésie de Baudelaire évoquent le langage intérieur, la narrativité et la poésie antérieure à toute
formulation grammaticale ou narrative codée – une « autre langue »
dit Rilke, et Benveniste emploiera à peu près les mêmes termes.
Voilà, donc, pour ce qui est de la partie
biographique, qui constitue le contexte dans lequel je vais poser
quelques considérations théoriques.
Une
sémiologie de l’énonciation
Et, tout d’abord, la double signifiance. Dès le
premier tome des Problèmes de linguistique générale, Benveniste s’écarte de la linguistique structurale, dont il
s’inspire bien
sûr, pour proposer sa linguistique
du discours fondée sur l’allocution, le dialogue, avec des notions telles qu’énonciation, subjectivité, intersubjectivité – notions que désormais, dans le sillage de la philosophie analytique, et
notamment des énoncés performatifs, nous
comprenons mieux. Mais il existe une autre référence benvenistienne dont, à mon avis, on ne parle pas assez, c’est celle
de la psychanalyse. Il est le seul linguiste de ce type avant Milner (et, à
mon sens, plus profondément freudien que Milner, qui est davantage lacanien) à se pencher sur la révolution
freudienne : dans « Remarques sur la
fonction du langage dans la découverte freudienne » (tome 1 des Problèmes de linguistique
générale), la subjectivité dans l’énonciation
est référée à des mouvements de sens translinguistiques ou prélinguistiques qui
vont au-delà de l’intentionnel des phénoménologues. Ce dernier, de toute
évidence, élargit beaucoup la linguistique, qu’elle soit chomskyenne, structuraliste ou analytique (au sens de la philosophie analytique). Benveniste ouvre le raisonnement linguistique,
de surcroît, à la pensée de Freud, et à un « sujet de
l’inconscient » – lequel ne serait structuré
comme un langage, mais travaillé par « une force
anarchique que le langage réfrène et sublime
[5]
». Nous sommes déjà à cette
frontière (évoquée plus haut avec Artaud) entre le
pulsionnel qui travaillent le corps humain et le langage, supposé réfréner et sublimer cette pulsionnalité. Le linguiste le constate à partir « des déchirures qui
introduisent de nouveaux contenus, celui de la motivation
inconsciente et un symbolisme spécifique quand le pouvoir de la censure est
suspendu
[6]
».
Ces nouvelles dimensions de la linguistique générale vont être reprises dans le
second tome des Problèmes de linguistique
générale. En
discussion avec Saussure, Benveniste introduit ces
deux types dans la signifiance du langage, le sémiotique et le sémantique, que
je me
propose de reprendre pour développer comment l’écriture esquissée
dans les dernières leçons se comprend à l’horizon de
cette théorie-là. Le sémiotique va être dissocié du sémantique. Le
sémiotique – et là on est encore près de Saussure –, c’est
le semeion ou signe caractérisé par
son lien arbitraire ; « arbitraire » signifie
résultat d’une convention sociale (en français « livre », en anglais book) entre signifiant et signifié, c’est
un sens générique qui est clos, binaire, intralinguistique, systématisant et
institutionnel. Il est important pour l’anarchiste que Benveniste
reste dans
son âme : d’affirmer le caractère
institutionnel de la langue, du pacte social, de la communication. Ce
sémiotique qui fait autorité et fondation, se définit
par les relations de paradigme et de substitution - c’est très bien dit dans l’Avant-propos aux Dernières leçons de Jean-Claude Coquet
et d’Irène Fenoglio. Toutefois, pour exercer la liberté du sujet de l’énonciation, cette
dimension du langage ne suffit pas. Elle aura besoin du sémantique. Le sémantique – à différencier de la modalité de signifiance du
sémiotique – s’exprime dans la
phrase et il articule le signifié du signe ou l’intenté. Il s’agit ici de la
fréquente allusion à l’intention phénoménologique qui a influencé certains
linguistes, les
auteurs de l’Avant-propos ont cité Hendrik Josephus
Pos. Je pense
que Benveniste va plus loin et sous-entend au « sujet
transcendantal » d’Edmund Husserl. Ce sujet husserlien est une
instance qui ne se constitue que par la phrase, qui n’existe que parce
qu’il construit des formulations prédicatives (sujet-prédicat). Mais les
phénoménologues avec Husserl vont aussi poser une dimension antéprédicative, sensorielle (que Benveniste abordera seulement dans ses
derniers brouillons). Il reste cependant redevable à
la « thèse prédicative » et le « Mitsein » (être ensemble) des phénoménologues. Le sémantique selon lui se
définit par une relation de connexion et de syntagme où le signe devient mot : « livre » n’est jamais
seulement le signe d’un référent, mais participe d’une intention (« je
vous apporte le livre », par exemple), il est
articulé dans un discours adressé à quelqu’un d’autre dans l’acte de
l’énonciation. Benveniste insiste beaucoup sur le fait qu’une activité
de locuteur est requise dans la dimension sémantique. Celle-ci met en action la
langue dans la situation du discours adressé par la première personne « je » à la deuxième personne « tu », la troisième - c’était déjà dans le second tome des Problèmes - se situant hors du discours : « Sur le fondement sémiotique la langue comme discours
construit une sémantique propre, une signification de l’intenté produite par la
syntagmation de mots où chaque mot ne retient qu’une toute petite partie de la
valeur qu’il a en tant que signe
[7]
. »
Cette
conception duelle de la signifiance ouvrant une recherche nouvelle présentée en 1966 devant le Congrès de philosophie de langue
française, est
reprise au Congrès de Varsovie en 1968. Benveniste va insister sur le dépassement de la notion de
signe, du langage comme système, soulignant l’importance de cette double
articulation, à la fois intralinguistique – qui consiste à ouvrir une nouvelle dimension de la signifiance,
c’est-à-dire la dimension du discours distincte de celle du signe –, et translinguistique, qui
va s’intéresser à ce qu’il appelle une méta-sémiotique des œuvres et des textes
sur la base d’une sémantique de l’énonciation. Parfaitement conscient de la nouveauté de ce qu’il propose, qui a toujours du mal à
prendre corps et qui est sans doute par définition inachevé, Benveniste écrit : « Nous sommes tout à fait au commencement d’une
réflexion sur une propriété qui n’est pas encore définissable d’une manière
intégrale. »
[8]
Cette orientation qui traverse la linguistique obligera
à réorganiser l’appareil des Sciences de l’homme
Adossées à son époque et aux travaux des PLG 2, les Dernières leçons semblent poursuivre une réflexion qui s’adresse à ce nouveau continent qu’il
appelait de ses vœux, et dont fera partie le « langage poétique » comme en témoignent ses Notes sur Baudelaire.
Pour plus de commentaires sur
les deux volets de la signifiance, le sémiotique et le sémantique, je vous
renvoie à ma Préface, Je vaux
maintenant développer plus en détail les avancées de Benveniste concernant
l’écriture. Car l’écriture occupe une
place importante dans les Dernières
leçons ; tout
en étant le relais entre les deux pôles de la
signifiance,
l’écriture permet de reformuler la théorisation de ces deux pôles.
Ecriture,
production, engendrement
En
effet, l’écriture devient le levier de cette
capacité qu’a le langage d’être une production et un engendrement. Ces notions ne sont pas à
entendre au sens de la grammaire générative, mais (c’est la raison pour
laquelle je vous ai rappelé l’insistance de Benveniste sur le langage comme l’organisme. Selon Aristote, et sur le
langage dans la découverte freudienne de l’inconscient) dans un sens impliquant la complexité de l’appareil
psychique.
L’écriture, vous vous en souvenez, était
au centre de la réflexion philosophique et littéraire dans les 50 dernières années du
XXe siècle: les travaux de Roland Barthes, Le degré zéro de l’écriture, Jacques
Derrida, La grammatologie et La voix et le phénomène, et, dans le domaine de la littérature, le groupe
Tel Quel avec Philippe Sollers, L’écriture
et l’expérience des limitesde ce dernier, ou encore le nouveau roman. Benveniste ne fait pas référence à
ces
œuvres, mais il est manifeste qu’elles suscitent son intérêt
et que son œuvre en propose une formulation linguistique
rigoureuse.
Il
commence par prendre ses distances avec la conception saussurienne selon laquelle l’écriture est subordonnée à la langue, dont elle ne serait qu’une
sorte de calque. La leçon 8 est très explicite à ce sujet : cette prise de
distance se fait en interrogeant l’acte d’écrire,
l’apprentissage de l’écriture et les types d’écriture constitués
au cours de l’histoire, Benveniste prend soin – de le souligner – qu’il ne cherche pas l’origine de l’écriture. Il me
l’a souvent répété que la question de l’origine n’était pas du ressort de la
linguistique. La leçon 9 l’exprime clairement : ce qui l’intéresse, ce
sont les diverses solutions de la
représentation graphique de la signifiance.
Quelles sont les
représentations graphiques de la signifiance comprise a deux
volets, comme signe et comme discours ? Le signe renvoie à une extériorité référentielle
et porte le signifié. Il s’agira de mettre en question ce qu’il appelle « le rapport on ne peut plus intime qu’a élaboré la
civilisation du livre entre écriture, langue, parole et pensée
[9]
». Les réflexions qu’il fait à ce sujet nous importent d’autant plus à
nous, qui nous posons la question de la possible mise à mort de cette
civilisation.
Benveniste
se donne pour tâche de
décoller parole, écriture et langueafin de comprendre en quoi l’écriture est un système
sémiotique particulier. Ne pas subordonner l’écriture à la langue, tenter de voir, à travers l’histoire de l’écriture et à
travers son apprentissage, en quoi consiste sa particularité. En découplant la parole de l’écriture, pour que celle-ci devienne une « abstraction de haut degré », le locuteur écrivant
s’extrait, en somme, de l’activité verbale, la
convertit en images, et prend ainsi conscience, par cette iconisation de la parole, du fait que son
flux verbal, auquel auparavant il ne prêtait pas attention en tant que tel, se
compose d’unités qui peuvent être décomposées. Cette prise de conscience
s’accompagne, remarque Benveniste, d’un certain nombre de pertes
importantes,
telles que le contact avec la locution, la corporéité, mais présente également des
bénéfices : l’« extériorisation » et la « communication ». En effet, par l’écriture, nos pensées prennent une existence hors de nous ; elles peuvent être connues
d’individus avec lesquels nous n’entrerons jamais physiquement en contact ;
elles peuvent être enfin mémorisées, conservées. Mais au-delà de cette
dimension utilitaire, ce qui
constitue la principale qualité de l’écriture, selon Benveniste, est qu’elle
est la première grande abstraction : « Elle [l’écriture]fait
de la langue une réalité distincte, détachée de sa richesse contextuelle et
circonstancielle », permettant au locuteur écrivant de réaliser que la langue et la pensée sont faits de
mots représentés en signes matériels ou en images. C’est là un premier point.
Benveniste poursuit dans la
leçon 8 en précisant que cette iconisation de la
pensée est la source d’« une expérience unique du locuteur avec
lui-même », et le mot expérience – déjà significativement présent
dans le tome 2
des Problèmes de linguisitique
générale – revient avec intensité pour marquer un moment capital de la constitution
de soi. Le
locuteur – et notamment l’enfant lorsqu’il fait l’apprentissage de l’écriture – prend conscience que ce n’est pas de la parole
prononcée, du langage en action que procède l’écriture, mais
d’un langage intérieur, global, schématique, non grammatical, allusif, rapide,
incohérent, intelligible pour lui seul, et que, partant, la tâche qui lui est assignée
est de convertir cette pensée confuse en schéma
communicable. Cette
tâche qui se présente à tout locuteur écrivant, Benveniste l’appelle « opération de conversion du
langage intérieur et de la pensée dans une forme intelligible aux autres ». La représentation
iconique construit ensemble la parole et l’écriture, l’écriture organise la
pensée et la parole. L’iconisme
n’est donc pas seulement ce qui se trace à l’extérieur, ce
n’est pas seulement l’idée d’avoir à tracer ou l’intention de tracer, l’écriture organise le langage lui-même. L’écriture
est une organisation de la langue, elle construit un
objet externe qui est l’image, mais en opérant cette iconisation elle permet à
l’écrivant de bâtir son langage de manière
plus cohérente. Il est remarquable que ceux
qui écrivent ne se présentent pas de la même façon que ceux
qui parlent sans avoir jamais écrit. Une manière de
discipliner la pensée s’opère par le moyen de l’écrit.
L’idée de Benveniste selon laquelle « [la pensée] va de pair avec l’élaboration de la parole
et l’acquisition de l’écriture » et l’acte d’écrire rejoint ce que
Derrida – qu’il a peut-être lu, mais dont il ne m’a
jamais parlé – appelle l’archi-trace, c’est-à-dire le frayage de l’image mentale sous-jacente au tracé. Pour Derrida le concept d’archi-trace suppose qu’avant de prendre une forme graphique, un état mental organise le flux
de la pensée. C’est bien ce que Benveniste, prenant ses distances avec Saussure pour qui « l’écriture est subordonnée à la langue », tente d’exprimer
dans la leçon 2 en commentant Peirce : « le
signe iconique associe la pensée au graphisme et à la verbalisation », c’est-à-dire les organise, les
associe et les discipline simultanément. Ainsi la
représentation iconique se développerait parallèlement à la représentation linguistique,
ce qui laisse entrevoir une autre relation entre pensée et icône, moins littérale et
plus globale que la relation entre pensée et parole. Benveniste fait l’hypothèse que l’écriture est associée
au langage intérieur, à l’inconscient et à sa force anarchique, à ses défaillances, à ses jeux de langage, etc., comme il avait pu le repérer
en évoquant l’écriture surréaliste et comme en sémiotique les notes sur
Baudelaire.
Il me semble que ces notes des Dernières leçons, interprétées à la lumière de ce
qu’il dit du langage intérieur dans le texte sur l’inconscient, complètent les réflexions sur l’intenté phénoménologique : si l’écriture
accompagne le mouvement grammatical – car
l’intenté phénoménologique sous-entend la prédication –, elle
s’adresse à quelque chose de moins littéral, à des blocs de signifiés qui ne sont pas
encore grammaticalement structurés. Ce langage intérieur du parlant écrivant ne
se limite donc pas à la propositionnalité, il mobilise des
situations oniriques et des états disloqués de la subjectivation, ou
antérieurs à la subjectivation. Ici Benveniste tente d’introduire, dans le concept linguistique, des résonances phénoménologiques et
freudiennes.
Deux
révolutions dans l’histoire de l’écriture, rappelle-t-il, éclairent la double signifiance de la langue (ici Benveniste ne se penche pas sur l’acte d’écrire, mais
sur l’histoire de l’écriture). La première est représentée par les écritures où la double signifiance de la langue est soumise à la découverte d’un graphisme susceptible de
produire la phone en un nombre limité
de signes, ce qui a pour conséquence que le locuteur écrivant doit reproduire non pas le contenu du message porteur d’un événement, mais
la forme linguistique de ce message. Dans les écritures
idéogrammatiques, si le message consistait à
dire « je vous apporte un livre », par exemple, un homme
portant un livre était dessiné, si bien que seul le contenu de la phrase était
pris en considération, pas la phrase elle-même. La
grande révolution s’opérera en Chine, lorsque la formulation linguistique qui
porte l’événement décrit, et non plus l’événement lui-même, sera représentée. Tout en
célébrant le génie des scribes chinois, Benveniste remarque que ce coup de
génie tient beaucoup à ceci que le chinois est
une langue monosyllabique : à chaque mot correspond une syllabe = musique. Cette « chance
linguistique », les Chinois ont su l’exploiter tout en concevant des
signes qui auront pour conséquence de désambiguïser l’écrit.
La deuxième étape de cette iconisation de la
parole – et non pas de
l’événement – par l’écriture est représentée
par les langues polysyllabiques, qui procèdent à une segmentation supérieure
; il s’agit de segmenter, non pas en phone,
en mots simples, mais en syllabes : il en résulte des variantes tels
que le sumérien, l’écriture cunéiforme, l’acadien ou l’écriture égyptienne (Leçon 10). Une étape – jugée décisive par Benveniste – de cette histoire de la représentation graphique est constituée par l’écriture sémitique alphabétique, où un
schéma consonnantique porte le sens, tandis que la fonction
grammaticale revient à la vocalisation. « Le sémantique prédomine dans la
structure sémiotique ; les consonnes priment les voyelles », enseigne
Benveniste et déduit une « prédominance de l’étymologie ou du sémantique
sur le grammatical » (Leçon 11).
L’alphabet grec, en revanche, qui décompose les
syllabes en
consonnes et voyelles, perd le référent sémantique de base, qui se dissout dans une perte de la
référence collective et dans une incitatio à une plus grande inventivité
personnelle dans la construction de la subjectivité de l’énonciation. Cette évolution de l’écriture,
en ne renvoyant pas le locuteur au bloc de signifiant sémantique du message
collectif tel qu’il se trouve dans les textes sacrés, accorde au locuteur une
plus grande liberté d’expression personnelle, dont Benveniste estime qu’elle
aurait pu avoir, jointe aux facilités de traduction accrues, un rôle
déterminant dans le progrès de la liberté et de la laïcité. Plusieurs pistes s’ouvrent à partir de là, qui
restent à explorer.(Leçon 7, Leçon 14)
Un autre élément relatif au rôle organisateur de
l’écriture me semble important. Le fait d’écrire en
chinois, en hébreu ou dans un système consonantique
et vocalique implique une manière spécifique d’être
au monde. Benveniste
le notifie dans la leçon 14, en établissant une ligne de partage assez nette : à l’est, d’une part, la Mésopotamie, l’Egypte et la Chine, où prédomine une civilisation de l’écrit, caractérisée par
le primat de l’écriture, où le scribe joue un rôle central dans
l’organisation de la société ; à l’ouest, d’autre part, en Occident, où
l’écrit est tenu dans un mépris relatif (chez
Homère graphô ne signifie que « gratter ») et ne renvoie pas à des blocs de sens, de sémantique ancestrale.
A peine cette typologie des signifiances
disciplinées par l’écriture est-elle évoquée que, des propriétés nouvelles de
l’écriture se font jour. L’écriture non seulement organise la langue, mais
elle prolonge aussi l’écrit. Un moment nouveau dans la pensée de Benveniste, prend son départ ici.
Benveniste ne s’achemine pas vers un nouveau relativisme linguistique : ce
qui l’intéresse, c’est de comprendre comment l’iconisation
déclenche et affine la formalisation de la langue intérieure. L’écriture (Leçon
12) est un système de signes qui ressemble beaucoup plus
au langage intérieur qu’à la chaîne du discours. Cet enchevêtrement de pensées
confuses dont nous sommes tissés est élaboré dans l’expérience littéraire, qui propose une langue nouvelle, le style, et organise le flux
pré-linguistique en une sorte de mythe personnel. Parce qu’il formule ses propres
mythes, l’écrivain poursuit l’œuvre du scribe, selon Benveniste.
Un acheminement vers la fiction
Le
glissement de sa réflexion qui se déplace de l’écriture comme
auto-sémiotisation grammaticale de la langue vers la fiction, sans minorer le
rôle de la première dans l’élaboration de la seconde, impose qu’on appréhende
la grammaire avec une autre forme d’organisation de la pensée, conduisant à l’invention de nouveaux mots ou de
nouvelles alliances de mots qui deviendront des métaphores, des
condensations métaphoriques.
J’aimerais prendre le
temps d’insister sur ce rôle de la logique
narrative comme composante de l’écriture comprise dans un sens large
d’organisation de la pensée. On en trouve deux exemples dans
la théorie contemporaine, l’une chez les phénoménologues, l’autre chez les psycholinguistes.
Je pense à Husserl et à la place qu’il accorde – avec et par delà la
prédication – à la fiction. Fiktion dont il écrit qu’elle est « l’élément
vital » de la phénoménologie et de toutes les sciences qui traitent de la
vie de l’esprit. Entendons que la fiction « fertilise » les
abstractions en se servant de riches et exactes données sensorielles,
transposées en images claires.
[10]
Les cognitivistes de leur côté ont récemment introduit la narration dans leurs
recherches en scrutant les premières élocutions de l’enfant, , les holophrases.
L’holophrase se présente lorsqu’aux différents babils enfantins succèdent des
mots, par exemple « biberon ». Par « biberon », l’enfant entend : « je veux mon biberon », demande qu’il ne sait encore formuler mais qui est sous-entendue par
l’holophrase. Pour les psycholinguistes, l’holophrase
est donc
bien plus qu’une structure narrative innée (selon les chomskyens), un narratème, un petit récit. Il se cache implicitement derrière le mot, et sera développé en performance plus tard. Autrement dit, les psycholinguistes introduisent la
subjectivité interactive et l’intersubjectivité dans le pré-langage
et supposent donc qu’existe tout un ensemble de mouvements affectifs
pré-grammaticaux mais non dénués de sens – que, pour ma part,
j’appelle sémiotiques – qui se font entendre quand des
troubles de l’acquisition du langage se présentent. Avec Freud, Mélanie Klein et
leurs disciples j’ajoute que l’observation de la relation précoce mère-enfant
révèle un ensemble. Nous parlons en psychanalyse, aussi, de « fantasme
originaire », qui seraient des « narratèmes » dont l’enfant est porteur mais qu’il ne peut pas dire, et qu’il
faut entendre dans le transfère de la cure pour lui faciliter
l’accès au langage. Les psycholinguistes parlent d’enveloppes pre-narratives : quand l’enfant dit « biberon », il importe d’analyser l’enveloppe narrative pour accéder aux mouvements intersubjectivs sous-jacents.
Ces
recherches nous éloignent du champ linguistique auquel se tient l’œuvre de
Benveniste. Si je les évoque, c’est parce que l’extrême polyphonie de sa
théorie du langage, écriture comprise, nous livre une conception de langue –
rare, sinon unique en linguistique – non plus comme un instrument, mais comme
un organisme signifiant, une intersubjectivité dont
dépend la
qualité de vie et sans laquelle le développement du langage
stricto sensu, tel que les grammairiens l’entendent, est impossible.
Parmi
ces trains de pensée qui tissent les Dernières
leçons plus encore que les œuvres publiées (narrativité intérieure,
globalité, expérience etc.) j’évoquerais la créativité spécifique au langage
poétique : elle opère par « le choix et l’alliance des mots ». Cette formulation figure dans des notes manuscrits sur le discours poétique et Baudelaire,
[11]
ou songe aux vers de
Baudelaire ou de Rimbaud, tels : « Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses », « Vaste
comme la nuit et comme la clarté » : « Voilà la Cité, assise à
l’Occident » : - juxtapositions de métaphores qui évoquent un vécu
et comme telles relèvent de l’écriture narrative, mais sans faire fonction de
récits. Des signifiances complexes qu’aucun mot isolé n’exprime sont suggerées
par l’assemblage des métaphores qu’affleurent, rappelant cette « langue
différente de la langue et qui transforme les figures de
la civilisation » dont Benveniste parlait dans la leçon 14 à propos de la poésie
de Rilke. Ici l’écriture est bien l’acte fondateur compris
dans toutes ses extensions, et que linguiste définit comme « la
révolution la plus profonde que l’humanité ait connue ».
Ainsi
s’achève une troisième étape dans sa réflexion sur l’écriture. La première étape consiste dans l’iconisation de la langue : elle permet de comprendre les éléments et les règles du langage ; la deuxième étape reconnaissait que l’écriture est interne au langage. Dans la troisième, l’écriture est perçue comme activité génératrice d’autres langages.
Cette
particularité de l’écriture dans son rapport à la langue renforce aussi une
ultime constatation : la langue et l’écriture « signifient exactement
de la même manière ». L’écriture transfère la signifiance de l’ouïe à la vue, c’est une « parole dans une forme
secondaire ». La parole étant la première, « l’écriture est une
parole transférée ». « La main et la parole se tiennent dans
l’invention de l’écriture’, écrit Benveniste. Le rapport écriture/parole est
l’équivalent du rapport parole entendue/parole énoncée. L’écriture se
réapproprie la parole pour transmettre, communiquer, mais aussi reconnaître
(c’est le sémiotique) et comprendre (c’est le sémantique). L’écriture est
partie prenante de l’interprétance de
la langue. Ce relais de la parole fixée dans un système de signes reste un
système de la parole, à condition d’entendre cette dernière comme une
signifiance susceptible d’engendrements ultérieurs d’autres systèmes de signes.
Jusqu’aux supports numériques, tels les blogs et Twitter…
Quelle
extraordinaire expansion de l’objet langage Benveniste nous invite ici à
penser ! L’écriture est une parole transférée,
la main et la parole se tiennent dans l’invention de l’écriture, tout ce que
Benveniste a glané dans l’écriture va devoir être cherché dans la langue. C’est
comme s’il nous disait : « Ne châtrez pas
votre langage de toutes ces capacités pour la
réduire à un code exsangue. » Ce point de vue de langue comme work in progress le conduit
naturellement à se poser la question de l’illimité, de l’infini, qui trouvera sa réponse dans la leçon 13, à travers une référence du Philèbe au Platon et à sa réflexion sur le nombre, l’illimité et le limité. Comment, à partir de toutes les
capacités que la langue recèle et que l’écriture nous révèle, arrive-t-on à faire
du fini ? Benveniste considère dès lors que le grammairien est semblable au mathématicien, qui tente de
saisir l’infini pour en faire des nombres finis. La capacité des poètes à enrichir la langue par
de nouvelles alliances suggère en effet que celle-ci, comme les nombres, est
infinie. Dans cette même leçon 13, Benveniste insiste sur la capacité de la
langue à coder les sensations,
multipliée par l’écriture, et envisage celle-ci comme expérience de la
sensation.
On
pourrait s’étonner qu’il n’ait pas rapproché cette fascination de l’infini de
la langue et des nombres à la Kabbale, dont les adeptes opéraient de subtils
calculs avec les lettres des textes sacrés afin d’y découvrir un sens caché. C’est
que, même si sa conception de la langue doit sans doute au talmudisme dont il
fut imprégné dès son plus jeune âge, celle-ci s’est construite dans le sillage
de ce que nous appelons l’ontothéologie, c’est-à-dire
la philosophie grecque et la philosophie chrétienne, dont les sciences humaines sont
héritières. Benveniste participe de cet héritage : l’aristotélisme, les modi significandi du Moyen Age, la linguistique renaissante, la linguistique du XIXe siècle, etc. Et la notion d’infini à laquelle les philosophies grecque et chrétienne
accordaient une place prépondérante, sa pratique de linguiste l’a reconnue dans
cette capacité de la langue à se renouveler sans cesse, à travers le poète et
la métaphoricité du langage poétique.
Avant de revenir au mot « THEO» tracé sur mon chemisier, j’aimerais souligner que dans
le tome 2 des Problèmes
de linguistique générale, p. 67 sq, et 79sq., comme dans les textes
sur Baudelaire, Benveniste ne cesse d’insister que la langue n’est ni un système nie une chaîne du
discours, mais production, engendrement, mouvement. Le langage poétique, « tout à l’envers des
propriétés de la communication, parle une émotion que le langage transmet
mais ne décrit pas ». Ainsi le poète fait bien plus que transmettre un message, il « contamine » le lecteur de son langage intérieur, de ses
« impressions musculaires
[12]
» qui « procède du
corps du poète » et imposent une forme d’explosion du langage, de telle
façon que celles-ci ne s’adressent qu’aux
entités qui participent d’une nouvelle communauté, qui n’est pas celle du
pacte social : « il n’y a pas d’institution sociale capable de l’accueillir, abriter,
transmettre. Si ce n’est…. l’organisme du langage, et la linguistique. Cette de
Benveniste qui la considère comme l’universalité elle-même : « La
linguistique est l’universalité, mais le pauvre linguiste est écartelé dans
l’univers. »
[13]
Dans les Problèmes
de linguistique générale, Benveniste parle d’une « subjectivité instante et élusive qui forme les
conditions du dialogue ». (PLG II, p.66) Ces
états de bouillonnement identitaire, de
pré-subjectivité de l’écrivain, je les retrouve dans le deuxième
Heidegger, pas celui de L’être et le temps où le langage est
envisagé comme Rede, comme discours et intersubjectivité, mais celui de L’Acheminement
vers la parole, où le langage est envisagé comme « la Dite », Sage, « ce qui est parlé », et
ouvre vers ce qui n’est pas propositionnel. Méditant des textes de Hölderlin, il fait une brèche dans
l’intenté dans lequel il se situait lui-même antérieurement et parle de ce
qu’il appelle « le venir à la langue ». Il me semble que c’est
ce que Benveniste recherche dans le langage intérieur :
une signifiance qui est un venir à la langue à travers la langue. Cela ne vient pas de nulle part, car il y a toujours le bain de langage où se trouvent l’enfant et l’écrivain, langage qui parle uniquement avec et par lui-même et sa sonorité. Si j’entends des échos de ce deuxième Heidegger chez Benveniste, c’est pour remarquer aussitôt qu’au contraire
Benveniste s’écarte du « laisser-aller » lourdement menacé de devenir
« insensé » au cœur même de l’essence du langage selon le philosophe. Le linguiste, lui, se montre toujours soucieux que cette créativité infinie se rattache à la
syntagmation : il faut que ça puisse se dire, se formuler. Une discipline est nécessaire
dans la composition muette du dit et de l’écrit autant que dans sa
représentation graphique afin que le message soit transmissible. En ceci
Benveniste est tel que je l’ai connu, c’est-à-dire animé
par un immense respect des institutions et des lois et, en particulier, des
lois de la République et de l’éducation, tout en ayant le souci
d’inscrire dans ce domaine un espace de liberté novatrice.
Pourquoi THEO ?
J’arrive maintenant à l’histoire de « THEO », sur laquelle je souhaitais revenir.
J’avais rendu de
nombreuses visites à Benveniste après son accident cérébral, en compagnie parfois de Tzvetan Todorov, Djafar
Moïnfar ou Pierre Nora.
Ainsi un jour je lui ai demandé de me
dédicacer son premier livre, The Persian Religion According to the Chief
Greek Texts (1929), que j’avais trouvé en anglais chez un antiquaire
orientaliste. D’une écriture tremblée, en lettres capitales d’imprimerie, il
écrivit son nom, E. BENVENISTE, en ajoutant la date 23 sept. 1971, qu’il
corrigea aussitôt en 24 sept. 1971 : il demeurait donc présent dans l’acte
de l’interlocution, et conservait la notion du temps. En 1971, le numéro spécial de la revue Langages sur « L’Epistémologie de
la linguistique », dirigé par moi, lui fut dédié : « Hommage à Emile Benveniste » – ce dont il
s’est réjoui. Avec Pierre Nora (directeur
de la Bibliothèque des Sciences humaines chez Gallimard), nous lui apportâmes aussi
l’édition du deuxième volume de ses Problèmes
de linguistique générale. En 1975, un recueil conçu par Nicolas
Ruwet, Jean-Claude Milner et moi-même sous le titre Langue, discours, société. Pour Emile Benveniste lui fut
consacré au Seuil. Il l’accueillit avec plaisir. Bien sûr ces lectures
étaient fatigantes, et sans doute en appréciait-il davantage l’existence même
plus que les détails.
Mes
visites par la suite se sont espacées, et je ne l’avais pas vu depuis un moment
quand en 1975 je reçus une lettre de sa sœur. Son frère, m’écrivait-elle, souhaitait
me revoir. Il n’avait plus alors la possibilité de s’exprimer par la parole, mais
il le lui avait fait comprendre en touchant mon nom sur une liste qu’elle lui
avait présentée.
Je me rends donc à cette invitation et
le trouve serein, quoique de toute évidence désireux et impatient de me
communiquer quelque chose d’important. C’est du moins ainsi que j’interprète
les signes énigmatiques qu’il trace du doigt sur mon chemisier, provoquant chez
moi une certaine gêne. Pensant qu’il souhaite boire ou manger, je lui tends une
feuille, sur laquelle il écrit le mot « Theo ». Je n’en obtins rien
de plus et notre échange s’arrêta là.
Pendant longtemps l’énigme de
ce mot tracé sur mon chemisier puis sur une feuille me préoccupa, j’étais
certaine qu’il recelait un sens, mais sans parvenir à l’identifier. J’ai mis
longtemps à refouler l’événement et je n’y ai plus songé, jusqu’à ce qu’Irène
Fenoglio me sollicite pour écrire la Préface aux Dernières leçons. C’est en me repenchant sur son parcours
biographique et intellectuel, depuis l’école rabbinique jusqu’aux réflexions
sur l’expérience trans-linguistique du poète qui crée un langage
nouveau, que j’ai acquis la conviction que ce « THEO » représentait justement
l’infini de la signifiance qui s’actualise dans la rencontre entre deux corps,
dans l’intersubjectivité dont le fonctionnement est explicité dans les Problèmes
de linguistique générale. Pour simplifier en une formule : la signifiance. La signifiance universelle se
réalise dans la rencontre entre deux corps qui parlent. Le corps
apparaît moins dans les travaux publiées de Benveniste, il l’est davantage dans les Dernières
leçons, en filigrane, et il est présent dans le Baudelaire : « la musculation, les sensations du poète qui cherche
un langage », la rencontre de deux corps qui peut se dire… à
l’infini.
J’ai acquis la conviction que le mot « THEO » était le
signe de cette res divina qui pour
les scoliastes est l’infini du monde. Il aurait écrit
« YAHVE », peut-être, s’il ne s’était détaché intellectuellement du
judaïsme pour devenir, en tant que linguiste, l’héritier du continent
ontothéologique gréco-latin. J’en suis restée là après avoir achevé ma préface.
C’est à la faveur d’une autre
sollicitation que ma réflexion s’est poursuivie. En
octobre 2013, Marc-Alain Ouaknin, écrivain et philosophe dont j’ignorais alors
qu’il était également rabbin, m’invite à parler de
Proust sur France Culture, dans l’émission matinale Talmudiques. Après l’émission, il s’approche
et me confie : « J’ai lu votre Préface au
texte des Dernières leçons de
Benveniste, et je sais pourquoi Benveniste a
écrit THEO. »
Comme, curieuse de son interprétation, je l’interroge, il argumente :
« Vous dites que Benveniste s’est détaché du judaïsme, c’est certainement
vrai, mais il est impossible qu’il n’ait pas conservé la mémoire de ses études
talmudiques à l’école rabbinique. Or dans les interprétations
talmudiques de la Torah, et
notamment dans le Talmud babylonien Yoma
54A
[14]
, il est enseigné au nom
de Rav Yehouda que la transcendance du divin se manifeste en une image
érotique, « comme deux seins de femme » qui apparaissent, « visibles et
invisibles » sur le rideau qui, dans le temple de Jérusalem, séparait l’espace
appelé Saint du Saint de celui appelé Saint. Ouaknin m’expliqua plus
précisément que « toujours cachées par le rideau (parokhèt), les barres pouvaient coulisser dans les anneaux placés
aux quatre coins de l’arche et être poussées contre le rideau pour apparaître
alors «comme deux seins de femme». Enseignement que le Talmud met en relation
avec un verset du Cantique des cantiques : « Mon bien-aimé est un sachet de myrrhe, il repose entre mes seins. »
Marc-Alain Ouaknin ajoute que dans ce verset du Cantique, l’expression « mes seins » est dit en hébreu shaddaï, expression qui est aussi l’un
des noms de Dieu. Et de conclure : «J’en déduis que le THEO que Benveniste a
tracé sur votre chemisier n’est autre que ce nom shaddaï. » Le jeune Ezra, comme tout élève de l’école rabbinique,
même s’il ne connaissait pas précisément ce texte de Yoma 54A, ne pouvait ignorer, selon lui, le double sens du mot shaddaï. Le souvenir de jeunesse de
Benveniste, qui s’origine dans la tradition juive elle-même serait ainsi revenu
dans sa vision du langage où l’infini et le corporel font jeu commun.
Marc-Alain Ouaknin m’adressa ensuite une lettre
reprécisant le jeu dynamique des barres avec le rideau tel qu’il est commenté
dans ce texte Yoma 54A, accompagné
d’un document décrivant le Saint des saints et l’arche d’allience avec ses deux
barres de transport.
[15]
Loin d’être inconvenant, le geste de
Benveniste était lié à son histoire, dont peut-être il avait voulu me
communiquer le sceau. Je suis
d’autant plus convaincue désormais que l’enseignement religieux qu’il a reçu enfant
doit être pris en compte lorsqu’on étudie sa perception du langage et cet
intérêt prononcé qu’il a marqué dans ses derniers textes pour la créativité
infini de la signifiance.
La
France et l’Europe, comme l’ont écrit Arendt et Tocqueville, sont la seule civilisation à
avoir rompu le fil de la tradition, avec la sécularisation, l’émancipation des
hommes et des femmes par la liberté de penser. Mon travail personnel, mon
expérience de femme, théoricienne et d’écrivaine s’inscrit dans cet humanisme
sécularisé. Désormais nous sommes de l’autre côté du rideau, mais le
rideau est ouvert et nous sommes libres d’interpréter l’irreprésentable. Il nous revient d’opérer cette transvaluation de la
tradition pour ne pas imputer notre conception du langage de ses toujours vivantes et infinies potentialités.
L’œuvre de Benveniste fut interrompue
brutalement par son accident cérébral. Je n’ai jamais cru que ses facultés intellectuelles
étaient tout entières annihilées, mais désormais mon sentiment est qu’il n’a peut-être
jamais cessé de poursuivre en pensée cette œuvre toujours et encore en chemin à
travers nos lectures. Il n’est pas impossible que sept ans durant, il n’a songé
à ses conceptions de la signifiance, que sa langue intérieure s’écrivait sans
le dire et qu’il a voulu tracer dans le cœur d’une jeune femme venue d’ailleurs
l’innommable, l’interminable si énigmatique, pour le transmettre.
JULIA KRISTEVA
DISCUSSION
Jean-Claude Coquet : Je trouve que ton exposé est non
seulement très argumenté, mais en même temps très convaincant ; je
pense qu’Irène et moi nous nous retrouvons parfaitement dans ce que tu as dit.
Une chose, cependant, que tu n’as pas dite peut-être et sur quoi tu aurais pu
insister, c’est la relation d’interprétance.
J. K. : Le mot est dans mon texte, je ne l’ai pas dit peut-être ; mais les
mouvements de la signifiance par le truchement de l’écriture constituent l’interprétance.
J.-C. C. : Tu as très justement fait valoir le
problème de l’infini et à partir de la relation d’interprétance on peut
retrouver ce schème : l’écriture étant le maillon formel, matériel, en quelque
sorte, à partir duquel on interprète la parole, de la parole on remonte à la
langue, de la langue on remonte à la société et à partir de la société on a des
ouvertures sur l’Être et en particulier sur l’infini, dont
tu as très justement parlé. Donc je pense que tu as eu tout à fait raison de
faire valoir ce passage du singulier au total. THEO, c’est tout de
même une figure du totalisant et l’intérêt aussi de ton témoignage, c’est
qu’on y voit un personnage très diminué, c’est entendu, mais capable de faire
une sorte de démonstration de ce que peut être l’intersubjectivité et en
particulier de l’intercorporéité, parce que le fait de
tracer sur ton corps interne de la transcendance, c’est allier la corporéité
et le transcendantal. Donc c’est une magnifique conclusion, si l’on
peut dire, pour la vie de Benveniste d’avoir réussi à conjuguer, d’une manière
factuelle mais très émouvante et éprouvante, ce qui faisait le nœud de sa
pensée. Tu as très bien fait valoir tout cela et nous t’en remercions.
J. K. : J’ai voulu « augmenter » la notion d’interprétance
par l’idée d’engendrement, pour aller vers l’infini,
dans la capacité de la langue de créer à l’infini. Benveniste parle
d’un auto-engendrement qui me parait participer de l’interprétance. Mais le terme d’interprétance peut avoir le
désavantage de clore la langue qui s’interprète, « en vase clos », alors que le thème d’auto-engendremant, du fait
que l’écriture crée de nouveaux sémantèmes et de nouvelles relations au corps, ouvre
la dimension de l’infini.
J.-C. C. : La relation
d’interprétance, c’est quand même une chaîne :
interprétant/interprété, interprétant/interprété, etc., il n’y a pas de clôture.
J. K. : A propos de THEO, est-ce que c’est la
totalité ? Je
me considère comme très leibnizienne dans l’interprétation de
la religion. Je
pense à cette vision du divin chez Leibniz non pas comme une totalité, mais
comme infini qui insiste dans chaque unité, qui l’impacte ; de telle sorte que l’unité
en est habitée : c’est la monade. Il n’y a pas d’unité
sans que l’infini y insiste. C’est ce que j’entends dans les pages
des Dernières leçons que je viens de commenter : chaque unité signifiante est susceptible d’engendrer une chaîne
infinie de significations, d’interrelations, etc. Ce que Ouaknin
signale à la fin du texte qu’il m’a envoyé, c’est
qu’il y a une espèce d’intertextualité entre la notion hébraïque de divin et la
notion gréco-latine de la transcendance infinie. THEO renvoie à « vision », et il y a
une racine grecque, thea, qui renvoie à la visibilité. Ouaknin dit que, peut-être, dans le fait d’écrire THEO, Benveniste invite à rendre visible l’infinie interprétance de la langue : la
reconnaître et à la partager. Plutôt que de se
perdre dans une contemplation, d’amorcer des pratiques de mises
en acte linguistiques où cet infini se partage et insiste dans le corps social.
Ce n’est pas le Gelassenheitheideggérien, ce n’est pas l’ek-stase mystique. C’est la vision qui, en
misant sur la communicabilité, sur le partage, conduit davantage à une
position, dans le monde : créativité translinguistique, éducative, philosophique,
esthétique…
J.-C. C. : Encore une chose, tu as effleuré le
problème des notes sur Baudelaire. Ces notes font apparaître qu’il distingue un
monde, celui de la communication, de ce qu’il appelle un ultra-monde, un
autre monde, une autre réalité, et là, c’est encore une façon de faire
valoir la notion d’infini. Baudelaire sert de référence pour faire
apparaître combien on peut nourrir poétiquement la notion d’infini.
J. K. : Quand Benveniste dit que la poésie de Baudelaire procède du corps
du poète et des impressions
musculaires, c’est du langage sensitif qu’il parle : la poésie
recrée un autre monde, non conventionnel, hors
de la communauté. Les signifiants poétiques proviennent des
singularités spécifiques de chaque sujet, sont illimités en nombre et, de ce fait, le langage poétique change d’instrument, comme le voulait Rilke. Mais cet autre monde pour
lequel ce nouvel instrument est créée, c’est aussi le nôtre, c’est un monde en plus. Maintenant (c’est mon dada
actuellement), les astrophysiciens, ou
plutôt les cosmologistes, qu’il n’y a pas qu’un univers, mais des mondes où le temps et l’espace
sont à cinq, six ou dix dimensions… Et au
lieu de parler d’un univers, ils envisagent un « multivers ». Des
multimondes. Le monde de Baudelaire n’est peut-être ni le
mien ni le
vôtre, mais chacun est invité à y accéder : un polymorphisme inhérent à
la capacité linguistique est ainsi esquissé, ouvrant à des libertés plurielles.
N’est-ce pas extraordinaire de placer les linguistes à cet endroit stratégique,
comme témoins et incitateurs de cette liberté plurielle ! Le moins que
l’on puisse dire, c’est que nous sommes loin du compte, on ne va pas assez loin
sur le chemin qui nous est ainsi ouvert.
I. F. : Je voudrais insister – et
cela prolonge ce qu’a dit Jean-Claude – sur le vivant de ce que nous propose
Benveniste. Lorsque l’on va dans le détail d’un de ses articles pour comprendre
et approfondir ce qu’il dit sur un point précis, on oublie cette ampleur
vivante de l’activité de Benveniste, et je vous remercie, Julia, d’avoir réussi à faire apparaître cette attention qu’il portait à
tout ce qui se passait, y compris sur le plan littéraire.
J. K. : Merci, Irène, d’avoir été sensible à cela. Je pensais, en venant voir les
jeunes linguistes qui sont autour de vous, que je me devais de partager avec
eux la crainte qui est la mienne de voir le métier de linguiste devenir parchemineux, de se
réduire à une
peau de chagrin étriquée, fiable. Je sais, la spécialisation et
les outils techniques exigent de mettre au second plan cette dimension – disons : théorique - que les grands
linguistes que j’ai connus, que ce soit Benveniste ou Jakobson, avaient nécessairement. Ils étaient innovants dans leur discipline parce qu’ils étaient en contact avec le corps érotique et politique, et avec l’histoire. C’était important pour les étudiants et les jeunes
chercheurs – à leur tour - d’entendre comment la
langue vit à des moments clés du tissu social, et de construire leur
théorie en conséquence.
Dominique Ducard : Vous avez évoqué le texte
de 1969, « Sémiologie de la langue », et sa
conclusion quelque peu énigmatique qui appelle à une translinguistique
méta-sémantique fondée sur la sémantique de l’énonciation. Jean-Michel Adam est
revenu sur ce texte, il n’y a pas très longtemps, et il situe ce qu’il appelle son « analyse textuelle des discours » dans le prolongement de cet appel, il cite également
la poétique de Meschonnic, la linguistique du discours de Barthes et votre sémanalyse.
Mais, en fait, il faudrait renverser
le jeu chronologique ou d’influence, car à mon sens lorsque Benveniste dit cela dans la conclusion de
son article, il pense directement à vous puisqu’il reprend un terme que vous utilisez
dès 1968. Je
pense donc qu’il est très proche à ce moment-là de
ce que vous dites, et que chez Benveniste il y a une double postulation, il y a
le grammairien comparatiste qui recherche des relations, des systèmes, et puis
il y a la référence, la psychanalyse, la phénoménologie, la poésie, et
donc une dualité que l’on voit quand on lit ses textes. Et s’il y a
double postulation : c’est qu’il y a un nœud, il y
a ce mouvement de la pensée-corps dans la langue que Benveniste essaie de
traduire dans sa théorisation.
J. K. : Je vous remercie d’avoir rappelé cette diachronie et cette
dualité. En donnant quelques exemples de mes
échanges avec
Emile Benveniste, j’essayais de montrer, sans le dire explicitement, comment Benveniste se montrait
attentif à un certain nombre de choses qui me
travaillaient, que ce soit la signifiance – le
mot même de signifiance dont il me disait que peut-être le père de Paulhan l’avait utilisé, alors que pour moi, le terme ne venait pas du tout de Paulhan, mais des modi significandi des sémioticiens du Moyen Âge –, le spho_a ou la question du géno-texte
et du phéno-texte, ou encore de la chora sémiotique (que je devais détailler dans ma Révolution du langage poétique, 1974). Benveniste était à l’écoute de ces
tatonnements dans lesquelles j’évoluais pour écrire ma thèse, j’en ai perçu des
échos dans la conférence dont vous parlez, que j’ai entendue à
Varsovie. J’avais l’impression qu’on était dans un laboratoire bicéphale. J’ai
eu la chance de travailler avec deux grands professeurs très différents, lui et
Roland Barthes, mais qui avaient en commun de considérer
leurs élèves comme des égaux, ils écoutaient le développement de la jeune pensée
sans désirer qu’elle prenne le même chemin que la leur.
De fait, Benveniste m’avait téléphoné au
début du mois
de janvier, quelques jours avant qu’on lui fasse ce vaccin contre la grippe qui l’a conduit dans l’état que l’on
connaît. Il lisait Recherches
pour une sémanalyse, cela l’intéressait et il m’avait dit qu’il voulait
en parler : « On passe les vacances et nous en parlerons après », m’avait-il dit.
Marie-Christine Lala : Je suis frappée par cette permanence
d’une profondeur de pensée et par une persévérance dans l’être. Je reprends une
phrase du Manifeste
que vous avez évoqué, La révolution d’abord et toujours, une
petite phrase que l’on pourrait mettre en exergue à tout ce que vous avez dit : « Car en définitive nous avons besoin de la liberté,
mais d’une liberté calquée sur nos nécessités spirituelles les plus profondes,
sur les exigences les plus strictes et les plus humaines de nos chairs, en
réalité ce sont toujours les autres qui ont peur que l’époque moderne ait fait
son temps, la stéréotypie des gestes, des actes, des mensonges de l’Europe
accomplit le cycle du dégoût. » Benveniste vous a-t-il parlé
de ce texte concernant le discours poétique et Baudelaire ?
J. K. : Non. Mais je lui parlais de Mallarmé, parce
que je préparais ma thèse sur lui et Lautréamont. En réalité, je finissais ma thèse de troisième cycle sur le roman et je lui parlais beaucoup du fait que la structure profonde de la narrativité n’était pas binaire, mais
transposait dans unités du discours l’acte grammatical : SVO. J’avais déjà
écrit cela, il me restait de soutenir. Et je mentionnais aussitôt la thèse d’Etat que j’allais faire sur Mallarmé, parce que cela me paraissait être
une coupure radicale avec mon structuralisme sémiologique antérieure, fût-il
syntaxico-générativiste. Or dans les notes sur
Baudelaire, Benveniste justifie le fait de s’intéresser à ce poète en disant qu’il l’a choisi c’est parce qu’il est
le dernier à écrire dans le langage de la poésie classique, avant la révolution mallarméenne. Benveniste a donc pris comme objet de sa nouvelle recherche l’ancêtre, celui d’avant la coupure et chez qui, le linguiste peut analyser des formes plus traditionnelles de l’art
poétique, plus généralisables.
Mais ce que vous me dites tous les deux me
fait comprendre comment je me suis éloignée de la linguistique – bien que je ne l’aie pas
fait de manière programmatique, intentionnelle. Il me semble que malgré tout je ne m’en suis
jamais tout à fait éloignée. Par exemple, lorsque dans
les premières pages de mon livre sur Proust j’analyse
le passage sur la madeleine, en détaillant aussi bien des mots (étymologie, sonorité,
polysémie), que des métaphores, que la structure syntaxique des
célèbres phrases proustiennes emboîtées à satiété, et que je glisse du sensible
au narratif et à la philosophie du temps et du désir ; ou, d’une autre façon, quand j’analyse le discours de mes patients sur le divan, en cherchant de repérer comment dans les associations
libres de cet homme-ci, de cette femme-là afflux des signes linguistiques qui
signalent régression, angoisses, perte d’identité, parfois catastrophe , ménageant
de psychose… J’ai le sentiment de continuer à pister la double signifiance qui n’est
pas de la linguistique formelle, mais agit, vit ou s’effondre dans la vraie vie de la langue.
Clemilton Pinheiro : Si j’ai bien compris, vous nous
avez fait part de deux réflexions, l’une sur la double
signifiance, et l’autre sur l’écriture. Ces
deux réflexions doivent-elles rester séparées ou bien faut-il mettre en relief
le rapport entre elles ?
J. K. : Je ne vous ai pas cité la position de Benveniste qui
ouvre son cours, mais elle affirme explicitement que « la nature
signifiante de la langue », c’est-à-dire sa double signifiance, commande toutes les fonctions qu’elle
peut assumer
[16]
. Je
souligne « commande toutes les fonctions », autrement dit la culture
même des êtres parlants que nous sommes se trouve déterminée par cette double
signifiance de la langue. On comprend que la conception de la langue que Benvensite propose est tellement vaste, par ce qu’elle est très profonde, de telle sorte qu’il ne veut pas qu’il y ait quoi que ce soit de transcendant, ni Dieu, ni réalité en dehors du champs du langage
pour les humains que nous sommes. Le référent lui-même n’est pas extérieur,
il entre dans la langue par l’intersubjectivité et toute la culture est en germe dans
la langue.
Pour montrer cette découverte, le linguiste ne dit pas : il y a les écritures et
puis après la langue. Il dit : l’écriture a formé la langue dont elle fait partie, la langue se développe avec l’écriture et cette co-présence,
co-interprétation engendre la culture. Replaçons cette logique à
l’heure d’aujourd’hui : la langue est numérique, elle est en train de le devenir. Il existe d’autres expressions, bien sûr, mais si la numérisation devient notre culture,
il n’y aura pas de culture extérieure à ce que la numérisation nous fait vivre.
La numérisation crée son sujet. Le petit enfant qui naît dans la
numérisation est
doté d’un certain être au monde qui est forgé par une
manière de faire la langue avec la numérisation, et la culture autre, c’est
celle de son grand-père ou de sa grand-mère ; cela fait « multivers ». Il n’y a pas de
culture extérieure aux langages qui l’engendrent, la
culture c’est la langue mais elle-même comprise comme interprétance et auto-engendrement infini.
Je crois que Benveniste a raison : nous sommes si et seulement si nous sommes
des êtres parlants, et conformément aux signifiances de nos langues. Pensez à toute cette génération de gens qui ont subi l’horreur la Shoah, dont la vie a été bouleversée, voire détruite, par la
barbarie et
qui se sont abrités dans la langue pour conserver leur dignité humaine. Hannah Arendt n’a cessé de repéter qu’il
existe deux espèces de vie, zoe et bios. Zoe, la vie « naturelle » qui ne parle pas encore, vie
« zoologique », les totalitarismes essaient de nous réduire à cette vie-là, celle des bêtes ; et bios, c’est
la vie racontée, où vous faites le récit de vote expérience. Où je raconte, j’écrit ma bio-graphie, habité de langage recréé, à travers la grammaire et la poésie,
je crée un lien avec autrui : c’est ce qu’on appelle
la culture. Mais
cette culture n’est pas extérieure au langage, c’est de notre récit plus ou moins bio-graphique que dépend ce que sera la culture. Benveniste intègre la culture dans le langage. Quelle importance ? Enorme ! Dites-vous
cela, et vous trouvez que la créativité est en vous, vous êtes libre. Ce n’est pas réducteur de dire que la culture est
intérieure au langage, c’est au contraire une incitation à l’initiative, à l’inventivité.
I. F. : C’est en ce sens que Benveniste renverse les
choses par rapport à Saussure. La langue n’est pas un système de signes parmi les autres, et nous revenons à la
notion d’interprétance, la langue est le système qui interprète les autres et qui engendre de nouveaux systèmes.
J. K. : Oui, c’est exactement cela. Cette
interprétance se relaie. Dans les dernières pages du cours sur
l’écriture, Benveniste dit bien qu’elle engendre d’autres
systèmes de signes.
I. F. : Vous parliez de la numérisation, mais dans
cette vision, peut-on dire que la numérisation soit hors de la
langue ? Je ne
le pense pas. En même temps, la numérisation duplique le monde.
J. K. : Il y a des éléments de la numérisation qui
utilisent la langue en la dupliquant tout simplement et en l’appauvrissant, et
d’autres qui révèlent de nouvelles potentialités. Mais la
numérisation dans son ensemble reste interne à la langue, oui.
Giuseppe D’Ottavi : Moi je suis attiré par cette réflexion
sur l’écriture, très puissante, très originale, et que l’on ne trouve
pas dans le corpus benvenistien connu jusque-là. Je me pose alors la
question : est-il possible, est-il légitime d’établir une généalogie
de la pensée benvenistienne ? Cette vision de
l’écriture procède d’un sens aigu du langage comme activité, Benveniste dit « communication vivante », « créativité infinie ». L’écriture, pour
ce faire, arrête ce mouvement-là : c’est une opération de réification
d’elle-même, de réification de la langue.
J. K. : Il
n’emploierait pas le mot « réification ». Iconisation n’est pas réification. Il s’agit d’une
prise de conscience par la visualisation. Une iconisation qui est
une interprétance permettant de prendre ses distances du flux verbal, d’opérer une
première abstraction, de prendre de ses constituants (éléments et règles). Des
lors, la conscience de soi advient aussi, je me pose comme sujet et objet de
l’échange verbal. Mais cela ne signifie pas
qu’il se fige, ni qu’il se réifie. Le processus reste ouvert
parce que la langue crée d’autres systèmes de signes mais aussi d’autres mondes
de langue. C’est ce que j’appelle « pratiques signifiantes » : le code de la
route, les rituels comportementaux, mais aussi des créations comme la poésie,
la peinture, le cinéma…
G. D’O. : C’est le sujet scribe qui crée la forme
linguistique à partir d’une forme langagière, à partir de la langue conçue en
tant qu’activité, et, soudainement, il semble
que l’acte d’écrire se pose à la base de la réflexion linguistique tout court.
J. K. : Oui, c’est exactement cela.
G. D’O. : C’est pour cela que je
trouve la réflexion de Benveniste très originale et très puissante, car
l’écriture, chez lui, ne procède pas de l’oral.
J. K. : Dès qu’il y a de l’oral, l’écrit est à l’œuvre, implicite ; l’écrit organise l’oral, il le féconde, l’explicite, et le rend plus
puissant pour affronter la communication, les échanges et le monde. Car, non content d’être
auto-interprétant et sémiotisant de la langue elle-même, l’écrit est
générateur. En même temps, l’écrit engendre d’autres
systèmes de pensée que l’oral intersubjectif, immédiat, n’avait pas. L’écrit permet, par exemple, d’affiner et complexifier les narrations, de la poésie, de passer le relai à d’autres
traces visibles et audibles, d’autres langages (musique, peinture, théâtre…)
Les notes succinctes des Dernières leçons et certains passages des Problèmes esquissent une véritable
généalogie des pratiques signifiantes translinguistiques, chez Benveniste.
Aussi ai-je essayé d’adosser la réflexion sur
l’écriture aux deux textes que sont la « Sémiologie de la langue » et les Notes sur Baudelaire. Ils arrivent à un moment donné de son histoire, après la guerre, après
le surréalisme, dans le contexte français des travaux sur l’écriture, le
nouveau roman, dans lequel Benveniste (et le
mouvement sémiologique lui-même) tente de
rendre compte de cette revivisance culturelle. Mais le linguiste ne conçoit pas l’écriture comme quelque chose qui
réifie, cela serait plutôt la conception saussurienne,
selon laquelle la parole est vivante et l’écriture répète et
fige. Ce
n’est pas de cela que parle Benveniste : il envisage l’écriture comme une « économie psychique » qui passe par la main, mais opère aussi implicitement
(« archi-trace »). Si l’oral et l’auditif passe par la main, c’est-à-dire le corps,
pour se rendre visible , la dynamique
de la signifiance opère dans l’organisme, avec ses pulsions, affects, musculations, sensations… Et la linguistique
jouxte la….psychanalyse. Une frontière que Benveniste ne franchit pas. Il est
au Collège de France, on respecte les disciplines….
G. D’O. : Oui mais, même s’il ne le sait
pas, Benveniste est très saussurien
I. F. : Il le sait et il le dit.
J. K. : Oui, il le sait, mais il se décale, sans être contre Saussure.
G. D’O. : Oui, mais je veux préciser certaines choses
à propos de l’écriture. Le noyau de ce que dit Saussure à propos de l’écriture
est qu’elle est un système, tout à fait comme la langue, mais
parallèle au système de la langue. L’écriture est
subordonnée et dépendante de la langue, mais ce qui est important est qu’elle se
pose en tant que système.
J. K. : Oui, bien
sûr, mais le fait que l’écriture soit un
système interprétant n’est pas spécifiquement
saussurien. Ce qui est spécifiquement saussurien, c’est cette subordination
de l’écriture à la langue. Alors que Benveniste, si vous avez suivi son mouvement, et
le mien qui a essayé de vous le faire revivre, dit d’abord que l’écriture est différente, ensuite qu’elle n’est
pas différente mais parallèle, et, ensuite, ajoute qu’elle
participe de l’auto-engendrement de la langue. Donc
il ne dissocie pas vraiment l’écriture de la langue, mais affirme que la première n’est pas subordonnée à la seconde, et
même lorsqu’il dit que l’écriture est parallèle à la
langue, cela veut dire qu’il imprime les formes de la langue. Cela signifie qu’en commençant
à écrire l’humanité organise sa manière de parler et/ou de penser. Qu’il y a
donc des traces mnésiques psychiques de l’écriture
dans toute parole, il y a de l’immanence de l’écrit au moment même qu’il est tracé.
G. D’O. : Une dernière chose. On a
prononcé les noms de Barthes et Derrida à propos de ce caractère tout-puissant
de la langue en tant que sémiotique. Il faudrait peut-être
citer aussi Hjelmslev, selon qui la langue est la sémiotique la
plus puissante parce qu’elle peut se prendre pour objet.
J. K. : Dans mes rencontres avec Benveniste, il n’a
pas évoqué cet auteur et dans la mesure où Hjemslev était
le maître à penser de Greimas, j’avais l’impression que Benveniste lui avait laissé le monopole de
Hjemslev.
J.-C. C. : Oui, mais il y a une correspondance, par
exemple entre Benveniste et Martinet au sujet de Hjelmslev, pendant la guerre,
il y a encore une correspondance qui s’effectue entre eux, mais il faut
reconnaître que la pensée de Benveniste était très éloignée de celle de
Hjelmslev, sauf sur le plan structural. La sub-linguistique, par
exemple, est quelque chose qui vient de Hjelmslev.
Pierre-Yves Testenoire : Sur la question de
l’écriture, notamment la comparaison avec Saussure, vous avez parlé de
l’importance de la scription, et notamment de l’hébreu.
Il est certain que la réflexion de Saussure sur l’écriture est frustrante, et ce
qui a peut-être poussé Benveniste à reprendre cette question, c’est
que Saussure appuyait sa réflexion sur l’écriture du grec qui restait son
modèle. Le fait que Benveniste ait pris en compte l’écriture
des langues sémitiques a permis peut-être une autre approche. Et il y a une
autre question qu’aborde Benveniste et dont nous n’avons pas beaucoup parlé, c’est
celle de la lecture. Il y a tout un chapitre où il fait, un peu à
la manière du Vocabulaire des institutions
indo-européennes, des analyses sur la
désignation de la lecture. Et il fait aussi, dans les notes sur
Baudelaire, toute une réflexion sur la lecture. Je ne sais pas si vous avez
réfléchi à cela.
J. K. : J’ai l’impression que la manière dont
Benveniste comprend la lecture fait écho de sa compréhension de l’écriture sans pour autant la redoubler.
Je ne pense pas que la lecture comme réception change la conception de l’écriture comme interprétance et
engendrement. Ecriture-lecture, et Lecture-écriture, en somme ! La lecture est un miroir qui invite à assumer la
logique de l’écriture, celui qui lit est un écrivain potentiel.
I. F. : J’ai une réflexion que j’aimerais partager. J’ai beaucoup apprécié l’insistance avec laquelle vous avez affirmé que Benveniste s’appuyait sur sa
connaissance de Freud. Je le pense aussi profondément. Et je me
suis toujours demandé si cette découverte par Benveniste de la double dimension
sémiotique/sémantique, et précisément cette dimension sémantique, ne
vient pas, pour une part en tout cas, de Freud, de cette compréhension de Freud
par lui, qu’il intègre
dans une réflexion théorique rigoureusement linguistique pour laquelle il va
chercher un appareil formel.
J. K. : Ce
que vous dites me va tout à fait, d’autant plus qu’en préparant ma conférence vous avez vu que j’ai repris quelques réflexions de
ma Préface aux Dernières
leçons, et en particulier cette phrase d’Héraclite que
reprend Benveniste : « La langue ne dit ni ne cache, elle signifie. » Elle a fait écho pour moi à une sentence de Freud que l’on trouve vers la
fin de L’interprétation des rêves : « Le rêve ne pense ni ne calcule, il se contente de
transformer », c’est quasiment la même chose. Dans « Le rêve ne pense ni ne calcule mais transforme », la pensée renvoie à quelque chose d’extérieur, le calcul ferme dans le propositionnel, seul le rêve transforme. Le rêve étant la voie royale
pour accéder à l’inconscient, Freud se fait héraclitéen pour suggérer le
caractère fluide, transformateur, vital aussi de l’inconscient. Benveniste
ausculte ce caractère transformatif de la langue elle-même, mais reste
linguiste et n’aborde pas les poussées énergétiques ou hormonales du
fonctionnement psychiques qui préoccupent Freud. La théorie freudienne sera hétérogène : psycho-somatique.
Benveniste côtoie cette dimension, l’évoque même explicitement mais
métaphoriquement (« musculation baudelairienne », « force
anarchique » et « déchirure » surréaliste), mais reste linguiste
et opère dans une dimension homogène : la signifiance de la langue seule (quelles qu’en soit les motivations
biologiques). Lacan a perçu cette élévation de la dynamique freudienne au seul
niveau du signifiant, chez Benveniste. Il lui
a demandé avec beaucoup d’insistance, paraît-il, de
participer au premier numéro de la revue Inconscient
[17]
. Mais
Benveniste était beaucoup plus freudien que lacanien, car
pour lui l’inconscient est peut-être structuré comme un langage, mais à
condition de prendre le « comme » au sens d’évoquant une
ressemblance, aucunement une identité. L’article sur le langage selon Freud
était donc beaucoup plus freudien que
lacanien et, du coup, les relations ont été
rompues entre les deux. Mais je suis tout à fait d’accord avec vous, le freudisme était très
présent dans la
pensée de Benveniste.
I. F. : Je voulais revenir sur la narrativité et le
récit. Benveniste dit, je ne sais plus dans quelle leçon, que les
premiers hommes qui dessinaient dans les cavernes écrivaient, et écrivaient
du récit. Je trouve cela tout à fait intéressant, et je fais le lien avec
ce que dit Pascal Quignard : le récit est premier, mais il ne
passe pas forcément par la syntagmation, par le verbal.
J. K. : Benveniste a posé le
scribe en tant que figure emblématique de l’émergence de l’écriture. Avec
une image ou une image comportant un phonème, cela dépend du type
d’écriture, le scibe l’écriture en tant qu’interprétance de la
langue. Par
ailleurs en développant son concept de « langage intérieur »,
Benveniste semble installer le « scribe » mystique au cœur du
fonctionnement langagier : imprécis, mêlé d’affects et
« imagé », le langage intérieur progressivement « prend
forme », s’organise, « s’écrit »…pour être proféré, énoncé,
communiqué. Le processus spécifique à l’écrivain s’avère être à l’œuvre du
langage intérieur accédant à l’énoncé partageable. Là aussi, la démarche
freudienne vient à l’esprit. Le mal être psychique qui mène l’analysant chez le
psychanalyste, Freud le diagnostique comme une difficulté à symboliser : à
faire accéder les traumas et les angoisses à la…signifiance. Je demande à
l’analysant de s’allonger sur le divan et de
raconter. C’est par le récit de la libre association qu’il va accéder au langage comme créativité. Les premières interventions de l’analyste consistent à
essayer de rendre possible le cours narratif. L’écrivain, d’une autre
façon, se recrée en créant une autre langue qui sera son style, il est notre
scribe laïc dans une civilisation qui a coupé le fil avec la tradition, où
l’autorité religieuse n’est plus chargée de nous
transmettre la vérité du langage. Nous déléguons ce rôle à ceux qui sont capables de s’auto-créer à
travers le récit. Et nous invitent à les répondre dans cette alchimie.
I. F. : Vous avez mentionné la citation de
Lautréamont par laquelle Benveniste termine son texte « L’eau virile » : « Vieil Océan, Ô grand célibataire ! » Avec Jean-Claude Coquet, nous avons repris en exergue
à notre introduction des Dernières leçons une citation de Kierkegaard que Benveniste a recopiée dans
ses notes : « Chaque fois que l’histoire du monde fait un
pas important en avant et poursuit une passe difficile, s’avance une formation
de chevaux de renfort : les hommes célibataires, solitaires, qui ne vivent que
pour une idée
[18]
. » On croit savoir que Benveniste est resté célibataire
toute sa vie… que faite-vous de cela ?
J. K. : Il faudrait consacrer une
étude attentive au texte de Benveniste « L’eau virile ». Il raconte son être de
célibataire, dont
l’objet de désir est l’océan. Que révèle cette métaphore,
étant elle-même une « enveloppe pré-narrative » ? L’océan serait-il le langage en expansion. Un
flot de sens, mais très anthropomorphe, puisque imaginé comme un être
bisexuel : eau (féminin) mais virile (masculin). L’enchainement
métonimico-métaphorique mène à cette femme lituanienne, la mère Marie Benveniste, qui suit tendrement, fermement, amoureusement,
rigoureusement son fils…de loin…et don il doit faire le dénie dans la
séparation au cour même d’une adolescence solitaire. Orphelin, il s’idéalise en
« célibataire », et évoque les plus grands parmi les chantres
océaniques : Homère, Baudelaire, Lautréamont… Est-ce dire que la langue
maternelle, épouse impassible, il en célèbre les infinis mouvements. Sans
s’immerger dans le culte fétichiste du plaisir poétique, mais en se maîtrisant
dans l’austérité de l’ascèse scientifique, une sorte de rigueur ? Quand j’entrais dans son antre de sage, rue
Monticelli, le
logis sentait le vieux parchemin, comme
un temple antique.
J.-C. C. : Est-ce que tu as pu parler avec sa sœur ?
J. K. : Parler, c’est beaucoup dire. Je
l’ai croisée,
échangé quelques mots. Quand je venais chez le Professeur, c’est elle qui préparait le thé (elle n’habitait
pas chez lui, je crois, mais elle s’y rendait souvent). Je l’ai
vue à l’hôpital et c’est elle qui m’a écrit pour me
demander d’aller le voir. J’ai une très belle lettre d’elle. Elle me parlait
simplement de Jean de Menasce
[19]
, un dominicain converti d’origine juive, qui était resté aphasique après une attaque
d’apolplexie, comme son frère, mais qui au contraire était parvenu à continuer
d’écrire.
Chloé Laplantine : J’ai une remarque au sujet de « L’eau virile ». J’ai toujours lu ce
texte comme un texte de recherche de Benveniste, où il tente de voir comment les écrivains travaillent sur le
thème de l’eau, et je suis donc étonnée de la
lecture psychanalytique que vous en faites. Ce texte est paru dans
un numéro de la revue Pierre à feu
[20]
consacré à un peintre, Pierre Marchand, un peintre du sud de la France qui peignait beaucoup la mer.
J. K. : Votre étonnement me conforte beaucoup, un vrai
cadeau. J’essaye de me placer dans la situation de Benveniste à l’époque où il écrit ce texte, 1924. Je me suis beaucoup intéressée à l’histoire
littéraire du surréalisme, incandescents des années vingt aux années quarante. De jeunes intellectuels
révoltés, singuliers, d’origine et de philosophies fort différentes, mais tous
révoltés et habités par le désir d’innover, cherchent à échapper aux normes et
créent des « milieux » dissidents. Poètes, anarchistes, communistes,
trotskystes, juifs…avides de « communautés inavouables », dit plus
tard Blanchot. Rappelez-vous les noms des signataires du Manifeste de 1925.
Tous les créateurs effervescents, universitaires ou artistes, étaient unis par
un intense engagement subjectif : Artaud, Breton, Aragon, Benveniste, Eluard,
Lenoir, Lefebvre, Politzer. C’est par cet engagement qu’ils se trouvaient là,
dissidents, et prêts à frayer des voies risquées. La question surgit don,
absolument, cette question est aucune autre : Que veut dire cette eau
virile, de Rilke à lui, ce garçon de Smyrne, 22 ans, célibataire de sa mère morte
à Samokov, après le feu d’une Première guerre mondiale ? Je ne veux pas
dire que votre question est illégitime, bien sûr que non ! « Comment
les écrivains travaillent sur l’eau ? » - voilà une question,
pourquoi ne pas s’y atteler. Mais ce qui m’intéressait, et m’intéresse
toujours, moi ; c’est : que cherche-t-il, Benveniste, dans cette
« eau virile », lui, et pas « l’écrivain » en soi ?
Voyez-vous, c’est très important, me semble-t-il, quand on est jeune chercheur,
et pas seulement jeune, de choisir « sa question », « sa
problématique ». Le « bon » choix est, selon moi, forcément,
nécessairement subjectif. Mais il va mener à des révélations originales et surtout
partageables, qui éclairent la connaissance générale. Sinon, on refait un
résumé. Au mieux on écrit son roman, sa poésie, on n’élucide pas. J’ai choisi donc cette « entrée en matière »
d’inspiration freudienne, et elle m’a menée à un Benveniste Assoiffé de source
maternelle, ne s’autorisant pas à y pénétrer, mais rigoureux et austère
observateur de ses lois. Comme il n’arrêtait pas de boire à la source de la
Torah, mais du bord de la science positive, avec précaution et respect,
discipliné observateur de l’infini. Sans refoulement, à proximité maximale et
tolérable de cette mémoire sensible.
Ce que je ne vous ai pas dit, c’est
que j’ai tenté
de consulter les archives de son école talmudique, afin d’y trouver témoignage le concernant. La
personne avec laquelle je me suis entretenue m’a reçue n’a rien pu me dire à ce
sujet, si ce n’est que c’était sans doute grâce à sa mère, qui avait des liens
avec la communauté juive ashkénaze à
Paris, qu’Ezra Benveniste a pu approfondir le contact avec Sylvain Levy ou Salomon Reynach. Ce serait donc sa mère qui lui
aurait permis d’accéder à un enseignement laïque
universitaire et d’entrer dans le cercle le plus prestigieux de l’intelligentsia française.
I. F. : Cela entrerait en contradiction avec ce qu’affirme Françoise Bader. Ce serait donc
sa mère qui l’aurait orienté vers l’enseignement
laïque ? Il se serait donc conformé au désir de sa mère ?
J. K. : D’une certaine façon, la métaphore puissante « d’eau virile » pousse à le penser. Aucun document ne le prouve, si
ce n’est la lettre de sa mère qui se plaint de la « situation
intenable » de son fils à l’école rabbinique, et ses possibles liens avec
des intellectuels de renoms. Ce n’est qu’une
hypothèse,
mais elle apparaît plausible : sa mère l’aurait
orienté indirectement
ou directement vers l’université, par l’intermédiaire des Ashkénazes, tandis que son père était séfarade.
I. F. : C’est un point de vue complètement différent
de celui de Françoise Bader, selon laquelle sa mère se serait inquiétée de voir son fils quitter l’école rabinnique.
J. K. : Oui, en effet. Sa mère semble avoir dit que son fils était « en grande souffrance », et pour l’en protéger elle
aurait demandé le soutien des siens. La communauté ashkénaze, voyant que
c’était aussi le désir du fils, accéda à cette requête. De toute façon, les parents de Benveniste appartenaient aux judaïsme de
la Haskala, des Lumières juives. Sa mère enseignait à l’Alliance israélite universelle, sur l’exemple de laquelle
s’est construite l’Alliance française.
Catherine Boré : Je voudrais faire
une remarque qui m’a traversé l’esprit en vous écoutant, quand vous
avez dit que pour Benveniste l’écriture ressemblait beaucoup au langage
intérieur. Je me suis demandé s’il avait
pu avoir connaissance du travail de Vygatzki, car il
y a plusieurs ressemblances : langage non prédicatif, global…
J.-C. C. : Dans les manuscrits, il y a en marge la
mention Vygatzki, donc il l’a lu.
J. K. : Il lisait énormément ;
quand j’entrais chez lui, il fallait naviguer entre des piles de
livres par terre, c’était quasiment impraticable.
[1] Symposium international de sémiotique, Varsovie, 25 août-1er septembre 1968
[2]
Le Jabberwocky est un des poèmes les plus connus de Lewis Carroll. Il apparaît à l'origine
dans Through the Looking-Glass, and What Alice Found There (De l’autre côté du miroir).
[3]
Ibid.
[4]
Lettre du 31 mars 1942, signée
entre autres par Crémieux, Friedmann, Levy-Bruhl, Benveniste, à l’initiative de
Marc Bloch pour attirer l’attention sur la ghettoïsation des Juifs de France.
[5]
PLG – I, p. 78, 1956
[6]
Ibid.
[7]
PLG II, p. 60 sq., et 229.
[8]
PLG II, p. 238.
[9]
Leçon 9.
[10]
Edmund Husserl, Ideen I, § 70, trad . P. Ricoeur, Gallimard, 1971, p. 22
[11]
Emile Benveniste, Baudelaire,
Présentation et transcription par Chloé Laplantine, Limoge, Ed. Lambert-Lucas,
2011.
[12]
Cf. Préface, Dernières Leçons,
p. 31, manuscrits BNF.
[13]
Lettre d’E. Benveniste du 17
octobre 1954 à Georges Redard, in Dernières
Leçons, p. 152.
[14]
Ouaknin m’adressa le 3 novembre
2013 ce texte accompagné d’un plan du temple indiquant précisément la place de
l’arche derrière le rideau, supportée par deux barres.
[15] Lettre du 3 novembre 2013. On retrouvera toutes ces questions de l'érotisme et de la transcendance dans Marc-Alain Ouaknin, Le Livre brûlé, Seuil, «Points Sagesse» n°52, 1993, dans un chapitre intitulé Le visible et l'invisible, érotisme et transcendance, consacré à l'analyse et aux commentaires de ce texte de Yoma 54A. [16] Leçon 2
[17]
Avec l’article « Remarques
sur la fonction du langage dans la découverte freudienne », repri in PLG
I, p. 78 sq., 1956.
[18]
Dernières leçons, p. 41
|
 |
|---|