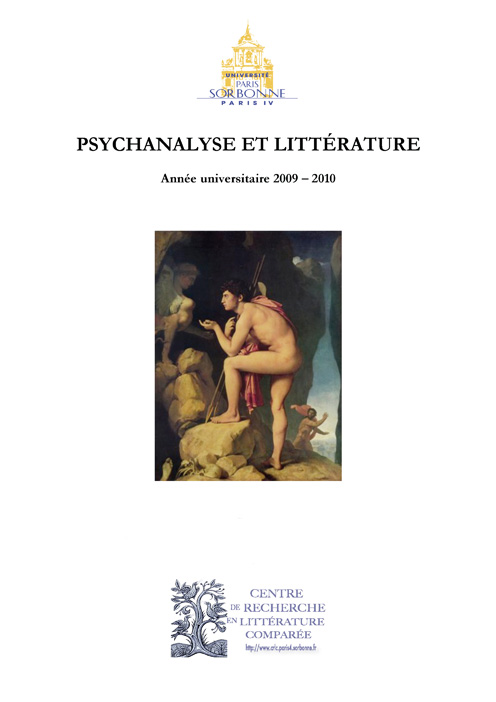Céline : ni comédien ni martyr
par Julia Kristeva
I.
Quelle
psychanalyse ?
Louis Ferdinand
Destouches, dit Céline (1894-1961) ne cesse de
provoquer émotions et indignations. La preuve : la récente publication de
sa correspondance dans la Pléiade. Certains saluent le courage de l’éditeur
Gallimard, et forcément de l’écrivain qui va aux abîmes des humains avec le scalpel du médecin, que
le génie de ce voyageur au bout de la nuit appelait un « opéra du
déluge ». D’autres fustigent ce sacre, dont ne devrait pas être couronné l’auteur
antisémite de Bagatelle pour un massacre.
Beaucoup d’entre vous en ont entendu parler. Peu l’ont lu, ne dites pas le
contraire, je le sais. Si j’ai pris le risque de vous en parler, après avoir
pris le risque d’écrire Pouvoirs de
l’horreur, c’est pour deux raisons essentielles.
D’une part, ces écrits ne sont
pas de la littérature : en jouant sur toutes les cordes de la langue
française, Céline met à nu l’inconscient jusqu’à l’insoutenable, et fait rire
l’être parlant de sa bestialité elle-même. D’autre part et en même temps, son
angoisse fracasse ce garde-fou qu’on
appelle une sublimation et se complaît dans une excitation mortifère à laquelle
l’histoire européenne offre une décharge : l’antisémitisme.
Un corps s’écrit dans les livres de
Céline, traversant la vie et la mort dans une expérience qui le dénude de son identité et le
porte au sommet de son excitabilité et de ses angoisses. Une expérience comme celle qui crée des
mystiques et que les philosophes (de Hegel à Heidegger) essaient d’élucider
après-coup ? A cette différence près, et elle est radicale, que Céline pratique son expérience et nous la livre dans la langue
la plus surveillée qui soit : le français « royal », dit-il. Jusqu’à
le faire vibrer en danse et en musique, et le porter aux limites du sens, ivre
du seul plaisir de la justesse du mot et du rythme, pour en pleurer d’horreur
et de rire. Quelle autre approche que la psychanalyse pourrait se risquer sur cette crête où la pulsion
et les mots se côtoient et s’affrontent pour s’abîmer et se sublimer tandis que
« je » m’effondre ou m’exalte dans une apocalypse sans dieu ?
De surcroît - est-ce la tragédie de la Shoah ?
Est-ce la logique implacable de l’homo
religiosis qui, de saleté en souillure, de tabous lévitiques en péché et codes
moraux, affine ses logiques et ses rites de purification en bord-à-bord avec
ses passions, mais bien souvent y succombe ? - le voyage de Céline au bout de la nuit s’est trouvé un bouc
émissaire : un pôle de fascination et de haine - dans la figure imaginaire
du juif. Quel art, autre que la psychanalyse, peut relever le pari d’éclairer
cette compromission antisémite, et d’en défaire le pathos mortifère ?
La psychanalyse, telle que je l’entends et la pratique, ne peut pas
se dérober à ce nœud de passions intimes et politiques. Si elle s’avance vers
ce carrefour, où la beauté croise le délire et où le goût de la vérité perd le
sens du mal et du meurtre, la psychanalyse ne peut se limiter à
« appliquer » les schémas conceptuels hérités de ses fondateurs, et que
les diverses écoles analytiques enrichissent depuis lors, dans les thérapies
des névroses et des psychoses. Instruite par la clinique, mais confrontée aux
expériences culturelles, la psychanalyse se doit de relever un nouveau défi.
Immergée dans l’histoire sociale, politique, culturelle, le psychanalyste/ la psychanalyste
repèrent la nouveauté passionnelle - ou, en d’autres termes, le nouveau
symptôme, la nouvelle maladie de l’âme -, que lui révèle ce texte, cet auteur, cette crise politique. Ainsi seulement,
il ou elle se donne le moyen d’ausculter la cible psychosexuelle que ce texte,
cet auteur, cette crise politique atteignent chez les contemporains, et au-delà : jusqu’à les faire
vibrer de plaisir (dit esthétique) ou d’indignation (dite morale), quand ce ne
sont pas les deux à la fois.
C’est dire que le/la
psychanalyste n’est pas un/une technicien(e) que le divan et le fauteuil
protègent du monde. Mais qu’il/elle se risque, en prêtant une oreille attentive
à ses patients, bien sûr, mais plus encore en bouleversant le discours de la
critique et de la théorie littéraire : il ne s’agit plus de parler de la littérature, mais de parler à la littérature. Comme je parle à mon analysant dans le transfert/contretransfert,
et jamais de lui ou d’elle. Le Neveu de Rameau de Diderot, dans ce
stupéfiant dialogue entre Moi-Philosophe et Lui-Etrange musicien spasmodique, laissait
imaginer un « homme orchestre ». Le/la psychanalyste qui parle à la littérature
est cet « homme orchestre », amené à conduire un polylogue. Telle est en tout cas mon expérience. Sans cette
polylogique où celui ou celle qui
parle apprivoise la nuit et les abîmes, pour ainsi seulement les interpréter, « psychanalyse et
littérature » ne serait qu’une
discipline de plus, qui peut cumuler les « poubellications », les
grades et les échelons académiques, mais ne participera jamais à cet état d’esprit
qu’on appelle une culture.
Après avoir lu tout Céline et
presque tout sur lui, sans oublier des écrivains estimables qui se sont compromis avec son
antisémitisme, j’avais du mal à penser ensemble Céline l’écrivain et Céline l’idéologue. J’avais acquis
la certitude qu’il n’y avait pas
deux Céline : d’un côté le rigodon des amours, des haines et du
« français langue royale » ; de l’autre le pourfendeur amoureux de « Yubelblat »,
du « fond de sa substance d’ordure », « chié par Moïse »,
que le plus souvent on dissocie. Certains préférant oublier la politique pour
se bercer de joies esthétiques, d’autres exécrant le pamphlétaire au point de
censurer l’écrivain. Dans ma lecture, les deux Céline tenaient ensemble, dans une même dynamique
psychique qui pouvait revêtir des
facettes diverses : des éclats de tendresse, des jets de lumière, comme
des salves de déjection, de pus et de sang, d’appel au meurtre.
C’est alors que, dans une période
dramatique de ma vie personnelle, et après avoir lu Céline tard dans la nuit, je me suis réveillée avec le
mot « abjection ». Et la conviction que ce mot résume l’énigme
Céline.
Je ne suis pas en train de vous dire
que ma lecture (dont je vous donnerai aujourd’hui quelques éléments) constitue
une explication exhaustive de son style, et encore moins de l’horreur
antisémite dans laquelle il s’est compromis en ricanant. Je dis seulement que
cette dynamique psychique, que j’appelle une abjection, s’ajoute aux raisons religieuses, politiques, sociales,
historiques qui, depuis plus de deux millénaires, ont fait du juif l’ennemi
d’élection en Europe. Et aujourd’hui encore, l’ennemi d’élection du monde
musulman, quoique d’une autre
façon sociopolitique, mais en puisant au même réservoir psychique.
Beaucoup de choses ont été dites par
les sociologues et les politologues sur les causes de la tragédie antisémite
qui a conduit à l’Holocauste. Il reste plus encore à dire sur les motivations
religieuses internes aux trois monothéismes, qui attisent cette violence fratricide. L’analyste, comme toujours à partir
d’un discours singulier (ici : Céline), ne peut y ajouter qu’un
éclairage complémentaire : un coup de sonde visant ce lieu psychique
pourtant redoutable et cependant exquis, où l’être parlant tout à la fois perd
et construit son identité. Ni sujet ni
objet, un abjet/abject. Ni toi ni moi, tous abjects, mais toi davantage que
quiconque. Qui, toi ? Toi - mon autre : mon Moi abject que je
projette en Toi confondu avec mon abjection, la notre-la tienne.
Ainsi comprise, l’abjection a une longue vie devant elle : parce qu’elle habite
les plis entre langage et pulsion, là où les identités vacillent, elle peut aussi bien commander la création imaginaire, que fomenter toutes
ces confrontations à autrui où dominent le pouvoir de l’horreur, la fascination
et le dégoût, l’antisémitisme et le racisme durables et à venir.
J’entends votre objection : en expliquant l’imaginaire et l’horreur
fascinée par et pour l’autre, en les comprenant,
l’abjection ne risque-t-elle pas de les
innocenter ? L’abjection n’explique ni l’imaginaire ni l’antisémitisme.
L’abjection dit : ça vous excite ? ça vous fait rire ? ça vous
brûle ? Alors, méfiez-vous. Soyez vigilants, lucides. Interprétez !
Pensez !
II. Pourquoi ce
pouvoir de l’horreur ? Approche psychanalytique.
Pas de bête qui n'ait un reflet
d'infini;
Pas de prunelle abjecte et vile
qui ne touche
L'éclair d'en haut, parfois tendre
et parfois farouche
Victor Hugo,
La
Légende des siècles.
Ni sujet ni objet
Il y a, dans
l'abjection, une de ces violentes et obscures révoltes de l'être contre ce qui
le menace et qui lui paraît venir d'un dehors ou d'un dedans exorbitant, jeté à
côté du possible, du tolérable, du pensable. C'est là, tout près mais
inassimilable. Ça sollicite, inquiète, fascine le désir qui pourtant ne se
laisse pas séduire. Apeuré, il se détourne. Écœuré, il rejette. Un absolu le
protège de l'opprobre, il en est fier, il y tient. Mais en même temps, quand
même, cet élan, ce spasme, ce saut, est attiré vers un ailleurs aussi tentant
que condamné. Inlassablement, comme un boomerang indomptable, un pôle d'appel
et de répulsion met celui qui en est habité littéralement hors de lui.
Quand je suis
envahie par l'abjection, cette torsade faite d'affects et de pensées que
j'appelle ainsi n'a pas à proprement parler d'objet définissable.
L'abject n'est pas un ob-jet en face de moi, que je nomme ou que j'imagine. Il
n'est pas non plus cet ob-jeu, petit « a » fuyant indéfiniment dans la
quête systématique du désir. L'abject n'est pas mon corrélat qui, m'offrant un
appui sur quelqu'un ou quelque chose d'autre, me permettrait d'être, plus ou
moins détachée et autonome. De l'objet, l'abject n'a qu'une qualité - celle de
s'opposer à je. Mais si l'objet, en s'opposant, m'équilibre dans la
trame fragile d'un désir de sens qui, en fait, m'homologue indéfiniment,
infiniment à lui, l'abject au contraire, objet chu, est radicalement un exclu et me tire là où le sens s'effondre : dans l’affect (quantité
énergétique mouvante et tonalité
subjective). Un certain « moi» affectif qui s'est fondu avec son maître, un
sur-moi affectif a carrément chassé l’objet de désir. L’abject est dehors, hors de l'ensemble dont il semble ne pas
reconnaître les règles du jeu : hors jeu. Pourtant, de cet exil, l'abject
ne cesse de me défier ainsi que son maître. Sans (lui) faire signe, il
sollicite une décharge, une convulsion, un cri : de peur, de haine, de fascination
mêlées – c’est l’abjection. A
chaque moi son objet, à chaque surmoi son abject.
Ce n'est pas la
nappe blanche ou l'ennui étale du refoulement, ce ne sont pas les versions et
conversions du désir qui tiraillent les corps, les nuits, les discours. Mais
une souffrance brutale dont «je» s'accommode, sublime et ravagé, car « je » la
verse au père (père-version ?) : je la supporte car j'imagine que tel est le
désir de l'autre et de l’Autre. Surgissement massif et abrupt d'une étrangeté
qui, si elle a pu m'être familière dans une vie opaque et oubliée, me harcèle à
présent comme radicalement séparée, répugnante. Pas moi. Pas ça. Mais pas rien
non plus. Un « quelque chose - que je ne reconnais pas comme chose. Un poids de
non-sens qui n'a rien d'insignifiant et qui m'écrase. A la lisière de
l'inexistence et de l'hallucination, dont la réalité qui, si je la reconnais,
m'annihile, l'abject et l'abjection sont
là mes garde-fous. Amorces de ma culture.
Exemples ?
L'impropre
Dégoût d'une
nourriture, d'une saleté, d'un déchet, d'une ordure. Spasmes et vomissements
qui me protègent. Répulsion, haut-le-cœur qui m'écarte et me détourne de la
souillure, du cloaque, de l'immonde. Ignominie de la compromission, de
l'entre-deux, de la traîtrise. Sursaut fasciné qui m'y conduit et m'en sépare.
Le dégoût
alimentaire est peut-être la forme la plus élémentaire et la plus archaïque de
l'abjection. Lorsque cette peau à la surface du lait, inoffensive, mince comme
une feuille de papier à cigarettes, minable comme une rognure d'ongles, se
présente à mes yeux ou touche mes lèvres, un spasme de la glotte et plus bas
encore, de l'estomac, du ventre, de tous les viscères, crispe le corps, presse
les larmes et la bile, fait battre le cœur, perler le front et les mains. Avec
le vertige qui brouille le regard, la nausée me cambre, contre cette
crème de lait, et me sépare de la mère, du père qui me la présente. De cet
élément, signe de leur désir, « je » n'en veux pas. « Je » n’en veux rien
savoir, « je» ne l'assimile pas, «je» l'expulse. Mais puisque cette nourriture
n'est pas un « autre» pour « moi» qui ne suis que dans leur désir, je m'expulse, je me crache, je
m'abjecte dans le même mouvement par lequel « je » prétends me poser. Ce
détail, insignifiant peut-être, mais qu'ils cherchent, chargent, apprécient,
m'imposent, ce rien me retourne comme un
gant, les tripes à l'air: ainsi ils voient, eux, que je suis en train de devenir un autre au prix de ma propre mort. Dans
ce trajet où « je » deviens, j'accouche de moi dans la violence du sanglot, du
vomi. Protestation muette du symptôme, violence fracassante d'une convulsion,
inscrite certes en un univers symbolique (ma famille), mais dans lequel, sans
vouloir ni pouvoir s'intégrer pour y répondre, ça réagit, ça abréagit. Ça
abjecte.
Le cadavre (de cadere, tomber), ce qui a
irrémédiablement chuté, cloaque et mort, bouleverse plus violemment encore
l'identité de celui qui s'y confronte. Une plaie de sang et de pus, ou l’odeur
doucereuse et âcre d’une sueur, d’une putréfaction, ne signifient pas la mort.
Devant la mort signifiée – par exemple un encéphalogramme plat – je
comprendrais, je réagirais ou j’accepterais. Non, tel un théâtre vrai, sans
fard et sans masque, le déchet comme le cadavre m'indiquent ce que
j'écarte en permanence pour vivre. Ces humeurs, cette souillure, cette merde
sont ce que la vie supporte à peine et avec peine de la mort. J’y suis aux
limites de ma condition de vivant. Le cadavre – vu sans Dieu et hors de
la science – est le comble de l’abjection. Il est la mort infestant la
vie. Abject. Il est un rejeté dont on ne se spare pas, dont on ne se portège
pas ainsi que d’un objet. Etrangeté imaginaire et menace réelle, il nous
appelle et finit par nous engloutir.
Ce n'est pas
l'absence de propreté ou de santé qui rend abject, mais ce qui perturbe une identité, un système, un ordre. Ce qui ne
respecte pas les limites, les places, les règles. L'entre-deux, l'ambigu, le
mixte. Celui qui refuse la morale n'est pas abject - il peut y avoir de la
grandeur dans l'amorale, et même dans un crime qui affiche son irrespect de la
loi, révolté, libérateur et suicidaire. L'abjection, elle, est immorale,
ténébreuse, louvoyante et louche : une terreur qui se dissimule, une haine qui
sourit, une passion pour un corps lorsqu'elle le troque au lieu de l'embraser,
un endetté qui vous vend, un ami qui vous poignarde.
Dans les salles
obscures de ce musée qui reste maintenant d'Auschwitz, je vois un tas de
chaussures d'enfants, ou quelque chose comme ça que j'ai déjà vu ailleurs, sous
un arbre de Noël, par exemple, des poupées je crois. L'abjection du crime nazi touche à son apogée lorsque la mort qui, de
toute façon, me tue, se mêle à ce qui, dans mon univers vivant, est censé me
sauver de la mort : à l'enfance, à la science, entre autres.
L'abjection de
soi
S'il est vrai que
l'abject tout à la fois sollicite et pulvérise le sujet, on comprend qu'il
s'éprouve dans sa force maximale lorsqu'il trouve que l'impossible, c'est son être même, découvrant qu'il n'est autre qu'abject. L'abjection de soi
serait la forme culminante de cette expérience du sujet auquel est dévoilé que
tous ses objets ne reposent que sur la perte inaugurale fondant son être
propre. Rien de tel que l'abjection de soi pour démontrer que toute abjection
est en fait reconnaissance du manque fondateur de tout être, sens,
langage, désir.
On glisse toujours
trop vite sur ce mot de manque, et la psychanalyse aujourd'hui n'en retient en
somme que le produit plus ou moins fétiche, 1'« objet du manque ». Mais si l'on
imagine (et il s'agit bien d'imaginer,
car c'est le travail de l'imagination qui est ici fondé), l'expérience du manque lui-même comme logiquement préalable à l'être et à l'objet - à l'être de
l'objet -, alors on comprend que le seul signifié du manque est l'abjection, et à plus forte raison
l'abjection de soi. Son signifiant étant... la littérature. La chrétienté mystique a fait de cette
abjection de soi la preuve ultime de l'humilité devant Dieu, comme en témoigne
cette sainte Elisabeth, qui « toute grande princesse qu'elle estoit, aimait sur
tout l'abjection de soy-mesme ».
Essentiellement
différente de « l'inquiétante étrangeté», plus violente aussi, l'abjection se
construit de ne pas reconnaître ses
proches: rien ne lui est familier, pas même une ombre de souvenirs.
J'imagine un enfant ayant avalé trop tôt ses parents, qui s'en fait « tout
seul » peur et, pour se sauver, rejette et vomit ce qu'on lui donne, tous
les dons, les objets. Il a, il pourrait
avoir, le sens de l'abject. Avant même que les choses, pour lui, soient -
avant donc qu'elles soient signifiables -, il les ex-pulse, dominé par la
pulsion, et se fait son territoire à lui, bordé d'abject. Figure sacrée. La peur cimente son enclos mitoyen d'un
autre monde, vomi, expulsé, déchu. Ce qu'il a avalé à la place de l'amour
maternel est un vide, ou plutôt d'une haine maternelle sans parole pour la
parole du père ; c'est de ça qu'il essaie de se purger, inlassablement. Quel
réconfort rencontre-t-il dans ce dégoût ?
Peut être un père,
existant mais ébranlé, aimant mais instable, simple revenant mais revenant
permanent : la parole du père plutôt que sa loi ou sa présence est cette bouée de sauvetage
qui le protège de sombrer dans le délire ou le suicide. Sans cette introjection précoce de la parole (du
Verbe), l’enfant sacré n'aurait probablement aucun sens du sacré; sujet nul, il
se confondrait au dépotoir des non objets toujours chus dont il essaie, au
contraire, armé d'abjection, de se sauver.
Car il n'est pas fou, celui par qui l'abject existe. De la
torpeur qui l'a gelé devant le corps intouchable, impossible, absent de la
mère, cette torpeur qui a coupé ses élans de leurs objets, c'est-à-dire de
leurs représentations, de cette torpeur, dis-je, il fait advenir, avec le
dégoût, un mot - la peur. Le phobique n'a d'autre objet que
l'abject. Mais ce mot « peur» - brume fluide, moiteur insaisissable -, à
peine advenu s'estompe comme un mirage et imprègne d'inexistence, de lueurs
hallucinatoires et fantomatiques, tous les mots du langage. Ainsi, la peur mise
entre parenthèses, le discours ne paraîtra soutenable qu'à la condition de se
confronter sans cesse à cet ailleurs, poids repoussant et repoussé, fond de
mémoire inaccessible et intime: entre-deux plutôt que frontière l'abject.
Par-delà
l'inconscient
Il y a des
existences qui ne se soutiennent pas d'un désir, le désir étant toujours
d'objets. Ces existences-là se fondent sur l'exclusion. Elles se
distinguent nettement de celles entendues comme névroses ou psychoses, et qu'articulent
la négation et ses modalités, la transgression, la dénégation et
la forclusion. Leur dynamique met en question la théorie de
l'inconscient, dès lors que celle-ci est tributaire d'une dialectique de la
négativité.
La théorie de
l'inconscient suppose, on le sait, un refoulement de contenus (pulsions,
peut-être affects et représentations) qui, de ce fait, n'accèdent pas à la
conscience, mais opèrent chez le sujet des modifications soit du discours
(lapsus, etc.), soit du corps (symptômes), soit des deux (hallucinations,
etc.). Corrélativement à la notion de refoulement, Freud a proposé celle
de dénégation pour penser la névrose, et de rejet (forclusion) pour
situer la psychose. L'asymétrie des deux refoulements s'accentue du fait que la dénégation porte sur l'objet tandis que
la forclusion affecte le désir lui-même (ce que Lacan, dans la droite ligne
de Freud, interprète en «forclusion du Nom du Père »).
Pourtant, face à
l'ab-ject et plus spécifiquement à la phobie et au clivage du moi, on peut se
demander si ces articulations de la négativité propre à l'inconscient (héritées
par Freud de la philosophie et de la psychologie) ne sont pas caduques. Avec
l’abject, les contenus «inconscients » demeurent exclus, mais d'une
manière étrange : pas assez radicalement
pour permettre la différenciation solide sujet/objet, et néanmoins avec une
netteté suffisante pour qu'une position de défense, de refus mais aussi d'élaboration sublimatoire puisse avoir
lieu. Comme si l'opposition fondamentale était, ici, entre Je et Autre, ou, plus archaïquement encore, entre Dedans et
Dehors. Comme si cette opposition subsumait celle, élaborée à partir des
névroses, entre Conscient et Inconscient.
Du fait de
l'opposition ambiguë Je/Autre, Dedans/Dehors opposition vigoureuse mais
perméable, violente mais incertaine -, des contenus «normalement » inconscients
chez les névrosés, deviennent donc explicites sinon conscients (et encore moins
« raisonnés ») dans des discours et des comportements «limites» (borderlines). L’inconscient des névrosés est
ici affranchi du refoulement, ce qui ne veut pas dire que celui (celle) qui en
est le théâtre en assume la responsabilité consciente. Ces contenus abjects se
manifestent souvent ouvertement dans des pratiques symboliques, sans pour
autant s'intégrer à la conscience jugeante des sujets en question. Parce qu'ils
rendent impertinente l'opposition conscient/inconscient, ces « sujets »
et leurs objets sont les terrains propices d'une discursivité sublimatoire
(« esthétique» ou «mystique », etc.) plutôt que scientifique ou rationaliste.
Un exilé qui dit : « Où ? »
Celui par lequel
l'abject existe divise, exclut et, sans à
proprement parler vouloir connaître ses abjections, ne les ignore nullement. Souvent d'ailleurs il s'y inclut, jetant ainsi à l'intérieur de soi le scalpel
qui opère ses séparations.
Au lieu de
s'interroger sur son «être », il s'interroge sur sa place : « Où suis-je?
» plutôt que « Qui suis-je? ». Car l'espace qui préoccupe le jeté, l'exclu, n'est
jamais un. Ni homogène, ni totalisable. Mais
essentiellement divisible, pliable, catastrophique. Constructeur de
territoires, de langues, d'œuvres, le jeté n'arrête pas de délimiter son
univers dont les confins fluides -
parce que constitués par un non objet, l'abject - remettent constamment en
cause sa solidité et le poussent à recommencer. Bâtisseur infatigable, le
jeté est en somme un égaré. Un
voyageur dans une nuit à bout fuyant. Il a le sens du danger, de la perte que
représente le pseudo objet qui l'attire, mais ne peut s'empêcher de s'y risquer
au moment même où il s'en démarque. Et plus il s'égare, plus il se sauve: en fuyant, en se fuyant, insaisissable
« identité ».
Jouissance
Frontière sans doute mais perméable, l'abjection est surtout ambiguïté. Parce que, tout en démarquant, elle ne détache pas
radicalement le sujet de ce qui le menace - au contraire, elle l'avoue en perpétuel danger. Mais aussi parce que l'abjection
elle-même est un mixte de jugement et
d'affect, de condamnation et d'effusion, de signes et de pulsions.
A la limite du refoulement originaire
A cette limite, et à
la limite, on pourrait dire qu'il n'y a
pas d'inconscient, lequel se
construit lorsque des représentations et des affects (liés ou non à elles)
forment une logique. Ici, au contraire, la conscience n'use pas de ses droits pour
transformer en signifiants les démarcations fluides des territoires encore
instables où un « je» en formation
n'arrête pas de s'égarer. Nous ne
sommes plus dans l'orbe de l'inconscient mais à cette limite du refoulement originaire qui a trouvé néanmoins une marque
intrinsèquement corporelle et déjà signifiante, symptôme et signe : la
répugnance, l'écœurement, l'abjection.
Prémisses du
signe, doublure du sublime
Arrêtons-nous un peu à ce moment. Si l'abject est
déjà une amorce de signe pour un non objet, aux lisières du refoulement
originaire, on comprend qu'il côtoie d'une part le symptôme somatique, de
l'autre la sublimation.
Le symptôme : le
« langage », déclarant forfait, structure dans le corps un étranger
inassimilable, monstre, tumeur et cancer, que les écouteurs de l'inconscient
n'entendent pas, car c'est en dehors des sentiers du désir que se blottit son
sujet égaré.
La sublimation, au
contraire, n'est rien d'autre que la possibilité de nommer le prénominal, le
préobjectal, qui ne sont en fait qu'un transnominal, un transobjectal. Dans le symptôme, l'abject m'envahit, je le
deviens. Par la sublimation, je le tiens et l’épure en cherchant ses mots, ses
sons, ses couleurs. L'abject est bordé de sublime. Ce n'est pas le même
moment du parcours, mais c'est le même sujet et le même discours qui les font
exister.
Car le sublime, lui
non plus, n'a pas d'objet. Quand le ciel étoilé, tel espace marin ou tel
vitrail de rayons violets me fascinent, c'est un faisceau de sens, de couleurs,
de mots, de caresses, ce sont des frôlements, des odeurs, des soupirs, des
cadences qui surgissent, m'enveloppent, m'enlèvent et me balaient au-delà des
choses que je vois, entends ou pense. L'objet sublime se dissout dans les
transports d'une mémoire sans fond. Non pas en deçà mais toujours avec et à
travers la perception et les mots, le sublime est un en plus qui nous
enfle, qui nous excède et nous fait être à la fois ici, jetés, et là, autres et éclatants. Écart, clôture impossible, Tout manqué, joie :
fascination.
Avant le
commencement: la séparation
L'abject peut
apparaître alors comme la sublimation la plus fragile (d'un point de vue synchronique), la plus archaïque (d'un point de vue
diachronique) d'un « objet» encore inséparable des pulsions. L'abject est ce
pseudo objet qui se constitue avant, mais
qui n'apparaît que dans les
brèches du refoulement secondaire. L'abject serait donc l' « l'objet» du
refoulement originaire.
L'abject nous
confronte, d'une part, à ces états fragiles où l'homme erre dans les territoires
menaçant de l'animal ou de l'animalité, imaginés comme des représentants du
meurtre et du sexe.
L'abject nous
confronte, d'autre part, et cette fois dans notre archéologie personnelle, à
nos tentatives les plus anciennes de nous démarquer de l'entité maternelle avant
même que d'ex-ister en dehors d'elle grâce à l'autonomie du langage. Démarquage
violent et maladroit, toujours guetté par la rechute dans la dépendance d'un
pouvoir aussi sécurisant qu'étouffant. Dans cette guerre qui façonne l'être humain,
le mimétisme, par lequel il s'homologue à un autre pour devenir
lui-même, est en somme logiquement et chronologiquement secondaire. Avant
d'être comme, «je» ne suis pas, mais sépare, rejette, abjecte. L'abjection, en un sens élargi à la
diachronie subjective, est une précondition
du narcissisme. Elle lui est coexistensive et le fragilise en
permanence.
La chora,
réceptacle du narcissisme
Entrons un instant
dans cette aporie freudienne dite du refoulement originaire. Curieuse origine,
où ce qui est refoulé ne tient pas vraiment en place, et où ce qui refoule
emprunte toujours déjà sa force et son autorité à ce qui est apparemment très
secondaire : le langage. C'est la pulsion qui, ici, règne pour constituer un
étrange espace que nous nommerons, avec Platon (le Timée, 48-53), une chora, un réceptacle.
L'objet - parure de l'angoisse. Le petit Hans et la
théorie de l’objet dans la phobie
Lorsque la
psychanalyse parle d'objet, elle parle de l'objet du désir tel qu'il se
construit dans le triangle œdipien. Selon cette figure, le père est le support
de la loi et la mère le prototype de l'objet. C'est vers la mère que convergent
non seulement les besoins pour la survie, mais surtout les premières
aspirations mimétiques. Elle est l'autre sujet, un objet qui garantit mon être
de sujet. La mère est mon premier objet désirant et signifiable.
Aussitôt esquissée,
cette thèse vole en éclats sous ses contradictions et sa fragilité.
N'y a-t-il pas, avant (chronologiquement et logiquement parlant), sinon des objets du moins des préobjets, des pôles d'attraction pour la demande d'air, de nourriture, de mouvement ?
N'y a-t-il pas aussi, et dans le procès de constitution de la mère comme autre,
une série de semi objets qui jalonnent la transition entre un état d'indifférenciation
et un état de discrétion (sujet/ objet) : ces objets dits précisément «
transitionnels» par Winnicott ? N'y a-t-il pas enfin toute une gradation dans
les modalités de séparation : privation réelle du sein, frustration imaginaire
du don comme relation maternelle, castration symbolique inscrite dans
l'Œdipe pour finir? Une gradation qui constitue, comme Lacan l'a brillamment
formulé, la relation d'objet en tant qu'elle est toujours « instrument à
masquer, à parer le fond fondamental d'angoisse» (Séminaire, 1956-1957) ?
La question de
l'objet met en branle, ou en cause, toute la construction freudienne. Le
narcissisme : à partir de quoi, ou de quand, celui-ci se laisse-t-il
déborder par la pulsion sexuelle qui est la pulsion vers l'autre ? Le refoulement
: quel type de refoulement produit une symbolisation et donc un objet
signifiable, et quel autre, au contraire, barre la voie à la symbolisation et
fait basculer la pulsion dans le sans objet de l'asymbolie, ou dans l'auto objet
de la somatisation? Le rapport entre l'inconscient et le langage : quelle
est la part de l'acquisition du langage ou de l'activité langagière dans la
constitution et dans les avatars de la relation d'objet ?
C'est au sujet de la
phobie du petit Hans que Freud aborde avec le plus de clarté cette question
cruciale pour la constitution du sujet qu'est la relation à l'objet. Peur et
objet se voient d'emblée associés.
Métaphore du manque en tant que tel, la phobie
porte la trace de la fragilité du système signifiant du sujet. Il faut bien voir que ce n'est pas en rhétorique
verbale que s'écrit cette métaphore, mais dans l'hétérogénéité du système psychique fait de représentants
pulsionnels et de représentations de choses liées aux représentations
verbales : Hans apeuré de ses désirs qui ne résistent pas à la séparation, hallucine des choses et des mots à
connotations aussi dégoûtantes que désirables (le cheval, etc.). Quand une phobie se constitue à l'aide de
pensées inconscientes, une condensation a lieu, et c'est pourquoi le cours
d'une analyse ne peut jamais suivre celui du développement d'une névrose.
L'écriture, l'art en
général, serait alors le seul, non pas traitement, mais « savoir-faire » avec
la phobie. Le petit Hans est devenu metteur en scène d'opéra.
La phobie ne disparaît pas mais glisse
sous la langue, l'objet phobique est une
proto écriture et, inversement, tout exercice de la parole, pour autant
qu'il est de l'écriture, est un langage de la peur. Je veux dire un langage du
manque tel quel, ce manque qui met en place le signe, le sujet et l'objet. Non pas de l'échange désirant de messages ou d'objets qu'on se transmet dans
un contrat social de communication et de désir au-delà du manque. Mais langage
du manque, de la peur qui l'aborde et le
borde.
« J'ai peur
d'être mordu » ou « j'ai peur de mordre»?
Pourtant la peur ne
voile-t-elle pas une agression, une violence qui revient à sa source avec son
signe inversé ? Qu'est-ce qui était au début : le manque, la privation, la peur originaire, ou bien la
violence du rejet, l'agressivité, la pulsion mortelle de mort ? Disons alors
que manque et agressivité sont chronologiquement séparables mais
logiquement coextensifs. L'agressivité nous apparaît comme une réplique
à la privation originaire, éprouvée depuis le mirage dit « narcissisme
primaire»; elle ne fait que se venger des frustrations initiales. Melanie Klein
est allée plus loin que Freud dans cette direction.
III. Le récit selon Louis-Ferdinand Céline
« On est puceau de
l'Horreur comme
on est puceau
de la Volupté. »
Voyage
au bout de la nuit
Céline
Quels rapports entre l’abjection et le récit de Céline ? Je vous
invite à relire Pouvoirs de l’horreur (éditions du Seuil, 1983), et en
particulier ma lecture de Céline, de ses thèmes, de ses figures, de son style.
Je me borne ici à quelques thèmes.
Le récit - cache de la douleur
« Au commencement
était l'émotion... », répète souvent Céline, dans ses écrits et ses entretiens.
A le lire, on a l'impression qu'au commencement était le malaise.
La douleur comme
lieu du sujet. Là où il advient, où il se différencie du chaos. Limite
incandescente, insupportable entre dedans et dehors, moi et autre. Saisie
première, fugace : « douleur », « peur », mots ultimes visant cette crête où le
sens bascule dans les sens, l'« intime » dans « les nerfs». L'être comme
mal-être.
Le récit célinien
est un récit de la douleur et de l'horreur non seulement parce que les « thèmes
» y sont, tels quels, mais parce que
toute la position narrative semble commandée par la nécessité de traverser l'abjection dont la douleur est le côté
intime, et l'horreur le visage public.
On commence à le
savoir après tant de « formalisme russe », mais aussi après tant de biographies
confiées sur le divan : un récit est
en somme la tentative la plus élaborée, après
la compétence syntaxique, de situer un être parlant entre ses désirs et
leurs interdits, bref à l'intérieur du triangle œdipien.
Mais il a fallu attendre
la littérature « abjecte» du XXe siècle (celle qui prend la relève de l'apocalypse et du
carnaval) pour entendre que la trame narrative est une mince pellicule
constamment menacée d'éclatement. Car,
lorsque l'identité narrée est intenable, lorsque la frontière sujet/objet est ébranlée
et que même la limite entre dedans et dehors devient incertaine, le récit est
le premier interpellé. S'il continue néanmoins, il change de facture : sa
linéarité se brise, il procède par éclats, énigmes, raccourcis, inachèvements,
enchevêtrements, coupures. A un stade ultérieur, l'identité intenable du narrateur
et du milieu censé le soutenir ne se narre plus, mais se crie ou
se décrit avec une intensité stylistique maximale (langage de la
violence, de l'obscénité, ou d'une rhétorique qui apparente le texte à la
poésie). Le récit cède devant un thème-cri qui, lorsqu'il tend à
coïncider avec les états incandescents d'une subjectivité-limite que nous avons
appelée abjection, est le thème-cri de la douleur-de l'horreur. En d'autres
termes, le thème de la douleur de
l'horreur est l'ultime témoignage de ces états d'abjection à l'intérieur d'une
représentation narrative. Voudrait-on aller plus loin encore aux abords de
l'abjection, on ne trouverait ni récit ni thème, mais le remaniement de la
syntaxe et du lexique - violence de la poésie, et silence.
« De la
pourriture en suspens ... »
Tout est déjà dans
le Voyage: la douleur, l'horreur, la mort, le sarcasme complice,
l'abjection, la peur. Et ce gouffre où parle une étrange déchirure entre un moi
et un autre - entre rien et tout. Deux extrêmes qui changent
d'ailleurs de place, Bardamu et Arthur, et attribuent un corps douloureux à
cette synthèse interminable, ce voyage sans fin : un récit entre apocalypse et
carnaval :
« Ça a commencé comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit. Rien. C'est
Arthur Ganate qui m'a fait parler. »
« J'avais tout, pour
moi tout seul, ce soir-là. J'étais propriétaire enfin, de la lune, du village,
d'une peur énorme. »
« C'est
des hommes et d'eux seulement qu'il faut avoir peur, toujours. »
« Dans
aucune d'elles (les lettres du général au colonel) il n'y avait donc l'ordre
d'arrêter net cette abomination ? On ne lui disait donc pas d'en haut qu'il y avait
méprise ? Abominable erreur
? »
Ce sont évidemment
les atrocités de la guerre qui sont données comme cause réelle de cette peur. Mais sa permanence violente,
quasi mystique, l'élève de la conjoncture politique et même sociale (où elle
serait due à l'oppression) à un autre niveau : la peur devient indice d'humanité, c'est dire qu’elle
est un appel d'amour.
« Faut
pas croire que c'est facile de s'endormir une fois qu'on s'est mis à douter de
tout, à cause surtout de tant de peurs qu'on vous a faites.
... tu finiras sûrement par le trouver le truc qui
leur fait si peur à eux tous, à tous ces salauds-là autant
qu'ils sont, et qui doit être au bout de la nuit.
« Un
exceptionnel sentiment de confiance qui, chez les êtres apeurés,
tient lieu d'amour ... »
Et aussi:
« On
ne soigne pas la peur, Lola. »
« La meilleure des choses à faire, n'est-ce
pas, quand on est dans le monde, c'est d'en sortir? Fou ou pas, peur ou
pas. »
Ou cette mère qui
n'est que chagrin bourré de peur:
« ... il lui faisait comme peur ce
chagrin; il était comblé de choses redoutables qu'elle ne comprenait
pas. »
Et cette définition,
enfin, attendue, de l'art désuet, celui dont Céline se sépare pour dire, lui,
la vérité de l'art comme peur inavouée:
« Le bonheur sur terre ça serait de mourir avec plaisir dans du plaisir ... Le reste
c'est rien du tout, c'est de la peur qu'on n'ose pas avouer, c'est de l'art. »
Au commencement
était une guerre qui me fait être dans la peur. Dans cet état originel,
« je » suis faible, apeuré face à de redoutables menaces. Se défendre
? Par décapage uniquement, par réduction non pas transcendantale mais mystique.
Mystique : mot que Céline emploie (le voyage dans le corps de Lola est une aventure « mystiquement
anatomique » ; « leurs actions (des hommes qu'on redoute) ne vous ont
plus ce sale attrait mystique qui vous affaiblit et vous fait perdre du
temps ». Ça consiste à ne
camper aucun « au-delà » mais toujours deux termes, face à face, l'un
et l'autre se jugeant, à tour de rôle, et se réduisant pour finir tous deux, à
la même abjection. Le bas d'un côté; le discours que je tiens et qui me tient,
de l'autre. La nature, le corps, le dedans. Face à l'esprit, aux autres, aux
apparences. La vérité étant du côté bas : côté nu, sans fard, sans semblant,
pourri et mort, malaise et maladie, horreur.
« La
vérité de ce monde, c'est la mort.
... elle [sa
mère] demeurait cependant inférieure à la
chienne parce qu'elle croyait aux mots qu'on lui disait pour m'enlever. La
chienne au moins, ne croit que ce qu'elle sent,
Tout nu, il ne reste plus devant vous en somme
qu'une pauvre besace prétentieuse et vantarde qui s'évertue à bafouiller futilement dans un genre ou dans un autre.
Ç'avait beau être la
nature, elle me trouvait aussi dégoûtant que la nature, et ça
l'insultait. »
Et ceci, à propos
d'un écrivain
« Un
homme, parent ou pas, ce n'est rien après tout que de la pourriture en suspens. »
Ce qui la fait
pourtant exister, cette vérité de l'horreur et de la maladie, de la faiblesse
et de la déchéance, c'est sa confrontation avec l'autre terme - le puissant, le
riche, le redouté : « On est deux. »
« Mais quand on est faible ce qui donne de la
force, c'est de dépouiller les hommes qu'on redoute le plus du moindre prestige
qu'on a encore tendance à leur prêter. Il faut s'apprendre à les considérer
tels qu'ils sont, pires qu'ils sont, c'est-à-dire à tous les points de vue, Ça
dégage, ça vous affranchit et vous défend au-delà de tout ce qu'on peut
imaginer. Ça vous donne un autre vous-même. On est deux. »
Pourtant, dans ce
fascinant face-à-face d'une guerre sans merci, les deux se retrouvent du même
côté, unis dans l'abomination ;
alors, le langage vire à la bave, la conversation à la défécation, et c'est le
bout de la nuit.
« Quand on s'arrête à la façon par exemple
dont sont formés et proférés les mots, elles ne résistent guère nos phrases au
désastre de leur décor baveux. C'est plus compliqué et plus pénible que la
défécation notre effort mécanique de la conversation. »
N'y a-t-il, en
raison de ce signe égal entre le haut et le bas, entre le même et l'autre,
aucune solution, aucun salut ? L'univers célinien se donne, malgré tout, par
intermittence et maintenu dans la dérision attendrie, un dehors. Un pôle de sublimation, mais provisoire.
Pas encore un foyer (le foyer, ce sera le juif).
Ce dehors, ce pôle d’abjection, ce sont parfois les femmes qui, elles,
n'éprouvent pas la répulsion, mais l'imaginent seulement, peut-être. Une autre
solution apparaît quelquefois - impossible, condamnée, et non moins vétuste -
qui consisterait à s'en tenir à l'Idée,
une seule idée garante et contrepoids de l'abjection envahissante. Et enfin, la
voie que Céline choisit pour lui-même: se tenir dans l'horreur mais à une toute
petite distance, infinitésimale et
immense, qui, du cœur même de l'abomination essentielle pour Céline, distingue
et inscrit : c’est l'amour sublime pour
un enfant, ou dans un au-delà de la sexualité et analogue à elle, l'écriture sublimation.
1.
Le bord : les
femmes, ou la courtoisie insultée
Le prototype de
l’abject, pas selon la freudienne que je suis, mais selon Céline, c’est la
femme, forcément femme-mère. Ecoutez : « Ces
femelles qui vous gâchent l’infini… « Elles sont rares les femmes qui ne
sont pas vaches ou bonniches alors elles sont sorcières ou fées. » (Mort à
crédit). « les femmes, ça décline à la cire, ça se gâte, fond, coule,
boudine, suinte sous soi. […] C’est
horrible la fin des cierges, des dames aussi.» (Féerie pour une autre fois)
« Les femmes ont des natures de domestiques.
Mais elle imagine peut-être seulement la répulsion, plus qu'elle ne l'éprouve;
c'est l'espèce de consolation qui me demeure. Je lui suggère peut-être
seulement que je suis immonde. Je suis peut-être un artiste dans ce genre-là. »
2.
L'Unité
salvatrice : une idée dérisoire et impossible
« Les miennes d'idées, elles vadrouillaient
plutôt dans ma tête avec plein d'espace entre, c'était comme des petites
bougies pas fières et clignoteuses à trembler toute la vie au milieu d'un
abominable univers bien horrible. […] mais enfin c'était pas à envisager que je
parvienne jamais, moi, comme Robinson, à me remplir la tête avec une seule
idée, mais alors une superbe pensée tout à fait plus forte que la mort ... »
3.
Le sublime
enfin, avec ses deux visages pudiques.
D'un côté l’enfance:
« Alcide évoluait dans le sublime à son aise
et pour ainsi dire familièrement, il tutoyait les anges ce garçon, et il
n'avait l'air de rien. Il avait offert sans presque s'en douter à une petite
fille vaguement parente des années de torture, l'annihilement de sa pauvre vie
dans cette monotonie torride ... »
De l'autre : la
sublimation musicale que la plupart ratent et que Céline va constamment garder
en ligne de mire de son écriture:
« Il ne pouvait rien sublimer, il voulait s'en
aller seulement, emporter son corps ailleurs. Il n'était pas musicien pour
un sou. Baryton, il lui fallait donc tout renverser comme un ours, pour finir.
Avoir du chagrin c'est pas tout, faudrait pouvoir
recommencer la musique, aller en chercher davantage du chagrin. »
4.
Histoires
de vertiges
Mais la solution la
plus normale, à la fois banale et publique, communicable, partageable, est,
sera, pour Céline, le récit. Le récit
comme narration de la douleur: la peur, le dégoût, l'abjection criés, se
calment, enchaînés en histoire.
A la pointe
lancinante de sa douleur, Céline va chercher une histoire, une
vraisemblance, un mythe, C'est la fameuse histoire de sa blessure à la tête
lors de la Première Guerre mondiale, blessure dont la gravité, selon la plupart
des biographes, est très exagérée par Céline qui y insiste tant devant les
journalistes que dans ses écrits. Douleurs à la tête, à l'oreille, au bras.
Vertiges, bruits, vrombissements, vomissements. Crises, même, dont les
éclatements font penser à la drogue, à l'épilepsie. Déjà dans Mort à crédit, Céline l’appelle : la folie, avec sa
rivale : la musique.
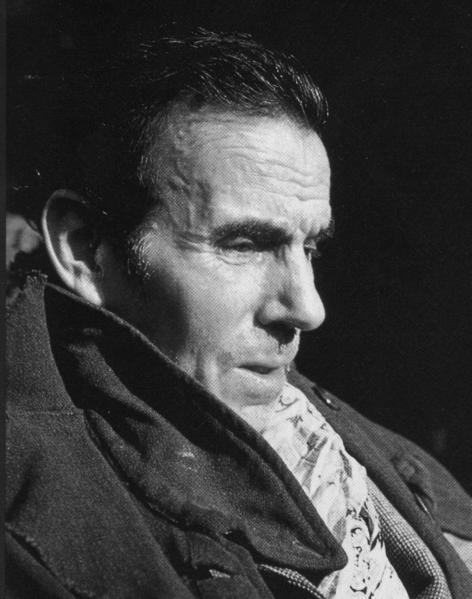
« Depuis
la guerre ça m'a sonné. Elle a couru derrière moi, la folie ... tant et plus
pendant vingt-deux ans. C'est coquet. Elle a essayé quinze cents bruits, un
vacarme immense, mais j'ai déliré plus vite qu'elle, je l'ai baisée, je l'ai
possédée au « finish ». […] Ma grande rivale c'est la musique, elle est
coincée, elle se détériore dans le fond de mon esgourde… Elle en finit pas
d'agonir ... […] C'est moi les orgues
de l'Univers ... J'ai tout fourni, la bidoche, l'esprit et le souffle ...
Souvent, j'ai l'air épuisé. Les idées trébuchent et se vautrent. Je suis pas
commode avec elles. Je fabrique l'opéra du déluge. […] Je suis chef de la gare
diabolique. […] La porte de l'enfer dans l'oreille c'est
un petit atome de rien. »
La douleur dit ici
son mot - « folie» - mais ne s'y
attarde pas, car la magie de ce surplus, l'écriture, transporte le corps, et à
plus forte raison le corps malade, dans un au-delà fait de sens et de mesure.
Au-delà du récit, le vertige trouve son langage: c'est la musique, comme
souffle des mots, comme rythme des phrases et pas seulement
comme métaphore d'une rivale imaginaire où se blottit la voix de la mère et de
la mort:
« C'est
un beau suaire brodé d'histoires qu'il faut présenter à la Dame. »
Le récit culte : à la Dame abject
Le récit, par
contre, est toujours ombiliqué à la Dame - objet fascinant et abject de la
narration.
C'est d'ailleurs
déclenchée par la mère, sur la mer agitée de la Manche, que se déchaîne une des
scènes d'abjection ou de nausée les plus abominables de la littérature. Nous
sommes ici loin de la douleur vrombissante qui
s'élève en musique. Le corps mis à l'envers, renvoie du fond des tripes, boyaux
retournés dans la bouche, nourriture et déjection confondues, évanouissements,
horreurs et ressentiments :
« Maman, elle, va s'écrouler sur la rampe…
Elle se revomit complètement... Il lui est remonté une carotte… un morceau
de gras ... et la queue entière d'un rouget ... »
« On est noyés dans la trombe! On s'écrase
dans la tinette ... Mais ils
arrêtent pas de ronfler ... Je ne sais même pas moi si je suis mort. »
Une humanité saisie
au ras de son animalité, se vautrant dans ce qu'elle vomit, comme pour se
rapprocher de ce qui, pour Céline, est essentiel, au-delà de toutes «
fantaisies » : la violence, le sang, la mort. Jamais peut-être, même chez
Bosch ou chez le Goya le plus noir, la «nature humaine, l'autre côté du «
sensé », de l'« humain civilisé», du «divin » n'ont été ouverts avec
autant de cruauté, avec si peu de complaisance, d'illusion ou d'espoir. Horreur
d'un enfer sans Dieu : car si aucune instance de salut, aucun optimisme, fût-il
humaniste, ne se profile à l'horizon, le verdict est là, et sans pardon
possible - le verdict enjoué de l'écriture.
Le Pont de
Londres est non moins révélateur
de cette guerre avec les entrailles, promues au rang viril cette fois (le
général des Entrayes apparaît dès le Voyage), qu'est la douleur de
l'intérieur:
« C'est un vertige !... C'est un malaise !...
Je suis victime de la fièvre ! Je m'assois !... Je ferme fort les yeux...
Je vois quand même… rouge et
blanc... le colonel des Entrayes !... debout sur les étriers !... Ça c'est
un spectacle de souvenir!... Je re-suis dans la guerre !... merde alors!... Je
re-suis un héros !... Lui aussi !... C'est beau le souvenir !...
Je m'allonge du coup sur le sofa... Je fais ma crise !... Je revois des
Entrayes, mon colonel bien-aimé !... C'était pas un fol celui-là !... Il
était debout sur les étriers ! la latte en bataille... en l'air !...
dardant au soleil... »
Douleur en somme
schreberienne, que seuls l'humour et le style font basculer des mémoires du
névropathe freudien dans une des pages les plus crues de la littérature
moderne.
Douleur et
désir : une débilité
Rien de glorieux
dans cette douleur; elle n'est pas une ode: elle
n'ouvre que sur l'idiotie. La débilité est ce terrain, permanent chez Céline, où la douleur de l' « intime »,
à la fois physique et psychique, rejoint le débordement sexuel. Rien de
pornographique, rien de séduisant ou d'excitant dans cette mise à nu des
instincts. Saisi sur ce versant noir où le désir sombre dans la pulsion ou dans
l'affect, où les représentations s'estompent, s'éclipsent les significations,
ce sexe-là est une ébriété, autre mot pour désigner la douleur débile.
« J'avais
atteint les limites... […] Mimine!... je voulais plus être
halluciné… Je savais comment ça me prenait... j'avais l'expérience à présent…
sur un tout petit peu d'alcool... juste un petit verre suffisait… et puis un
coup de discussion... quelqu'un qui me contredisait… je m'emballais... c'était
fini !... Toujours à cause de ma tête, c'était écrit sur ma réforme !... »
« Toutes les douleurs me rattrapent… de part
en part me traversent !.. le front, les bras, les oreilles… j'entends les
trains qui me fondent dessus !... me sifflent, me ronflent plein la
tête!... Je veux plus rien savoir, chierie foutre!... Je flanche!... Je me
raccroche à la rampe… Un petit vertige... Je me retrouve tout tremblant devant
elle… Ah quelle frayeur !... quelle émotion !... […] M'aime-t-elle un peu ?... Je me pose la
question... Je me la rabâche à ses côtés... Je suis si ému!... Je ne sais pas
bien où je pose mes pieds!... je trébuche partout... je vois plus devant moi...
ni les devantures ni les personnes..., ni même les trottoirs, je bute, je
cogne... je me ramasse, je suis dans l'extase... dans la féerie de sa
présence... […] Je vois pas le soldat qui m'agonit que
je lui trépigne les arpions… ni le conducteur qui me secoue... qui me tarabuste
dans mon songe… »
La scatologie
banalisée
Au no man's land du vertige qui lie douleur
et sexe, succède le dégoût de la pourriture ou de la déjection, Céline en parle
avec la même neutralité, avec le même naturel apparent que lorsqu'il décrit la
douleur ou la débilité.
Comme si l'écriture
célinienne ne s'autorisait que de s'affronter à ce «tout autre » de la signifiance;
comme si elle ne pouvait être que de faire exister comme tel ce « tout autre»
afin de s'en écarter mais aussi d'y puiser sa source; comme si elle ne pouvait
naître que de ce face-à-face qui rappelle les religions de la souillure, de l'abomination et du péché. Le récit, lui, disloqué sous l'effet
de ce dispositif, est à la fois brisé et ponctué dans sa continuité simplement
biographique et logique par ces îlots de fascination: le décousu retrouve sa
cohérence dans la permanence de l'abjection.
C'est à la pourriture que renvoie cette obsession,
que ce soit par l'évocation de l'excrément découvert par le malheureux père
comme l'envers du succès scolaire de son enfant (Mort à crédit), ou par celle de la saleté anale où se fixe l'intérêt pour l'intérieur
grouillant d'un corps, dont Ferdinand n'aura pas à se demander s'il est mâle ou
femelle.
« Je
me torchais toujours aussi mal, j'avais toujours une gifle en retard... Que je
me dépêchais d'éviter... Je gardais la porte des chiots ouverte pour entendre venir...
Je faisais caca comme un oiseau entre deux orages... »
La pourriture: lieu
privilégié du mélange, de la contamination de la vie par la mort, de
l'engendrement et de la fin. On en trouve peut-être l'apogée dans la
description apocalyptique de la terre pourrie par les asticots du savant Courtial des Pereires. Les
expériences scientifiques de l'inventeur du Genitron, loin de perpétuer la vie,
n'arrivent qu'à transformer une nourriture, les pommes de terre, en puanteur
impossible (« le cadavre ou la pomme de terre ») et à corrompre jusqu'aux
pierres:
« Plus
qu'un désert de pourriture. Ça va! ça va ! l'esprit fermente ! […] La
charogne veux-tu que je te dise ? Hein? moi je vais te le dire... c'est tout ce
qu'il faut supporter !... »
C'est pourtant le cadavre humain qui donne lieu à la
concentration maximale d'abjection et de fascination. Tous les récits céliniens
convergent vers un lieu de massacre ou de mort - le Voyage débutant par
la Première Guerre l'avait indiqué, Rigodon et Nord traversant
une Europe ravagée par la Seconde y mettent un point d'orgue. L'époque moderne
sans doute s'y prête, maîtresse en massacres, et Céline reste le plus
grand hyperréaliste des carnages des temps modernes. Mais nous sommes ici bien
loin du reportage de guerre, fût-il le plus horrible. Ce que Céline traque, débusque, étale, c'est l'amour de la mort
dans les fibres, l'enivrement devant le cadavre, cet autre que je suis et
que je n'atteindrai jamais, cette horreur avec laquelle je ne communique pas
plus qu'avec l'autre sexe dans la volupté, mais qui m'habite, m'excède et me
porte au point où mon identité se renverse dans l'indécidable. On trouve
l'évocation vertigineuse, apocalyptique et grotesque de volupté devant la mort
dans une des scènes finales de Mort à crédit. Le curé Fleury, devenu
fou, dépèce le cadavre de Courtial:
« Il
plonge les doigts dans la blessure ... Il rentre les deux mains dans la viande
... il s'enfonce dans tous les trous ... Il arrache les bords !... les mous! Il
trifouille!... Il s'empêtre ... Il a le poignet pris dans les os! Ça craque ... Il secoue ... Il se débat comme dans
un piège ... y a une espèce de poche qui crève!... Le jus fuse! gicle partout!
Plein de la cervelle et du sang!... Ça rejaillit autour. »
Le carnage dans
les fibres
L'écriture
célinienne puise sa nuit et son support ultime dans la mort comme lieu suprême
de la douleur, dans l'agressivité qui la provoque, dans la guerre qui y
conduit. L'abjection est bordée de meurtre, le meurtre est freiné par
l'abjection.
« Les
hommes n'ont pas besoin d'être saouls pour ravager ciel et terre! Ils ont le
carnage dans les fibres ! C'est
la merveille qu'ils subsistent depuis le temps qu'ils essaient de se réduire à
rien. Ils pensent qu'au néant, méchants clients, graines à crime! Ils voient
rouge partout! Faut pas insister, ça serait la fin des poèmes... »
Sûrement, mais pas la
fin des textes de Céline, bien au contraire. On pense aux tentatives de
meurtres, aux multiples assassinats que relatent ses romans : de la vieille
Henrouille, de Ferdinand (dans Voyage). Aux heurts permanents avec la
mort dans Le Pont de Londres où l'expérience «scientifique» se mêle,
comme dans un carnaval lugubre, au risque mortel et aux violences massacrantes
des bistrots, des orgies, des métros. On pourra évoquer les râles de Titus dans Guignol's Band; les clameurs atroces autour de son corps mourant qui se
débat entre les deux corps de femmes, la cliente et la bonne, indices d'une
orgie impossible, déplacée dans le meurtre :
« Il
gît là dans ses soieries! plein de ses dégueulages… ses renards... il
glougloute encore!... ses yeux pivotent... figent… révulsent… Ah! c'est affreux
à regarder !... et puis plof !... Il tourne cramoisi !... Lui, si blême,
juste à la seconde!... Il lui remonte plein de gros gromelots... plein la
bouche... il fait l'effort... » (Guignol’s Band).
Comme une acmé de sa
maladie, l'asthme :
« ...
quand ça le prenait, cette panique!... fallait voir alors ses calots !...
l'horreur qui le saisissait !... »
La scène
apocalyptique du meurtre atteint son comble lorsque la drogue se mêle à
l'orgie, comme dans la séquence de l'incendie, avec l'Affreux (Guignol's
Band).
« Je
vois une grande scène de bataille!... C'est une vision!... un cinéma!... Ah! ça
va pas être ordinaire !... dans le noir au-dessus de la tragédie !... Il y a un
dragon qui les croque tous!... il leur arrache à tous le derrière... la
tripaille... le foie. […] Je te vois la Douleur! […] Je vais lui couper les narines à ce malotru!... J'aime pas
les pédocs !... Et si je lui coupais les organes!... ah, ça serait inouï! J'y
pense!... J'y pense!... »
Et puis, la vision
du meurtre tourne en sublime, l'apocalypse meurtrière offre sa face lyrique,
avant que tout ne sombre dans le vomissement, l'argent avalé comme nourriture
ultime, excrément réincorporé, et que le feu, effectivement apocalyptique, ne
ravage tout, après le meurtre de Claben par Boro et Céline-La Douleur :
« ...
tout tourne autour du globe !... comme au manège... la lampe à eau... je vois
des choses dedans! Je vois des guirlandes… je vois des fleurs !... Je vois des
jonquilles. […] Je le dis à Boro !... Il me rote !... Il est
entre Delphine et le vieux!... Ils arrêtent pas leurs saloperies ! ... là dans
le grand page!... Ils m'écœurent à force!... L'autre qu'a bouffé tout son
pécule!... il s'écœure pas celui-là !… toute la monnaie de la sacoche!... il
est content... »
Ferdinand la
Douleur: un meurtrier
Ferdinand la
Douleur, celui qui parle à la première personne, est ici un des principaux
protagonistes du meurtre. C'est toujours lui, « Moi », qui dans Guignol's
Band, précipite sous le métro son persécuteur Matthew. Cette scène qui met
en branle le tourniquet persécuteur-persécuté, change la représentation
visionnaire du meurtre de la séquence précédente en une radiographie plus dynamique
du mouvement meurtrier. Un véritable royaume souterrain de la pulsion de mort trouve son lieu naturel dans les entrailles du
métro, équivalent célinien de l'enfer dantesque. Le meurtre comme doublure
souterraine de l'être pensant dans l'immonde.
« Mon
sang fait qu'un tour !... je respire plus !... je bouge plus!... je reste
hypnotisé... Il me regarde !... Je le regarde! Ah! je pense quand même!... Je
pense là net!... C'est le nabot !... là contre moi!... C'est lui. […] Ça se prépare tout seul !...
ma réflexion... je concentre... concentre... je pipe pas du tout... au
sang-froid... […] On l'entend qui gronde la rame… elle
arrive!... là-bas dans le noir... dans le trou... à ma droite… Bon !... Bon
!... Bon!... elle se rapproche la rame. Elle gronde énorme, fracasse, enfle...
«Brrr Brrrroum !... » Bon!
Bon! Bon! C'est près... je regarde Matthew en face… […] Plouf! un coup
de cul moi que je l'envoye ! le nabot! en l'air !… Le tonnerre déferle, passe
dessus ! »
La Deuxième
Guerre
Cependant, c'est
dans la guerre que le déferlement apocalyptique de l'agressivité et de la mort
atteint, chez Céline, et dépasse l'intensité d'un Goya ou d'un Bosch. Guerre
abominable mais vite traversée dans le Voyage, guerre sinistre et
carnavalesque dans le Pont de Londres et dans Guignol's Band.
« Je
suis assassin! Monsieur le Major! j'en ai tué dix !... j'en ai tué
cent !... j'en ai tué mille !... Je les tuerai tous la prochaine fois !...
Monsieur le Major, renvoyez-moi !... ma place est au front !... za la guerre
!... »
Sans la guerre, il
est difficile d'imaginer une écriture célinienne. Elle semble en être le
déclencheur, la condition même. Elle a le rôle de la mort de Béatrice qui
entraîne la Vita Nuova ou de l'évitement de la mort par Dante qui amorce
le premier chant de La Divine Comédie. La trilogie où se déploie
l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale (D'un château l'autre, Nord et Rigodon) saisit au mieux cette blessure que Céline n'arrête pas de palper, de
l'individu à la société. Fresque sociale et politique, débordante de rejets et
de sarcasmes envers une politique que par ailleurs Céline semble approuver
(nous y reviendrons), de trahisons, d'escapades, de massacres, de bombardements
et de destructions : l'agressivité la plus destructrice y montre soudainement
son abominable versant débile, dans une infernale jouissance _ mobile abject de
l'Histoire. Le lieu de l'écriture célinienne est toujours cette crête
fascinante de la décomposition-composition, de la douleur-musique, de
l'abomination-extase.
« ...
qu'ils se meurent, puent, suintent, déboulent à l'égout, mais ils demandent ce
qu'ils pourront faire, à Gennevilliers? Pardi ! à l'épandage ! à
l'égout !... […] le vrai sens de l'Histoire... et où nous en
sommes! sautant par-ci !... et hop ! par-là !... rigodon !... pals partout !
épurations vivisections... peaux retournées fumantes... sapristis gâtés
voyeurs, que tout recommence ! arrachement de viscères à la main ! qu'on
entende les cris, tous les râles, que toute la nation prenne son pied... »
Rappelons, à propos
de cette musique apocalyptique qu'est la trilogie, le bombardement de Hambourg
où dans le fracas, la puanteur et le chaos, la frénésie de l'abjection bascule
en beauté sinistre :
« ... les flammes vertes roses dansaient en
rond... et encore en rond!... vers le ciel!... il faut dire que ces rues en
décombres verts... roses... rouges... flamboyantes, faisaient autrement plus
gaies, en vraie fête, qu'en leur état ordinaire, briques revêches mornes... ce
qu'elles arrivent jamais à être, gaies, si ce n'est pas le Chaos, soulèvement,
tremblement de la terre, une conflagration que l'Apocalypse en sort... »
« ...
je vous ai dit l'effet, trois ou quatre fois Notre-Dame... […] le jour
venait d'en haut, de tout en haut... du trou du cratère… l'effet je vous répète
d'une géante nef en pleine glaise... […] ... Hambourg avait été détruit au phosphore liquide... ça avait fait le
coup de Pompéi… tout avait pris feu, les maisons, les rues, le macadam et les
gens à courir partout... et même les mouettes sur les toits… »
Le sacré et
l'histoire, Notre-Dame et Pompéi, le sens et le droit, accouchent ici, dans ce
gigantesque dévoilement de la douleur et du meurtre qu'est la
Deuxième Guerre mondiale, de leur envers macabre. Et cet autre côté,
tout-puissant, de la culture fragile, est, aux yeux de Céline, la vérité de
l'espèce humaine; pour l'écrivain, c'est le point de départ de l'écriture comme dénuement du sens.
C’est-à-dire comme apocalypse (littéralement).
Que la vision de
Céline soit une vision apocalyptique, qu'elle ait des accents mystiques dans sa
fixation au Mal comme vérité du Sens impossible (du Bien, du Droit) - soit.
Pourtant, si apocalypse signifie, étymologiquement, une vision, il faut
bien l'entendre à l'opposé de la
révélation d'une vérité philosophique, de l'aletheia. Il n'y a d'être apocalyptique que strié,
défaillant, à jamais incomplet et incapable de se poser comme tel, qui éclate
dans les flammes ou retentit dans les cris de l'effondrement universel. Céline
n'exhibe donc pas un « mal » philosophique : à penser, à condamner, à
bannir. Aucune interprétation idéologique ne peut d'ailleurs s'appuyer sur la
révélation célinienne : quel principe, quel parti, quel camp, quelle classe
sortent indemnes, c'est-à-dire identiques à eux-mêmes, de cet embrasement
critique total ? La douleur, l'horreur et leur convergence vers l'abjection
nous semblent être des indications plus adéquates à cette vision apocalyptique qu'est l'écriture célinienne.
Un récit ? Non,
une vision
Vision, oui, au sens
où le regard y est massivement convoqué, coupé par le bruit rythmé de la voix.
Mais vision qui s'oppose à toute représentation si celle-ci est le désir de coïncider
avec une identité présumée du représentable. La vision de l'abject, par définition, est le signe d'un ob-jet
impossible, frontière et limite. Fantasme si l'on veut, mais il introduit
dans les fameux fantasmes originaires de Freud, dans les Urfantasien, une
surcharge pulsionnelle de haine ou de mort, qui empêche les images de se
cristalliser comme des images de désir et/ou de cauchemar, et les fait éclater
dans la sensation (douleur) et dans le rejet (l'horreur), dans la sidération de
la vue et de l'ouïe (feu, vacarme). La vision apocalyptique serait alors
l'éclatement, ou l'impossibilité non seulement du récit, mais aussi des Urfantasien sous la pression d'une pulsion.
« Juivre ou mourir » (Les Beaux Draps)
Enthousiasme
c'est beaucoup délirer – Hélas !
Freud certes a
déliré beaucoup –
mais notre délire
à présent semble être uniquement
de fanatismes politiques
–
c'est encore plus
ridicule Je le sais. J'y ai été pris.
(Lettre à Hindus, le 5 août 1947)
Les balancements
logiques : un anarchisme
Contradictoires sans
doute, emportés, « délirants» si l'on veut, les pamphlets de Céline (Mea
culpa, 1936, Bagatelles pour un massacre, 1937; l'École des
cadavres, 1938; les Beaux Draps, 1941), malgré la stéréotypie des
thèmes, prolongent la beauté sauvage de son style. Les isoler de l'ensemble
de son texte est une protection ou une revendication de gauche ou de droite,
idéologique en tout cas, pas un geste analytique ou littéraire.
Les pamphlets
donnent le substrat fantasmatique (de la personne Louis-Ferdinand) sur lequel
se bâtit, par ailleurs et ailleurs, l'œuvre romanesque (de l’auteur Céline).
C'est ainsi que, très « honnêtement», celui qui signe et ses romans du prénom
de sa grand-mère, Céline, retrouve le nom
de son père, son état civil, Louis Destouches, pour assumer la paternité
tout existentielle, biographique, des pamphlets. Du côté de mon identité, «je »
n'ai de vérité à dire que mon délire :
mon désir paroxystique sous son aspect social. Du côté de cet autre qui écrit, et qui n'est pas mon moi patrilinéaire,
«je» dépasse, «je» déplace, « je » ne suis plus, car le bout de la nuit est
sans sujet, rigodon, musique et féerie. Destouches et Céline : biographie et thanatographie, délire
et écriture - la distinction existe sans doute, mais jamais complète, et comme
Janus qui évite le piège d'une identité impossible, les textes, romans ou
pamphlets, exposent, eux aussi, deux faces.
Ainsi, Céline peut
tout à la fois attaquer l'écroulement
des idéaux et la réduction du peuple aux bas besoins en même temps qu'il
célèbre ceux qui encouragent une telle situation, Hitler en tête. Il
écrit par exemple dans les Beaux
Draps:
« Le
peuple il a pas d'idéal, il a que des besoins. C'est quoi ses besoins ? […] C'est un programme tout en matière, en bonne
boustiffe et moindre effort. C'est de la bourgeoisie embryonne qu'a pas encore
trouvé son blot. »
Ou bien :
« Les
damnés de la Terre d'un côté, les bourgeois de l'autre, ils ont au fond qu'une
seule idée, devenir riches ou le demeurer, c'est pareil au même, l'envers vaut
l'endroit, la même monnaie, la même pièce, dans les cœurs aucune différence.
C'est tout tripe et compagnie. Tout pour le buffet. »
Et dans L'École
des cadavres :
« Quel
est le véritable ami du peuple? Le fascisme. / Qui a le plus fait pour
l'ouvrier ? L'URSS ou Hitler ? / C'est Hitler. / Y a qu'à regarder sans merde
rouge plein les yeux / Qui a fait le plus pour le petit commerçant ? C'est pas
Thorez, c'est Hitler ! »
Ce qui ne l'empêche
pas, par ailleurs, de critiquer violemment Hitler, après la guerre, il est vrai
:
« La
vocifération hitlérienne, ce néo-romantisme hurlant, ce satanisme wagnérien m'a
toujours semblé énormément obscène et insupportable - Je suis pour Couperin,
Rameau-Jacquin (...), Ronsard... Rabelais. » (Lettre à Hindus)
« Derrière
Hitler, il n'y avait rien ou presque rien, je parle au point de vue spirituel,
une horde de petits bourgeois provinciaux cupides, la curée. » (Ibid.)
(C'est ce qui, aux yeux de Céline, a rendu
les nazis inaptes au nazisme.)
Il peut lancer de cinglantes
invectives contre les francs-maçons, universitaires et autres élites laïques
mais avec des attaques non moins violentes, à résonance nietzschéenne, contre
l'Église catholique.
« Propagée
aux races viriles, aux races aryennes détestées, la religion de «Pierre et
Paul » fit admirablement son œuvre, elle décatit en mendigots, en
sous-hommes dès le berceau, les peuples soumis, les hordes enivrées de
littérature christianique, lancées éperdues, imbéciles, à la conquête du Saint
Suaire, des hosties magiques, délaissant à jamais leurs Dieux, leurs religions
exaltantes, leurs Dieux de sang. Leurs Dieux de race. »
« Le
plus éhonté brelan de christianeux enfifrés qui soit jamais tombé sous la
férule des youtres ... […] La religion christianique ? La
judéo-talmudo-communiste ? Un gang ! Les Apôtres ? Tous juifs ! Tous gangsters !
Le premier gang ? L'Église ! Le premier racket ? Le premier commissariat du
peuple ? L'Église ! Pierre ? Un Al Capone du Cantique ! Un Trotski pour moujiks
romains ! L'Évangile ? Un code de racket... »
La connivence judéochrétienne,
telle quelle, fantasme Céline, prélude à la grande curée judéomaçonnique. Il descend en flammes le communisme et la « Révolution moyenneuse », mais
aussi le maurrassisme. Ainsi, par exemple, l'ensemble de Mea
Culpa ou en d'autres textes :
« Le
communisme sans poète, à la juive, à la scientifique, à la raison raisonnante,
matéraliste, marxiste, à l'administrative, au mune, au peigne-cul, aux 600
kilos par phrase, n'est plus qu'un très emmerdant procédé de tyrannie
prosaïque, absolument sans essor, une imposture juive satrapique absolument
atroce, immangeable, inhumaine. une très dégueulasse forcerie d'esclaves, une
infernale gageure, un remède pire que le mal.
De la même façon, il
est d'une colère noire contre l'école
réductrice de la spontanéité animale, école basée sur la raison abstraite et
paternelle qui contraint et estropie.
L'anarchisme ou le
nihilisme écrasant de ce discours bascule, et comme à l'envers de ce
négativisme, apparaît un objet : de haine et de désir, de menace et
d'agressivité, d'envie et d'abomination.
Cet objet, le juif, donne à la pensée un
foyer où toutes les contradictions s'expliquent et s'assouvissent. On verra
peut-être mieux la fonction du juif dans l'économie du discours célinien, si
l'on commence par relever deux traits communs, au moins, qui structurent
cette fluctuation pamphlétaire.
Contre la Loi
symbolique : un ersatz de Loi
Le premier est la rage
contre le Symbolique, Celui-ci est représenté ici par les institutions
religieuses, parareligieuses et morales (Église, franc-maçonnerie, École, Élite
intellectuelle, Idéologie communiste, etc.) ; il culmine dans ce que Céline
hallucine et sait être leur fondement et ancêtre: le monothéisme juif. A suivre ses associations d'idées, son
antisémitisme - virulent, stéréotypé, mais passionné - apparaît comme le simple
aboutissement d'une rage pleinement laïque ; l'antisémitisme serait un laïcisme jusqu'au-boutiste balayant, avec la
religion qui est son ennemi principal, tous ses représentants latéraux,
l'abstraction, la raison, le pouvoir altéré, jugé dévirilisant.
Le second est la
tentative de substituer à ce symbolique contraignant et frustrant une autre
Loi, absolue, pleine, rassurante. C'est vers elle, positivité mystique,
qu'iront les vœux de Céline idéologue fasciste :
« Il
y a une idée conductrice des peuples. Il y a une loi. Elle part d'une idée qui
monte vers le mysticisme absolu, qui monte encore sans peur et programme, Si
elle file vers la politique, c'est fini. Elle tombe plus bas que la boue et
nous avec […] il faut une idée, une doctrine dure, une doctrine de diamant, plus terrible
encore que les autres pour la France. »
Au-delà de la
politique mais sans l'ignorer, cette positivité matérielle. substance
pleine, tangible, rassurante et heureuse, sera incarnée par la Famille, la
Nation, la Race, le Corps.
Le romancier Céline n'a pourtant que trop exploré l'abomination qui travaille ces
entités. Mais le pamphlétaire les
souhaite et il les fantasme comme pouvant être pleines, sans autre, sans
menace, sans hétérogénéité; il veut qu'elles absorbent harmonieusement leurs
différences dans une sorte de mêmeté, obtenue par un glissement subtil, une
scansion, une ponctuation qui relaie mais ne coupe pas - calque du narcissisme
primaire.
« Il
faudrait rapprendre à danser. La France est demeurée heureuse jusqu'au rigodon.
On dansera jamais en usine, on chantera plus jamais non plus. Si on chante plus
on trépasse, on cesse de faire des enfants, on s'enferme au cinéma pour oublier
qu'on existe […]»
« Ô
l'exquise impertinence! Environnés à tourbillons (...) De grâce ! à mille
effronteries ! pointes et saccades de chat ! se jouent de nous ! Ta ! ta! ta !... […] où mélodie nous a conduits... appel en fa ! tout s'évapore !... deux
trilles encore !... une arabesque !... une échappée ! Dieu les voici !... fa...
mi... ré… do... si !... Mutines du ciel nous enchantent ! damnés pour damnés
tant pis ! » (Les Beaux Draps)
Existe-t-il un
langage qui pourrait relever de cette plénitude émotionnelle en douleur et en exultation ?
Le style célinien prouve que cette féerie duelle entre le « non encore un » et
le « pas tout à fait autre » peut s'écrire. Il nous persuade que cette
jouissance de l'immanence du narcissisme dit primaire peut se sublimer dans un
signifiant remanié et désémantisé jusqu'à
la musique.
D'autre part, il est impossible de ne pas entendre
la vérité libératrice de cet appel au rythme et à la joie, par-delà les
contraintes mutilantes d'une société réglée par le symbolisme monothéiste et
ses répercussions politiques et légales.
Entre les deux, les
deux à la fois : le délire crée la figure imaginaire du juif-foyer de
l’abjection. Elle concentrera, d'une part, l'amour dénié devenu haine pour la
Maîtrise, d'autre part et conjointement le désir de ce que cette maîtrise
retranche : la faiblesse, la substance jouissante, le sexe teinté de féminitude
et de mort.
L'antisémitisme pour lequel existe un objet aussi
fantasmatique et ambivalent que le juif, est une sorte de formation
parareligieuse: il est le frisson sociologique, à même l'histoire, que se donne
le croyant comme le non-croyant pour éprouver l'abjection. Fascination et horreur pour cet autre que j’aime et
que j’ai peur de ne pas être.
On peut supposer,
par conséquent, qu'on trouvera un antisémitisme d'autant plus violent que le
code social et/ou symbolique se trouve en
défaut devant l'élaboration de l'abjection. C'est en tout cas la situation
de notre modernité et, pour des raisons plus personnelles, la situation de
Céline à partir des années 30. Toutes les tentatives, dans notre orbe culturel
au moins, de sortir des enclos du judéochristianisme par l'appel unilatéral
d'un retour à ce qu'il a refoulé (le rythme, la pulsion, le féminin, etc.), ne
convergent-elles pas vers le même fantasme célinien antisémite? Parce que
déniant l’amour du Maître et de ce qu’il retranche : l’ambiguïté de l’abjection,
précisément ? Cette abjection
que, au contraire et par d’autres moyens que la psychanalyse, le judaïsme a
sondée ? Car les écritures du
peuple élu se sont placées, de la manière la plus résolue, sur cette crête
intenable de l'hominité comme fait symbolique, qu'est l’expérience de l'abjection.
Les tabous lévitiques et leur évolution en codes moraux en témoignent, je vous
renvoie aux pages que je leur consacre dans Pouvoirs
de l’horreur.
En ce sens, les
pamphlets de Céline sont le délire avoué
duquel émerge l'œuvre qui s'aventure dans les régions obscures aux limites de
l'identité. S'il s'agit de
délire comme Céline l'indique lui-même : « Enthousiasme, c’est beaucoup délire… »
Frère ...
Quels sont les fantasmes
que condense la figure du juif chez Céline, pour devenir le parangon de toute
haine, de tout désir, de toute peur du Symbolique?
Tout-puissant
d'abord, le juif fait figure de héros. Non pas tant de père que de fils
préféré, élu, bénéficiant du pouvoir paternel. Freud constatait que tout héros
est un parricide. Céline ne va peut-être pas jusqu'à penser à cet héroïsme-là,
quoiqu'il le présuppose implicitement lorsqu'il considère que, hors
comparaison, au dessus des autres fils, « le
juif est un homme plus qu'un autre » (Bagatelles).
Ce frère supérieur
et envié est essentiellement actif, par opposition à la « grotesque insouciance» de l'Aryen H. Tel Yubelblat de Bagatelles:
Plus encore, Céline
ira à l'encontre de l'idée reçue, en le voyant intrépide : « Le juif il a peur de rien ... », pourvu
qu'il puisse atteindre son but, le pouvoir: « Que ce soit toujours lui qui commande ».
C'est par une
maîtrise tout anale (« il a l'avenir, il a le pognon », Bagatelles),
qui consiste à avoir l'objet primordial (la richesse), que le juif
s'assure d'être, d'être tout et partout, totalisant le
monde en une unité sans faille, sous son contrôle absolu.
Secret, détenteur du
mystère (« Le juif il est
mystérieux, il a des façons
étrangères... »), il possède un pouvoir insaisissable. Son ubiquité ne se limite pas à l'espace,
il n'est pas seulement sur nos terres et dans notre peau, le tout prochain, le
presque même, celui qu'on ne différencie point, le vertige de l'identité: « on ne sait ni les gueules qu'ils ont, qu'ils peuvent avoir, leurs
maniérés ». Il embrasse aussi
la totalité du temps, il est héritier, descendant, bénéficiaire de la
lignée, d'une sorte de noblesse qui lui garantit la chance de thésauriser la
tradition ainsi que les biens du groupe familial et social :
« Tout petit juif, à sa naissance, trouve dans
son berceau toutes les possibilités d'une jolie carrière...»
Béni du père et des
familles solides, il manipule avec ruse les réseaux de la réalité sociale et
d'autant mieux s'il réussit à s'introduire dans l'aristocratie ...
Pourtant, cette
position de pouvoir n'a rien de commun avec la maîtrise froide et majestueuse
propre à la domination classique. Dans le fantasme antisémite, le pouvoir juif
ne suscite pas le respect comme le fait l'autorité paternelle. Bordé de
crainte, il déchaîne au contraire l'excitation que suscite la rivalité avec le
frère, et entraîne l'Aryen qui s'y engage dans le feu de la passion homosexuelle déniée. En effet,
ce frère élu exhibe trop la faiblesse (Céline évoque à son égard la petite taille, les traits indiquant le
métissage, quand ce n'est pas directement le prépuce circoncis : «Lénine,
Warburg, Trotzky, Rothschild ils pensent tout semblable sur tout ça. Pas un prépuce de différence, c'est le
marxisme 100 pour 100»), le manque ambivalent - qui est aussi bien cause de surplus voire de jouissance. On lui reprochera la faiblesse - il
sera considéré comme un usurpateur, mais on avouera rapidement que c'est de
jouir qu'on lui en veut. Comme s'il était cet unique, si différent du païen,
qui tire son aura de sa faiblesse, c'est-à-dire non pas d'un corps glorieux et
plein mais de sa subjectivation à l'Autre.
Dans le langage d'un
sado-masochisme directement sexuel, homosexuel, c'est en effet une jouissance
incompréhensible que Céline reproche à ce frère préféré : « Les 15 millions de juifs enculeront les 500 millions d'Aryens ».
« Il s'en fout énormément, il jouit, il
est d'âge, il s'amuse », à
propos de Roosevelt mais, dans le contexte, du juif aussi. «Les juifs, hybrides
afro-asiatiques, quart, demi-nègres et Proches-Orientaux, fornicateurs
déchaînés, n'ont rien à faire dans ce pays » ; ou bien cette lettre signée
« Salvador juif » et adressée à « Céline le dégueulasse » où on lit, entre
autres fantasmes : « Les Youtres te
déplaquent dans le trou du cul et si tu veux te faire enculer, tu n'as qu'à
nous avertir ». L'antisémite qui s'y confronte se voit réduit à une
position féminine et masochiste comme objet passif et esclave de cette
jouissance, agressé, sadisé.
Le fantasme de la
menace juive qui pèse sur le monde aryen (« Nous
sommes en plein fascisme juif », Bagatelles) à une époque au
contraire où commencent les persécutions contre les juifs, ne s'explique pas
autrement et vient en droite ligne de cette vision du juif comme être de
l'avoir, comme émanation du Tout dont il
jouit, et surtout de la sexualisation
immédiate de cette jouissance.
Dans le crescendo de
la construction fantasmatique, le juif finit par devenir alors un tyran
despotique auquel l'antisémite soumet son érotisme anal, chez Céline
explicitement, ailleurs de manière plus ou moins sournoise. Céline se décrit,
face à cet agresseur imaginaire, comme « une figure d'enculé », « les Youpins te chient dans la gueule »; il voit souvent « le bon aryen […] toujours prêt à faire jouir son juif. »
Pourtant, si de la
jouissance le juif est censé posséder le savoir, il apparaît soucieux de ne pas
(se) dépenser pour elle. Il est maître de la jouissance mais non artisan, non
artiste. Ce frère tyrannique obéit ainsi à l'instance d'une loi paternelle,
surmoïque, dominatrice des pulsions, à l'opposé de la spontanéité naturelle,
enfantine, animale, musicale. Anxieux de s'abandonner à un peu « d'humanité directe », le juif « redouble aussitôt de tyrannie »
Dominateur, il se domine d'abord lui-même par une froide raison qui le prive de
tout accès au talent. Le prototype de l'intellectuel, le
superintellectuel en quelque sorte (la
frigidité intellectuelle maximale est atteinte quand l'universitaire se trouve
être juif, comme M. Ben Montaigne, professeur dans les Beaux Draps) est le
juif incapable d'art mais inventeur
de la « taïchnique » (laquelle inaugure le monde artificiel des « braguettes sans bites ! les sphincters mous !
les faux nichons, toutes les saloperies d'impostures »). S'il est écrivain,
il est comme l'écrivain bourgeois auteur de « rafistolage d'emprunts, de choses vues à travers un pare-brise... un
pare-choc ou simplement volées au tréfonds des bibliothèques... »
Identifié ainsi à la Loi, à
la Maîtrise, à l'Abstraction et à la Raison, il glissera de la position de
frère désiré et jalousé à celle de père imprenable contre lequel vont
s'acharner toutes les attaques, très œdipiennes, de son écriture qui revendique
comme autre de la Loi et du Langage, l'Émotion et la Musique.
A cette limite du «
délire», l'antisémite dévoile sa croyance, déniée mais farouche, dans l'Absolu
de la Religion juive, comme religion du Père et de la Loi : l'antisémite en est le serviteur possédé, le
démon, le «dibouk
», a-t-on dit,
qui apporte la preuve a contrario du
pouvoir monothéiste dont il se fait le symptôme, le raté, l'envieux. Est-ce pour cela qu'il dit, de cette
religion, les topoï traumatiques - comme ceux de l'abjection - qu'elle, au
contraire, élabore, sublime ou maîtrise?
... ou femme
Un troisième pas
nous reste à franchir maintenant dans la construction de ce discours
antisémite, désir apeuré pour le frère héritier. S'il jouit d'être sous la Loi
de l'Autre, s'il se soumet à l'Autre et qu'il tire de là sa maîtrise comme sa
jouissance, n'est-il pas, ce juif redouté, un objet du Père, un déchet, sa femme
en quelque sorte, une abjection ? C'est d'être cette insupportable
conjonction de l'Un et de l'Autre, de la Loi et de la Jouissance, de celui qui
Est et de celui qui A, que le juif devient menaçant. Alors, pour s'en défendre,
le fantasme antisémite relègue cet objet à la place de l'ab-ject. Le juif:
conjonction du déchet et de l'objet de désir, du cadavre et de la vie, de la
fécalité et du plaisir, de l'agressivité meurtrière et du pouvoir le plus
neutralisant - «Que sçouais-je? » Je sçouais que c'est « juivre ou mourir!… d'instinct alors et
intraitable » (Les Beaux Draps)! Le juif devient ce féminin érigé en
maîtrise, ce maître altéré, cet ambivalent, cette frontière où se perdent les
limites strictes entre le même et l'autre, le sujet de l'objet, et plus loin
même, le dedans et le dehors. Objet de peur et de fascination donc. L'abjection même. Il est abject : sale, pourri. Et moi qui m'identifie
à lui, qui désire avec lui cette embrassade fraternelle et mortelle où je perds
mes limites, je me trouve réduit à la même abjection, pourriture fécalisée,
féminisée, passivée : « Céline le dégueulasse. »
L'antisémite ne se
trompe pas : le monothéisme juif n'est pas seulement le plus rigoureux adepte
de l'Unicité de la Loi et du Symbolique. Il est aussi celui qui porte avec le
maximum d'assurance, mais comme sa doublure, la trace de cette substance
maternelle, féminine ou païenne. S'il se détache avec une vigueur
incomparable de sa présence farouche, il l'intègre aussi sans complaisance.
Et c'est probablement elle, cette présence
autre et toutefois intégrée, qui confère au sujet monothéiste la force d'un
être.
Paroles d’abjection
dont l’écrivain est le sujet et la victime, le témoin est la bascule. Bascule
dans quoi ? Dans rien d’autre que cette effervescence de passion et de
langage qu’est le style, où se noient toute idéologie, thèse, interprétation,
manie, collectivité, menace ou espoir. Une apocalypse qui rit, une apocalypse sans dieu. Nihilisme radical qui
ne peut s’évanouir que dans « ces profondeurs pétillantes que plus rien
existe » (Rigodon). Musique, rythme, rigodon, sans fin, pour rien. La
forme ultime d’une attitude laïque, sans morale, sans jugement, sans espoir.
JULIA KRISTEVA
Psychanalyse et Littérature
Année universitaire 2009/2010
Cycle de conférence organisé par Frédéric SAYER
Dans le cadre des activités du Centre de Recherche
en
Littérature Comparée (direction : Jean-Yves
Masson)
Paris - Sorbonne - Paris 4