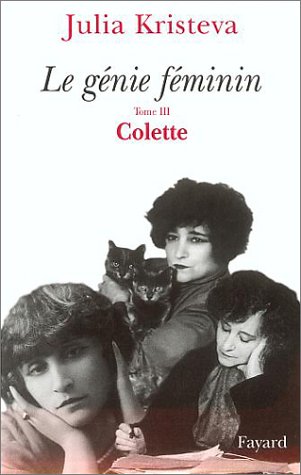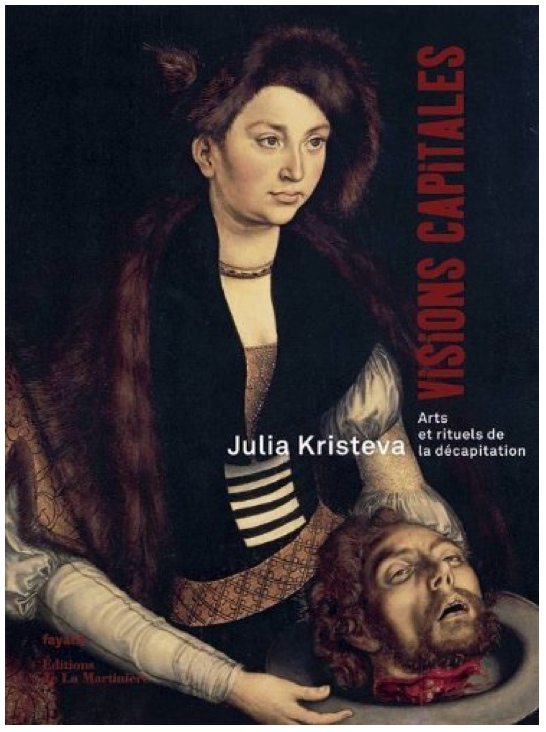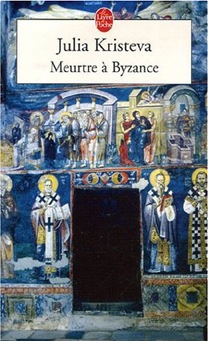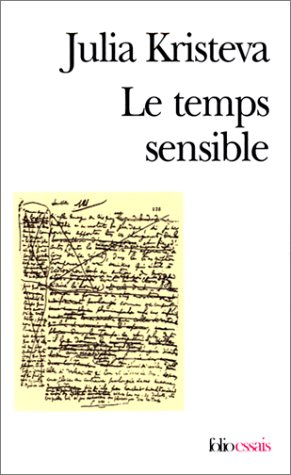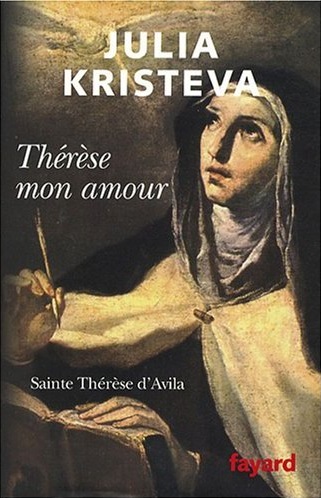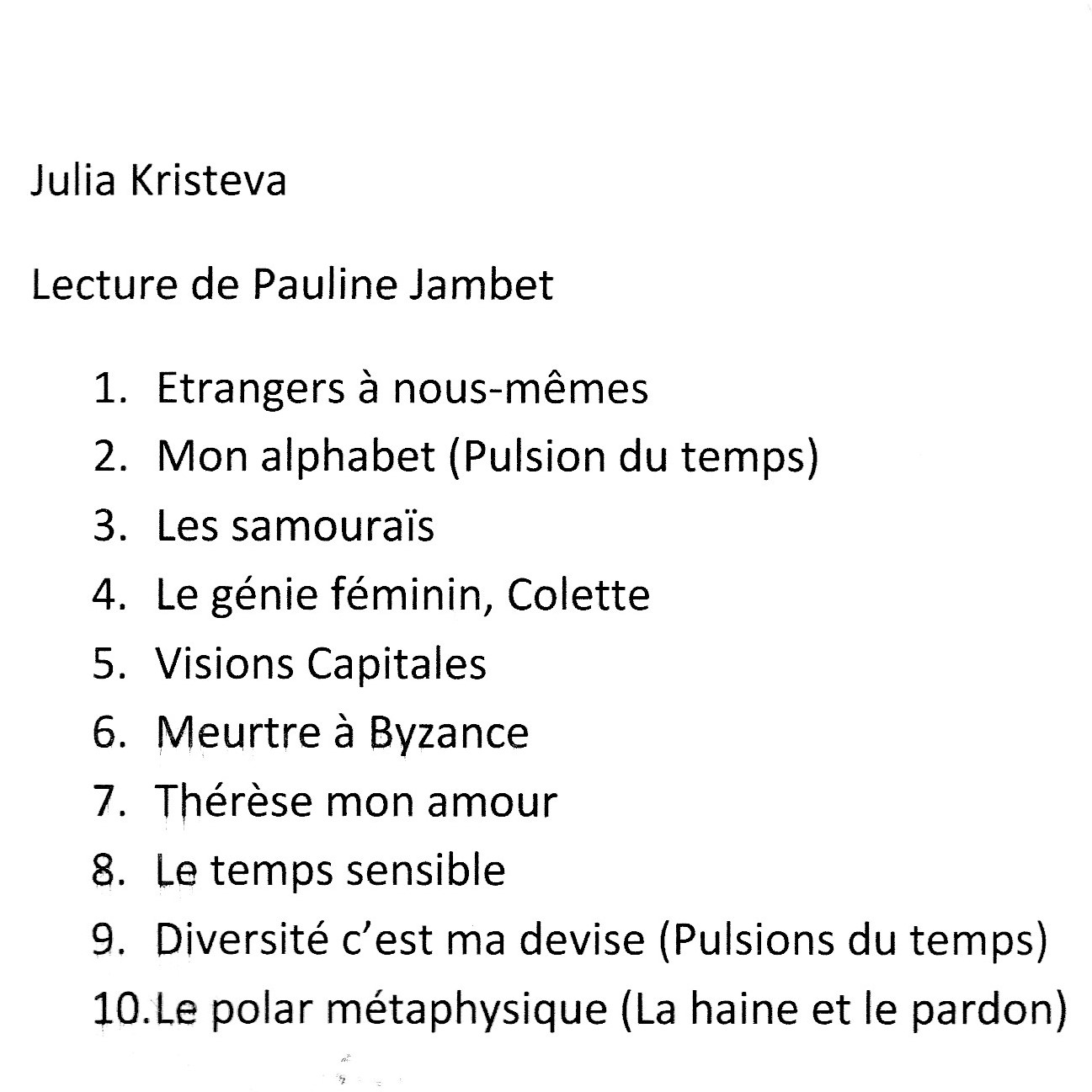|
|
||
|
Citations |
1.
Etrangers à
nous-mêmes, Fayard 1988
Toccata et fugue pour l'étranger
Étranger: rage
étranglée au fond de ma gorge, ange noir troublant la transparence, trace
opaque, insondable. Figure de la haine et de l'autre, l'étranger n'est ni la
victime romantique de notre paresse familiale, ni l'intrus responsable de tous
les maux de la cité. Ni la révélation en marche, ni l'adversaire immédiat à
éliminer pour pacifier le groupe. Étrangement, l'étranger nous habite: il est
la face cachée de notre identité, l'espace qui ruine notre demeure, le temps où
s'abîment l'entente et la sympathie. De le reconnaître en nous, nous nous
épargnons de le détester en lui-même. Symptôme qui rend précisément le « nous»
problématique, peut-être impossible, l'étranger commence lorsque surgit la
conscience de ma différence et s'achève lorsque nous nous reconnaissons tous
étrangers, rebelles aux liens et aux communautés.
L' «étranger », qui
fut l' «ennemi» dans les sociétés primitives, peut-il disparaître dans les
sociétés modernes?
Ne pas chercher à
fixer, à chosifier l'étrangeté de l'étranger. Juste la toucher, l'effleurer,
sans lui donner de structure définitive. Simplement en esquisser le mouvement
perpétuel.
S'évader de sa
haine et de son fardeau, les fuir non par le nivellement et l'oubli, mais par
la reprise harmonieuse des différences qu'elle suppose et propage. Toccatas el
Fugues: les pièces de Bach évoquent à mes oreilles le sens que je voudrais
moderne de l'étrangeté reconnue et poignante, parce que soulevée, soulagée,
disséminée, inscrite dans un jeu neuf en formation, sans but, sans borne, sans
fin. Étrangeté à peine effleurée et qui, déjà, s'éloigne.
Une blessure
secrète, souvent inconnue de lui-même, propulse l'étranger dans l'errance.
Ce malaimé ne la reconnaît pourtant pas: le défi fait taire chez lui la
plainte. « Ce n'est pas vous qui m'avez fait du tort », dénie, farouche,
cet intrépide, « c'est moi qui ai choisi de partir »; toujours absent,
toujours inaccessible à tous. Au plus loin que remonte sa mémoire, elle est
délicieusement meurtrie: incompris d'une mère aimée et cependant distraite,
discrète ou préoccupée, l'exilé est étranger à sa mère. Il ne l'appelle pas, ne
lui demande rien. Orgueilleux, il s'attache fièrement à ce qui lui manque, à
l'absence, à quelque symbole. L'étranger serait l'enfant d'un père dont
l'existence ne fait aucun doute, mais dont la présence ne le retient pas. Le
rejet d'un côté, l'inaccessible de l'autre: si l'on a la force de ne pas y
succomber, il reste à chercher un chemin. Rivé à cet ailleurs aussi sûr
qu'inabordable, l'étranger est prêt à fuir. Aucun obstacle ne l'arrête, et
toutes les souffrances, toutes les insultes, tous les rejets lui sont
indifférents dans la quête de ce territoire invisible et promis, de ce pays qui
n'existe pas mais qu'il porte dans son rêve, et qu'il faut bien appeler un
au-delà.
2.
Mon alphabet ou Comment
je suis une lettre, in Pulsions du Temps, Fayard, 2013
« Azbouka »
Aujourd’hui, 24 mai,
c’est la Fête de l’écriture, à Sofia. Ma première Fête de l’Alphabet. J’ai six,
sept ans peut-être ? Je sais en tout cas déjà lire et écrire, cela me
plaît et je progresse vite. Les Bulgares sont le seul peuple au monde à
célébrer un jour pareil : celui des frères Cyrille et Méthode, créateurs
de l’alphabet slave. Derrière l’immense effigie de ces deux moines, le pays
défile sur les grands boulevards : les écoliers, les professeurs en tout
genre – de la maternelle aux académies des sciences –, les
écrivains, les artistes, les amateurs de littérature, les parents… Tout le
monde arbore sur son plastron une grande lettre cyrillique.
Les bras chargés de
roses et de pivoines, enivrée par leur beauté épanouie et leur fragrance qui
trouble ma vue jusqu’à brouiller mes propres contours, je suis moi aussi une
lettre. Une trace parmi d’autres, une volute du langage, une hélice du sens.
Insérée dans une « règle qui guérit de tout » – comme, je
l’apprendrais plus tard, écrivait Colette qui cultivait son alphabet dans la
chair du monde – même du communisme. Et disséminée parmi tous ces jeunes
corps que le printemps a légèrement vêtus, entrelacée à ces voix offertes aux
chants antiques, à la soie des chemises et des cheveux et à ce vent ocre qui, à
Byzance ou dans ce qu’il en reste, s’alourdit d’un obstiné parfum de fleurs.
Imprimé en moi, l’alphabet a raison de moi ; tout autour de moi est
alphabet, pourtant il n’y a ni tout ni alphabet : rien qu’une mémoire en
liesse, un appel à écrire qui n’est d’aucune littérature. Une sorte de vie en
plus, « fraîchissante et rose », aurait dit Marcel Proust. Je
n’oublierai jamais ce premier 24 mai où je suis devenue une lettre.
« Alphabet »
se dit « Azbouka » en bulgare.
« Pourquoi Azbouka,
papa ? C’est étrange… “Az” (qui en bulgare veut dire “je”), je
comprends : c’est moi. Mais “bouk”, serait-ce “the book”, le
livre ? »
Après avoir terminé ma
maternelle française chez les dominicaines, et tout en continuant le français à
l’Alliance française, je viens de commencer l’anglais.
« Mais non, voyons…
Mais si, enfin… C’est du slavon, tu sais bien, du vieux slave. Az Bouki Vedi
Glagoli… : A,
![]() B,
B,
![]() V,
V,
![]() G,
G,
![]() … », me répond-il.
… », me répond-il.
Croyant orthodoxe et
féru de lettres, mon père m’accompagne jusqu’au cortège de l’école, en
m’expliquant l’étymologie du mot bulgare pour « alphabet »: AZBOUKA.
À chaque lettre nous attribuons un nom, qui n’est pas simple reprise phonétique
des lettres grecques avec leur sens renvoyant à leur invention instrumentale:
ni un mot de la vie quotidienne, comme les noms des lettres hébraïques :
« Mais une leçon de vie, prophétise papa. Une foi, si tu préfères ».
Bien entendu, je ne
préfère pas. Mon père le sait, et subit déjà tristement mon attitude de garçon
manqué et révolté qui ne rate pas l’occasion de railler ses enseignements et
convictions religieuses. Mais aujourd’hui, c’est fête : je me tais, j’écoute.
Attentivement. Car c’est ma curiosité qui nourrit ma révolte.
- « “Az”,
![]() dans “azbouka” désigne la première
lettre, le A et, comme tu l’as dit, c’est évidemment “je”, en l’occurrence
“toi”. “Bouki”,
dans “azbouka” désigne la première
lettre, le A et, comme tu l’as dit, c’est évidemment “je”, en l’occurrence
“toi”. “Bouki”,
![]() , qui équivaut à la
lettre B, signifie en vieux slave “les lettres”. “Vedi”,
, qui équivaut à la
lettre B, signifie en vieux slave “les lettres”. “Vedi”,
![]() ou V, notre troisième
lettre, veut dire “je connais”. “Glagoli”,
ou V, notre troisième
lettre, veut dire “je connais”. “Glagoli”,
![]() , pour le G, c’est “le
Verbe” ; “Dobro”,
, pour le G, c’est “le
Verbe” ; “Dobro”,
![]() , pour le D, c’est, tout
comme en bulgare moderne, “le bien ” ; “Est”
, pour le D, c’est, tout
comme en bulgare moderne, “le bien ” ; “Est”
![]() pour la lettre E, n’est
rien d’autre que le verbe “être”… »
pour la lettre E, n’est
rien d’autre que le verbe “être”… »
Lorsque mon père se
mettait en tête de m’instruire, ses leçons pouvaient être interminables. J’ai
oublié la suite des 30 lettres de l’alphabet cyrillique ainsi que leurs noms si
édifiants. Les ai-je même jamais sues ? Mais depuis ce jour, et à chaque
fête de l’Azbouka que j’ai célébrée depuis mon enfance jusqu’à mon départ pour
Paris en 1965, me revenaient ces mots : « Az bouki vedi glagoli dobro
est. » J’épinglais une grande lettre à mon chemisier de soie blanche et je
rejoignais le défilé en répétant cette formule magique. Je la tournais dans
tous les sens, décomposant, recomposant les sons, les syllabes, les mots, les
vers, les lettres, la lettre que j’étais, gravée, me mêlant aux chants, aux
roses, aux géraniums parfumés, aux drapeaux, aux slogans, au vent, à la lumière
de mai, à tout, à rien.
« Az bouki vedi
glagoli dobro est » : « Je / lettres / comprends / le verbe / le
bien / est. » « Je comprends les lettres, le verbe, donc le bien
existe, il est » ; et à rebours, la ritournelle : « le bien
est je, moi je, comprenant la lettre, le verbe et le bien. »
C’est-à-dire : « Je suis les lettres, je comprends le verbe, donc le
bien existe. » Ou encore : « En étant la lettre, je comprends le
verbe qui est le bien. » Mais aussi : « Je suis la lettre, le
verbe, le bien. » Et même : « Je suis l’écriture. »
Mieux : « Je est une écriture », car « Écrire le bien c’est
être », en clair : « Le Verbe ne fait que s’écrire en moi pour
que le bien soit. » Et cetera. Az
bouki vedi gragoli dobro est.
Les dessins des lettres,
les syllabes et les mots ne tenaient plus en place, se mettaient à danser et
m’emportaient en un tourbillon halluciné et lucide. Je retournais les courbes
et les jambages, les sons et les leçons du slavon perdu renaissaient dans ma
bouche, sous ma langue, sur ma poitrine, dans mes doigts. J’en pressais
l’antique mélodie à l’aide du bulgare actuel, je retraçais la graphie et j’en
volais le sens, je l’incorporais, le recréais. L’alphabet revivait en moi, pour
moi, je pouvais être toutes les lettres. Pour cette première fête, je suis la
lettre A,
![]() , az, moi. L’année
suivante je choisirai peut-être G,
, az, moi. L’année
suivante je choisirai peut-être G,
![]() , glagoli, verbe. Ou
pourquoi pas Z,
, glagoli, verbe. Ou
pourquoi pas Z,
![]() , zemlja, la
terre ? Ou encore P,
, zemlja, la
terre ? Ou encore P,
![]() , pokoi, la paix. L’Azbouka
renaît en moi en un présent infini, je est une lettre, je est les lettres. Et
voilà que nous nous rassemblons à quatre, cinq, dix, vingt, trente corps de
filles et de garçons, de femmes et d’hommes, pour former un mot, une phrase, un
vers, une idée, un projet… L’alphabet est devenu mon organe pour jouir du temps
hors du temps.
, pokoi, la paix. L’Azbouka
renaît en moi en un présent infini, je est une lettre, je est les lettres. Et
voilà que nous nous rassemblons à quatre, cinq, dix, vingt, trente corps de
filles et de garçons, de femmes et d’hommes, pour former un mot, une phrase, un
vers, une idée, un projet… L’alphabet est devenu mon organe pour jouir du temps
hors du temps.
Cette histoire culmine pour moi dans la Prière de l’Alphabet de Constantin de Preslav, un autre disciple des deux frères, et qu’adorait mon père. J’avais un père qui priait pour l’Alphabet. Plus tard, en me rendant visite à Paris, papa allait dire sa Prière de l’Alphabet à Notre-Dame. Elle était composée de trente-neuf vers, commençant chacun par une lettre de l’alphabet, selon leur ordre d’apparition dans notre Azbouka. Je ne comprenais pas tous les mots du slavon d’église qui tissaient cette prière, mais j’entendais, vers par vers, s’égrener la mélodie des lettres de l’alphabet et je restituais leurs noms tels que je les avais entendus ce premier jour de 24 mai où je suis devenue une lettre de l’alphabet : « Az bouki vedi glagoli dobro est », « Je suis la lettre qui connaît le bonheur de la parole écrite. »
3.
Les Samouraïs,
Fayard 1990
Monologue de Hervé Sinteuil pensant à Olga Morena
« Viens mon amour,
viens par ici. Tu te demandes si je suis un révolté, un inconstant, un
jouisseur? Tu le sais déjà - tu seras la seule à savoir - que je suis de ceux
auxquels on peut faire confiance. Surprenant, non? Pour certains. Pas pour toi.
J'ai été un enfant gai au paradis des vignes et des châteaux. Je me suis
longtemps plu avec les enfants tristes, j'ai aimé sous le soleil de Satan. Je
connais cette rhétorique d'amoureux mi-graves mi-décadents, je peux te la
rejouer, les femmes aiment bien ça. Oui, j'étais croyant, d'un catholicisme
haut et retors, tauromachique, si tu veux, pas français en tout cas. J’ai été
l'aimé des femmes qui croyaient aimer des hommes pour se faire plaisir à
elles-mêmes ou entre elles. L'aimé des fées, m'a dit quelqu'un, justement.
Peut-être. Pourquoi pas, aussi, des sorcières sous un masque de nymphes?
« Je
continue? Tu aimes ce conte courtois d'aventuriers contemporains, donc
désabusés? Carmen? Elle m'a violé, mais j'ai guéri; elle m'a quitté, mais j'ai
grandi. Puis est venue Solange, qui m'a enveloppé comme une tante maternelle,
j'étais son fétiche, l'homme entretenu, l'enfant prodige. Je l'ai renversée de
plaisir, j'ai cassé son rôle de dominatrice, elle s'est mise à une place
insoupçonnée, indélogeable parce que humble, ma gouvernante perverse. Et ainsi
de suite, j'arrête là pour aujourd'hui, tu les connais, tu les connaîtras. Les
femmes me servent et je les sers.
« Tu vois, les
événements me donnent raison: tous les couples sont et seront désormais
bizarres. Ma solitude deviendra un produit de supermarché. Cependant, je suis
et serai toujours hors cadre; une étrangeté, tu le sais. Une foule d'exceptions
qui me ressemblent me poussent à aller plus loin encore, je cherche
l'inaccessible paradis de ma bizarrerie que les autres rejoindront peut-être,
je veux bien, mais seulement en état de bonheur secret, incommensurable. En me
lisant, par exemple.
« Et toi, mon
Écureuil, que viens-ru faire là-dedans? Je suis descendu te chercher en enfer,
et si ce n'est pas encore fait, je le ferai. Je descendrai sous terre: te
souviens-tu comme je me suis couché sur le quai Blériot, un peu soûl
(croyais-tu)? Mais non, car en amour on a envie de briser l'écorce terrestre,
de renverser le globe. Depuis les frontières d'Asie ou d'une steppe que je n'ai
pas envie de connaître, jusqu'à ce Fier avec ses églises romanes, tu as refais
(et moi avec toi) la migration des Barbares. Nous sommes en avance sur notre
temps; tu vas voir, dans vingt ans, ils auront tous un amant ou une maîtresse
venus de l'Est. L'Europe - depuis notre moulin caché dans les marais jusqu'aux
neiges de Moscou, et plus loin encore - sera un même immense chantier dirigé
par des contremaîtres allemands. Tu es mon souffle, ma biographie, un trait
d'union pour demain.
« Tu te
souviens du voyageur au bout de la nuit que tout le monde exècre maintenant,
sacré voyou sensible? Il nous voit, nous, Français, comme la race la plus
fatiguée d'avoir fait le voyage le plus long: tu imagines, du fond de la
toundra à l'Atlantique, comme cela peut être épuisant, en effet! Seuls les plus
tenaces y arrivent, peut-être les plus doués, mais en quel état! Eh bien, tu es
en bon état, mon Écureuil, et moi aussi, et on a plein de choses à faire sur
cette terre de clochers qui est en passe de devenir un vrai musée, une proie
pour collectionneurs et antiquaires. Mai a bousculé pour un moment ce train-train.
Toi aussi, le mien.
« Je t'aime
parce que tu n'es pas dupe. Pas trop. Tu sais que tu as épousé l'insaisissable,
la révolte permanente, pour parler comme on parle aujourd'hui. Je me sens
Vieux-Français, par moments, j'aime trop le bordeaux, les cèpes, l'entrecôte.
Les Montlaur n'ont pas été assez fossilisés pour que je veuille détruire toute
la tradition. Il reste, dans ces vieux châteaux, tant de bagages à embarquer
avec nous pour d’autres couchers de soleil ! »
4.
Le Génie féminin,
Colette, Fayard 2002
Lancée dans un
combat acharné pour affirmer sa liberté de femme et sa signature d'écrivain, et
avant d'être couronnée par une réussite des plus académique, Colette impose
dans les lettres françaises une sensualité qui défie le refoulement plus ou
moins chaste des gens convenables, mais sans revendiquer pour autant un
érotisme triomphal dans lequel vont s'illustrer ses consœurs dites « libérées
», ni, non plus, à l'opposé, une décence doloriste plus conventionnelle.
Provocante, scandaleuse par l'audace de ses mœurs et de son parcours, cette
femme attachante refuse de s'enfermer dans un quelconque militantisme et ne
prêche aucune transgression. Elle parvient à donner à son expérience de liberté
sans complexe le langage d'une profusion maîtrisée par une rhétorique
classique, qui renvoie les lecteurs modernes à la sérénité du miracle grec.
Fallait-il être
l'étrangère que je suis pour se laisser fasciner par sa sorcellerie, qui ne
serait donc pas seulement française, mais, peut-être, sait-on jamais,
universelle? Alphabet pour alphabet, je me souviens des 24 mai de mon enfance,
jour de la fête de l'Alphabet cyrillique. Chargée de roses et de pivoines,
soûlée de leur beauté épanouie et de leurs fragrances qui me brouillaient la
vue jusqu'à me faire perdre mes propres contours, j'arborais, à chaque défilé,
une lettre différente de l'alphabet slave. J'étais une trace parmi d'autres,
insérée dans une « règle [qui] guérit de tout» - même du communisme -, et
cependant disséminée parmi tous ces jeunes corps dénudés par le printemps,
entrelacée dans les voix offertes aux chants antiques, dans la soie des
chemises et des cheveux, et dans ce vent ocre qui, à Byzance ou dans ce qu'il
en reste, s'alourdit d'un obstiné parfum de fleurs. Imprimé en moi, l'alphabet
avait raison de moi, tout autour de moi était l'alphabet, pourtant il n'y avait
ni tout ni alphabet: rien qu'une mémoire en liesse, un appel à écrire qui
n'était d'aucune littérature, une sorte de vie en plus, « fraîchissante et rose
», comme aurait dit Marcel Proust.
En durcissant sa
juste cause, un certain féminisme a enfermé la lutte pour 1'amélioration de la
condition féminine dans les seules revendications politiques ou sociologiques
des suffragettes. Cette tendance se ressent aussi dans Le Deuxième Sexe, même
si Simone de Beauvoir y prône l'émancipation des mœurs. Au contraire, Colette,
qui ignore la politique, ne songe qu'à révéler la jouissance féminine. De fait,
son alphabet du monde est un alphabet du plaisir féminin, soumis au plaisir de
l'homme, mais affecté d'une incommensurable différence par rapport à celui-ci.
Qu'il n'y a pas d'émancipation féminine sans une libération de la sexualité de
la femme, laquelle est fondamentalement une bisexualité' et une sensualité polyphonique:
c'est ce que Colette ne cesse de clamer tout au long de sa vie et de son œuvre,
dans un dialogue permanent entre ce qu'elle appelle «le pur» et «l'impur », et
en se décrivant d'emblée comme un« hermaphrodite mental ».
Plus encore, et
contrairement à une autre image facile qu'on s'est forgée de Colette, cette
gourmande de plaisirs sexuels fut aussi une femme dont l'œuvre est une
perpétuelle évasion de la relation amoureuse et un arrachement permanent à la
vie de couple (hétérosexuel ou homosexuel) au profit d'une immersion dans
l'infini du monde. Nul, mieux que Colette, n'a saisi combien la vie érotique
est dominée par les pulsions, d'une part, et par les liens à l'objet ou au
partenaire, de l'autre. Nul, mieux qu'elle, n'a su écrire comment la liberté
d'une femme ne se conquiert qu'à la condition de s'arracher et à ses pulsions
et à l'autre; et cela, moins pour accéder à une fusion mystique avec le Grand
Autre, que pour s'immerger dans un orgasme singulier avec la chair du monde.
Expérience hardie,
à la fois cruelle et apaisante, la transmutation de l'amour en style sera
réalisée, tout au long de sa vie, par Colette l'écrivain. A trente-six ans,
quand elle publie sous le nom de Colette Willy, elle cherche déjà « un amour,
différent de l'Amour, [qui] peut fleurir dans l'ombre même de l'Amour» ; avant
de préciser, sous le nom de Colette, à cinquante-cinq ans, qu'« une femme [ ...
] naît sous chaque ciel où elle guérit la douleur d'aimer », et que, si
elle apprécie« la joie intelligente de la chair », elle préfère ces «
profondeurs où l'amour, superficielle écume, n'a pas toujours accès ». Et
elle exprime cette conviction, enfin, qui scandalisera nos chantres
postmodernes amoureux de l'Amour: «Une des grandes banalités de l'existence,
l'amour, se retire de la mienne [ ... ]. Sortis de là, nous nous apercevons que
tout le reste est gai, varié, nombreux.»
Substitut de
l'amour, ce lien de l'écriture selon Colette est en effet lyrique, poétique,
et, s'il emprunte les voies du récit, il ne s'y tient pas. Que raconter si rien
n'est interdit? Puisqu'une narration, depuis la nuit des temps, ne fait que
retracer les épreuves nécessaires à la quête - transgression, interrogation,
punition ? Immergée dans l'instant du plaisir, Colette peine à raconter des
histoires : ses contes éclatés nous bouleversent surtout par les flashes
sensuels et les méditations sur la guerre des sexes, et fort peu, voire pas du
tout, par leurs intrigues répétitives et plutôt banales. Le temps du récit
s'éclipse chez Colette, ses vaudevilles désuets se fanent et vieillissent mal,
mais demeure intacte la poésie du pur temps incorporé, à l'instar de celui
inventé de Proust, que Colette remodèle à sa façon: moins métaphysique, plus
gai, d'une sensualité plein la bouche, plein la langue. Cette fanatique de
Balzac (« Je suis née dans Balzac» - elle l'a lu dès six ans, et Labiche à
sept) a hérité de lui le talent de dépeindre les excès de la passion amoureuse,
et non les drames de l'argent. Mais c'est dans le voyage au bout de la nuit
passionnelle qu'elle imprime son véritable génie, et en ce sens qu'elle s'en
évade. Son chemin ne sombre jamais dans les ornières scatologiques ou
blasphématoires d'un Céline ou d'un Proust. Si Colette partage avec les maîtres
du roman contemporain l'art poétique de capter le temps sensible, elle le fait
à sa manière incomparable, avec cette inhumaine sérénité qu'épouse la
jouissance de l'homme et de la femme lorsqu'ils s'accordent avec la chair du
monde. Car si «je » me réconcilie avec 1'« objet » (objet primordial, objet
maternel, objet d'amour), il n'y a plus de « sujet» ni d'« objet », et le« moi»
se dissémine, incorporé dans l'écriture de l'Être.
5.
Visions Capitales, La
Martinière, 2013
Du dessin, ou la vitesse de la pensée
Nulle distance entre la
pensée et la main. Nul tâtonnement : l’esprit de l’artiste, identifié au geste,
taille l’étendue, découpe ombres et lumières, et, sur l’extériorité plane d’un
support, tel le papier, fait surgir le volume d’une intention, d’un
jugement, d’un goût. Opérant avec
des moyens ténus – traits et vides –, le dessin associe non
seulement la contemplation à l’action, mais aussi et surtout le
dessinateur à celui qui regarde, dans la certitude fulgurante
qu’ensemble ils créent le visible. Le dessin : indice majeur d’une
humanité subtilement conquérante du dehors et de l’autre qu’on appelle un
talent.
Peut-être cette
perception du dessin me vient-elle de ce que la première personne de ma
connaissance qui en ait été capable est ma mère. Un visage, un paysage,
un animal, une fleur, un objet revivaient à l’improviste sous
son crayon, d’une précision d’autant plus surprenante qu’elle lui était
naturelle : sans se forcer, sans y penser, l’air de rien, ma mère
dessinait comme d’autres respirent ou brodent. Ce don lui paraissait à elle-même
banal, elle n’en tirait aucune fierté, jamais il ne lui serait venu à l’esprit
de se prendre pour une artiste, « cela » allait de soi. Avec l’âge, je réalisai
combien ce naturel la distinguait des autres, la rendait supérieure aux
autres. Et pour commencer, à moi-même, qui parvenais tant bien
que mal à peindre un tableau, à force de couleurs et de
coups de pinceau, mais ne réussissais jamais à inscrire l’instant
des êtres, dans cette ellipse spontanée ou conception et exécution ne
font qu’un, et qui confère cette grâce concise à l’art graphique.
Un dessin reste gravé
dans ma mémoire, qui m’a été donné avec nonchalance mais comme une
élection, ainsi que seuls savent le faire les êtres doués et les mères.
C’était un de ces hivers blancs et froids qui congèlent les Balkans et
réunissent les familles autour des poêles à charbon. Penchée sur la
plaque rougeoyante, je réchauffais mes joues glacées et mes doigts gourds
en écoutant distraitement une émission de radio destinée aux enfants : «
Quel est le moyen de transport le plus rapide au monde ? Envoyez-nous
votre réponse, avec le dessin correspondant, sur carte postale, à l’adresse
suivante… » « Je sais, c’est l’avion », s’empressa de répondre ma jeune sœur.
« Pas du tout, la fusée », avançai-je, contente d’avoir le dernier mot. «
Je dirais plutôt que c’est la pensée », compléta maman. Je ne pouvais que
m’incliner, non sans essayer une coutumière insolence : « Peut-être, mais
on ne peut pas dessiner une pensée, c’est invisible. – Tu vas voir.
» J’ai encore devant les yeux la carte qu’elle dessina en mon nom et qui
me valut le premier prix du jeu radiophonique. Un grand bonhomme de neige
est en train de fondre dans la partie gauche, la tête tombante, comme tranchée
par l’invisible guillotine du soleil. A droite, le globe terrestre sur son
orbite interstellaire propose ses étendues imaginaires à des voyages
immobiles.
En fait, ce dessin
n’avait rien d’exceptionnel. Mais à mes yeux d’enfant, il révélait
subitement cette vitesse de la pensée que je louais dans la réponse
suggérée par ma mère. Le dessin la laissait voir aussi bien dans
la concision de son concept (un corps périssable se transcende et se
transfère par la puissance du raisonnement) que par la rapidité enjouée
du contour (sans tomber dans la caricature, le tracé nerveux et plein
d’esprit trahissait la mélancolie de notre condition mortelle, en même
temps que l’ironie triomphante d’une intimité qui réfléchit).
Ce dessin dont ma mère
ne se souvient plus guère me revient par intermittence ; tout récemment encore,
j’ai cru me reconnaître dans l’histoire d’une femme décapitée. Je sais
que sous ses traits sont nouées mes angoisses de mort : mon corps est
aussi passager que ce bonhomme de neige qui commence par perdre la tête
avant de s’effacer dans une flaque d’eau. Et une de ces certitudes que
les mères, parfois, nous transmettent : la seule incarnation crédible ne
serait-elle pas celle de la pensée, qui sait dessiner les êtres parce
qu’elle est apte à saisir les vecteurs de sa propre vitesse ? A
les saisir dans le sensible, au-delà du sensible, en tranchant dans le
sensible.
C’est à ce pauvre dessin
que je reviens aujourd’hui, ou je prends le parti de rassembler quelques
visions capitales et de faire apparaître la force du dessin, à la
frontière du visible et de l’invisible.
Avant qu’il ne
commence à parler, le tout petit enfant devient irrémédiablement
triste. Cet état passager, qui a été désigné comme une « position
dépressive », correspond à l’expérience d’un deuil précoce et
constitutif : il transforme le bébé auto-érotique qui jouit de son corps
morcelé, des mamelons de sa mère, d’un chiffon ou d’une poupée, en être
parlant. Comment ? Jusque-là, le futur parlant émettait des vocalises qui
n’étaient que les « équivalents » de ses besoins et de sa dépendance du
corps maternel : je qualifie ces équivalents de « sémiotiques » (du grec semeion:
marque distinctive, trace, indice, signe précurseur, preuve, signe gravé
ou écrit, empreinte, figuration). A partir d’une certaine maturation
neuropsychique et de soins parentaux bénéfiques, le nourrisson devient
capable de supporter l’absence de sa mère : la séparation et le manque le
font souffrir, il se convainc qu’il n’aura pas tout, qu’il n’est pas
tout, qu’on l’a laissé tomber, qu’il est seul. De ce premier deuil, certains
ne se remettent pas : si maman est comme morte, ne dois-je pas à mon
tour mourir à moi-même, ni manger ni parler ? La plupart,
toutefois, remplacent le visage absent, aussi aimé que redouté, source de
joie et d’effroi par…une représentation. J’ai perdu maman ? Non, je
l’hallucine : je vois son image, puis
je la nomme. De mes gazouillis qui étaient son équivalent
sémiotique, je fabrique à présent des mots-signes : le signe n’est-il
pas, précisément, ce qui symbolise l’objet en l’absence de l’objet
? Ce qui représente arbitrairement ou par convention son référent
perdu.
La tristesse du futur
parlant est, en somme, un bon augure : elle signifie qu’il ne peut
désormais compter que sur lui-même, que le deuil de l’autre le
plonge dans un désarroi indélébile, mais qu’il n’est pas impossible
de compenser ce décollement… en prenant sur soi. En se concentrant sur sa
propre capacité à représenter, en investissant les représentations
dont il est capable, ses représentations de cet autre qui l’a laissé
tomber, qui meurt pour lui tout en le faisant mourir. La phase dépressive
effectue ainsi un déplacement de l’auto-érotisme sexuel à un
auto-érotisme de pensée : le deuil conditionne la sublimation. A-t-on
bien pris la mesure de ce que nos langues, dites maternelles, sont de la
sorte doublées de deuil et de mélancolie ? Que nous parlons au-delà de la
dépression comme d’autres dansent au-dessus d’un volcan ? Un corps me
quitte : sa chaleur tactile, sa musique qui flatte mon oreille, la vue
que me donnent sa tête et son visage sont perdues. A cette disparition
capitale, je substitue une vision capitale : mes hallucinations et mes mots.
L’imagination, le langage, par-delà la dépression : une incarnation ? Celle qui
me fait vivre, à condition que je continue à représenter,
sans cesse, jamais assez, indéfiniment, mais quoi ? Un corps qui m’a
quitté(e) ? une tête perdue ?
6.
Meurtre à Byzance,
Fayard 2004,
Portrait de Stéphanie Delacour
Vous voulez mon
adresse? J'habite les géraniums citronnelle, leur terreau humide hier,
aujourd'hui desséché, je me coule dans l'eau douce que je verse à leurs pieds,
que je bois avec leurs touffes foisonnant sur la rocaille, que je pétris en
petites fleurs mauves et timides au feu du soleil.
Ces fleurs coriaces
cramponnées à la croûte du volcan terrestre ne me sont qu'un refuge temporaire,
un seuil provisoire. Je m'y accroche comme une abeille ou une mouche avide
et ivre, éphémère amante de pollens parfumés, de couleurs innommées. Les
géraniums ne me lâcheront pas, je connais bien leur obstination d'enracinés, et
cependant je les oublie aujourd'hui, car la certitude m'envahit d'appartenir à
une lignée de voyageurs. Je ne me sens vraiment chez moi qu'en avion, loin des
racines et entourée d'inconnus, sans frontières: à cette altitude, l'espace
n'est à personne.
Je suis de la race
sans race des cavaliers des steppes, des caravaniers du désert, des migrateurs
d'aéroports. Dès que j'atterris, que mon pied se pose sur un sol, que mes
oreilles perçoivent une langue apparemment compréhensible et que mes yeux
croisent des regards censés me connaître, je m'invente absente.
Je ne me retire pas
au fond de moi, puisque ce fond se dérobe, mais je passe dans un entre-deux, ni
fond ni surface. Dans le vide, on me prête plusieurs langues, je n'en ai
aucune. Je ne m'exprime ni en mots ni en phrases, comme font les autres dans
leur langue maternelle, bien que j'aime à tracer des rythmes et des visions
plus aisément en français, car c'est la langue de mon fils, une langue
désormais infantile pour moi aussi, et cependant méditée, précautionneuse comme
l'est celle des enfants demeurés longuement mutiques - des huîtres qu'on a
prises pour des pierres.
Plus et moins que
les mots et les phrases, c'est le dessous de la langue que je sens couler dans
ma bouche, s'échapper de mes doigts quand j'écris mes reportages de Santa
Barbara ou d'ailleurs. Certains de nos lecteurs, locuteurs natifs, ressentent
mon expression comme empruntée, froide ou lointaine - «Vous allez trop loin, ma
chère Stéphanie», ponctue mon chef de service, heureux limité! Et moi-même je
ne m'oublie pas vraiment dans le jus de cette coquille de mots, comme font les
autochtones dans leurs babils maternels. Mais, toujours retenue par les
voyelles, consonnes et syllabes, je vais à la rencontre d'un insaisissable feu
follet sous l'écorce des signes, humeur et sens, bonté méchante et naïve,
fluide, fleuve fuyant sans cesse changeant, où le fameux vieux sage ne saurait
jamais se baigner deux fois dans le même. Non, jusque dans mes rêves les plus
triomphants, les plus insensés, je ne me prends pas pour une présocratique. Je
ne suis, s'il m'était possible de fixer le verbe au présent, qu'une Byzantine.
Qui est-ce ?
Étrangère, je sais
que je viens de Byzance, qui n'a jamais existé si ce n'est dans mon âme de
femme, sans réalité bien crédible. Après la Grèce qui, pour la première fois au
monde et mieux que personne, célébra le Beau et le Bien en lieu et place des
dieux, de Dieu, dans des temples splendides, et avant l'arrivée des Barbares qu'elle
ne cessa de repousser, de féconder et de résorber, ma Byzance à moi fut le pays
crucifié par excellence, sans doute parce qu'elle se plaisait dans une
sophistication jamais atteinte, je crois. C'est bien ça, vous y êtes! Les
sempiternels et incongrus débats sur le sexe des anges, c'est Byzance. Les
ravages des iconoclastes et les images sanctifiées des iconodules sans lesquels
le monde n'aurait jamais connu la télévision, les Guy Debord, Loft Story et un
Ben Laden plus ou moins virtuel sur Al-Jazira, c'est encore Byzance. La
première guerre de religion sur le Vieux Continent, ces légendaires Croisades
qui inspirent dorénavant le président Bush, avec pogromes, saccages de trésors,
tentatives ratées (déjà!) d'unification européenne et de globalisation au-delà,
oui, «globalisation» puisque les Croisés allèrent au-delà de l'Europe jusqu'au
tombeau du Christ envahi par les mécréants, vous vous souvenez? - c'est encore
et toujours par Byzance que ça passe. De ce point de vue, et pour moi, Byzance,
c'est l'Europe dans ce qu'elle a de plus précieux, raffiné et douloureux, que
les autres lui envient et qu'elle a du mal à assumer, à prolonger, à moins que
... qui sait?
Depuis peu, une
humanité en transit tente de s'exprimer, embarrassée dans sa no man's langue,
car plus à l'aise dans les spots visuels et les mixages sonores que dans ces
plaisirs de bouche qui rehaussaient les idées de nos ancêtres. J'exagère? Bien
sûr! Nabokov a bien quitté le russe et séjourné dans le français tout en
s'installant confortablement, et pour de bon, dans un anglais saturé de
vibrations slaves. Beckett n'a-t-il pas réalisé son matricide en atterrissant
dans la langue de Voltaire, qu'il ne cesse pourtant de vider de sa substance
pour se venger des profusions de Joyce et attendre Godot dans la maigreur du
doute protestant ou cartésien, au choix? Naipaul, enfin, transfère le continent
indien dans un anglais qui résonne comme un code cosmopolite, bien au-delà du
pathétique et musical shakespearien, écoutez le rap paumé de la mondialisation.
Et Untel, et Untel... A mon tour je loge dans le français, mais il me cache
plutôt qu'il ne me révèle et, à travers son armure chevaleresque, il n'y a que
les secrets de Byzance que j'essaie de faire transpirer. Si j'ai tendance à
croire que la vérité est en sous-langue dans l'invisible, serait-ce là une
résurgence byzantine, tardive greffe biblique dans le corps du miracle grec,
qui préféra contourner la clarté homérique au risque de creuser des abîmes de
complications forcément, tragiquement inutiles? Ma Byzance, vous l'aurez
compris, n'est pas un pays de cocagne que l'imagination populaire accole
aujourd'hui à ce vocable plutôt grinçant, ma Byzance fait tout bonnement signe
vers l'innommable ou ce qu'il vous plaît de ne pas révéler.
7. Proust et l’expérience littéraire. Le temps sensible, Gallimard 1994, Postface
Je veux faire
croire aussi, parce que j'en suis sincèrement persuadée, que je me soucie de
quelques autres. De mon fils, en premier lieu. Ses premiers pas, ses
balbutiements, ses études, ses amours, ses succès, ses échecs - tout cela
m'intéresse, j'y cours, je me dépense, j'assure, je prévois. A vrai dire, le
moindre signe qui vient de lui me fait fondre. Ceux que nous aimons nous
privent de nos moyens, de telle sorte que la raison, qui bâtit toujours une
logique de l'action, tourne court. D'abord parce qu'on est prêt à tout arrêter,
à simplement jouir dans l'instant où cet enfant, cet homme, cette femme nous
donne une impression qui coïncide avec un territoire secret, indicible, un peu
honteux, qu'on ne saura jamais communiquer. L'amour n'est ni un intérêt ni un
rêve, mais l'identification absolue, la refonte des frontières. Plus de « je»,
aucune limite. A partir de là, on peut s'apercevoir que ce qui « fond» c'est
bien « moi». Que cet enfant, cet homme, cette femme en sont le prétexte. Et que
la délicieuse catastrophe dite amour se joue entre les éléments de mon
histoire. Un court-circuit dans l'espace inconscient qu'alimente bien sûr
quelqu'un d'autre, mais un autre tel que je le vois.
Franchement, tant
de pages lues et écrites pour en arriver à ce quotidien, à cette banalité?
L'impatience perdue apprivoise le terne visage du banal. Elle y entrevoit la
bonté que le quotidien s'acharne à dissimuler, à détruire. Le tribunal du
surmoi, qui a raison de se révolter contre la bassesse du banal, devrait
apprendre le pardon. Savoir donner du sens aux broutilles ne signifie pas en
effacer l'insuffisance. Le pardon confère une signification à l'infiniment
petit, même à l'infiniment abject. Sans les rehausser, il leur permet de se
refaire une vie. Le pardon est la bonification de l'idiotie en imaginaire. Le
pardon s'énonce en roman.
Je ne devrais me
soucier que de ma mémoire involontaire et éventuellement de sa mise en forme.
Mais Proust l'a déjà fait, et j'ai choisi de l'accompagner. Nous sommes dans
l'après-midi de cet accompagnement, et pourtant il reste tant de choses à
faire. Un projet, fût-il celui de lire une expérience passée, est une fuite en
avant qu'on peut essayer de poursuivre sans impatience. Cette fuite est
virtuellement infinie, comme l'est le temps jeté en avant de lui-même. De plus,
attentive à l'aventure proustienne, une échappée peut aussi s'échapper
d'elle-même, pour inlassablement revenir en arrière et à côté. Retarder la fin,
s'attarder, empiler les enchâssements et les métaphores. Il vaudrait mieux
s'arrêter au provisoire, provisoirement. Nous allons voir une autre fois.
Voire. L'autre fois, plus tard ou jamais. Compter avec jamais. S'en tenir au
fragment. Travailler par touches, ambitieux et interminables arrêts. Une façon
de concilier la curiosité avec l'instant; l'inquiétude de l'enquête et du sens
avec la sensation qui est plénitude dérobée, infléchie. C'est dans l'ouverture
de l'incomplet, dans le suspens, que nous attend, peut-être, la chance
d'éprouver le temps sensible. Sentir le temps se perdre, mais rechercher, donc
nommer, l'expérience de cette dissolution. À l'embouchure de la durée qui
signifie et de la perception encore ou déjà insensée, à la bordure entre « je »
et « Être » : ce kaléidoscope d'impressions et de caractères qui balisent un
espace démesuré, de Combray à la Fin, de « Longtemps je me suis couché de bonne
heure» à « une place au contraire prolongée sans mesure [ ... ] dans le
Temps ». Longtemps le Temps. En prolongeant l'enfance et la sensation, en
différant la mort et le sens. Ni impatients ni ravis, entre deux, le temps d'un
roman.
8.
Thérèse mon amour,
Fayard 2008
Je vous salue,
Thérèse, femme sans frontières, physique érotique hystérique épileptique, qui
se fait verbe qui se fait chair, qui se défait en soi hors de soi, flots
d'images sans tableaux, tumultes de paroles, cascades d'éclosions convel1ies en
langues à l'écoute de qui de quoi, écoute le temps gravé, tympan gorge cri
écrit, nuit ct lumière, trop de corps et sans corps, hors matière, matrice vide
béante palpitante pour l'Aimé toujours présent sans jamais être là, mais il y a
être et être, II est en elle, elle en Lui, pressenti senti englouti, sensation
sans perception, dard ou cristal, transpercée ou transparente, telle est la
question, transverbération plutôt et encore inondation, la Madre est le plus
viril des moines, le plus adroit des meneurs d'âmes, un jumeau du Christ, elle
est Lui, Lui est elle, la Vérité c'est moi, c'est Lui au fond intime de moi,
moi Thérèse, parano réussie, Dieu c'est moi et alors! qu'est-ce? un festin pour
tous, qui fait mieux'? certainement pas Schreber, même pas Freud, trop sérieux
ce Viennois, triste peut-être, la femme trouve plus facilement comment dire
tout ça. quoi ça, mais elle, voyons, elle hors d'elle, évidemment, saisie
d'effroi et de délices, le petit papillon expire avec une indélébile joie car
Jésus est devenu lui c'est-à-dire elle, Jésus papillon, Jésus femme, je connais
une personne qui sans être poète compose aussitôt des poèmes, des romans qui
sont des poèmes avec quelque chose de plus, des mouvements en plu, vraiment je
me demande si c'est moi, Thérèse, qui parle, le chemin c'est la souffrance, le
Néant de tout, ce tout qui n'est rien, faites ce qui est en vous, mais en
allégresse. soyez gaies mes filles, depuis vingt ans j'ai des vomissements tous
les matins, maintenant c'est le soir et ça vient plus difficilement, je suis
obligée de les provoquer à l'aide d'une plume ou autre chose, tel un bébé ou si
vous préférez une bébée à la mamelle de l'Autre, mariage mystique ou bien
mariage spirituel. ce petit Jean de la Croix y voit une différence, moi à
peine, c'est l' mers et J'endroit, plutôt, Cantique des cantiques, comme
toujours et encore, elle chante faux mais écrit juste et ne cesse de fonder ses
couvents, ses filles, son Église, sa gestation à elle, son jeu, un jeu
d'échecs, il est permis de jouer, oui, oui, même dans les monastères. surtout
dans les monastères, Dieu nous aime joueuses, mes filles croyez-moi, Jésus aimait
les femmes, pourquoi cet effroi à notre égard chez les docteurs, oui, échec et
mat à Dieu aussi, oui, oui, Thérèse ou Molly Bloom, enfin je ne sens plus rien,
je me coule dans l'eau du jardin, on s'écoule, on ne fait que jouir, les âmes
qui aiment voient jusqu'aux atomes, mais oui, pour une âme comme la mienne tout
est oui, elle voit jusqu'aux atomes infinis qui sont des atomes amoureux, les
philosophes ne s'en doutent pas, ils deviennent lettrés, ils redoutent vos
sensations, les meilleurs se font mathématiciens, ils apprivoisent J'infini, et
pourtant c'est aussi simple que ça, mais oui, métaphores transmuées en
métamorphoses, à moins que ce ne soit le contraire, mais oui, Thérèse, oui, ma
sœur, invisible, extatique, excentrique, hors de vous en vous, hors de moi en
moi, oui, Thérèse mon amour, oui.
9. « Diversité, c’est ma devise », in Pulsions du temps, Fayard, 2013
« Diversité, c’est ma devise ».
Ainsi s’exprime Jean dea Fontaine, dans « Pâté d’anguille ». Quel génie
plus français que celui du fabuliste ? Pourtant, n’en déplaise aux avocats de
la célèbre « diversité culturelle » française, nombreux sont ceux qui
suspectent notre pays de ne chérir que sa propre diversité.
Citoyenne européenne, de nationalité française, d’origine bulgare et d’adoption
américaine, je l’ai écrit dans Etrangers
à nous-mêmes : « Nulle part on n’est plus étranger qu’en France,
nulle part on n’est mieux étranger en France ». Mais je fais mien le pâté
d’anguille de La Fontaine, car la France n’est jamais plus française que quand
elle se met en question, jusqu’à rire d’elle-même – et quelle vitalité
dans ce rire ! -, et à se lier aux autres. « Diversité, c’est ma
devise », donc. Avec La Fontaine. Comment ?
L’étranger – et désormais l’Européen passant d’un pays dans un autre, parlant
la langue de son pays avec celle, voire celles des autres –, se distingue
de celui qui ne l’est pas parce qu’il parle une autre langue. En Europe, nous
ne pourrons pas, nous ne pouvons plus échapper à cette condition d’étrangers
qui s’ajoute à notre identité originaire, une doublure permanente de notre
existence.
La souffrance, dans ce vaillant métissage ? J’attendais la question et ma
réponse n’est qu’à demi fourbie. Il y a du matricide dans l’abandon d’une
langue natale, et si j’ai souffert de perdre cette ruche thrace, le miel de mes
rêves, ce n’est pas sans le plaisir d’une vengeance, certes, mais surtout sans
l’orgueil d’accomplir ce que fut d’abord le projet idéal des abeilles natales.
Voler plus haut que les parents : plus haut, plus vite, plus fort. Destin
toujours douloureux, l’exil est la seule voie qui nous reste, depuis Rabelais,
la chute du mur de Berlin et le crime organisé des oligarques, pour rechercher
la dive bouteille. Laquelle ne se trouve jamais que dans la recherche se
sachant chercher, ou dans l’exil s’exilant de sa certitude exilaire, de son
insolence exilaire. Dans ce deuil infini, où la langue et le corps ressuscitent
dans les battements d’un français greffé, j’ausculte le cadavre toujours chaud
de ma mémoire maternelle. Ni involontaire ni inconsciente, mais je dis bien
maternelle : parce qu’à la lisière des mots musiqués et des pulsions
innommables, au voisinage du sens et de la biologie que mon imagination a la
chance de faire exister en français – la souffrance me revient, Bulgarie,
ma souffrance.
Je dialogue donc avec la Bulgarie dans cette expérience de l’« autre langue »,
mais j’entends bien qu’il y a France dans « souffrance ». De fait, mon dialogue
s’adresse autant sinon davantage à la langue choisie qu’à la langue donnée de
naissance.
La clarté logique du français, l’impeccable précision du vocabulaire, la
netteté de la grammaire séduisent mon esprit de rigueur et impriment - non sans
mal -, une droiture à ma complicité avec la mer noire des passions. Je regrette
d’abandonner les ambiguïtés lexicales et les sens pluriels, souvent
indécidables de l’idiome bulgare, insuffisamment rompu au cartésianisme, en
résonance avec la prière du cœur et la nuit du sensible. Mais j’aime la frappe
latine du concept, l’obligation de choisir pour tracer la chute classique de
l’argument, et cette impossibilité de tergiverser dans le jugement qui s’avère,
en français, plus politique en définitive que moral. Les ellipses de Mallarmé
me séduisent : tant de contractions dans l’apparente blancheur d’un contenu
insignifiant confèrent à chaque mot la densité d’un diamant, les surprises d’un
coup de dès.
Je me suis à tel point transférée dans cette autre langue, que je parle depuis
quarante ans, que je suis presque prête à croire les Américains qui me prennent
pour une intellectuelle et écrivain française. Il m’arrive cependant, quand je
reviens en France d’un voyage à l’Est, à l’Ouest, au Nord ou au Sud, de ne pas
me reconnaître dans ces discours français qui tournent le dos au mal, à la
misère du monde et exaltent la tradition de la désinvolture - quand ce n’est
pas du nationalisme -, pour tout remède contre notre siècle qui, hélas, n'est
plus ni le « grand siècle » ni celui de « Voltaire-Diderot-Rousseau ».
Et pourtant, j’aime retrouver la France. Je l’ai écrit dans Possessions, et je le répète : J’aime retrouver la France. Plus
d’opacité, plus de drames, plus d’énigmes. L’évidence. Clarté de la langue et
du ciel frais.
Je sais bien qu’il y a France et France, et que tous les Français ne sont pas si
limpides qu’ils voudraient le faire accroire. Pourtant, quand on revient de
Santa Barbara, cette vision s’impose. Pas un millimètre de paysage qui ne
réfléchisse ; l’être est ici immédiatement logique. Tout effort s’y dissout et
l’argumentation, cependant permanente, s’évide en séduction, en ironie.
Je loge mon corps dans le paysage logique de France, m’abrite dans les rues
lisses, souriantes et aisées de Paris, frôle ces gens quelconques qui se
refusent, mais désabusés, d’une intimité impénétrable et, tout compte fait,
polie. Les Français ont bâti Notre-Dame, le Louvre, conquis l’Europe et une
grande partie du globe, puis sont rentrés chez eux : parce qu’ils préfèrent au
plaisir guerrier un plaisir qui va de pair avec le bien-être, la sérénité. Mais
parce qu’ils préfèrent aussi le plaisir à la réalité, ils continuent de se
croire les maîtres du monde, ou du moins une grande puissance. Ce monde -
agacé, condescendant, fasciné -, qui semble prêt à les suivre, à nous suivre.
Souvent à contrecœur, mais quand même, pour l’instant. La violence des hommes a
cédé ici devant le goût de rire, tandis qu’une discrète accumulation
d’agréments laisse imaginer que le destin est synonyme de décontraction. Et
j’en oublie la mort qui règne à Santa Barbara.
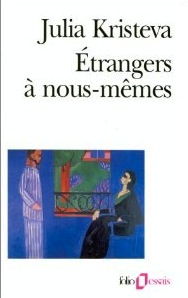
| Lectures de Pauline Jambet
|
|---|