Colette
Écrire
toujours, entre Balzac et Proust
Le Génie féminin, tome
3 : Colette
(extrait)
Julia Kristeva
« Le style,
c’est presque toujours le mauvais goût de nos devanciers, à dater du jour où il
nous devient agréable »
« L’écriture
est un dessin, souvent un portrait, presque toujours une révélation. »
« [...] la
réussite est moins affaire de pensée que de rencontre de mots. Signes errants
dans l’air, parfois les mots, appelés, daignent descendre, s’assemblent, se
fixent... Ainsi semble se former le petit miracle que je nomme l’œuf d’or, la
bulle, la fleur : une phrase digne de ce qu’elle a voulu décrire. »
9.1.
« Balzac ardu ? Lui, mon berceau, ma forêt, mon voyage... »
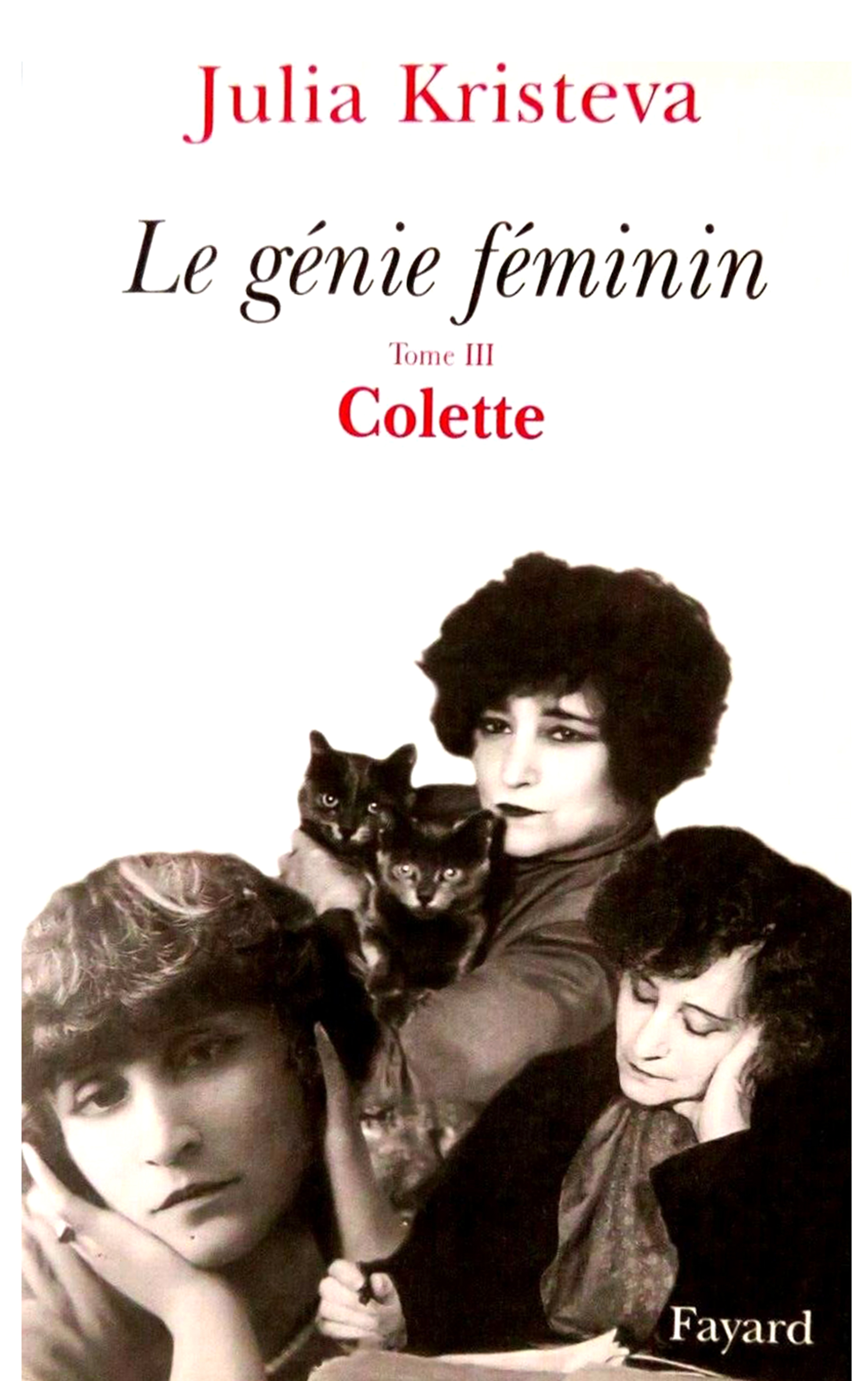
La
Maison de Claudine évoque la bibliothèque familiale,
« pièce maçonnée de livres », dans laquelle le « Balzac
noir » de Sido, grande lectrice, occupait une place privilégiée entre un
« Voltaire jaspé » et un « Shakespeare olive ».
L’édition Houssiaux des œuvres de Balzac que
possédait la famille, et dans laquelle il n’était pas interdit de fureter,
devint, pour la petite gloutonne, une « jungle inépuisable ».
Colette la remplaça par un Houssiaux II après son
premier mariage, auquel succéda un Houssiaux III qui
l’accompagna jusqu’à la fin de ses jours. A ceux qui s’étonnaient qu’elle pût
citer Balzac de mémoire, Colette répondait : « [...] il faut s’y
prendre tout petit »,
en faisant allusion à ces pages de Claudine à Paris où l’héroïne aime se « réchauffer aux titres connus des bouquins, et rouvrir de temps en temps
le Balzac »,
nostalgique de ces volumes qui « cachent entre leurs feuillets des miettes
de goûter ».
Dans Claudine en ménage, l’auteur
raconte s’être régalée de « pêches âpres, qu’[elle] déguste à plat ventre,
sous le grand sapin, un vieux Balzac entre [s]es coudes ».
On ne saurait trouver meilleure illustration du sentiment qui lie Colette à
l’auteur de La Comédie humaine : elle
associe à la joie de lire les plaisirs de bouche — plaisir des plus archaïque,
lien maternel s’il en est — et qu’elle apprécie plus que tout ! A Balzac, et à
lui seul, elle consacre non pas une mais quatre études substantielles.
Au fil de son œuvre, elle n’évoquera pas moins de cinquante-cinq personnages
balzaciens.
Retenons, dès 1910, cette coquetterie
appuyée de la Vagabonde, après un long passage sur l’acte d’écrire :
« Il faut trop de temps pour écrire ! Et puis, je ne suis pas Balzac,
moi... »
Et en 1947, à l’automne de sa vie, l’humble soumission de Colette qui, en fait,
se hisse à la hauteur du plus grand : « J’ai la longue habitude de
croire Balzac sur parole, de l’accompagner partout où il lui plaît de me
conduire. »
Entre les deux, un « balzacien génie du mensonge » possède Taillandy,
personnage qui transpose Willy dans La
Vagabonde. Et cet aveu de Bertrand de Jouvenel rappelant que leurs amours à Rozven pendant l’été 1921 se sont déroulées autour de
Balzac, et notamment de sa nouvelle Le
Chef-d’œuvre inconnu. D’un bout à l’autre de
son parcours, Colette se reconnaît un seul maître, sans expliquer en profondeur
cette élection. Mais elle nous laisse deviner, sur le fond de ce compagnonnage,
les ambitions secrètes de son œuvre.
Qu’admire-t-elle chez Balzac ? Très
spontanément, elle aime son sens du « détail », en se flattant de le
lui emprunter : la description d’une fleur, d’une courbe d’épaule, la notation
d’un rouge sanguin (couleur qui la séduit aussi dans les œuvres de son ami
peintre Christian Bérard), l’évocation précise de douze bracelets, ou encore
cette « fidélité française, éprise des bois précieux et durables, de la
profonde ciselure, des soieries » : au gré de tels « détails »,
c’est d’abord une époque qui revit, une ville avec sa topographie, un corps
avec ses passions ; pourtant, avec eux et au-delà, Colette contemple la
beauté idéale des sens. Si la jeune Colette s’est moquée d’un Balzac qui
écrirait « mal »,
l’écrivain confirmée rend, à la fin de sa vie, un hommage vibrant au réalisme
magique du maître : « O détails, ingénieux autant que puérils, on ne
me fera point rougir de vous, accommodements, féminins à l’extrême, et vous,
pendule et vases ! Joyau infléchi selon la courbe de l’épaule, monogramme
étincelant caché dans la cocarde d’une jarretière, camélia épinglé au col,
répété à la ceinture, puis à mi-jupe, puis sur l’ourlet, camélia sans qui la
robe n’aurait point de sens... ”Allons, bon ! s’écrie Balzac, voilà
les trois cents chèvres de Sancho !” Il se moque, mais se garde de
supprimer la fleur. Il compte, sur la chair ambrée de Josépha Mirah, douze bracelets de perles à chaque bras. Je les
compte avec lui, et j’y goûte la sérénité, la lucidité transmises par un écrivain
qui ne craignit jamais, à décrire le fin et même le
menu, de se rapetisser. »
Et encore : « Quand il nous introduit dans la chambre où mourra,
coupable d’y avoir aimé, la Fille aux yeux d’or, nous ne pouvons pas ne pas
nous écrier : “Le beau gîte pour y enfermer deux amants et un
crime !” Cramoisi, blanc, ponceau à bouffettes noires, çà et là de l’or,
la flamme des cires, aux murs une mousseline des Indes qui se fait rose en
glissant sur une tenture rouge, Christian Bérard n’aime rien autant aujourd’hui
que ces couleurs sanguines. Je les aimai avant lui, et si le destin me donnait
— encore une fois, rien qu’une — de déménager afin de goûter le plaisir
d’emménager, n’irai-je pas prendre, dans ma vieille édition Houssiaux,
les conseils de Grindot, le plus hardi des
architectes-décorateurs de 1847 ? »
Comme dans une hallucination, ce goût du
détail textuel se substantifie en culte de l’objet réel — qui devient alors un fétiche —, quand il ne vire pas à l’adoration de tel bibelot ayant
appartenu au grand homme. Ainsi Colette la lectrice se double-t-elle d’une
collectionneuse qui aime à raconter comment sa marraine, la générale Désandré, lui avait légué l’« épingle
de cravate de Balzac ». Ce don, qui transite par l’amour de sa marraine
pour Sido, et par les carrières militaires de son parrain et du capitaine
Colette, est très symboliquement perdu à la mort de l’amputé. « Une sorte
maligne de désordre » serait entrée dans la maison des Colette au décès du
père. Et, comme par hasard, au moment même où l’on découvre que ce dernier n’a
rien écrit, on constate que l’épingle de cravate de Balzac est perdu !
Papa disparaît avec l’épingle de cravate
de Balzac ! On a souvent lié l’expérience littéraire de Colette à l’échec
paternel, que la fille se devait d’effacer. Maintenant, on sait que s’y ajoute
un second défi, bien plus gigantesque et inséparable du premier :
retrouver « l’épingle de cravate de Balzac ». L’écriture balzacienne,
dégustée jusque-là comme un goûter maternel, se serait-elle transmuée, sous la
double paternité du Capitaine et de Balzac, en autorité principale, manquante
et à restaurer ? Toujours est-il que Balzac fournit à Colette l’athée la
seule et unique occasion de se reconnaître une « religion de [s]on
adolescence, guide de [s]on éducation première ».
Dans sa troisième édition Houssiaux, l’œuvre de
Balzac joue pour elle le rôle d’une « Bible » façon Sido. Garantie de
bon goût littéraire et remède contre le mal-être, elle éveille la mémoire des
casse-croûtes appétissants et celle de quelques fleurs tout droit sorties du
Temps : « Un Houssiaux fait à ma mesure, marbré
noir et rouge [...] excellent contre la fièvre, souverain contre certains
romans qui “viennent de paraître”, contre ceux qui postulent un prix. Chez moi
il est indemne de miettes de pain et de croûtes de gruyère, mais pas toujours
sauf d’un vieux pétale de rose ou d’une raide pensée sèche qui ressemble à
Henri VIII. »
Pourtant, la séduction maximale de Balzac
réside, selon Colette, dans l’admiration que cet écrivain voue à la créature humaine,
« qu’elle soit chargée de crime ou, de par sa grâce, innocente de tout ».
Avec les « détails » et en se glissant en eux, c’est la coexistence
des contrastes dans les êtres humains et la folle violence de leurs passions
qui attirent Colette, bien plus que le tableau des luttes sociales et des
drames farouches du capital dans lequel est supposé exceller l’auteur de La Comédie humaine. Pour s’en persuader, il
suffit de citer, parmi les cinquante-cinq héros balzaciens évoqués par Colette,
outre sa préférée Valérie Marneffe qui a droit à un
article particulier, ceux qu’elle mentionne au moins quatre fois : Lucien
Rubempré, le baron de Hulot, Philomène de Watteville et Paquita Valdès. Mais on y trouve aussi le docteur Rouget, la duchesse de
Langeais, le colonel Chabert, le cousin Pons, Zambinella-Sarrasine...
Aussi divers que possible, ces personnages
retiennent l’attention de la fille de Sido parce qu’ils sont des
« créatures vigoureuses, fortes de leur sève, de leur vraisemblance
pathétique ».
Aucune mention n’est faite du Père Goriot, ni d’Eugénie Grandet qui séduisent
d’habitude l’imaginaire populaire. Colette leur préfère Lucien de Rubempré, non
pas tant pour son ascension sociale que parce que « ce jeune homme si beau
[...] de surcroît se voulait poète »,
et qu’elle songe « aux quatre lignes qui devaient sauver Lucien de
Rubempré » (elles sont contenues dans la première lettre « qui flaire
comme baume » et que Marie-Louise-Anaïs (Naïs) de Nègrepelisse a envoyée à
Lucien en réponse à sa longue épître) ! Sans surprise, un écrit révélateur
de la passion amoureuse que suscite l’ex-Lucien Chardon, fils du pharmacien
d’Angoulême, fixe l’attention de notre auteur. De même, le baron Hulot,
« ruine solide et dégradée »,
ne l’impressionne que comme jouet des amours féminines. Quant à Vautrin, il
est, à ses yeux, un expert en mascarades : tantôt faux abbé, Carlos
Herrera coiffé d’un papier graisseux sous sa perruque,
tantôt redoutable bandit comme Jacques Colin qui « tue, pille, puis entre,
comme on prend le froc, dans la police ».
Mais ce sont les femmes de Balzac qui, par
leur érotisme sournois et d’une implacable cruauté, captivent l’auteur de La Chatte. À travers elles, Colette lit
dans la Comédie humaine une
exploration de la sensualité monstrueuse, notamment féminine, qui serait le
véritable moteur de l’ascension bourgeoise tout autant que des rites
sophistiqués des aristocrates.
Les noms propres de ces passionnées
semblent lui importer plus et autrement que les brèves descriptions dont
Colette les entoure : ils apparaissent sous sa plume comme des emblèmes,
des condensés universellement transparents, et donc inutiles à développer à
l’intention des profanes. Dans les histoires souvent sanguinaires que Balzac
leur attribue, Colette se contente de prélever, une fois de plus, seulement
quelques détails apparemment anodins, bien français, mais tous révélateurs
d’une impitoyable pulsion de mort qu’elle appelle une « perdition ».
Philomène de Watteville est une cousette, une
brodeuse (comme Colette ?) qui vit dans l’ombre de sa mère (la baronne de Watteville, dévote et despote, impose à sa fille une sévère
éducation religieuse), mais cache sous son apparence frêle un « caractère
de fer » et « plus d’un Belzébuth dans sa peau ». La jeune fille
sage s’éprend de l’avocat Albert Savarus et brûle
d’une jalousie infernale pour le personnage féminin d’une nouvelle dont Savarus serait l’auteur, « L’Ambitieux par amour »... De tous ces imbroglios qui tissent un
« roman dans le roman », Colette ne retient que la passion refoulée (sic) de Philomène la brodeuse pour...
une héroïne imaginaire, et qui s’exaspère dans un acharnement criminel contre
l’auteur (homme) de la nouvelle : « Toutes les refoulées, les fomentatrices furent, sont encore de grandes
couseuses. Philomène de Watteville brodait
infatigablement des pantoufles ».
[...] « ténébreuses jeunes filles du XIXe siècle, étouffées dans l’ombre maternelle et
tirant l’aiguille... Balzac vous épie. « “A quoi penses-tu,
Philomène ? Tu vas au ras de la raie...” Trois points de trop sur le tracé
de la pantoufle qu’elle destine à son père, et Philomène de Watteville va livrer sa préoccupation profonde et criminelle... Mais elle défait les trois
points qui dépassent la raie et se remet à ourdir, dans l’invisible et le
périlleux, la ruine d’Albert Savarus. »
Madame Marneffe,
quant à elle, est décrite comme une « petite beauté potelée et bien
française », « toute charme et perdition ».
Colette se complaît dans les détails de l’habillement et de l’ameublement style
« dix-huit cent quarante-sept », dont l’opulence résonne comme une
métaphore fatale et suggère (mais uniquement aux lecteurs de La Cousine Bette) les charmes et les
menées diaboliques de cette « Laïs de Paris », qui incarne chez
Balzac le type de la « courtisane mariée ». Aucune allusion chez
Colette aux vicieuses stratégies de cette « fausse femme comme il
faut », complice de la cousine Bette dans sa vengeance contre les Hulot et
plus particulièrement contre sa trop belle cousine, Adélaïde Hulot. Plus qu’à
la chute de la maison Hulot ou à la déchéance de Hector Hulot, père débauché et
amant trop prodigue, c’est à sa jeune maîtresse Valérie Marneffe que va l’intérêt de Colette — et il est admiratif. Aucun recul, nulle
condamnation de Valérie — cette fleur du mal sur le pavé parisien dont la
séduction perverse mène le bal de la vengeance. Entre son misérable employé de
mari dont elle attend la mort, son amant brésilien dont elle accepte
« toutes les exigences », et le père Hulot qu’elle détruit, Valérie Marneffe est, pour Balzac, « un diable qui a pris des
jupes ». Colette, elle, n’en retient que le goût élégant d’une Valérie
artiste en séduction : pour atteindre son but, Madame Marneffe n’a pas besoin d’armes machiavéliques, une rose entre ses seins suffit pour
« faire baisser les yeux à tous les hommes âgés de moins de trente-cinq
ans ».
Sous sa plume, la perversité de Valérie Marneffe (le
personnage) se résout en prouesse d’écriture (de l’auteur : Balzac). Et
Colette ne relève, de ce déferlement des passions, que l’art du styliste qui
sait charger un détail visuel du lourd non-dit psychologique — qu’elle-même choisit précisément de
nous épargner.
La
Fille aux yeux d’or a droit à un peu plus de révélation
criminelle : brièvement, Colette rappelle la liaison de Paquita avec Henri
de Marsay, et surtout l’amour à mort qui l’attache à
sa demi-sœur, la marquise de San-Réal. Elle néglige la société secrète des
Treize hommes « assez forts pour se mettre au-dessus des lois » qui
fascine Balzac, et passe sur le sadisme des amours de Paquita Valdès avec de Marsay. C’est la volupté mortelle entre les deux femmes
qu’évoque Colette avec une extraordinaire parcimonie dont la précision est à la
hauteur de l’intensité passionnelle : « Je rêve de la lutte où la
marquise de San-Réal déchire le merveilleux corps de Paquita, la Fille aux yeux
d’or... »
« [...] la Fille aux yeux d’or marque de ses mains sanglantes la soie
ponceau, la mousseline blanche d’une retraite amoureuse où jamais aucune homme n’était entré... »
Parce qu’elle sait de quoi elle parle, et que sa langue est en adéquation avec
cette « retraite » rouge et blanche d’entre deux femmes qu’aucun
homme n’a visitée, Colette sait être aussi juste que Balzac, et plus concise
que lui ! Mais ne fallait-il pas qu’il la précède pour que, de tous les
feux allumés de cette sensualité dantesque en pleine France bourgeoise, Colette
pût retirer quelques charbons brûlants, quelques « vrilles de la
vigne » enflammées, comme elle sut les tresser ?
Succinctement, accompagnés de lapidaires
vignettes, les noms des personnages
balzaciens interviennent dans l’écriture de Colette comme pour ouvrir, sous
l’apparent classicisme et la pudeur de ses propres textes, l’abîme des passions
que son œuvre suggère en condensé, mais que le génie de Balzac avait exploré en
abondance. Il nous faut reprendre Balzac en « inter-texte »,
évoquer en perspective la complexité de Valérie Marneffe et de Paquita Valdès, pour que les « vrilles de la vigne » propres à
l’art de Colette déplient toute leur monstruosité qu’elles ne manquent jamais
de transmettre au lecteur, mais distillée et camouflée sous une décence trop
retenue. Revendiquée moins comme caution stylistique (malgré leur goût commun
du détail) que comme parenté dans la descente aux enfers, l’œuvre de Balzac
joue le rôle d’un « fanal rouge », à côté du « fanal
bleu ». Colette agite son Balzac tel un signe de reconnaissance qu’elle
adresse à tous ces explorateurs hardis de l’insoutenable, sous une apparence de
légèreté, que sont ses lecteurs à elle. Y compris ceux qui s’ignorent comme
tels mais se prennent pour des campagnards bucoliques ou pour des émules du
vicieux Willy, et à la confrérie desquels elle appartient aussi, sous ses
masques de grosse mangeuse, de belle jardinière ou d’ingénue libertine.
On ne s’étonnera donc pas qu’à la fin de
sa vie, Colette se soit s’interrogée sur le mystère de l’homme Balzac, et sur
l’énigme du beau. La jeune lectrice, en admirant la puissance de l’auteur, le
génie du détail, le maître de l’enfer amoureux, avait négligé le contexte de « la
douloureuse fécondité d’un écrivain traqué, ses déboires de financier,
d’imprimeur et de planteur d’ananas ». Tardivement, Colette désire
découvrir l’homme et sa vie : « à présent,
c’est cet homme que je cherche, l’éclat de son rire, sa lèvre rebordée [...]
dites-moi comment Balzac fut poursuivi, trahi, mal aimé ».
Elle accepte tout de lui : la robe de chambre tachée d’encre et de café,
l’intoxication qui « laboure un corps d’homme d’assis, trop longtemps
assis »... tout, sauf — signe suprême de leurs amours !
— madame Hanska : « j’écarte du grand homme cette dame slave... »
Sans doute mûrie par sa propre trajectoire
littéraire, Colette reconnaît en Balzac celui qui sait accompagner et dépeindre
les hommes en proie à leurs passions, mais en évitant la solitude divine d’un
pur désert, qu’il remplace par une comédie humaine — forcément humaine. Et
Colette de souligner, à la gloire de Balzac, ces seuls mots tracés par le
maître : « Le désert, c’est Dieu sans les hommes. »
Puis, ayant découvert, dans son troisième Houssiaux acheté chez les bouquinistes, les annotations
d’un précédent lecteur, Colette s’étonne que ce dernier ait inscrit un point
d’interrogation à côté de cette courte phrase de Splendeurs et misères : « Les sens ont leur beau idéal. » N’est-ce pas précisément la beauté de tous ces
monstres — Lucien, Paquita, Vautrin, Coralie, Louise de Bargeton et d’autres — qu’éclaire pour nous la Comédie de Balzac ? C’est bien parce que la déviance humaine est sublime que
l’humanité est comique : mais il faut être Balzac pour capter, dans un
détail, le beau idéal des sens infernaux. En suivant le maître à la trace, dans la
cartographie de ces perditions, n’est-ce pas ce que Colette cherche elle aussi
à faire ? ne prétend-elle pas qu’elle possède Balzac « cadastralement » ?
« J’aurai vendu des fermes, changé de maison, perdu mon argent :
Balzac est mon domaine inaliénable. »
Plus « inaliénable » donc que la maison de Sido qui, elle, fut
perdue, vendue, transformée ? Pour Colette qui a compressé le temps en espace
sensible, cette humble, cette prétentieuse fidélité cadastrale à Balzac
l’idéal, à ce Balzac au désert impossible, est l’aveu le plus intime de son credo littéraire. Au-delà du jardin de
Sido, c’est la topographie de Balzac qui aimante l’écrit de Colette.
Jamais mentionné à ma connaissance par
Colette, Le Chef-d’œuvre inconnu occupe
cependant, dans le culte qu’elle voue à l’écrivain, une place d’autant plus
révélatrice que ce texte programmatique n’est pas sans résonances avec
l’esthétique propre à notre romancière. C’est au cours de sa relation avec
Bertrand de Jouvenel, dont nous avons vu l’importance pour cette
cristallisation qui devait mener le génie de Colette à Sido,
que les deux amants lisent le texte de Balzac : « C’est en ce temps
[1921] que Balzac devint un sujet de conversation entre nous, et combien
important ! C’est elle [Colette] qui me fit goûter cette nouvelle
prodigieuse : Le Chef-d’œuvre
inconnu, extraordinaire leçon d’autodestruction d’une œuvre, si elle est
trop souvent remise sur le métier. » Le thème de l’autodestruction
que Jouvenel, tout à sa propre histoire, choisit de privilégier dans la
nouvelle, n’est pas le seul. Balzac y développe surtout une esthétique de la
forme vivante, influencée par Hoffmann, Diderot, Delacroix et Théophile
Gautier, qui met en scène la rivalité entre la vie et l’œuvre. Non
seulement cette préoccupation, comme nous l’avons vu, sous-tend l’écriture de
Colette dans son ensemble, mais elle se trouve au cœur de son expérience
biographique et romanesque au début des années 1920. Comment ne pas imaginer
que la coalescence que Colette cherche entre l’expression verbale et le monde
sensible, entre la littérature et la chair du monde, ne trouve pas un écho
vibrant dans les digressions de Fernhofer qui, dans Le Chef-d’œuvre inconnu, appelle à
briser « la première apparence » pour « descendre » dans l’« intimité de la forme » et saisir ce « rien »
qui est la « fleur de la vie » ?
Le vieux maître est si amoureux de son tableau de La Belle Noiseuse qu’il interdit à quiconque
de le voir. Passant outre son amour pour Gillette, le jeune Nicolas Poussin
propose celle-ci comme modèle à Fernhofer, obtenant
en échange le droit de voir le chef-d’œuvre. Balzac oppose ainsi l’érotisme
réel (de Nicolas Poussin avec Gillette) à l’enthousiasme esthétique (que Fernhofer éprouve pour son portrait de Catherine Lescault, dite la Belle Noiseuse) :
comme Colette elle-même, qui oscille entre son lien réel avec Bertrand de
Jouvenel, d’une part, et le monde imaginaire de Chéri et du Blé en herbe,
de l’autre. De la personne réelle ou de la créature imaginaire, qui doit
l’emporter ? Nicolas Poussin (comme Colette ?) semble vouloir
concilier les deux : il cède cependant aux élans du vieil artiste, en
privilégiant la jouissance de l’œuvre. Avant de s’apercevoir que le vertige
esthétique de Fernhofer est destructeur : ne subsiste
du prétendu chef-d’œuvre qu’un chaos de couleurs d’où n’émerge « un pied
délicieux, un pied vivant ».
En définitive, l’œuvre ne serait-elle qu’un aimable et dérisoire fétiche, tel
ce pied de femme, qui flotte sur une « lente et progressive destruction » ?
Serait-elle une jouissance à jamais inconnue, illusoire ? Illusion à laquelle seules la simplicité de Gillette et la modération bien
française de Poussin, en équilibrant par le plaisir érotique les convulsions
démoniaques du génie, peuvent se soustraire ?
Voilà le dilemme balzacien dans lequel
Colette plonge le jeune Bertrand, en s’attribuant, bien sûr, le rôle mâle des
artistes, et en faisant jouer au fils de son mari le rôle... de Gillette ou de
la Belle Noiseuse, au choix ! Fernhofer finit par brûler sa toile avant de se donner la
mort. Bien loin d’une telle métaphysique absolutiste de la création, Colette —
qui devait plutôt s’identifier à Nicolas Poussin, vu par Balzac — se réserve le
droit de faire de sa vie elle-même une œuvre, tout autant que d’insuffler dans
son œuvre la chair même de la vie.
Enfin, c’est toujours dans Balzac que
Colette découvre le personnage d’Antonia Chocardelle,
« une femme aimable encore et malchanceuse », qui tient un « cabinet de lecture
[…] commerce convenant à dame seule », et dont notre auteur préconise de
ressusciter la pratique pendant l’Occupation ! Démarche « politique » qui propose la lecture, et celle de Balzac
de préférence, comme unique remède contre le désespoir national ? Ou aveu
discret de cette métamorphose qui devait mener l’« amoureuse
Colette » à sa solitude cosmique et néanmoins balzaciennement habitée par cet « amour de lire » qui conduit à l’« amour du livre »,
le seul qui vaille ?
9.2.
Proust ? « Comme dans Balzac, je m’y baigne... C’est délicieux... »
Colette vénère Balzac, mais plus
explicitement encore, c’est à son contemporain Marcel Proust qu’elle voue une
grande admiration : belle reconnaissance de proximité, sinon de complicité.
L’enfance, la mémoire, le temps sensible, et maints écrits consacrés à l’auteur
d’A la recherche m’avaient laissé
deviner, au-delà des flagrantes différences entre Colette et le « petit
Marcel », une forme de gémellité mystérieuse qui me semblait hisser Proust
à la hauteur de Balzac dans le panthéon colettien —
quand j’ai découvert, tardivement, que ce rapprochement avait été fait par
Colette elle-même. Au cours d’une conférence de M. Paul Reboux sur le thème « Comment ils écrivent : de Marcel Proust à Jean
Cocteau », le critique s’adresse à Colette et lui demande de parler de ses
confrères. Après quelques hésitations (Colette répugne à se couler dans le rôle
du critique, ce « coupeur de têtes » dit-elle), elle accepte de
s’exprimer sur Proust :
« Colette :
« […] J’ai une espèce de passion pour tout ce qu’a écrit Marcel Proust,
pour presque tout ce qu’il a écrit... Comme dans Balzac, je m’y baigne... C’est
délicieux... (Longs applaudissements).
Paul
Riboux : Mais la longueur de ses phrases ne vous
gêne pas ?
Colette : Non. Et pourquoi me troublerait-elle ? C’est une onde particulière. Il
faut être bon nageur, quelquefois... Mais c’est affaire aux lecteurs d’aller
jusqu’à Proust et non pas à Proust d’aller aux lecteurs... Ils y viendront
bien... (Nouveaux applaudissements). »
Cet enthousiasme, qui s’est affermi avec
les années, fut pourtant loin d’être immédiat. Colette rencontre Proust dans le
salon de Mme Arman de Caillavet (née Léontine Lippmann) et se retrouve très
vite mêlée à diverses intrigues mondaines qui faillirent du reste la brouiller
avec l’écrivain. En effet, Anatole France, amant de Mme Arman de Caillavet,
n’est pas insensible aux charmes de Colette, tandis que Willy, de son côté,
tente de séduire la belle-fille de Mme de Caillavet, Jeanne Pouquet.
Mme de Caillavet en avertit Colette. A son habitude, Willy plaisante en
déclarant que cette révélation risque de faire perdre la vue à sa femme. Proust
propose les soins d’un oculiste. Mme de Caillavet exige la rupture avec les
Gauthier-Villars, peu après la grave maladie de Colette… Une première lettre de
Colette à Proust date de cette période (vers mai 1895 ?). La jeune femme
écrit visiblement sous la dictée de Willy : elle critique la façon de
Proust de lire des extraits de ses « Portraits de peintres » chez
Madeleine Lemaire (« Il ne faut pas les abîmer comme vous le faites en les
disant mal, c’est malheureux »), loue le jeune homme d’avoir déceler chez
Willy un talent qui n’en est réalité qu’un génie propre au seul Proust « [vous]
aviez si nettement vu que, pour lui [Willy], le mot n’est pas une
représentation mais une chose vivante ») et termine par cette phrase
lourde d’insinuations homosexuelles et bisexuelles : « Car il me
semble que nous avons pas mal de goûts communs, celui de Willy, entre autres. »
La première mention, anonyme, de Proust
par Colette l’écrivain, se devine sans mal dans Claudine en ménage : la jeune héroïne rencontre chez la
« mère Barmann » (Mme Arman de Caillavet)
un « jeune et joli garçon de lettres ». Colette l’avait d’abord
qualifié de « jeune youpin de lettres », expression que Willy, plus
prudent que sa femme, s’était fait une obligation de corriger.
Proust, écrivain débutant, couvre Claudine/Colette de compliments maladroits,
surchargés d’allusions aux muses hermaphrodites, et chante son âme de Narcisse,
« emplie de volupté et d’amertume ». « “Monsieur, lui dis-je
fermement, vous divaguez. Je n’ai l’âme pleine que de haricots rouges et de
petits lardons fumés.” Il se tut, foudroyé. »
La franche ironie de Colette, qui ne
manque pas de trahir sa sourde hostilité, s’estompe cependant au cours des
années : des thèmes et des personnages communs apparaissent dans les
œuvres de Colette et de Proust, avant que ne s’affirment une poétique complice,
sinon commune, et une admiration réciproque.
1901 : Claudine à Paris se découvre un cousin, prénommé Marcel :
aucun rapport avec Proust l’écrivain, si ce n’est que ledit cousin est
homosexuel et fascine la jeune femme comme s’il était son double ! Marcel
va l’accompagner jusqu’à La Retraite
sentimentale (1907).
1902 : Colette raille Mme Arman de
Caillavet, alias Mme Barmann, dans Claudine en ménage — on la retrouvera sous les traits de Mme Irène
Chaulieu dans L’Ingénue libertine en
1909. Proust s’inspire de la célèbre égérie d’Anatole France pour créer le
personnage de Mme Verdurin, dès 1908. En effet, le
« clan » Verdurin se définit dès le début
par l’exclusion des gêneurs, ce qui
n’est pas sans rappeler les « ruptures entre Mme de Cavaillet et les Gauthier-Villars ainsi
qu’avec Proust lui-même.
1903 : Rose-Chou, un personnage de Claudine s’en va, serait inspirée de
Jeanne Pouquet, la belle-fille de Mme Arman de
Caillavet. Proust l’utilisera lui aussi pour créer Gilberte.
1904 : Colette publie les premiers Dialogues de bêtes au Mercure de France.
Sous le masque des animaux, elle y fait « exsuder » « goutte à
goutte »,
dit-elle, une sensibilité profonde, plus intime que celle des Claudine, et y explore un
« plaisir » « vif, honorable », un « devoir envers [s]oi-même », « de ne pas parler d’amour ». Cet
être sensible, au carrefour de l’enfance et de l’animalité, Proust l’appellera
un « moi profond », dans le Contre Sainte-Beuve, qu’il entreprendra
entre 1908 et 1910, sans jamais l’achever (le volume sera publié en 1954).
1908 : Les Vrilles de la vigne mentionnent, en baie de Somme, la forêt de
Crécy — « à la première haleine » de ces bois, « mon cœur se
gonfle », « un ancien moi-même se dresse... »
Serait-ce ce même « moi profond » esquissé dans les notes non publiées
de Proust la même année ? Il inventera la lignée nobiliaire des de Crécy,
et le personnage d’Odette de Crécy en 1910-1911.
1913 : Du côté de chez Swann paraît le 14 novembre. Dans une lettre datée
du 28 novembre, Proust écrit à Louis de Robert que, « quant à Mme de
Jouvenel […] j’ai la plus grande admiration pour elle », et, à la fin
du même mois, il réitère : « Je lui trouve un immense talent. »
1917-1918 : Colette publie Les Heures longues, où elle livre ses
impressions de voyages (faits en 1915) à Venise et à Rome. Proust, qui avait
découvert l’Italie avec Ruskin et visité Venise avec sa mère en 1900, écrit à
Colette une lettre d’éloges.
Croisements fortuits ? Échos
diversement apprivoisés par les deux auteurs, mais qui sont des lieux communs
d’une même société, d’une même culture ? Sans doute, et il est impossible de
repérer lequel des deux auteurs détient la primauté de telle ou telle
invention, tant leurs pistes sont parallèles, quoique tracées par un génie
spécifique et généreux dans ses inimitables développements. Toutefois, les
dates semblent indiquer que Colette aurait une longueur d’avance dans la
plongée sensorielle et infantile qu’elle amorce dès les Claudine. Proust, quant à lui, expose, détaille et médite cette
mémoire involontaire avec une plus vaste culture et un souffle haletant, moins
soucieux de dignité cosmique que de compromissions identitaires. Par ailleurs,
tandis que l’auteur de Sodome et Gomorrhe débusque l’infantile comme un secret caché, souvent obscène, et qui ne se livre
qu’« involontairement » (au point qu’on a
pu, fort abusivement, le comparer à l’inconscient freudien), Colette, pour sa
part, n’est apparemment jamais sortie du paradis infantile et se baigne en
permanence dans sa réconfortante et prétendue pureté.
On peut cependant s’interroger sur cette
présence immédiate de l’enfance chez Colette : lui est-elle vraiment aussi
« naturelle » qu’elle l’affirme ? ou bien n’est-ce qu’une
trouvaille venue à point nommé dans sa « recherche » à elle, face aux
épreuves d’une vie conjugale dont l’érotisme n’était pas de tout repos ?
D’autant que l’univers de Montigny, de la maison de Claudine et de Sido,
s’élabore progressivement, préservant ce bonheur passé comme une « autre
scène » aux antipodes et en contrepoint de la vie parisienne. J’ai déjà
indiqué que ce mythe de l’écriture-enfance sous l’égide de la déesse Sido s’est
élaboré grâce à une exploration des fantasmes, puis de la réalité
incestueuse : l’inconscient chez Colette ne reste pas refoulé, il est
souvent abréagi dans un passage à l’acte pervers qui ne se fige pas en passion,
mais favorise au contraire la sublimation. Néanmoins, si l’infantile de Colette
est bel et bien lui aussi « recherché », il n’est ni coupable ni
transgressif, et c’est cette innocence (païenne, utopique, féminine), cette
soustraction à la Loi mais non au « scrupule », qui le distinguent de
la mémoire toujours quelque peu « maudite » de Marcel Proust.
C’est en 1919, à la sortie de Mitsou, que
l’auteur déjà connu de Sodome et Gomorrhe,
qui obtiendra le prix Goncourt en cette même année pour A l’ombre des jeunes filles en fleurs, écrit sa désormais célèbre
lettre à Colette, dans laquelle il avoue qu’il a pleuré « en lisant la
lettre de Mitsou ».
Jusqu’à la fin de sa vie, malade, admiratif et ironique comme à l’accoutumée,
Proust maintiendra le contact épistolaire avec Colette, tout en regrettant de
ne pouvoir cultiver le lien social avec la baronne.
« A dater de Mitsou »
(1919), comme dit Colette, les deux écrivains échangent leurs livres, tandis
que les lettres de Colette se font à leur tour élogieuses,
quoique moins effusives, comme le veulent le style et le caractère de la fille
de Sido. « Ah ! si je pouvais seulement avoir la veine qu’on sorte un
Marcel Proust pour mes vacances. »
Proust n’est pas en reste : « C’est moi qui suis fier d’être décoré en même temps que l’auteur du génial Chéri [...]. Vous savez bien que l’admirateur c’est moi, et que l’admiré c’est
vous » — non sans ironiser sur les occupations mondaines de Mme de
Jouvenel : « Quand vous en aurez fini avec tous vos châteaux de
Bretagne, de Corrèze, de partout... »
Colette reprend l’avantage : début juillet 1921 elle lit Le Côté des Guermantes II, suivi de Sodome et Gomorrhe ; et « toutes
les nuits Jouvenel retire doucement de dessous de moi, habitué, votre livre et
mes lunettes. “Je suis jaloux, mais résigné”, dit-il. [...] Personne au monde
n’a écrit des pages comme vous sur l’Inverti, personne ! » Suit un
aveu qui fait de Proust un rival, non plus de Sidi, mais de Colette elle-même,
et ô combien supérieur : « Je vous fais là une louange orgueilleuse,
car si j’ai voulu autrefois écrire sur l’inverti une étude pour le Mercure, c’est celle-là que je portais en moi, avec l’incapacité et la paresse de
l’en faire sortir. »
Enfin, la lettre révèle l’admiration de Colette pour le style de Proust qui
sait écrire le sexe en « végétal » et en « animal » (comme
Colette le fait elle-même, d’une tout autre façon) : « Qui oserait
toucher, après vous, à l’éveil lépidoptérien,
végétal, ornithologique, d’un Jupien à l’approche
d’un Charlus ? »
A lire cet échange de plus près,
l’analyste y déchiffrerait la suprême infidélité que Colette inflige à son
époux : Sidi plaisante, sans se douter qu’il a raison d’être jaloux de
Marcel Proust, de son écriture, de son monde d’invertis. Colette
« couche » en effet avec le texte de Sodome et Gomorrhe et cherche la version féminine de la « race
maudite ».
Faisons un pas de plus : a-t-on remarqué
que la relation avec son beau-fils, Bertrand de Jouvenel, vient à la suite de
cette lecture de Du côté de Guermantes,
et de Sodome et Gomorrhe ?
L’infidélité à Henry de Jouvenel-Sidi avec Proust précède donc celle que
Colette va consommer avec Bertrand, et qui la conduira à La Maison de Claudine, puis à Sido.
Colette laisse entendre à son confrère l’existence de Bertrand — comme pour
s’excuser d’être mère ? ou bien, au contraire, pour suggérer qu’après
avoir lu Sodome et Gomorrhe, elle
s’apprête à son tour à habiter des contrées aussi dangereuses et
transgressives, quoique tout autrement ? « Je pars le 12 avec une
famille bariolée d’enfants Jouvenel, une fille que j’ai faite, deux autres qui
me viennent d’ailleurs et qui sont charmants. »
Proust ne lui avait-il pas pris ses fleurs à elle pour décrire les
homosexuels ? A son tour, Colette s’avance au plus près des races
maudites, ose comme il ose, mais à sa façon de femme, de mère...
Ce n’est qu’une hypothèse, mais tel
pourrait bien être le fantasme, sans doute inconscient, qui se noue entre Mitsou, Chéri/Sodome et Gomorrhe/Le Blé en herbe, La Maison de Claudine : un
miroir de ressemblances et de différences, de modèles réciproques, de
compétitions et de libertés. A l’homosexualité de l’un répond l’inceste
mère-fils chez l’autre. Jusqu’à la fin de sa vie et bien après la mort de Proust,
Colette continuera à fouiller dans ses noms de fleurs à lui, en croyant prendre
en défaut son savoir botanique (alors que c’est elle qui, pour une fois, se
trompe sur l’« aigremone eupatoire » !), non sans admirer — encore ! — le style de
son complice : « “Fleurs de lys en lambeaux” c’est plein de grâce. »
On pourrait donc mettre sur le compte
d’une influence proustienne l’éclosion de la figure maternelle, Sido, dans
l’œuvre tardive de Colette : son analogue dans l’œuvre de Proust serait la
grand-mère qui vient hanter le narrateur.
Il est vrai que Colette relit les lettres de sa mère Sidonie-Colette pour
« en extraire quelques joyaux » et écrire La Naissance du jour ; il est vrai également que la première
épigraphe de ce livre est empruntée à Proust : « [...] ce “je” qui
est moi et qui n’est peut-être pas moi ».
Puis Colette la remplace par une autre, indépendante de Proust et qui est,
comme les épigraphes de Stendhal, complètement inventée :
« Imaginez-vous, à me lire, que je fais mon portrait ? Patience :
c’est seulement mon modèle. » En dépit de la dette qui la liait au
« jeune garçon de lettres », a-t-elle su qu’elle avait, de son côté,
retrouvé son propre temps perdu ? A sa façon personnelle, et sans le
formuler, comme l’aurait fait Proust, dans des tournures à la fois
philosophiques et rêveuses, mais dans un saisissement qui demeure lucide au
cœur même des intensités sensibles : sobre, clairvoyant, voire
prémonitoire ? Depuis les effusions infantiles et bucoliques des Claudine, depuis la perception profonde
que laissaient entrevoir les Dialogues
des bêtes, depuis l’« ancien moi-même »
des Vrilles de la vigne qui égrenait
déjà « les instants d’or de ce beau jour lent et pur »
et qui donnaient en primeur l’avant-goût du « pur temps incorporé »
que Proust n’énoncerait que dans Le Temps
retrouvé…
L’éclosion de Sido s’est donc réalisée par
un mouvement transgressif d’appropriation de l’infantile, qui passe en outre
par l’expérience de l’inceste.
Que la lecture de Proust ait été un encouragement dans cette audace sexuelle,
la lettre de Colette à l’auteur de Sodome
et Gomorrhe écrite en juillet 1921 le laisse entendre. Mais que sa voie à
elle, vers cet infantile auquel s’abouche la perversion, soit toute différente,
proprement féminine et spécifiquement colettienne,
l’œuvre ultérieure de l’écrivain va le démontrer. Elle l’avait déjà écrit dans Chéri (1920), qui précède sa liaison
avec Bertrand, et que Proust a trouvé « génial » ; elle va le
mettre en acte, car telle est la nécessité de sa logique inconsciente, de son
voyage personnel mû par la lecture de Sodome
et Gomorrhe et engagé dans une compétition avec le « petit
Marcel ». A côté des figures maternelles incestueuses, telle Léa (1920) ou
Mme Dalleray (1923) qui lui ont frayé le passage, se
dessine celle qui les sublime : Sido (1929). La figure maternelle prendra dès
lors, chez Colette, une dignité et une prestance qu’elle n’obtiendra jamais
chez Proust le sarcastique. La mémoire infantile, qui a toujours été le moteur
secret de l’écriture colettienne, s’arrogera, à
partir de cette confrontation avec Sodome
et Gomorrhe, une nouvelle place, visible et à méditer, centrée autour de
Sido. Colette consacrera à Proust des commentaires fulgurants, tant sur sa
personne que sur sa conception de la perversion.
Deux logiques de la mémoire inconsciente
se profilent désormais, à l’œuvre chez ces deux auteurs tout à la fois proches
et inconciliables. Les remarques de Colette à compter du Pur et l’Impur, ramassées, comme toujours, en « vrilles de la
vigne », les éclairent avec une belle honnêteté.
Dix ans après sa lettre d’hommage à l’« inverti » de Proust, Colette revient en effet
sur le sujet dans Le Pur et l’Impur (1932).
Abandonnant en apparence le thème de la mémoire, elle continue cependant à
l’explorer avec une intuition spécifique de son génie apaisé — et que je
résumerai ainsi : le chemin de la perversion n’est qu’un chemin
vers l’infantile. Et bien que les « impurs » s’acharnent à le refuser,
Colette reste persuadée, sans l’expliciter mais en le laissant lire en filigrane
dans les mini-récits du Pur et l’Impur,
que la perversion conduit nécessairement, inévitablement à l’infantile, dont la
mémoire — la face archaïque — se situe dans l’inceste mère-enfant, et dont la
pureté — la face sublime — s’achève par l’immersion dans l’Être. Pour ainsi
seulement baigner son écriture dans la chair du monde. Ce faisant, elle rend au
maître de Sodome son dû, puisqu’il avait tracé la même voie, mais, en même
temps, elle se place face à lui en meilleure exploratrice de Gomorrhe :
« Depuis que Proust a éclairé Sodome, nous nous sentons respectueux de ce
qu’il a écrit. Nous n’oserions plus, après lui, toucher ces êtres pourchassés,
soigneux de brouiller leur trace et de propager à chaque pas leur nuage
individuel, comme fait la sépia. »
La respectueuse Colette ne se reconnaît pourtant pas, on le sait,
dans les « insondables et précieuses jeunes filles » de la Gomorrhe
proustienne, avec leur « frénésie de mauvais anges ». L’image de
Gomorrhe n’a pas la « vérité foudroyante » de Sodome, et lui semble
tout au plus divertissante. Tombe alors le verdict : « C’est, n’en
déplaise à l’imagination ou l’erreur de Marcel Proust, qu’il n’y a pas de
Gomorrhe. » L’homosexualité féminine se compose, pour elle, de solitudes
et de prisons, d’aberrations et de snobisme ; elle se nourrit de la
puberté et de la communauté des collèges ; mais ces « maigres
pépinières [seraient] insuffisantes à engendrer et ravitailler un vice
nombreux, bien assis, et sa solidarité indispensable. Intacte, énorme,
éternelle, Sodome contemple sa chétive contrefaçon. »
Reprocher à Colette, dans cette rivalité
admirative avec Proust, une envie de lui disputer son aura d’expert en
« races maudites » serait facile. Sans doute se trompe-t-elle sur la
complexité de l’homosexualité féminine. Son expérience personnelle et sa propre
vision littéraire de l’homosexualité féminine la conduisent, je l’ai dit, à en
faire un passage obligé, mais un passage seulement, vers la capture de la
mémoire infantile ; nullement une exploration d’une sexualité en soi. C’est en
ce lieu précis que les deux auteurs divergent, et il faudra revenir sur leurs
approches respectives de la mémoire retrouvée : transgression
blasphématoire chez l’un, dignité sereine chez l’autre.
Au cœur d’une méditation sur la mémoire,
Colette est naturellement amenée à évoquer Proust. Significativement, c’est une
mémoire qui se veut désormais délestée du poids d’un lien amoureux privilégié
(plus de couple, le partenaire homme ou femme est désormais secondaire), pour
se lover dans les fleurs et dans les mots, ou plutôt dans cet abîme où fleurs
et mots éclosent ensemble, « tout mouillé[s] d’obscurité mortelle ».
Comme Proust qui rêve à propos d’un « pan de mur jaune », Colette se
dit soumise à « la tentation du passé » plutôt qu’à la « soif
véhémente de connaître l’avenir ». « La rupture avec le présent, le
retour en arrière et, brusquement, l’apparition d’un pan [sic !] de passé frais, inédit, qu’ils me soient donnés par le
hasard ou par la patience, s’accompagnent d’un heurt auquel rien ne se compare,
et duquel je ne saurais donner aucune définition sensée ». Dans la suite
de l’évocation de ce « pan de passé frais », le nom de Proust surgit
pour confirmer que « ce n’est guère le rôle des écrivains, ni leur facilité,
que d’aimer l’avenir ».
Vient enfin le temps où Proust se
transforme en personnage de Colette. Fleur parmi les fleurs, emblème de la
France, de son goût et de ses arts, Proust — ses cheveux, sa bouche — est
décrit dans Flore et pomone.
Colette se souvient de ses dix-huit ans et de ses grands yeux avec une
« absence d’expression toute orientale », du portrait qu’en a fait
Jacques-Émile Blanche, et de leurs rencontres au Ritz. D’un trait ferme, elle
dessine la vitalité et la faiblesse de l’écrivain : « La maladie, le
travail et le talent repétrirent ce visage sans pli, ces douces joues pâles et
persanes, bouleversèrent les cheveux qui étaient non point soyeux et fins, mais
gros, d’une vitalité à faire peur, drus comme la barbe noire et bleue qui, à
peine rasée, perçait la peau… »
Elle campe l’impénitent de génie : « Tout au contraire j’attendais
que parût, ravagé mais puissant, le pécheur qui de son poids de génie faisait
chanceler le frêle jeune homme en frac… »,
et reste interdite devant un Proust décidément inaccessible :
« Personne ne se garde mieux qu’un être qui semble s’abandonner à tous.
Derrière sa première ligne de défense entamée par l’eau-de-vie, Marcel Proust,
gagnant des postes, plus obscurs et plus difficiles à forcer, nous épiait. »
Mes
cahiers (1945) évoquent une série de portraits dans
laquelle Proust précède Balzac. Elle insiste sur sa « fraîcheur
fatiguée », sur son « agitation et sa pâleur [qui] semblaient le
résultat d’une force terrible », sur sa politesse empressée, note le mélange
de « traces morbides » et d’« extrême
jeunesse », et commente l’énergie nocturne de ces « êtres
exceptionnellement fragiles » qui s’éveillent aux heures de lassitude des
autres. Puis elle revient en détail sur leur rencontre au Ritz, durant la
Grande Guerre. Tel « un garçon d’honneur ivre », Proust propose de la
raccompagner à Auteuil, puisque aucun cocher ne veut l’y conduire en pleine
nuit. Il se lamente, et Colette lui « raconte » qu’elle a l’habitude
de se déchausser sous les réverbères de la Concorde et que, souliers et bas en
baluchons, elle rentre pieds nus chez elle. « Il se plut beaucoup à ma
petite histoire […] », et laisse à la jeune femme d’alors le souvenir d’un
sourire étonné et jeune, ainsi que de l’« ombre
[qui] combla l’ovale noir de sa bouche, ouverte pour chercher de l’air ».
Une dernière rafale de souvenirs réintroduit Proust chez Colette dans
« Trait pour trait » (En pays
connu [1949]). Et c’est de nouveau l’homme qui s’impose avec son mystère,
plutôt qu’avec l’écriture qui en porte les traces ; un Proust dont la
fameuse « jeunesse » est diagnostiquée par Colette comme plus que
féminine : « C’est qu’il paraissait
singulièrement jeune que tous les hommes, plus jeune que toutes les jeunes
femmes. »
Encore un Proust tragique sous les raids aériens au-dessus du Ritz :
« Oui. Je me souviens que, sous un réverbère bleu, Marcel Proust
suffoquait d’asthme, renversait une face mauve creusée d’ombres, envahie d’une
barbe avide. Nous pouvions lire, sur ses traits, dans cette bouche ouverte qui
buvait l’obscurité piquetée de bleu violet, qu’il mourrait bientôt. Il avait la
force encore d’admirer la nuit et ses pervenches de guerre. Au même moment un
raid d’avions accourut et je dus m’abriter avec Proust dans l’hôtel Ritz.
L’alerte passée, il s’empressait, haletant mais animé d’une grâce mondaine, et
parlait d’envoyer chercher pour moi une voiture comme s’il y eût des voitures
dans Paris à deux heures du matin. »
Elle évoque aussi le dandy en proie à un « vent furieux » :
« Un uniforme de gala quotidien, en somme, mais dérangé comme par un vent
furieux qui, versant sur la nuque le chapeau, froissant le linge et les pans
agités de la cravate, comblant d’une cendre noire les sillons de la joue, les
cavités de l’orbite et la bouche haletante, eût pourchassé ce chancelant jeune
homme, âgé de cinquante ans, jusque dans la mort. »
9.3.
La mémoire et la dignité
La recherche du « temps perdu »
mobilise chez Proust une « mémoire involontaire » qui éveille des
sensations délicieuses et des désirs interdits. Les réminiscences les plus
anodines et apparemment idylliques, comme celles que provoque la dégustation
d’une madeleine trempée dans du thé, déclenchent chez le narrateur d’A la recherche une cascade de souvenirs
qui sont autant de profanations. L’appropriation de la mère, qui sous-tend
celle de la mémoire infantile, suppose un lien incestueux vécu comme une
transgression. S’ensuivent d’abord le désir de garder pour soi une maman
destinée à papa — ou à M. Swann ; puis le blasphème adressé à une figure
maternelle latérale, tante Léonie, et enfin la profanation de son canapé, vendu
à une maquerelle, et éprouvée comme le « viol d’une morte ». Ce
défilé s’achève dans l’arrachement impossible à l’étreinte désirée de l’autre.
Une étreinte figurée-vécue par le biais de l’étouffement de soi dans la crise
d’asthme ou, peut-être, par la scène de masochisme dans laquelle le baron de Charlus se fait fouetter, enchaîné à un lit, dans un bordel
d’homosexuels. Pour Proust, la recherche de la sensation perdue est toujours
une recherche de l’infantile, même si elle demeure un horizon plus ou moins
lointain, tandis que l’espace de ses aventures, à la fois désirées et
menaçantes, sources d’infinis plaisirs sadomasochiques,
se déploie dans les liens scandaleux de la « race maudite ». Sodome
et Gomorrhe sont la vérité de la madeleine ; les drames du désir éclipsent les
idylles des satisfactions infantiles régressives, et c’est l’histoire sociale,
avec ses guerres et ses intrigues, qui finit par dominer la poésie sensuelle du
temps retrouvé.
Le parcours de Colette est différent. On
peut lui accorder la primauté de cet arrimage de l’écriture à la mémoire
infantile que Proust, pour sa part, ne cesse d’emphatiser et de théoriser. Car
c’est dès Claudine à l’école (1900),
après les premières révélations sexuelles et les blessures conjugales qui les
accompagnent, dans le creuset de cette initiation et du renoncement propre à sa
maturation psychique, que Colette s’installe dans l’écriture. D’emblée pour
elle, c’est une saisie de l’infantile : « Je m’appelle Claudine,
j’habite Montigny ; j’y suis née en 1884 ; probablement je n’y
mourrai pas. » Le décor est planté en quelques traits, et une page suffit
pour que le temps passé s’énonce en durée sensible et musicale :
« juste ce qu’il faut de toits rouges pour faire valoir le vert velouté
des bois. Chers bois !... ».
Le pari inconscient est tenu dans toutes les Claudine : aux antipodes de la vie amoureuse, de ses frasques
et de ses déboires, il existe une sérénité de la mémoire infantile — refuge,
doublure et dignité. L’héroïne mettra du temps à expliciter la logique et les
voies de cet enracinement dans la figure de la mère enfin retrouvée (projection
d’elle-même, ou modèle prémonitoire ? qui peut le dire ?). Immédiatement,
le souvenir colettien est une extase : saisie
fulgurante de l’objet senti, et élévation du moi. Contrairement à Proust qui
avance sur les sentiers de la profanation aussi sinueux que son souffle et sa
syntaxe, Colette procède par captures sereines, dans une adéquation fulgurante
du senti et du dit, étayées sur la certitude — qu’elle croit être son droit —
non pas de s’approprier la mère par un quelconque blasphème, mais de partager
avec celle-ci une mutuelle osmose dans l’alphabet du monde. Aussi sa quête de
la mémoire délaisse-t-elle le chemin de la culpabilité qui est celui d’une
narration, mais progresse au contraire par affirmations incisives d’une fierté
sûre d’elle-même, sous l’aspect poétique d’une série de condensations.
La conscience que son écriture est une
installation dans la mémoire infantile, aux antipodes des tempêtes amoureuses,
semble s’imposer à Colette dans La
Retraite sentimentale (1907) puis dans Les
Vrilles de la vigne (1908). Proust a abandonné les ébauches de Jean Santeuil, et c’est le Cahier de 1908, longtemps inconnu du
public, qui contient tous les germes d’A
la recherche. Colette serait ainsi la pionnière du temps retrouvé, mais son
frayage jusqu’à la mémoire dite par Proust « involontaire » est
différent. S’il ne paraît donc pas injuste de dire que c’est elle qui a inventé
« la recherche du temps perdu », il faut tout de suite préciser que
c’est pour y trouver une « inexpugnable innocence ».
1907. Écrire c’est rejoindre une sagesse
infantile ; écrire c’est arrêter le temps en instants repus ; écrire
c’est trouver une « voix secrète » en même temps qu’un
« animal » dans lequel je me dédouble ; écrire c’est revivre le
temps incorporé dans un « soleil aussi blond, un lilas aussi bleu à force
d’être mauve... » : « Quand j’étais petite, une grande sagesse
précoce m’envoya, au plus beau de mes joies, plusieurs avertissements
mélancoliques, d’une amertume savoureuse au-dessus de mon âge. Elle me dit…
Vous pensez à une belle dame en blanc avec un diadème, qui m’apparut parmi
l’obscur feuillage du vieux noyer ? Pas du tout ! C’était simplement
banalement, la “voix secrète”, une immobilisation presque douloureuse de ma
pensée, de tout mon petit animal bien portant, excité et repu, une porte
entrouverte qui pour les enfants de mon âge demeure d’habitude fermée… Elle me
disait : “Vois, arrête-toi, cet instant est beau !” Y a-t-il
ailleurs, dans toute ta vie qui se précipite, un soleil aussi blond, un lilas
aussi bleu à force, d’être mauve, un livre aussi passionnant, un fruit aussi
ruisselant de parfums sucrés, un lit aussi frais de draps rudes et
blancs ? Reverras-tu plus belle la forme de ces collines ? Combien de
temps seras-tu encore cette enfant ivre de sa seule vie, du seul battement de
ses heureuses artères ? Tout est si frais en toi que tu ne songes pas que
tu as des membres, des dents, des yeux, une bouche douce et périssable. Où
ressentiras-tu la première piqûre, la première déchéance ?… Oh ! souhaite d’arrêter le temps, souhaite de demeurer encore un peu
pareille à toi-même : ne grandis pas, ne pense pas, ne souffre pas !
Souhaite cela si fort qu’un dieu, quelque part, s’en émeuve et t’exauce !”… »
1908. La mémoire est un espace
abandonné : « J’appartiens à un pays que j’ai quitté » ;
une « forme des années », tel un ruban incrusté de cristaux :
« La forme des années a changé pour moi — durant que, moi, je changeais.
L’année n’est plus cette route ondulée, ce ruban déroulé qui, depuis janvier,
montait vers le printemps, montait, montait vers l’été pour s’y épanouir en
calme plaine, en pré brûlant coupé d’ombres bleues, taché de géraniums,
éblouissants, — puis descendait vers un automne odorant, brumeux, fleurant le
marécage, le fruit mûr et le gibier, — puis s’enfonçait vers un hiver sec,
sonore, miroitant d’étangs gelés, de neige rose sous le soleil… Puis le ruban
ondulé dévalait, vertigineux, jusqu’à rompre net devant une date merveilleuse,
isolée, suspendue entre les deux années comme une fleur de givre : le jour
de l’An… »
Écrire est un antidépresseur qui sèche les larmes en transplantant dans la
mémoire « bonté » et « justice » : « Éloigne-toi
lentement, lentement, sans larmes ; n’oublie rien ! Emporte ta santé,
ta gaieté, ta coquetterie, le peu de bonté et de justice qui t’a rendu la vie
moins amère ; n’oublie pas ! »
Dès lors, l’idée développée par Proust du souvenir comme être
biface apparaît en filigrane : tout souvenir enclôt une sensation passée,
accolée à une sensation éprouvée et écrite au présent — « Je suis un
sensitif, et il suffit de me rappeler certaines émotions vives pour que je les
éprouve de nouveau... »
La Vagabonde (1910) déploie ce dédoublement spécifique au souvenir, en
évoquant une Colette petite fille qui, depuis l’enfance, regarde la narratrice
passer : « Debout, au bord du bois, une enfant nous regardait passer,
une fillette de douze ans, dont la ressemblance avec moi me saisit. [...] Oui,
debout au bord du hallier, mon enfance farouche me regardait passer, éblouie
par le soleil levant… » Et jusqu’à Trois... six... neuf... (1944), le
souvenir est comme suspendu dans une durée immobile, inexistant en tant
qu’écoulement temporel, fixé à jamais entre un « nous », campé au
présent, et « nos yeux d’enfant », rivés sur le passé :
« Une maison natale, même bien-aimée, n’existe jamais tout à fait
réellement, puisque nous la voyons avec nos yeux d’enfant, vastes et
déformateurs. »
Un texte tardif « Passé » résume le rôle
que Colette attribue au passé infantile d’offrir une compensation aux
déceptions de la vie amoureuse adulte et, de ce fait, d’être un foyer de
l’imaginaire : « Ô solitude de mon enfance, toi mon refuge, toi mon
remède, citadelle de mon jeune orgueil, de quelle force je t’aimais, et combien
je craignais, déjà, de te perdre ! » Et un peu avant cette
confidence, elle place ainsi l’enfance, en double fond absolu mais inaccessible,
du roman : « Le roman de mon enfance... je voudrais l’écrire, et je
crains, en l’essayant, d’échouer. Qu’une histoire d’amour semble donc facile et
petite, à côté de celle d’une adolescence où l’idée de l’amour, ternie par des
passions rivales, apparaît non comme le but et la fatalité d’une vie, mais
comme un couronnement incertain, redoutable comme le chapiteau périlleux et
fragile d’une colonne, comme l’arabesque étincelante et superflue... » Car le
temps infantile retrouvé, la temporalité s’abolit : rien n’est perdu et rien ne
(se) passe. Demeure l’espace ébloui.
Se souvenir, pour Colette, c’est avant tout sentir. Les souvenirs
appartiennent aux yeux, aux narines et à la bouche, pour constituer l’essence
intemporelle des mots : « Tu protestes, tu hoches la tête avec ton
rire grave, le vert de l’herbe neuve décolore l’eau mordorée de ton regard…
Plus mauves… non, plus bleues… Cesse cette taquinerie ! Porte plutôt à tes
narines le parfum invariable de ces violettes changeantes et regarde, en
respirant le philtre qui abolit les années, regarde comme moi ressusciter et
grandir devant toi les printemps de ton enfance… »
Une violette, perçue et nommée aujourd’hui,
est aussi immédiatement un souvenir de violettes : « O violettes de mon enfance ! Vous montez devant
moi, toutes, vous treillagez le ciel laiteux d’avril, et la palpitation de vos
petits visages innombrables m’enivre… »
Ainsi agencé en doublets, le souvenir est un havre de sécurité,
une solitude heureuse : « Ah ! j’en étais sûre ! Claudine
ne résiste jamais à une évocation du passé. À ces seuls mots : “Vous
souvenez-vous ?” elle se détend, se confie, s’abandonne toute... À ces
seuls mots : “Vous souvenez-vous ?” elle incline la tête, les yeux
guetteurs, l’oreille tendue comme vers un murmure de fontaines invisibles... »
C’est dans La Vagabonde (1910)
que se précise et s’explicite le « royaume » interne de la mémoire,
espace de la solitude sensible en même temps que de l’écriture : le
personnage de Renée Néré le découvre en réponse à son drame intérieur, qui est
celui d’un désir (féminin, hystérique ?) toujours harassant, étranger à
l’assouvissement. Quand la pensée de Max devient un « tourment »,
l’héroïne se réfugie dans « un de ses parfaits moments » où elle
goûte les « merveilles de la terre » et qu’elle appelle un
« royaume ». Cette
retraite, moins solitaire que ne le prétend cette fugueuse, exige la
voluptueuse discipline de sentir dans
le but de nommer ; le monde devenant,
à cette seule condition, son véritable royaume. Renée Néré se
« souvient » en effet d’avoir trouvé refuge dans l’acte de l’écriture
— elle a été l’auteur de deux ouvrages, A
côté de l’amour et de La Forêt des
oiseaux : « […] pour moi, tel mot suffit à recréer l’odeur, la
couleur des heures vécues, il est sonore et plein et mystérieux comme une
coquille où chante la mer ».
L’érotisme enfin traversé — mais jamais définitivement —,
l’écriture s’impose à Colette comme une mémoire refuge qui requiert le mot de
« dignité ». Le souci du
« silence honorable », l’aversion pour « l’indiscrète poésie »
sont présents dès les premiers écrits de la jeune femme, lorsqu’elle se
découvre trompée : « Qui a donc osé murmurer, trop prêt de mon
oreille irritable, les mots de déchéance, d’avilissement ?... Toby-Chien,
Chien de bon sens, écoute bien : je ne me suis jamais senti plus digne de
moi-même. Du fond de la sévère retraite que je me suis faite au fond de
moi-même, il m’arrive de rire tout haut... » Plus tard,
Colette insinuera, par Sido interposée, qu’elle n’est pas elle-même une grande
amoureuse (elle cite une lettre inventée de sa mère dans La Naissance du jour : « Je serais donc, à ma manière,
une grande amoureuse ? Voilà une nouvelle qui eût bien étonné mes deux
maris ! »). Mais
elle n’en affirme pas moins qu’au commencement, préside la certitude d’être
aimée. Par le capitaine Colette ? par Sido ? avant Willy ?
Peut-être est-ce dans cette image d’un surmoi parental aimant que
s’enracine ce qu’elle appellera un « scrupule ». C’est-à-dire
l’exigence propre à notre conscience de se conformer à l’idéal laissé par les
parents : « […] rêver, puis rentrer dans la réalité, ce n’est pas changer
la place et la gravité d’un scrupule ».
Paradoxalement, logiquement, elle revient à cette exigence de
dignité après avoir été en infraction avec l’interdit parental de l’inceste.
Les « scrupules » s’affirment plus nettement après sa liaison avec
Bertrand de Jouvenel : c’est après Chéri et Le Blé en herbe, dans La Maison de Claudine qu’advient cette
explicitation de la mémoire infantile comme capture de droit, capture heureuse,
de la mère. Là aussi se forme le regret ambigu (parce qu’il appelle un démenti,
et semble si sûr de l’obtenir) de ne pas en être « digne » ;
l’idée de la transgression des interdits s’atténue, car elle est subsumée par
une sérénité cosmique : « Maison et jardin vivent encore, je le sais, mais
qu’importe, si la magie les a quittés, si le secret est perdu qui ouvrait —
lumière, odeurs, harmonie d’arbres et d’oiseaux, murmure de voix humaines
qu’a déjà suspendu la mort — un monde dont j’ai cessé d’être digne ?... »
Je l’ai dit, c’est à Sido que Colette fait remonter cette
certitude de la dignité : parce que sa mère possédait ce don « décrétal de l’observation » et ne se pliait à aucune
complaisance, ni vis-à-vis de la religion ni même de l’amour sacrificiel de son
époux ; parce qu’elle était la fille de cette grand-mère, Mme Eugène Landoy, dont Colette retrouvera le médaillon volé :
« Mes enfants, récitai-je, n’oubliez jamais votre digne et vertueuse mère ». Parce que
l’amour entre une mère et sa fille paraît à l’écrivain d’une évidence
naturelle, mais à condition, répétons-le, que les haines soient traversées,
écartées, oubliées ou analysées (cela n’est pas exclu !) — dans ce passage
à l’acte que fut l’inceste réécrit dans Chéri et Le Blé en herbe, et qui présente
des figures féminines ambiguës, détestables ou enviables.
En deçà ou au-delà de toute perversité, ce lien enfin retrouvé de
la fille à sa mère participerait d’un autre
temps que le temps du désir qui
est, Proust l’a bien vu, le temps de la guerre et de la mort. Plongée, au
contraire, dans la durée de l’éclosion, c’est l’autre césure, celle du
commencement, de l’éternel recommencement que Colette célèbre avec son temps
retrouvé à elle. Un temps forcément extatique, forcément cyclique, condensé en
instants heureux et en « vrilles de la vigne » aigres-douces, amères,
ivres. Vivantes.
Aucune effraction, aucune malédiction, aucun déshonneur, aucune
pénétration phallique ne l’entache — rien d’autre que le temps maternel du commencement : Colette s’épanouit
dans un temps paradoxal qui ne cesse d’amorcer des éclosions, comme Sido
s’émeut et patiente devant une fleur encore en bouton : « Il n’y eut
jamais dans sa vie le souvenir d’une aile déshonorée, et si elle tremble de
désir autour d’un calice fermé, autour d’une chrysalide roulée encore dans sa
coque nissée, du moins elle attendit, respectueuse,
l’heure... Pureté de ceux qui n’ont pas commis d’effraction ! » Cette
introjection de l’éclosion ne saurait se raconter longuement ; elle
s’inscrit d’un geste concis qui est à la fois saveur et sens, symbole et
goût : « Noël partout s’est nourri de symboles : nous ferons
cette année comme Noël, et aux symboles nous ajouterons ce dessert doux
amer : la poignante, l’impérissable saveur du souvenir. » Les intrigues
s’estompent, demeure le condensé des résonances : « Encore
est-ce une fidélité, dirai-je, de résonance. »
Pas question d’enfantillages ou de complaisance avec un passé qui
nous retient prisonniers, comme le fut Léo, le frère cadet perdu dans son rêve
d’une réalité infidèle. A l’inverse de ce sylphe malheureux, Colette se voudra
un « enfant invulnérable ».
Une pure solitude, accompagnant la tension résorbée, résume l’état
intérieur de la mémoire ainsi retrouvée en « vrilles de la
vigne » : Colette est une cruelle qui s’attendrit dans sa tension.
« Tendre vers l’achevé, c’est revenir vers son point de départ. Les vrais
aventureux n’y reviennent pas ; mais je n’ai rien de la vraie aventureuse. »
Le sommeil lui-même devient pour elle un souvenir sans histoire,
réplique d’une présence maternelle apaisante : pure image de beauté
visuelle, tactile, douce et vibrante comme un papillon : « Le sommeil
s’approche, me frôle et fuit… Je le vois ! Il est pareil à ce papillon de
lourd velours que je poursuivais, dans le jardin enflammé d’iris… Tu te
souviens ? »
A l’instar de ce sommeil calfeutrant, l’écriture à la recherche de
l’éclosion scrute la naissance et suspend le temps, parce qu’elle résorbe le
mal dans l’élation d’un départ : « J’étais retournée au commencement
de ma vie. Tant de chemin à faire pour me rejoindre, jusqu’ici ! J’appelle
le sommeil enfui, le sombre rideau qui m’abritait et qui vient de se retirer de
moi, me laissant frissonnante et comme nue… Les malades qui se croient guéris
connaissent ces reprises du mal ; elles les trouvent puérilement étonnés
et plaintifs : “Mais je croyais que c’était fini !” Pour un peu
je gémirais, à voix haute, comme eux…
« Funeste et trop doux sommeil, qui abolit en moins d’une
heure le souvenir de moi-même ! »
Qu’importe si au commencement était la douleur, quand persiste
cette volonté de vivre et de faire renaître les souvenirs jusqu’à celui de sa
propre naissance : « A force de cris et de peine, ma mère me chassa de ses
flancs, mais, comme je surgis bleue et muette, personne ne crut utile de
s’occuper de moi... ». Et
encore : « Une quinzaine d’autres 28 janvier passèrent, sans y rien
changer, sur cette chambre où je naquis à demi étouffée, manifestant une
volonté personnelle de vivre et même de vivre longtemps, puisque je viens
d’accomplir le soixante-quinzième anniversaire que mes amis autour de moi
s’obstinent à appeler “un beau jour”. »
Sur ce fond de célébration de l’instant, les règlements de comptes
n’en continueront pas moins, et de plus belle : Willy en aura sa part dans Mes apprentissages, et Jouvenel dans Julie de Carneilhan. Deux régimes du
souvenir soutiendront ainsi l’écriture de Colette elle-même : celui,
érotique, de la vengeance ; et celui, bucolique, d’un Dionysos féminin
réconcilié avec la mère originelle et libre de s’abandonner à une ivresse
sereine. Puisqu’il n’y a pas de temps, il n’y a pas d’Histoire pour Colette :
la suspension de la politique est structurelle chez elle, nullement une simple
étourderie d’ingénue...
Les rêves de Colette ? On n’en saura pas grand-chose. Des
« lions pervenche » ou « un brin anglais » : c’est
presque tout ce qu’elle consent à nous livrer. Figures surréalistes d’une
cruauté apprivoisée, d’une animalité apaisée jusqu’au végétal. Même la menace
archaïque (maternelle), la guérilla entre femelles, est retournée en bucolique
ironie. Cette dignité, cette
innocence du temps retrouvé à la Colette seraient-elles le signe d’un manque
d’imagination, comme on l’en a accusée ? Ou, au contraire, à la manière de
Mallarmé, un retrait de l’imaginaire, par le biais du souvenir, vers ce que
Freud appelle l’« ombilic du rêve » et que
Colette nomme un « fond du rêve ». Point ultime, au bord de
l’irreprésentable sensation, où l’imaginaire se replie, où il se
« refus[e] un essor quotidien » pour mieux nommer le seul instant qui
mérite de durer, l’instant de l’acquiescement au monde, l’instant de
commencement, de renaissance ? « Un de mes confrères, et non des
moindres, a affirmé que je n’ai aucune imagination. Voilà, si cela est vrai,
une bien bonne chose. Mais que dirait-il de Mallarmé, cité par Henry
Mondor ? Au fond du rêve peut-être se débat l’imagination de gens lui
refusant un essor quotidien... »
Si Colette fut cette « oublieuse qui quitte[ra] la maison
maternelle sans tourner la tête », comme elle
s’en accuse, elle ne cesse en réalité de s’appuyer sur l’instant fugace du
souvenir retrouvé. Souvenir, je te tiens, dit-elle en substance. Je n’ai nul
besoin de te chercher. Il importe simplement, naturellement, de recommencer à
ajuster le sens au sensible. Cela s’appelle écrire.
Avec la justesse des amitiés rivales, Anna de Noailles a révélé
cette Colette faite de « solitude », d’« orgueil »
et de « mépris », qui puise son originalité dans « le sentiment
d’une géographie humaine ». Elle a noté qu’il n’y a pas, à proprement parler, de temps chez Colette, si
ce n’est celui des purs instants qui comblent la « contrée », faite
indistinctement « de l’âme et des corps » qu’elle a créés. Sans
hiatus entre les composantes, sans voyage, sinon à l’intérieur de sa fière
solitude, « inexpugnable innocence ».
Nous comprenons mieux maintenant comment cette résorption du temps et de l’espace natal s’étaie, chez Colette, d’une réconciliation avec
l’infantile qui a nécessité un passage par la mère-version. Cette écriture
déculpabilisée de la perversion qu’est la mère-version colettienne nous apparaît comme la logique nécessaire qui incurve la course du temps en un
Eden, espace de jouissance. Espace hors temps, a-politique, a-social, lieu imaginaire donc, et en ce sens
non-lieu : n’est-ce pas l’u-topie elle-même ? L’utopie comme réconciliation avec la
mère-version sous-tend la dynamique de la sublimation chez Colette.
L’imaginaire habite cette utopie où je est la mère. Alors que la psychanalyse essaie d’élaborer
la violence du désir et la perversion elle-même en s’appuyant sur un sujet
conscient de la « castration » (selon Freud), de la « position
dépressive » (selon Klein), du « manque » (selon Lacan), l’expérience de la sublimation diverge de cette voie. Elle crée une u-topie, au sens d’un lieu imaginaire, a-social,
d’ex-tase qui suspend les limites entre
« sujet » et « objet » et immerge le moi dans l’Être. Énigmatique, scandaleuse, radieuse sublimation : elle évoque la
jouissance qui inonde la face du dieu Mithra : « […] la figure baignée de
lumière du jeune dieu perse est restée obscure pour notre compréhension », avoue Freud
tourné vers le père. Puissions-nous approcher de cette lumière, en lisant
l’extatique Colette qui passa de la maison de Claudine pour recréer Sido, son
modèle et son double !
Je verrais dans l’« inexpugnable
innocence » de Colette la source de cette honnêteté de jugement qui
commande sa plume lorsqu’elle écrit sur… Artaud, par exemple. Rien de plus
éloigné, en apparence, que l’infernal Artaud de la bucolique Bourguignonne.
Mais, lorsqu’une presse hostile se déchaîne après la représentation des Cenci, Colette consacre à l’art d’Artaud
deux articles qui rapprochent étrangement sa pureté monstrueuse du
« théâtre de la cruauté ». Loin d’être tendre
avec le comédien-poète, Colette, visiblement choquée par sa violence, se fait
néanmoins complice de sa vérité nietzschéenne : « M. Antonin Artaud
est un exécrable acteur. Et pourtant, avec sa violence absurde, ses yeux égarés
et sa fureur à peine feinte, il nous emporte avec lui au-delà du bien et du
mal, dans un désert où la soif du sang nous brûle. » Mais c’est le
second article qui encourage Artaud, et recommande son spectacle :
« Si vous restez jusqu’à la fin, écrit Colette, ayant détesté, honni, hué
la pièce, reconnaissez qu’une expérience comme celle d’Artaud sert mieux le
théâtre que la comédie gentillette qui se croit adroite parce qu’elle n’a rien
risqué. » Puis elle conclut : « Allez cette semaine à la mauvaise
pièce nouvelle, avant d’aller entendre les autres. » Artaud ne s’y
trompe pas : « N’est-ce pas Colette qui dans Le Journal donne l’opinion publique du Journal et qui dans une feuille à part et libre donne son opinion
personnelle qui est enthousiasme pur. » Nullement engagée
dans l’art moderne, comme le fut l’auteur de L’Ombilic des nerfs,
Colette n’a jamais repris officiellement son texte : il n’en demeure pas
moins qu’avec son « inexpugnable innocence »,elle l’a écrit au cœur même de la bagarre, toujours à l’écoute de
l’« Inexorable ».
Colette la sensuelle nous confronte ainsi à une expérience des
plus énigmatique, celle de la sublimation qui tisse indissolublement le réel et le symbolique, la chair et les mots, et qui a fini par
gouverner, fait rare, tout son être. Elle ne se prive d’ailleurs pas de la
commenter, tout en se prétendant rétive aux « généralités ».
9.4. « Car
écrire ne conduit qu’à écrire. »
Depuis sa revendication d’absence de
vocation littéraire,
et jusqu’à l’aveu d’un besoin « membru » d’écrire,
Colette émaille son œuvre de notes éparses sur l’écriture qui s’impose, au fil
du temps, comme l’expérience absolue : avec et contre l’amour, avec et
contre l’histoire. C’est l’écriture seule qui module le caractère de la
femme ; c’est elle aussi qui inflige son espace et son temps spécifiques à
la réalité de l’existence elle-même, insufflant ainsi une logique
« prémonitoire » au déroulement même de la vie.
Ne ressemblant ni à son père, le
Capitaine, qui ne lègue que des pages blanches, ni à Sido, qui, au contraire,
« attablée n’importe où [...] écrivait »,
Colette dévoile que, bien loin d’être légère, sa propre histoire d’« écrivain qui ne voulait pas écrire » s’avère
être « une aventure mélancolique ».
Elle sourit avec compassion aux poètes qui chantent la nuit, sous ses fenêtres
du Palais-Royal : « Car la timide créature humaine a besoin de “dire
quelque chose à quelqu’un”, fût-ce en termes grossiers. ».
Elle moque la préciosité des admirateurs du beau style — « Le style, c’est
presque toujours le mauvais goût de nos devanciers, à dater du jour où il nous
devient agréable. » :
une façon de dénier son intérêt pour la littérature. Toutefois, la langue
française maniée avec « grand style » enthousiasme notre
Bourguignonne : « Mais à chaque joyau de beau langage, recueilli tout
brillant dans la blanche poussière provençale, j’admire qu’une syntaxe de grand
style refoule l’alluvion d’argot, de patois sportif, de prétentieux humour qui
afflue de toutes parts. »
En pleine débâcle, Colette prête l’oreille aux vocables désuets du langage
populaire qui ressuscite, sans le savoir, le Grand Siècle : « Une si
belle phrase, qui sent son XVIIe siècle, fleurit pourtant ici sur
des lèvres illettrées » ;
et assure la pérennité de termes latins. Soignant une hirondelle battue du
vent, qui s’était abritée sous les tuiles à godrons, une paysanne s’exprime
ainsi : “Laissez, dit-elle, demain elle aura repris ses vertus.” »
Si, dans les dernières années de sa vie,
l’écriture s’impose comme un souci formel à Colette, elle a été d’emblée vécue
comme une expérience singulière, voire comme la preuve par excellence de la
singularité : « De
l’imagination ; mais on sent un parti pris de se singulariser. Elle
m’est restée dans la mémoire, cette note écrite à l’encre rouge en marge d’une
composition française. »
Heurtant le conformisme scolaire, cette affirmation de soi avait pour but
originel de compter avec les cicatrices — sous-entendu qu’une cicatrice n’est
pas une marque de naissance, mais « une acquisition » bien singulière.
Pourtant, Colette ne recense pas ses chagrins et célèbre la joie qu’elle
préférera toujours aux plaintes : « J’eus bien raison de me fier à ce
que je connaissais le moins, mes semblables, la sollicitude humaine... Si
j’écrivais quelque jour mes souvenirs de “l’autre versant”, il me semble que
par contraste le “han” d’effort, le cri de douleur y rendraient un son de fête,
et je ne saurais m’y plaindre qu’avec un visage heureux. »
Hédonisme trompeur s’il en est, car contre
toute attente c’est la peine d’écrire que dévoile discrètement cette femme.
Seuls ses lecteurs fidèles la débusquent au détour de ses phrases, en-dessous
des images cicatrisées. « Je prends encore la plume, pour commencer le jeu
périlleux et décevant, pour saisir et fixer, sous la pointe double et ployante,
le chatoyant, le fugace, le passionnant adjectif... Ce n’est qu’une courte
crise, la démangeaison d’une cicatrice... »
Le souci de l’écrivain pour le mot juste s’étaie de la fascination
qu’elle eut, dès l’enfance, pour le son qui pousse à la rêverie, bouscule les significations convenues, surcharge
d’idées bizarres une mélodie étrange, parvenant enfin à faire basculer le
langage dans la chair du monde, où il s’égale à un « venin » ou un
« escargot écrasé ». Et Colette la « réaliste » de nous
révéler, nous l’avons vu, l’alchimie très « surréaliste » de son
écriture, en détaillant sa rêverie enfantine sur le mot « presbytère ».
Contrairement à ce que croirait un esprit scientiste, ce n’est pas en censurant
la rêverie, mais en la laissant résonner, que l’écrivain saisit la chance
d’ajouter le son au sens et à la chose.
Pour la petite provinciale, le
« grand événement » est-il de se fiancer ou plutôt celui d’écrire des
lettres à son futur époux ? « Le grand événement de nos fiançailles, pour
moi, ç’avait été notre correspondance, les lettres que je recevais et écrivais
librement. »
A ses débuts parisiens, Colette se glisse dans le rôle de femme du monde, et
l’écriture devient alors son « royaume » secret, sa citadelle
protectrice : un dédoublement. Même marquée du sceau de Willy, c’est
contre la « prison » qu’il aurait imposée à Colette que l’écriture se
développe, tel un exil, pour donner naissance aux Claudine. Plus tard, au-delà du moyen de défense spontané qu’elle
fut initialement, son écriture
s’affirme par ces anti-Claudine que
sont les textes du style « vrilles de la vigne », et programme un
véritable art poétique. Définie comme « double » de Claudine, en
« miroir » face à son « parti pris d’indifférence », et à
sa « forteresse de solitude », l’écriture creuse une nouvelle
« retraite » qui « défie l’envahisseur » : d’un côté,
l’« ironique » et « douce »
Claudine, et, de l’autre : « laissez-moi ma part d’incertitude,
d’amour, d’activité stérile, de paresse savoureuse, laissez-moi ma pauvre petite
part humaine, qui a son prix ! »
Dès ce moment-là, Colette la terrienne
commence une heureuse méditation sur son exil dans le pays de la sublimation.
Renée la Vagabonde est l’auteur d’un
livre qui ne rencontre aucun succès mais qui l’installe dans cet autre
« royaume » où les mots créent les choses : « pour moi, tel
mot suffit à recréer l’odeur, la couleur des heures vécues, il est sonore et
plein et mystérieux comme une coquille où chante la mer ».
Comme Sido qui sait « qu’on possède dans l’abstention, et seulement dans
l’abstention »,
l’héroïne de Colette suggère qu’après la souffrance crue et naïve (« Mon
Dieu ! que j’étais jeune, et que je l’aimais cet homme-là ! et comme
j’ai souffert !... »), vient le temps d’une
seconde souffrance « avec orgueil et un entêtement intraitable », qui
précède immédiatement l’acte de « faire de la littérature ».
Loin de se réduire à une simple défense de
l’amoureuse blessée, l’acte d’écriture s’épanouit dans ce mouvement de dispersion du moi qui se « suspend » à tout ce qu’il traverse, puis
se dissocie de l’auteur surveillant cette immersion : « Vagabonde,
soit, mais qui se résigne à tourner en rond, sur place, comme ceux-ci, mes
compagnons, mes frères… Les départs m’attristent et m’enivrent, c’est vrai, et
quelque chose de moi se suspend à tout ce que je traverse — pays nouveaux,
ciels purs ou nuageux, mers sous la pluie couleur de perle grise —, s’y
accroche si passionnément qu’il me semble laisser derrière moi mille petits
fantômes à ma ressemblance, roulés dans le flot, bercés sur la feuille,
dispersés dans le nuage… Mais un dernier petit fantôme, le plus pareil de tous
à moi-même, ne demeure-t-il pas assis au coin de ma cheminée, rêveur et sage,
penché sur un livre qu’il oublie de lire ?
»
L’écriture est une avidité qui se substitue à tout ce qui manque : « Mon
souhait vorace crée ce qui lui manque et s’en repaît. »
Mais elle est aussi une fièvre. Colette décrit le dédoublement qui s’empare
d’elle sous l’effet de la maladie, et nous rappelle certains états de dépersonnalisation
de sa petite enfance : elle croit apercevoir une jumelle aux cheveux plats
qui lui dispute l’amour de Sido. « Durant que je grandissais,
vieillissais, elle a eu la chance de rester petite fille. Elle date de loin.
Aux heures de fièvre Sido ma mère se penchait sur moi : “Tu veux boire,
Minet-Chéri ?” Je voulais surtout qu’elle n’aperçut pas ma jumelle
suspecte, la fillette aux cheveux plats qu’elle aurait pu aimer. »
Pourtant, ce processus hallucinatoire est au cœur de l’expérience littéraire
elle-même qui, plus maîtrisée cependant qu’une forte fièvre, modèle la
véritable personnalité de la narratrice : Colette est-elle née de Sido et
du Capitaine, ou bien de cette perte et de ce remodelage de soi qu’est
l’écriture elle-même ? Comme la fièvre, la fiction « c’est le
commencement de ce qu’on ne nomme pas »
et, telle une enfant sauvage, elle « ba[t] les
taillis et les prés gorgés d’eau en chien indépendant qui ne rend pas de
comptes ».
Maîtresse assurée de la
« fièvre » et du « chien indépendant » qui l’impulsent,
Colette ne demeure pas moins son propre thème privilégié, dissimulé à peine par
ses personnages fictifs. Fruits de ce dédoublement et de ces dispersions de
soi, d’impitoyables portraits de la narratrice par elle-même nous restituent à
la place de l’auteur — de la femme, et plus largement des humains — un polytope
vertigineux. Fascinante, Colette ? « Essayez donc ! Si j’étais
homme et que je me connusse à fond, je ne m’aimerais guère : insociable,
emballée et révoltée à première vue, un flair qui se prétend infaillible et ne
fait pas de concessions, maniaque, fausse bohème, très “propriote”
au fond, jalouse, sincère par paresse et menteuse par pudeur…
Je dis ça aujourd’hui, et puis, demain, je
me trouverai charmante… »
Son écriture vise à tracer un tourbillon
d’identités : sera « femme » la création imaginaire qui témoigne
au mieux de ce corps polymorphique, sans repos, sans frontières, sans
prix : « Comme tout change vite !… Les
femmes surtout… Celle-ci, en quelques mois, perdra presque tout son mordant,
son pathétique naturel et inconscient. Un sournois atavisme de concierges, de
petits commerçants cupides, va-t-il se faire jour en cette folle Jadin de dix-huit ans, si prodigue d’elle-même et de la
pauvre galette ? Pourquoi, devant elle, songé-je aux Bell’s,
acrobates allemands au nom anglais que nous connûmes, Brague et moi, à
Bruxelles ? Incomparables de force et de grâce sous des maillots cerise
qui pâlissaient leur peau blonde, ils habitaient, à cinq, deux chambres sans
meubles, où ils cuisinaient eux-mêmes, sur un petit fourneau de fonte. Et tout
le jour, c’étaient — nous raconta l’impresario — des palabres mystérieux, des
méditations sur les journaux financiers, des disputes sauvages à propos de
mines d’or, de Sosnowice et de Crédit foncier
d’Égypte ! L’argent, l’argent, l’argent… »
Essayez de la fixer, ses traits
s’échappent : belle ou laide ? « Nattée à l’alsacienne, deux
petits rubans voletant au bout de mes deux tresses, la raie au milieu de la
tête, bien enlaidie avec mes tempes découvertes et mes oreilles trop loin du
nez, je montais parfois chez ma sœur aux longs cheveux. »
Blessée autant par les gratifications que par les épreuves ? Sûrement :
« Au hasard et à l’inconnu, j’ai demandé des compensations, qu’ils m’ont
quelquefois versées un peu comme le cocotier ses noix, pan ! en plein sur
le crâne. »
Comme chez Proust, son goût pour l’exhibition dissimule un mystère qui se
refuse obstinément : « On ne pénètre pas dans l’intimité d’une
cariatide, on la contemple. » Aux facettes contradictoires que le
temps dépose dans l’espace, s’ajoute le kaléidoscope des identifications et des
projections de la narratrice : « Sido » est-elle Sido ou
toujours Colette ? modèle ou copie ? On se souvient de l’exergue de La Naissance du jour : « Imagine-t-on,
à me lire, que je fais mon portrait ? Patience : c’est seulement mon
modèle. »
La force du désir vient brouiller à son
tour et définitivement ses traits. Car, mû par un fantasme impétueux, le désir
construit une réalité « prémonitoire », c’est-à-dire un imaginaire si
impératif que le corps réel est obligé d’accomplir ce que l’écriture avait déjà
programmé, avant de laisser à son tour le dernier mot à l’imaginaire :
d’abord Léa et Chéri, puis Colette et Bertrand, et puis encore Le Blé en herbe.
Dans cet entrelacs des
identités, Colette — qui déteste les généralités ! dit-elle — médite
pourtant avec une justesse éblouissante sur l’« éphémère »,
cible privilégiée de son écriture, et souligne le déséquilibre qui caractérise
ses récits. Ni le « notoire », ni le « vénérable » ne
méritent que l’auteur s’y attarde ; seul vaut le banal ou le
« rebattu ». Entendez : le quotidien rendu à l’étonnement,
révélé dans ses détails vivifiants qui appellent la saisie d’une écriture en
« vrilles de la vigne ». — « Vingt pages sur le coloré, le
tonique et mystérieux éphémère ; vingt lignes sur le notoire et le
vénérable que d’autres ont chanté et chanteront ; de l’étonnement devant
le rebattu, çà et là une propension à dormir d’ennui au son des grands
ah ! qu’est en train de pousser le monde devant un prodige, un messie ou
une catastrophe — voilà, je pense, mon rythme… »
Centre organisateur de toute son existence, l’écriture ne devient
pourtant jamais chez Colette une activité fétiche. Elle se moque joyeusement des
rituels qui entoure le culte de l’écrit et de ses confrères : « Nous ne
sommes pas jolis, quand nous écrivons. L’un pince la bouche, l’autre se tâte la
langue, hausse une épaule ; combien se mordent l’intérieur de la joue,
bourdonnent comme une messe, frottent du talon l’os de leur tibia ? »
Affichant un mépris souverain pour le « processus créateur », Colette
préfère garder secret le plaisir fiévreux qui accompagne la trouvaille du mot
juste, et se plaint de peiner quand cette grâce tarde. Aucun besoin de
« notes », « grimoires » ou autres
« repères » pour écrire. En revanche, Colette insistera sur le
parallèle entre la sexualité et l’écriture, la violence et le portrait, en
suggérant que tel personnage a favorisé la « puberté littéraire » de
la narratrice qui se pose, par l’acte de l’écriture lui-même, désormais en
« mante religieuse » de ses héros et objets : « Parmi mes
notes... Quelles notes ? Derrière moi on n’en trouvera pas une. Oh !
j’ai essayé. Tout ce que je notai devint triste comme une peau de grenouille
morte, triste comme un plan de roman. Sur la foi des écrivains qui prennent des
notes, j’avais pris des notes sur un papier, et je perdis le papier. J’achetai
donc un carnet, déjà américain, et je perdis le carnet, après quoi je me sentis
libre, oublieuse et responsable de mes oublis.
« Pas une note, pas un carnet, pas le moindre petit grimoire
de repères. Par où sont donc venus mes héros sans empreintes ? Le premier
de tous, ce Renaud qu’épousa Claudine, il est l’inconsistance même, je ne l’eus
plus tôt créé que je le pris en grippe, et dès qu’il me prêta le flanc je le
tuai. Sa mort me donna l’impression d’accomplir une sorte de puberté littéraire
et l’avant-goût de plaisir que s’autorise la mante religieuse. »
L’écriture serait-elle en fin de compte une broderie ? Par ce
clin d’œil amusé à l’artisanat populaire, voire à la masturbation féminine,
plus ou moins heureuse ou revancharde — on se souvient de la perverse Philomène
de Watteville —, Colette persiste à
désacraliser la religion si française des belles lettres. Néanmoins, dans son
attachement à la broderie, c’est encore l’immersion de l’acte mental dans le
geste du corps vivant et dans la chair du monde qu’elle célèbre. Tout d’abord,
en brodant on peut chanter, ce que l’« écrivassier »
ne s’autorise pas d’habitude : façon de dire qu’elle, Colette,
contrairement à tant d’autres, chante en écrivant, et que cela s’entend dans
ses phrases ? « Nous autres écrivassiers, disait Carco, nous sommes
les seuls à ne pas pouvoir chanter en travaillant. » «
Mon nouveau travail chante. Il chante Boléro comme tout le monde. Il chante : “Croyant trouver de la bécasse au bas des prés...” Il chante : “Quand j’étais chez mon père — Petit Camuson...”
Désapprendre d’écrire, cela ne doit pas demander beaucoup de temps. »
En réalité, la broderie est loin de lui faire « désapprendre
à écrire », car elle rejoint le « travail cérébral »,
« s’accorde » et se « désaccorde » avec lui :
« Je perce et je reperce. L’équille — l’aiguille — brille entre deux fils,
remorque sa queue de laine. Mes Mémoires s’écrivent en verdure bleue, en lilas
rose, en anthémis multicolores. » Plume et
aiguille, esprit et main, langue et corps vont ensemble : « Que de
temps perdu avant d’inscrire, au nombre des vertus qu’engendre la tapisserie,
celle de régler les allures du travail cérébral. Comme s’accorde sur une route
sonore, puis se désaccorde pour s’accorder encore le trot de deux chevaux
attelés en paire, le besoin de faire de la tapisserie et l’invention littéraire
lient amitié, puis se séparent, puis se réconcilient. » Et voici une
dernière version de l’alphabet, selon Colette : c’est la tapisserie qui,
avec la laine et ses fils de toutes les couleurs, rejoint la peau vernissée des
cassis et des cerises : « Après une cinquantaine d’années occupées
par le devoir d’écrire noir sur blanc, je trouve doux de faire de la
tapisserie. L’aiguille mousse aux doigts, je perce et reperce un canevas de
gros fils, je conduis les laines captives du chas oblong, je décide que la
verdure est bleue, le lilas rose, la marguerite multicolore ; je tiens
pour naturel qu’un branchage convenant au cassis fructifie en cerises
démesurées, marquées, chacune, sur leur équateur écarlate, de quatre points
blancs, figurant le miroitement d’un épiderme vernissé...
Le point croisé, dit de tapisserie, me tient parmi ses
pratiquantes depuis peu d’années, mais le mal — ou le bien — vient de beaucoup
plus loin. »
« Furtivement les amants, dont je suis, du point croisé s’accorderont de
tressaillir à la vue d’un M extraordinairement majuscule et ceint de roses,
d’un chiffre 2 qui fait le beau, d’un Q sur sa queue, d’un petit compotier
portant six pommes en pyramide, d’une cigogne cagneuse... »
En somme, broderie, tapisserie ou non, écrire pour Colette est un
acte physique, un geste des mains et du corps tout entier. Elle la conduit
jusqu’à « entendre » les abeilles, les pintades et les truies, quand
elle ne la fait pas transiter par un « trou mental », « en
ressemblance parfaite » avec la mort, avant de redevenir tout simplement
un chemin, un amusant passage, sans fin : « Je pars, je m’élance sur
un chemin autrefois familier, à la vitesse de mon ancien pas ; je vise le
gros chêne difforme, la ferme pauvre où le cidre et le beurre en tartines
m’étaient généreusement mesurés. Voici la bifurcation du chemin jaune, les
sureaux d’un blanc crémeux, environnés d’abeilles en nombre tel qu’on entend, à
vingt pas, leur son de batteuse à blé... J’entends sangloter les pintades,
grommeler la truie... C’est cela, ma méthode de travail... Puis soudain, un trou mental, le vide, l’abolition, une ressemblance parfaite, je pense, avec ce
que doit être le début d’une mort, la route perdue, barrée, effacée...
N’importe, je me serai bien amusée en chemin. »
Les boules de verre, ou comme elle préfère les appeler les
« sulfures », sont l’autre artisanat qui semble offrir à Colette une
analogie avec l’acte d’écriture. En soufflant dans le verre un dahlia, une
pensée, la couronne bicolore de Saint Louis ou le profil de la reine Elizabeth,
l’artiste verrier immortalise une présence vivante (généralement florale), pour
la confier à la transparence du cristal. Sans être affectée de la manie des
collectionneurs, Colette aime cependant courir les boutiques et recevoir les
spécialistes en la matière, pour s’entourer des plus beaux objets. J’imagine
son antre de pythonisse du Palais-Royal, parfumé de jasmin et d’odeurs de chat,
décoré de presse-papiers en sulfures, de papillons du Brésil, de colliers
multicolores, son écritoire jonché de feuillets de son célèbre papier bleu, de
ses stylos et sa loupe rectangulaire, éclairé par son « fanal bleu »
— tout ici est artifice et écriture, les presse-papiers comme le masque de
l’officiante, visage au sourire malicieux, poudré de blanc, bouche mince peinte
de rouge et yeux soulignés d’un trait de khôl. Objets et auteur obéissent à la
même emprise sur l’éclosion : il s’agit de capter la plus fraîche des
présences, et de faire durer le charme gracile d’une « sphère d’eau
apprivoisée ». Comme Bel-Gazou, j’aime imaginer que ces
« boules » cristallisent autant l’imagination de Colette que
« les étangs et les sources de sa province natale ».
Ainsi vécue et pensée, l’écriture n’ignore pas la mort — comment
le pourrait-elle ? — mais la vide de son poids de souci (« La tombe, ce
n’est rien qu’un coffre vide »), et transforme la ligne du temps
(nécessairement perdu) vers une durée d’intermittences, d’éclosions. Le passé se déploie d’abord en
souvenirs d’instants sensibles (un mouchoir parfumé, une intonation), tandis
que le futur se mesure à la pérennité d’une « poignante
écriture » : « C’est d’un cœur contraint et froid que je la [la
tombe de Renaud] soigne. Rien ne m’y attriste, rien ne m’y retient. Rien ne
reste, là-dessous, de celui que j’aime, de celui de qui je parle encore, en mon
cœur, en disant : “Il dit ceci…
Il préfère cela…” » « Une tombe, ce n’est rien qu’un coffre vide.
Celui que j’aime tient tout entier dans mon souvenir, dans un mouchoir encore
parfumé que je déplie, dans une intonation que je me rappelle soudain et que
j’écoute un long instant la tête penchée… » Et
encore : « Un souvenir, une image, le son inoubliable d’une voix, une
poignante écriture : là seulement, là et point ailleurs, celui qui n’est
plus garde une chaleur secrète, là seulement il ressuscite, aux heures de culte
tendre et de désespoir. Mais la tombe ? Mais son vantail de pierre écrasant, et sa grossière parure de verroterie, de
porcelaine et de stuc, est-ce la résidence d’une âme ? Rien ne m’appelle
ni ne me retient sur le tertre, sur la dalle qui pourtant porte deux noms
bien-aimés. »
Pour cette païenne qui renaît dans le sacre de l’écrit, la mort
n’est qu’une illusion aussitôt évanouie, crapaud calciné ou ossuaire sec, elle
« ne [l]’intéresse pas » : « On en a trouvé un mort,
l’autre jour — un vieillard. Tout sec comme le crapaud défunt, que midi calcine
avant qu’un rapace ait le temps de le vider. La mort, ainsi frustrée d’une
grande part de corruption, est plus décente à nos yeux de vivants. Corps
friable et léger, ossements creux, un grand soleil dévorateur sur le tout,
sera-ce mon lot final ? Je m’applique parfois à y songer, pour me faire
croire que la seconde moitié de ma vie m’apporte un peu de gravité, un peu de
souci de ce qui vient après... C’est
une illusion brève. La mort ne m’intéresse pas, — la mienne non plus. »
En effet, lorsque le « soi-même » est aussi
indissolublement lové à l’écriture, qui elle-même est un « alphabet »
de la chair du monde, « monogramme de l’Inexorable », peut-on
vraiment envisager une fin de « soi-même », mettre fin à
soi-même ? « Comme il est difficile de mettre un terme à soi-même...
S’il ne faut qu’essayer, c’est dit, j’essaie. » Cette question
de Colette n’est pas seulement l’expression d’une angoisse de vieille dame, ni
seulement un reliquat de sa mélancolie vaincue, qui pointe par moments, jumelle
noire, quoique terrassée de son écriture : « Il y a toujours un
moment, dans la vie des êtres jeunes, où mourir leur est tout juste aussi
normal et aussi séduisant que vivre, et j’hésitais. ». Et plus tard :
« Mais j’abdique devant l’ennui, qui fait de moi un être misérable, au
besoin féroce. Son approche, sa présence capricieuse qui affecte les muscles
des mâchoires, danse au creux de l’estomac, chante un refrain que rythment les
orteils, je fais plus que les redouter, je les fuis. » C’est d’une
interrogation sur le renoncement à l’écriture qu’il s’agit, renoncement
auquel Colette, l’être le moins religieux qui soit, a pu songer, afin de
préserver sa liberté vagabonde détachée de toute entrave, y compris de la
contrainte d’écrire. Cependant, elle conclut « avec humilité » — mais
quel orgueil dans cette soumission ! — qu’elle va « écrire
encore » : « Il n’y a pas d’autre sort pour moi. »
Douleur, sévices ou insurrection, l’écriture ne cessera d’éclore
en elle tant que sa main pourra guider la plume sur le papier bleu :
« Or, si je suis immobile ce soir, je ne suis pas sans dessein, puisqu’en
moi bouge — outre cette douleur torse, en grosse vis de pressoir — un sévice bien moins
familier que la douleur, une insurrection qu’au cours de ma longue vie
j’ai plusieurs fois niée, puis déjouée, finalement acceptée, car écrire ne
conduit qu’à écrire. »
Au-delà de ce constat d’acharnement vital, c’est la spiritualité
spécifique de Colette qui pointe, soudaine et pudique, dans un requiem :
contrairement à d’autres travaux qui s’achèvent une fois déposé l’outil, une joie de l’écriture existe, qui tient à la durée propre de cette
pratique sublimatoire, et la voue à l’infini. Terminé, un écrit ? Plutôt
« à suivre », s’il s’inscrit dans l’ « Inexorable ».
Et si, dans l’« alphabet » de
« sable » mort que laisse derrière elle l’écrivain, une relecture
pouvait s’amorcer qui ranimerait, à travers le lecteur ou l’interprète, de
nouveau et sans fin, le « monogramme » lui seul « précieux »
de la chair du monde : « J’ai cru autrefois qu’il en était de la
tâche d’écrire comme des autres besognes : déposé l’outil, on s’écrie avec
joie : “Fini !” et on tape dans ses mains, d’où pleuvent des grains
de sable qu’on a cru précieux... C’est alors que dans les figures qu’écrivent
les grains de sable on lit les mots : “A suivre”... »
J’ai essayé, quant à moi, de faire vivre les grains de sable de
l’écriture de Colette, tout entière ciselée par la temporalité du commencement,
de la renaissance, de l’étonnement. Ainsi approchée, il est sûr qu’elle ne se
laisse pas « finir ». Car c’est le rythme même de l’éclosion qu’elle
nous transmet.
JULIA KRISTEVA
Le génie féminin, tome 3 Colette, Fayard, 2002