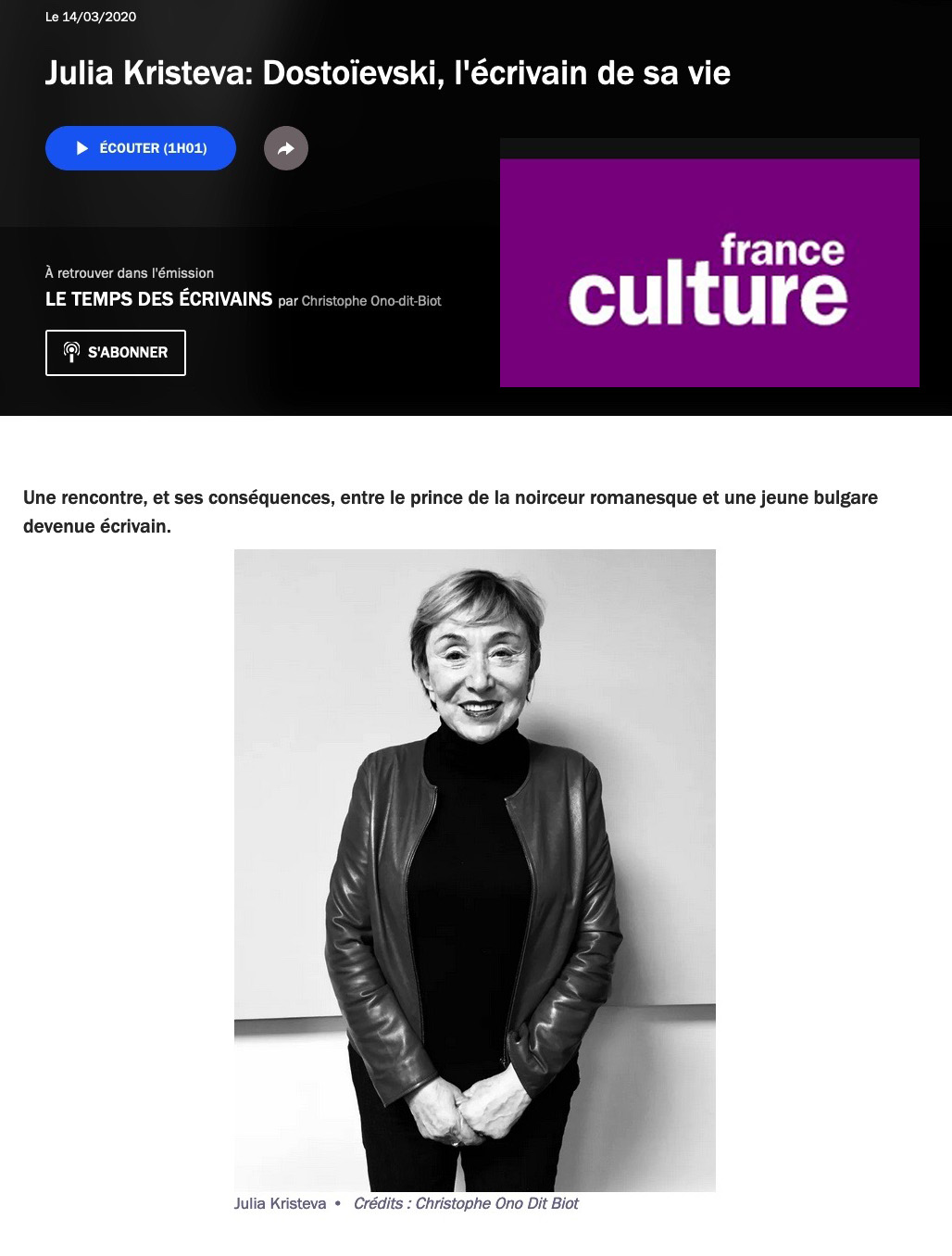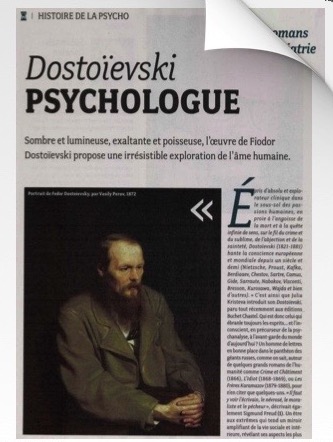|
||
|
|
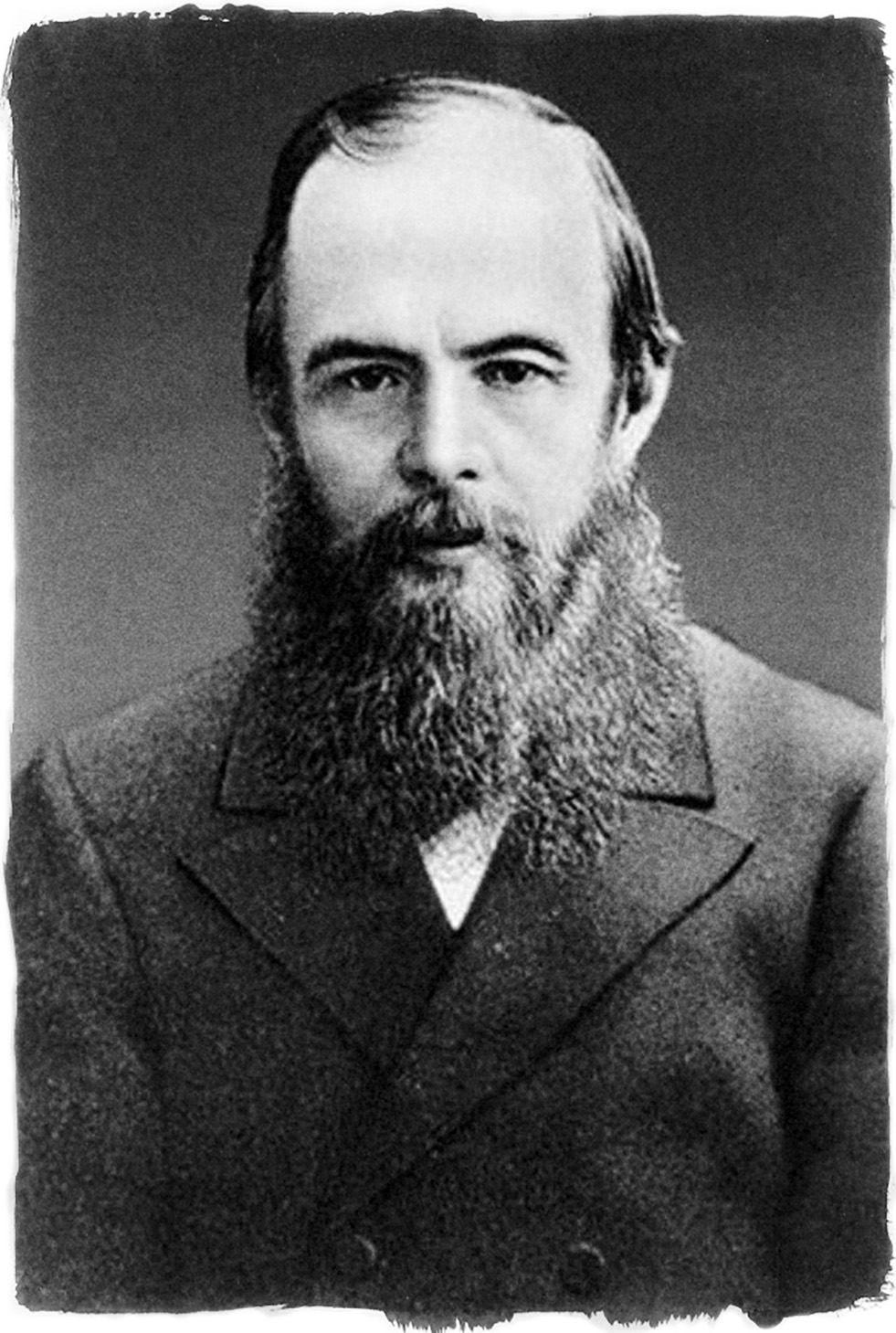 |
 |
Portes dans le multivers de Julia Kristeva Le Monde du 6 mars 2020
|
|
Dostoïesvski :
Portes dans le multivers de Julia Kristeva
Par Zoé Courtois
Le Monde, 07 mars 2020
Lorsque
les éditions Buchet-Chastel lui ont proposé d’écrire un Dostoïevski, Julia Kristeva en a eu le tournis. Car
la collection « Les auteurs de ma vie » (ex- « Les pages
immortelles »), qui accueille des textes où de grands écrivains
contemporains saluent d’illustres aînés, compte notamment un Virgile par Giono (1947), un Marx par Trotsky, et un Montaigne par
Gide (tous deux publiés en1939) – les deux premiers ont été réédités
respectivement en2016 et 2019. Impressionnée par ces prestigieux prédécesseurs,
la philologue, psychanalyste et romancière semblait
pourtant destinée à se livrer à l’exercice, tant elle a profondément fouillé la
manière dont les affects de lecteur travaillent l’écriture et la pensée d’un
auteur. Ainsi, c’est elle qui, dans les années 1960, a proposé la première
définition théorique de l’« intertextualité » – ce rapport d’innutrition entre les textes qui se trouve au
cœur même de la collection où elle publie aujourd’hui.
Intellectuelle française mondialement reconnue, Julia Kristeva est née en1941 en Bulgarie, pays qu’elle a quitté en1966 pour la France. En2018, la publication de documents bulgares lui a valu l’accusation d’avoir été recrutée au début des années 1970 pour renseigner les services d’espionnage de son pays de naissance sur les milieux culturels et la gauche française.Voilà deux ans qu’elle dément fermement ces informations.« Agent » n’est donc pas l’un des quatre termes autour desquels tenter de synthétiser avec elle le « multivers », comme elle le dit, de Julia Kristeva, fait de littérature, de linguistique, de philosophie et de psychanalyse.
Sous-sol
Entrons dans ce « multivers » par le bas. Comme dans ce Dostoïevski, au fil duquel elle creuse
six décennies de souvenirs de lectures sédimentés. Un travail minutieux de
fouille pour trouver ce qui l’émeut tant chez « saint Dosto », en commençant par les
fondations, ou plutôt le « sous-sol ».
« Le sous-sol, précise
Julia Kristeva au « Monde des livres », c’est un mot que j’utilise beaucoup parce
qu’il vient du texte de Dostoïevski Les Carnets du sous-sol. En russe, on dit “podpol’e”, et cela renvoie, dans certaines
constructions modernes, à tout ce qui est clandestin et hors la loi. » Mais chez cet écrivain, explique-t-elle, cela se réfère surtout au
bagne dans lequel il fut emprisonné entre 1848 et 1853. Ce n’est qu’une fois
revenu et au prix d’une longue « évolution », précise la psychanalyste, que
Dostoïevski comprit : la noirceur infernale des
criminels qui l’avait tant horrifié était inhérente à la condition humaine et
non le fait de marginaux. Ainsi naquirent les « démons » et les « possédés » de son œuvre.
Plus tard, quand elle en vint à commencer sa psychanalyse, il apparut à Julia Kristeva que le
« sous-sol » dostoïevskien était un autre nom pour le
« ça » de Freud. Reste, pour la théoricienne de la littérature
qu’elle est également, une question qui ne trouve toujours pas de réponse : « Pourquoi, mais pourquoi
la critique psychanalytique des œuvres littéraires est-elle si décriée en
France ? L’œuvre d’un géant comme Dostoïevski y appelle avec tant de force ! »
Dialogue
Parmi les lectures sédimentées que traverse le
livre, il y en eut une plus féconde que les autres, qui
suivit la découverte de l’ouvrage de Mikhaïl Bakhtine, La Poétique de Dostoïevski (Seuil, 1970). L’écrivain et critique
russe repérait chez l’auteur des Frères Karamazov une logique profonde : celle du « dialogue ». Le mot fait événement pour Julia Kristeva,
alors étudiante en philologie et littérature comparée.
Elle quitte la Bulgarie pour la France, emportant pour tout bagage son
exemplaire du Bakhtine « et 5 dollars ». Dans un coin de sa tête,
il y a l’idée qui donnera naissance à la notion d’intertextualité dans son
premier livre, Sémeiotiké. Recherche sur une
sémanalyse (Seuil,
1969) : appliquer l’analyse du dialogisme
bakhtinien à l’échelle du texte lui-même. Autrement dit : considérer que l’on ne peut écrire ou lire un texte sans les textes avec lesquels
il dialogue, même très indirectement.
Elle prend encore
l’exemple de Dostoïevski. « Ses romans répondent au roman européen,
qui lui-même répond à la satire ménippéenne, qu’on peut définir comme la forme
littéraire de l’incertitude, parce qu’on y entend en même temps l’énoncé et son autre. » Dans cette forme utilisée dans l’Antiquité par Lucien de
Samosate et dont on trouve des résurgences dans toute la littérature moderne,
on n’affirme une chose que pour immédiatement engager le lecteur à examiner son
contraire. Se trouve alors mis en abyme, « dans les textes », le dialogue qui a lieu « entre les textes ». Et ce dialogue omniprésent et perpétuel (« qui n’est pas un moyen,
mais “le” but », écrit
Kristeva en conclusion de sa préface) est le lieu où réside la beauté de
l’œuvre littéraire.
Trace
Lui revient souvent ce rêve où elle est « une lettre, c’est-à-dire une trace dans un ordre de
l’écriture ». Une image qui prend source dans ses souvenirs de l’ancienne fête nationale bulgare de
l’alphabet, célébrée le 24mai. « Il y avait dans le
communisme un certain enthousiasme pour les saints
Cyril et Méthode, inventeurs du cyrillique. L’on disait que la Bulgarie n’avait
survécu à l’occupation ottomane que grâce à sa langue et à sa littérature : à son alphabet, donc. » Lors des parades de ces carnavals,
outre « des couronnes de pivoines qui
ceignaient leurs fronts et de légères chemises
blanches sur leurs corps jeunes », les enfants portaient des costumes de
lettres d’alphabet. « Nous composions et recomposions
ainsi des mots et des phrases. Rien n’était écrit définitivement, et c’était – presque – une invitation à penser
autrement. »
Cette conception-là du
langage (vif, mutant dans l’espace même de la phrase et en enregistrant tous
les états), la linguiste l’avait retrouvée chez Dostoïevski. Et elle l’a faite
sienne dans ses travaux. Dans ce livre – c’est
étonnant de la part d’une universitaire si célébrée –, la professeure
émérite à Paris-VII-Diderot ne se montre pas en érudite formée, mais en
lectrice toujours occupée à se former. Parmi les certitudes d’autrefois
aujourd’hui rectifiées sans qu’en soit effacée, précisément, la « trace », il y a celle-ci : « J’ai naguère pensé que Dostoïevski
était un mélancolique qui cultivait la douleur. » Contresens, dit-elle aujourd’hui : « Quand on le lit dans la traduction d’André Marcowicz (ce
qu’il faut recommander aux francophones), on entend combien il n’a vaincu le
bagne et l’épilepsie que par la jouissance et l’ivresse heureuse du
verbe. »
Incarnation
Théoricienne, Julia Kristeva, évidemment. Mais
pas trop. Prenez à nouveau l’auteur de L’Idiot,qu’elle fréquente depuis ses 15ans – lorsque son père lui en a interdit la
lecture, forme d’incitation très sûre. « Il m’a fallu ces quatre
dernières années de lecture et d’écriture pour déceler
enfin chez lui le corps épileptique et souffrant de sa langue, qui traduit
magnifiquement la bataille pour la vie. » Le style du romancier traduirait donc
son corps, analyse qui permet d’appréhender différemment le rapport d’influence
entre Dostoïevski et Freud. « C’est, disons, Dostoïevski précurseur
de Freud, ce qui va à l’encontre de ce que l’on a toujours
pensé de leur relation », note-t-elle
sans fausse modestie, Mais cette lecture offre surtout un exemple de ce qu’elle
nomme la « chair des mots ».
Au sujet de son propre rapport à la langue,
Julia Kristeva assure curieusement qu’elle n’a appris le français que « très tard ». Oh, bien
sûr, elle a su tôt le français lisse des dissertations, puisqu’elle
fréquentait, en Bulgarie, l’Alliance française et que,
avant de s’exiler, elle était déjà une spécialiste du Nouveau Roman. Néanmoins,
le français de la « chair des mots », elle l’a d’abord appris en disant le
quotidien quand elle commença sa psychanalyse, puis en
devenant mère, par le « baby talk ». « Et cela a tout changé
dans mon écriture. J’ai pu écrire des fictions, et
dire la vie psychique, les sensations, les fantasmes, les rêves – sans
pour autant abandonner des pages méditatives ou relevant de la culture
savante. » Le
corps, souffrant ou jouissant, estropié ou plein : c’est ce que cherche Julia Kristeva, inlassablement, dans la langue littéraire
et la langue intime.
Arrêt
sur Dostoïevski
L’art de bâtir une anthologie suppose d’en
accepter le caractère forcément incomplet et essentiellement inabouti. Certes, Julia Kristeva semble, dans ce Dostoïevski, s’en être fait une raison.
La philosophe et linguiste sélectionne fort docilement dans sa préface
quelques-uns des thèmes de l’écrivain russe qui sont aussi les siens ; cela étant fait, elle classe les extraits
retenus selon le même modèle (par exemple « Le jeu », « Le
double », « Enfants » et, pour finir, « Jouissance »).
Et pourtant.
Tout
au long du récit de son compagnonnage de soixante années avec Dostoïevski,
Julia Kristeva magnifie les mécanismes d’écriture qu’elle a théorisés sa vie durant, c’est-à-dire la polyphonie et la référence
intertextuelle. Soit l’insatiable réflexion sur ce qui
se tapit sous les mots. Ainsi, le règne impérial des
italiques astreint le lecteur à une gymnastique intellectuelle complexe. Il lui faut lire les mots dans la phrase et puis les
relire encore seuls, pour, enivré, en saisir entièrement le sens.
Se compose ainsi un ouvrage foisonnant, érudit et sensible, qui brosse avec efficacité la mutation et la migration des idées dans l’Europe dostoïevskienne de la fin du XIXesiècle, comme dans l’Europe pré et post- « rideau de fer » de Kristeva. Un récit pour partie autobiographique, pour partie théorique et pour partie poétique, qui endosse au fil des pages des airs de bilan, sans toutefois esquisser, à la réflexion, un point final.
Zoé Courtois
Le Monde, 07 mars 2020
London Review of Books No. 23 · 3 December 2020
Just a Devil, by Michael Wood
Dostoïevski, by Julia Kristeva.
At the Risk of Thinking: An Intellectual Biography of Julia Kristeva, by Alice Jardine.
La Revue Française de Psychanalyse, Déc, 2020
Parution en italien, Donzelli Editore Roma
 |
 |
| Avvenire, 9/12/2020 | Alias, 20/12/2020 |
 |
 |
| Tutto libri 09/01/2021 | La Lettura 28/12/2020 |
Dostoïevski, l'écrivain de sa vie
Le temps des écrivains
par Christophe Ono-dit-Biot
France culture 14/03/2020
"Grandir c'est croire" et "Dostoïevski"
Dostoïevski de Julia Kristeva,
"VIVE LES LIVRES" Patrick Poivre d'Arvor
Entre crime et sainteté, Dostoïevski, Julia Kristeva
par Fabien Ribery
Julia Kristeva et le cas Dostoïevski, RFI 19 juin 2020
Dostoïevski de Julia Kristeva
par Nicolas Krastev-McKinnon, Esprit, 10/2020
 |
photo © Sophie Zhang, 2020