|
« La Révolution est d'abord intérieure »
On réédite
« L’Avenir d’une révolte »,
écrit en 1998. En quoi ce livre est-il toujours d’actualité ?
Dans cet ouvrage, je m’interrogeais sur le sens de la révolte à notre
époque. J’indiquais que les crises financières, économiques et
politiques sont insolubles non seulement parce qu’elles sont
nouvelles (globalisation, finances virtuelles, impuissance du modèle politique
fondé sur le bipartisme et les conflits sociaux). Mais parce qu’elles recouvrent
une profonde crise de civilisation. Que deviennent l’indépendance et la
créativité, la liberté de pensée des hommes et des femmes dans une culture de
« show » et d’ « entertainment » ? J’en
appelais à la révolte, non pas comme une nouvelle forme
d’engagement ou une promesse paradisiaque, mais au sens étymologique et
proustien du mot, comme une reconstruction du passé et de soi, de la mémoire et
du sens. Je crois que ce constat est toujours vrai. Aujourd’hui nous assistons
à un certain nombre de révoltes à travers le monde : le mouvement des
« Indignés » en Europe et aux Etats-Unis, ces jeunes qui se soulèvent
contre les marchés financiers ; le Printemps arabe, avec sa rébellion
contre des dictateurs sanglants ; ou, encore les mouvements de
protestations contre Poutine en Russie. Toutes éminemment sympathiques, voire
admirables de courage, mais, à l’heure actuelle, digérées par le spectacle
ou marginalisées, quand elles ne sont pas récupérées par des forces conservatrices,
voire intégristes.
Que voulez-vous
dire par là ?
La terreur révolutionnaire et les totalitarismes nous ont appris que
la liberté se conjugue au singulier. Or, ces révoltes se font sur le modèle
hérité des révolutions bourgeoises et prolétaires : un face- à - face qui
oppose deux blocs socio- politiques. Mais contre qui se révolter, quel
« face-à-face » si l’adversaire est la vacance du pouvoir, l’absence
de projet, les zones de non-droit, ou, au contraire, un ordre tyrannique,
mais virtuel et anonyme (la finance moderne, banques et
« traders ») et cumulant tous les pouvoirs (les oligarchies et
les mafias) ? Et qui peut encore se révolter, si la singularité
humaine disparaît sous la « personne patrimoniale » (qui n’est qu’un
propriétaire de son patrimoine génétique et de ses organes, dans le meilleur
des cas, car il est des pays où ils sont volés ou revendus) ? Il nous faut
revenir à des formes radicales parce qu’intimes de la révolte, qui garantissent
l’indépendance des esprits et la capacité créative : le questionnement
des valeurs et des identités, l’expérience intérieure, la remise en cause de
l’acquis, des clichés, des « éléments de langage ». Pour toucher,
sous les stéréotypes et les conventions, jusqu’aux traumas indicibles.
Pas pour les perpétuer, pas pour embaumer « ma dépression » ou « mon
inceste » en les inoculant à mes lecteurs ; mais pour les
décomposer, analyser, réévaluer. Et renaître dans de nouveaux liens, dans
la pluralité des liens à venir. Ceci est vrai pour l’Occident et, d’une autre
façon, pour les pays émergents où des sursauts libertaires tentent de se
ressourcer dans le retour aux traditions spirituelles, mais se retrouvent
piégés par l’obscurantisme. Que ce soit l’emprise de la technologie ou
celles des dogmes religieux qui banalisent les consciences, seule
l’expérience intérieure révoltée, intransigeante, peut encore nous sauver
.
Vous dites que la
révolte politique n’est plus efficace. Pourquoi ?
Pour la première fois dans l’histoire, nous nous apercevons
qu’il ne suffit pas de remplacer les anciennes valeurs par des nouvelles.
Il n’y a pas de « solution » parce que toute solution (le
« free-market », la consommation, la sécurité, l’hyper-connexion),
qui devient une « valeur » et prétend remplacer les anciens remèdes
(la charité, la lutte des classes), se fige à son tour en dogmes et
impasses, potentiellement totalitaires. Sous la pression de la technique,
de l’image et de l’accélération de l’information, nous oublions que
l’être parlant est véritablement vivant à condition d’avoir une vie
psychique. Or celle-ci n’existe que si elle est une perpétuelle remise en
question de ses normes et pouvoirs, de sa propre identité sexuelle,
nationale, linguistique ; de ses désirs, de ses souffrances, de ses amours
et de ses haines. C’est l’homme et la femme révoltée, dans leur inquiétude de
chercheurs, qui sont en prise sur le malaise dans la civilisation, pas les
appareils politiques. Je pense à ce président d’université en Argentine qui m’a
dit vouloir transformer des jeunes des quartiers sinistrés... en chercheurs.
Qu’ils fassent des recherches sur le pourquoi et le comment de la drogue, du
trafic d’armes, de la prostitution dans leur zone. Cet homme avait fait sa
thèse sur Maître Eckhart, un mystique du XIII-XIVe siècle qui demandait à Dieu
de le laisser libre de Dieu…
En somme, avant
de faire la révolution dans la cité, il faut faire la révolution en soi-même.
Par quels moyens doit-on opérer ce changement ?
Ils sont multiples. En tant qu’analyste, je considère que la
psychanalyse est évidemment l’un d’entre eux. Mais l’expérience artistique, la
redécouverte des expériences religieuses du passé, même quand on est athée, en
sont d’autres. Pour la psychanalyse, cela me semble particulièrement
vrai : sur le divan, il s’agit, pour une personne en souffrance
psychique, de se remémorer le passé, de l’interroger, pour s’en détacher, le
dépasser. La psychanalyse n’est pas, comme on le croit, une méthode qui permet
de mieux « s’adapter » à la société. Au contraire. Elle est un moyen
de réévaluer son passé pour affirmer sa singularité dans ce qu’elle a de
plus original, révélateur et en ce sens révolutionnaire. Freud est un des
esprits les plus incisifs, les plus révoltés de son temps, rien à voir avec le
fondateur d’une nouvelle religion qu’on l’accuse d’être. Cela ne se fait
pas dans son coin. Au fil de l’analyse, la renaissance du patient se traduit
toujours par les nouveaux liens qu’il arrive à créer avec autrui. Là est la
révolte possible. Elle n’est pas immédiatement politique, mais contribue à une
mutation éthique de longue et profonde haleine. Ainsi, l’œuvre
encore invisible de cette psychanalyse syrienne, Rafah Nached que j’ai défendue
avec d’autres psychanalystes français, car elle fut emprisonnée pour avoir mené
des psychothérapies contre la peur. Essayant de pratiquer la psychanalyse dans
un pays où l’on ne peut dire ni « non » ni « je »,
écrit-elle, cette femme a entrepris de traduire Freud en arabe en
changeant la rhétorique habituelle qui, dans cette langue, exprime la sexualité
en termes sacrificiels, par une rhétorique amoureuse empruntée au
grand poète musulman Mansour al-Hallaj (IXe siècle) ! Une vraie révolte,
telle que je l’entends, qui remonte aux sources traditionnelles et réconcilie
la modernité la plus exigeante avec la diversité culturelle.
Vous vous êtes
beaucoup intéressée aux religions ces dernières années. Vous avez même été
reçue par le Pape l’an passé ! Comment expliquer cela chez une
intellectuelle athée ?
Je suis une des rares athées qui restent paraît-il aujourd’hui, mais
j’estime qu’il est urgent d’établir des passerelles entre l’humanisme laïc et
l’humanisme chrétien, ainsi qu’avec les autres religions. Dans cet esprit, j’ai
créé avec des psychanalystes israéliens, un Forum interdisciplinaire sur les
religions à Jérusalem. La culture-révolte ne nous vient-elle pas du dialogue
philosophique grec, de l’interprétation rabbinique, du questionnement
rétrospectif chrétien ? Ne laissons pas la religion aux religieux !
Certains des enseignements des anciens mythes peuvent nous être d’un grand
apport, si nous savons les revisiter, les interpréter. En effet, notre société
laïque est tombée dans le piège d’une gestion uniquement comptable de la vie.
Elle réfléchit de plus en plus en terme de « données », de
« chiffres », de « valeurs » et de moins en moins en termes
de «questions ». Je vais vous donner un exemple. J’ai cherché pendant des
années un lieu pour accueillir mon fils David, avec ses difficultés neurologiques,
en respectant son autonomie tout en le protégeant. Les lois républicaines, avec
et malgré les efforts récents, n’assurent pas encore un véritable
accompagnement personnalisé des hommes et des femmes en situation de
handicap. Je ne l’ai découvert que dans une association catholique,
nouvellement créée dans l’esprit de l’Arche de Jean Vanier : il régnait-là un
engagement total, une ouverture à l’autre, dans toute sa différence, tout à
fait extraordinaire. Une preuve de plus qu’il est urgent de refonder
l’humanisme, en croisant les expériences de tous.
Vous avez
beaucoup lutté pour la reconnaissance des handicapés. La naissance de votre
fils est-il la raison principale ?
Bien sûr, la vulnérabilité de David nous a amenés à fréquenter des
écoles et des institutions dans lesquelles j’ai pris conscience de la
singularité de chaque personne handicapée. Mais j’étais, de par mon parcours,
sensible depuis toujours à la détresse des diverses exclusions. Ma jeunesse en
Bulgarie m’a rendue à l’écoute de tout ce qui ne rentrait pas dans la norme. En
effet, mes parents avaient refusé d’être des apparatchiks, de se couler dans le
moule. Mon père qui avait fait des études de théologie et de médecine avait
renoncé à exercer son métier de médecin à la campagne, et a occupé un poste
administratif à la capitale, pour pouvoir conserver une certaine indépendance
d’esprit et donner à ses filles une éducation convenable. Il n’a cessé de nous
encourager à étudier la littérature et les langues étrangères pour
« quitter cet enfer » !
Et vous avez
réussi à quitter l’enfer…
Oui, je suis venue en France à Noël 1965, avec une bourse de neuf
mois, pour faire une thèse sur le « nouveau roman ». J’y suis restée
car j’ai rencontré Philippe Sollers, avec qui je me suis mariée en 1967. J’ai
étudié avec Lucien Goldman et Roland Barthes, puis au Laboratoire de
Lévi-Strauss, sur des auteurs dits d’ « avant-garde », comme
Lautréamont, Mallarmé, Artaud, Joyce, Proust, Céline, dont l’art est en contact
direct avec des états psychiques limites, une souffrance sublimée. Plus
tard, en 1974, après notre voyage en Chine avec Philippe Sollers, je me suis
détachée de la politique, comme en témoigne mon livre Des Chinoises. Je suis devenue
psychanalyste avec cette même idée : rester à l’écoute de la révolte
intime qui transforme la vulnérabilité des êtres en art de vivre. Encore
aujourd’hui, je suis très sensible à la philosophie du « care », qui
est d’ailleurs une idée qui vient de la grande psychanalyste Mélanie Kein, à
laquelle j’ai consacré un livre.
Vous avez
beaucoup milité pour la cause des handicapés, mais vous avez toujours refusé de
parler en détail de votre fils. Pourquoi ?
Mais j’en ai parlé tout au long d’un livre de 234 pages, échange
de lettres avec Jean Vanier, Leur regard
perce nos ombres ( Fayard, 2011) ! Le
handicap est une exclusion pas comme les autres (celles qui vous excluent
pour des raisons de classe, de race, de religion ou de sexe), car elle nous
confronte aux limites de la vie, à la finitude des vivants, à la mortalité. La
sécularisation est la seule civilisation qui ne sait pas penser la mortalité à
l’œuvre en nous tout au long de nos vies. Comme nous manquons d’ailleurs
de discours sur la passion maternelle… La personne en situation de
handicap nous fait peur, « c’est pour les autres », ou bien on
l’infantilise par la compassion ; ou, au contraire, on l’héroïse dans les
jeux olympiques… Accompagner une personne handicapée demande beaucoup de
tendresse. David s’exprime en propos condensés, une sorte de haïkus
japonais. « Tu rêves », je le critique parfois,
imprudemment. « Je rêve, donc je suis », répond-il. Ou, à propos de
son père : « Papa est comme Dieu, il existe, mais on ne le voit pas beaucoup. »
Qui peut s’intéresser à cela ? Avec le Mouvement Handicap nous avons
échoué à organiser un Train du Handicap, qui devait passe dans toute la
France, comme il y en a eu pour le cœur par exemple, etc. : il paraît que c’est
trop cher. Je ne suis pas sûre que le changement de gouvernement puisse changer
cette mentalité rigide, défensive…
Je ne vois pas la contradiction (rires) ! Et je ne crois pas que
Sollers se reconnaisse dans le terme de « libertin » qu’on lui
attribue. Quant au « couple », vous savez… Thérèse d'Avila dit "Tout est Rien", qui peut s'entendre aussi comme "Rien n'est Tout": rien ni personne ne peut satisfaire
totalement l’infini du désir. Et « renaître n’a jamais été au-dessus de
mes forces », écrit Colette… Je dois beaucoup à la fragilité, à la
vitalité, à l’humour, aux écrits de Philippe Sollers. Nous sommes une association
d’amis, de complices, en effet, qui s’est construite sur la base d’une grande
passion amoureuse, affective et intellectuelle. Sa rencontre a été pour moi une
véritable initiation libératrice. Elle répondait sans doute à mon aspiration
profonde, dans un contexte d’exil qui n’a pas manqué d’être douloureux.
Philippe n’a pas freiné mon autonomie, qu’elle soit intellectuelle ou
amoureuse, il a encouragé cette indépendance. Nous ne vivons pas de la même
façon. Je tiens beaucoup au secret, la jouissance, en particulier féminine, a
besoin de secret. Et je ne suis pas de ceux qui mettent leurs
« secrets » sous les projecteurs. Je me contente de les recomposer
dans mes romans. Vous dites qu’il faut être fort psychiquement ? Je suis
persuadée d’avoir été très aimée par mes deux parents. Certaine donc que
je mérite l’amour, quels que soient mes défauts, et que si l’autre ne m’aime
pas, il se trompe.
Mais n’est-on
jamais détruit par la jalousie ?
Si vous vivez dans une révolte-révélation permanente, vous ne vous
fermez pas jalousement dans votre « univers », vous êtes un
« multivers ». Et un « multivers » ne peut pas être jaloux
du « multivers » de l’autre. Si vous avez vos propres relations, vos propres
amitiés, des activités multiples, une vraie liberté de pensée, vous ne pouvez
pas considérer la personne que vous aimez comme votre propriété, destinée à
remplir vos manques. Vous êtes des mondes complémentaires. Notre relation reste
cependant l’axe central autour duquel se construisent des liens nouveaux,
insolites, ouverts. Elle s’affine dans la durée, comme base indestructible
d’affection, de tendresse, de soin, de partage. Vous vous en doutez, je ne vous
dis pas tout…
propos recueillis par
Patrick Williams
ELLE du 21 septembre 2012
|


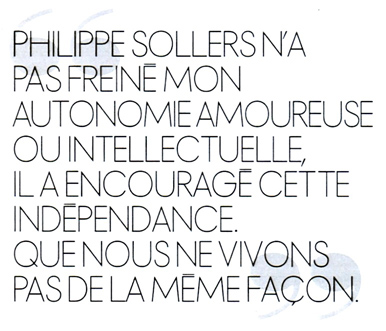 Vous formez avec
Philippe Sollers un couple qui fascine et qui étonne. Est-ce vraiment possible
de former un couple totalement libre, avec un mari libertin, ou êtes-vous
davantage une association d’amis ?
Vous formez avec
Philippe Sollers un couple qui fascine et qui étonne. Est-ce vraiment possible
de former un couple totalement libre, avec un mari libertin, ou êtes-vous
davantage une association d’amis ?
