JULIA KRISTEVA
ETRANGERE AU SEMBLANT

Merci de cette belle initiative, merci beaucoup de
ces belles paroles.
Vous ne serez pas surpris si je vous disais que mes
pensées vont aujourd’hui à Roland Barthes. Et tout particulièrement à son
texte L’Etrangère, avec lequel- en saluant mon recueil Séméiotikè en 1970- il m’a fait le
cadeau d’un destin qui ne s’est jamais démenti depuis et que je ressens pleinement aujourd’hui. Je ne vous en
citerai ni les propos fort élogieux à mon égard, ni ceux très caustiques à
l’endroit de nos ennemis d’avant et de maintenant que Barthes traitait de
participants « au grand carnaval du langage ». Je me rappelle, je
vous rappelle seulement que Barthes décrit l’étranger, en l’occurrence
l’étrangère comme une personne
dont « le rôle historique », ose-t-il prétendre, « est actuellement d’être l’intruse », de « déranger les
bons ménages exemplaires » en « orchestrant un
« remue-ménage », « puisque ménages il y a », insiste-t-il.
Vous-vous demandez comment serait-ce possible ? En
« activant la poussée et en donnant la théorie » de ce
« déplacement » qui « détruit le dernier préjugé ». Et ceci
par une « théorie » qui n’est « ni une abstraction, ni une
généralisation, ni une spéculation », mais une
« réflexivité » : en ce sens qu’elle se prend elle-même pour
cible. Ainsi faite, critique des préjugés et n’oubliant pas de se prendre
elle-même pour cible, l’expérience en question - précise Barthes –
éveille les « résistances » du « petit nationalisme de l’intelligentsia française ». Nouvelle version du
nationalisme en effet,
puisqu'elle ne porte
pas sur les nationalités, mais se
manifeste comme un « refus de l’autre langue »: entendons, une
« autre langue » qui n’est pas une autre langue nationale. « L’autre langue est celle
que l’on parle d’un lieu politiquement et idéologiquement
inhabitable : lieu de l’interstice, du bord, de l’écharpe, du
boitement. » Une langue, pensée, manière d'être qui « traverse,
chevauche, panoramise et offense ». Traversée des identités et des disciplines.
Imprenable solitude. Hannah Arendt que je devais lire plus tard n'écrit-elle
pas, reprenant Platon : « Bios
theoreticos est bios xenikos »- La vie dans/de la théorie est une vie
dans ou de l’étrangeté ». Plus romanesque, Barthes imagine l’étranger/
l’étrangère comme un « cavalier seul ».
Un diagnostique de
destin, disais-je, que cette « feuille de route » que RB m’a donnée
et que mon travail - notamment universitaire - n’a cessé de confirmer, que vous
confirmez. J’ai essayé de l’approfondir quelques années plus tard l' "étrangère" de Barthes,
en publiant en 1988 Etrangers à nous-mêmes, dont je tiens à
vous lire ces lignes :
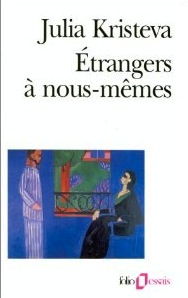
« Étranger : rage étranglée au fond de ma gorge, ange noir troublant la transparence, trace opaque, insondable. Figure de la haine et de l'autre, l'étranger n'est ni la victime romantique de notre paresse familiale, ni l'intrus responsable de tous les maux de la cité. Ni la révélation en marche, ni l'adversaire immédiat à éliminer pour pacifier le groupe. Étrangement, l'étranger nous habite : il est la face cachée de notre identité, l'espace qui ruine notre demeure, le temps où s'abîment l'entente et la sympathie. De le reconnaître en nous, nous nous épargnons de le détester en lui-même. Symptôme qui rend précisément le « nous » problématique, peut-être impossible, l'étranger commence lorsque surgit la conscience de ma différence et s'achève lorsque nous nous reconnaissons tous étrangers, rebelles aux liens et aux communautés.
L'animosité suscitée par l'étranger, ou du moins l'agacement (« Que faites-vous ici, mon vieux, vous n'êtes pas à votre place! »), le surprennent à peine. Il éprouve volontiers une certaine admiration pour ceux qui l'ont accueilli, car il les estime le plus souvent supérieurs à lui-même, que ce soit matériellement, politiquement ou socialement. En même temps, il n'est pas sans les juger quelque peu bornés, aveugles. Car ses hôtes dédaigneux n'ont pas la distance qu'il possède, lui, pour se voir et les voir. L'étranger se fortifie de cet intervalle qui le décolle des autres comme de lui-même et lui donne le sentiment hautain non pas d'être dans la vérité, mais de relativiser et de se relativiser là où les autres sont en proie aux ornières de la monovalence. Car eux ont peut-être des choses, mais l'étranger a tendance à estimer qu'il est le seul à avoir une biographie, c'est-à-dire une vie faite d'épreuves - ni catastrophes ni aventures (quoiqu'elles puissent arriver les unes autant que les autres), mais simplement une vie où les actes sont des événements, parce qu'ils impliquent choix, surprises, ruptures, adaptations ou ruses, mais ni routine ni repos. Aux yeux de l'étranger, ceux qui ne le sont pas n'ont aucune vie : à peine existent-ils, superbes ou médiocres, mais hors de la course et donc presque déjà cadavérisés. »
Etranger, étrangère : mais à quoi? Poursuivons
le raisonnement, pour clarifier
encore plus, si c’était nécessaire, si c’était possible. Evidemment, puisque j’en parle ici,
c’est de mon étrangeté vis-à-vis du discours universitaire qu’il s’agit
aujourd’hui. Une douleur et une chance à la fois, comme pour toute étrangeté,
je l’ai longuement détaillé dans le livre. Je m’en expliquerai davantage si la Présidence de Paris 7
parvenait à réaliser son projet de rencontre avec les lauréats du Prix Holberg,
prévu pour cette automne. Très brièvement aujourd’hui, sans trop alourdir cette
réception, comment ne pas mentionner que c’est au « discours
universitaire » que je revendique mon étrangeté ?
Ce discours que Lacan définit comme
n’étant que « du semblant », tout en lui rendant hommage, forcément
ironique : « dans ma position marginale /à l’endroit du discours
universitaire/, dit-il, qui croit
devoir me donner abri, ce dont certes je lui dois hommage ». Le discours
universitaire ne serait que du semblant : inapte à la vérité, il
diffuse « du savoir mis en usage à partir du semblant », et de ce
fait il reste « insuffisant à
remplir (même) sa fonction » qui consiste à éveiller le désir de vérité.
Incapable de produire le savoir (comme le fait la recherche), le discours universitaire se contenterait de sa « fonction
de chien de garde /de la vérité / pour la réserver à qui de droit » et
pour assurer « le
marché » par le truchement de divers « unités de valeur » (notez
le jeu de mots) qui préparent la « colonisation universitaire » du
désir de savoir.
Pour remédier à cette déconnexion entre savoir et vérité que
fabrique le discours du semblant, Lacan n’envisageait rien de moins que
de le confronter … à la psychanalyse : pour ainsi seulement faire entendre
que chacun « dépend de son rapport
au langage qui le tient et non qu’il tient ». Une dépendance dont
l’enseignement de Lacan prétend élaborer « le mapping » ( dit-il), la
carte.
En saluant cette salve salvatrice contre le « discours du
semblant », ce n’est pas le « mapping » que j’ai entrepris- pour
ma part- de transmettre à nos
étudiants, persuadée comme j’étais et comme je suis toujours que le
« mapping » dévie facilement dans le culte du mathème, autre variante
du « semblant » à
prétention de modèle. Au croisement de la littérature et de la psychanalyse,
comme l’UFR « Sciences des textes et documents » m’en avait donné
l’occasion et la chance, j’essaie plutôt de pratiquer ce que j’appelle, non pas
la « diffusion du savoir », mais la transmission de l’expérience du langage . Au double
sens du terme « expérience » que la langue allemande distingue avec
deux mots : Erlebnis (surgissement, fulgurance- qui devait me conduire aux extases de Thérèse
d’Avila) et Erfahrung (connaissance
de ce jaillissement, patient savoir- ce qui m'a fait apprivoiser la chora sémiotique chez Mallarmé ou le temps sensible dans le sadomasochisme de
Proust).
Transmettre l'expérience du langage s'est avéré être, s'avère être un projet difficile. Non
seulement parce que ceux qui s’y sont engagés devaient refaire toute l’armature du discours du
semblant (linguistique, stylistique, et bien sûr aussi psychanalytique). Mais
parce que la carrière universitaire, par définition, se protège de ces étrangers qui dérangent les
« derniers préjugés » et leurs « aménagements »
territoriaux qu'évoquait Barthes:
les carrières universitaires rejettent de plus en plus ces intrus, ces étrangers hors de leur emprise
institutionnelle où règne le semblant. De plus en plus souvent, même là où l’on ne s’y attendait pas,
vous en êtes les acteurs et les témoins. Est-ce vous dire que j’ai été surprise par ces signaux que le semblant ne cesse d’émettre? Pas
vraiment. Barthes et Lacan m’avaient prévenue, autant dire: ils m'avaient
éduquée et endurcie.
Loin
de me décourager donc, cette mise en évidence et cette perpétuation de
l’étrangeté que j’essaie de pratiquer ne peut que me stimuler à persévérer, au
cours de mon éméritat, dans la situation qui est la mienne et que je qualifierais
d’ « exclusion interne » dans ou de l’Université. Et - tout en m’excusant auprès de mes étudiants
et de ceux qui, en me suivant, ne cessent d’essuyer des échecs,- je reste
persuadée que dans le domaine des humanités il n’y a pas d’autres avenir de
l’Université (je la remercie à mon tour d’avoir abrité mon expérience!), que
d’essayer d’éveiller le désir de savoir. Qui s'enracine dans l'expérience du langage.
Je ne le répéterai jamais assez. Quelque difficile voire en déclin que soit cette
aventure, je suis persuadée que c’est en pratiquant les textes littéraires comme une expérience –en nous y risquant par
l’écriture et par
l’élucidation des logiques de
l’inconscient- que les Lettres
pourront contribuer à reconquérir cette place de vigile de la curiosité
psychique dans la chair même du langage et, par extension, dans tous mes
domaines de la vie de l'esprit. Une place qui manque à l’Université et dont a
besoin la refondation de l’humanisme dans le monde moderne.
Je l’ai dit dans Etrangers
à nous-mêmes, et je le répète : « Nulle part on n’est plus
étranger qu’en France ». Vous avez compris que la France, pour moi, c’est
ici, que la France dont je parle aujourd’hui c’est le discours universitaire
qui continue de faire semblant, et notamment de faire semblant que la tentative
d’y introduire l’expérience du langage n’a pas eu lieu – et
pourtant ça a eu lieu, et ici-même, par la fondation et la percée opérée dans
les « études littéraires » par STD, aujourd’hui LAC.
Nulle
part on n’est plus étranger qu’ici, et pourtant cette exclusion interne qui m’a été dévolue m’a été cependant
particulièrement bénéfique. Et j’ajoute, comme je l’avais fait dans mon
livre : « Mais nulle part on n’est mieux étranger qu’en
France ». Pourquoi ? Au moins pour deux raisons :
D’abord, parce que mon exclusion interne m’a
conduite à l’étranger, anticipant ainsi aussi bien l’ouverture des frontières européennes que l’incommensurable
globalisation. Vous le savez, ce sont les universités américaines et autres qui
témoignent à des étrangers de mon espèce de cette hospitalité que je
considère comme la seule définition possible de l’humanité : car, c’st
connu, nous n’avons de cette dernière qu’une notion négative (quand il s’agit
de « crime contre
l’humanité ») mais pas vraiment de définition positive.
Et ce
n’est pas tout. Nulle part on n’est mieux étranger qu’en France, parce que de
ma position d’exclusion interne ou d'inclusion externe j’ai eu la chance de rencontrer des
personnes- des singularités - dont
les parcours biographiques, si différents du mien, n’ont cessé de
m’accompagner de leur générosité, talent et pour tout dire l’humanité. Au point
que sans elles je ne puis concevoir aujourd’hui les divers accomplissement dont
vous venez de me gratifier et dont je vous remercie. Je les leur dois et je suis heureuse de les
dédier à eux.
En commençant par Raymonde Coudert, dont j’ai suivi
la superbe thèse sur le féminin chez Proust qui a obtenu le Prix de la
recherche en sciences humaines du Monde
de l’éducation. Son amitié, son génie de la langue française, son énergie,
sa finesse psychologique à mon égard comme avec les étudiants et avec tous les
intervenant dans cette entité si complexe qu’est l’Ecole doctorale, l’aide
qu’elle m’a apportée dans ma recherche et mon écriture, ont fait de ces années
universitaires un temps de grâce. Mille mercis, chère Raymonde, et bonne
continuation de votre travail et de votre personne et de votre accomplissement personnel.
Jocelyne Louis, avec laquelle j’ai partagé - presque depuis le
début - le souci de faire de cette UFR un lieu de renaissance de l’Université,
mais aussi les déceptions qui n'ont pas manqué dans cette aventure, pour mieux ne garder que les joies qui
la jalonnent. Sans votre tact, votre sens de la
vulnérabilité, votre discrétion et votre indéfectible efficacité je n’aurais
pas vécu ces années, aussi, comme ce que l’art de vivre à la française peut
donner de plus délicat, de plus solidaire , de plus précieux.
Et
Claude Zélawski que j’ai eu la chance de rencontrer seulement dernièrement, et
dont le sens artistique, la fragile sensibilité qui côtoie l'endurance dans l'exercice du devoir
professionnel m’ont persuadée, moi l’incrédule, que je suis peut-être bien une intellectuelle française dont
existence internationale mérite qu’on en prenne soin. Car, grâce à vous, chère
Claude, je ne suis plus seule quand je manque un avion, que mon blackberry est
en panne et que divers correspondants encombrent mon mail box : Alma Mater
n’est pas seulement du semblant, ça existe pour de bon, c’est Claude.
Pour
leur aide si affectueuse et compétente, pour leur tendresse, pour leur génie
féminin, et pour la
gaieté que nous partagions et
partagerons, je les remercie.
Elles
me donnent le courage de faire
mienne une des phrases les plus ambitieuses de Colette, que je considère comme
la meilleure réponse à la question métaphysique la plus difficile, une question
qui se pose immanquablement à certains moments clés de l’existence et tout
particulièrement à l'occasion d'une rencontre comme celle d’aujourd'hui, et forcément quand on mène sa
vie comme une expérience du langage. C’est la question du commencement. Y
a-t-il du commencement ? Où,
quand, comment peut-il y avoir du commencement ? Et voici la réponse
exorbitante de Colette, à laquelle
je souscris : « Renaître n’a jamais été au-dessus de mes
forces ». Je traduis : Commencer, recommencer n’a jamais été
au-dessus de mes forces. Grâce à ces étrangères à elles-mêmes, comme Raymonde,
Jocelyne, Claude.
Je vous
remercie.
Paris 7, 15 juin 2010
