Le
féminin transformatif et l’hétérosexualité
>>> English version

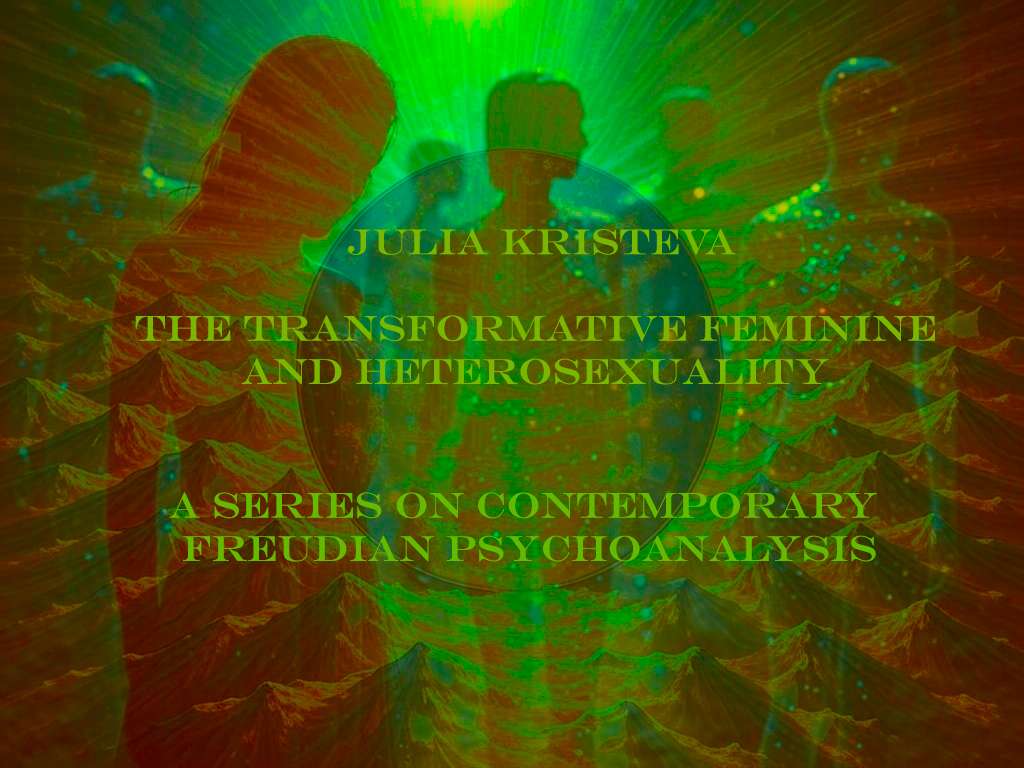
« On ne naît pas femme, on le
devient », écrit Simone de Beauvoir. Je dirais
plutôt : « ON (biologique) naît femme, mais JE
(conscient-inconscient psychosexuel) le deviens ». Pourquoi ?
Mon
expérience clinique m’a permis de comprendre « l’identité » féminine
comme un processus ouvert, changeant, inachevé, qui se compose de multiples
étapes et facettes. Cette « identité » féminine se construit comme un
voyage complexe tout au long de la vie, elle est structurellement transformative.
D’où sa capacité de traverser le féminin réprimé, maltraité, en proie à la
violence et au harcèlement sexuels ou encore instrumentalisé par la religiosité
intégriste. Quand il est lucide et assumé dans sa complexité, le féminin transformatif surprend par sa
maturité intense, multiforme, en formation continue.
Aujourd’hui, dans un contexte social et
politique chaotique et menaçant partout dans le monde, les femmes s’imposent
comme un, sinon LE facteur majeur de la transformation anthropologique en
cours. Victimes, elles forcent les législateurs à modifier les lois ;
créatrices de nouveaux langages et comportements, comme dans le procès de Mazan,
elles transforment les standards éthiques. Le temps est venu d’insister sur
cette révolte et cette reliance, vivacité inhérente à ce qu’on a longuement cru
être le « deuxième sexe ».
D’amblée
je tiens à rappeler brièvement la conception freudienne du sexuel pulsionnel,
souvent oublié ou ignoré, dans lequel se construits ou pas le féminin.
Une
« révolution psychique de la matière », évoquée dans Deux
principes dans le cours du développement psychique, (1911) loin d’évacuer
l’organique (la biologie et l’anatomie), l’a dé-naturé par le
refoulement originaire, la psychisation et l’émergence du langage. Cette disjonction originaire déplace l’instinct animal dans la pulsion désormais et
définitivement double, hétérogène (énergie-et-sens). L’être parlant se
constitue dans cette refonte (Spaltung) comme un sujet clivé auquel l’analyste prête l’oreille.
La
fécondité et l'érotisme féminins paraissent manifester et trahir cette disjonction,
et de ce fait deviennent la cible du désir et de l'envie. À posséder, à
maîtriser, à détruire aussi, au profit d'une domination masculine constatée
dans toutes les sociétés historiques.
Tandis
que la sexualité masculine se forme dans une seule structure oedipienne, le féminin transformatif se construit dans un complexe d’Œdipe biface :
Œdipe prime (avec la mère, objet du
premier désir de l’enfant) et Œdipe bis (avec le père) et se modifie dans ce que je nomme la reliance maternelle.
I -
L’Oedipe biface
J’appelle
Œdipe prime la période archaïque qui
va de la naissance à la phase dite phallique (jusqu’à l’âge de trois à six
ans). Bien loin de l'idyllique « minoén-mycénien » (Freud) et de la
sérénité de « l'être » avant le « faire » (Winnicott),
l'identification projective (Melanie Klein) est favorisée par la ressemblance fille-mère et par la projection du narcissisme et de la dépressivité
maternels sur la fille.
Ce lien
érotisée, oral-anal-et-génital, qu’est la coexitation originaire mère-bébé-fille spécifie ce que j’appelle une homosexualité endogène de la femme que
je considère comme sous-jacente à l’« identification projective » de Melanie
Klein, et qui demeure le centre refoulé de la psychosexualité féminine tout
au long de la vie du sujet, autant sinon plus inaccessible à l’analyse que le
« roc de la castration ». Elle est marquée par cette intrusion de l’adulte, et
plus particulièrement de la mère, dans la vie de l’infans néotène.
L’enfant, qui se laisse séduire et qui séduit avec sa peau et ses cinq sens,
se livre, de fait, avec ses orifices : la bouche, l’anus, et le vagin pour la
petite fille. Enfant séduit, orificiel, effracté : la sexualité
minoémycénienne – ou de l’Œdipe prime dans ma terminologie – est celle
d’un être sexuel, le « pervers polymorphe », qui anticipe... l’être
pénétré de la femme.
Mais,
et d’autre part, cette effraction orificielle spécifique de l’Œdipe prime de
la petite fille est compensée non seulement par l’excitation clitoridienne,
mais encore par l’élaboration précoce d’un lien d’introjection-et-d’identification
avec l’objet séducteur et intrusif qu’est la mère. Melanie Klein fut la première, me semble-t-il, à
suggérer que, dans des circonstances optimales, l’investissement libidinal du
corps creux de la mère, ainsi que du sien propre, se métabolise chez l’enfant
en profondeur psychique (« depth »). Je constate, quant à moi,
que par l’introjection, la fille installe la mère séductrice au- dedans : la cavité excitée du corps intérieur se mue en représentation interne.
S’amorce ainsi un lent et durable travail de psychisation qui sera accentué
par l’Œdipe bis, et dans lequel on reconnaît la tendance féminine à
privilégier la représentation-idéalisation psychique ou amoureuse, en
contrepoint à l’excitation érotique pulsionnelle.
À la suite de la maturation neurobiologique et
des expériences de séparation satisfaisantes avec l’objet, le stade phallique
devient l’organisateur central de la coprésence sexualité-pensée chez les
deux sexes : le sujet peut aborder l’Œdipe bis. L’enfant, qui a déjà
développé le langage et la pensée, ne se contente plus d’investir ses
organes et leur excitabilité, mais, suivant les mouvements intérieurs de son
excitabilité pulsionnelle, il associe et applique les opérations cognitives
au monde extérieur et aux identités personnelles ou sexuelles. Dans cette période que j’appelle de l’Œdipe
bis, contrairement au garçon, la fillette change d’objet : le père
remplace la mère comme cible du désir. Détaillons l’ambiguïté de ce
changement.
L'entrée
dans l'Œdipe bis jouxte un moment
décisif de la construction de la subjectivité féminine : l’investissement
(Besetzung, cathexis) de ce que Freud appelle « le père de la
préhistoire individuelle
[1]
» qui a les caractéristiques des deux
parents. Avant que la différenciation sexuelle « soit sûre », il
ne s’agit que d’une « identification directe et immédiate » (Einfühlung) avec le père, non encore
« objet », mais déjà instance tierce ET identificatoire qui, « en réunissant les caractéristiques des deux parents »,
« ramène à l’apparition de l’Idéal du moi ». J’insiste sur la
« bisexualité » (père et mère) qui s'immisce dans la tiercéité
originaire à l’origine de l’Idéal du Moi. Et je soutiens que la part « mère »
de ce « père imaginaire » ne peut que favoriser la transition de l’Œdipe prime féminin en Œdipe bis, et de ce
fait soutenir cette bisexualité dont Freud stipule qu’elle « ressort
beaucoup plus nettement chez la femme que chez l’homme».
Figure tierce, séparatrice et régulatrice de
la dyade sensorielle mère-enfant, le père devra se poser pour de bon en père symbolique, instance de l’interdit et de la loi, raison, pouvoir et codes moraux. Le pénis devenant, pour les deux sexes parlants, le phallus – signifiant de la privation, du manque et de ce fait du désir : désir de
copuler, de signifier, de sublimer, de créer.
Le
garçon entre dans l’Œdipe sous le régime du meurtre du père et de la
castration, et les « résout » par le Surmoi. La fille entre dans
l’Œdipe bis favorisée par le féminin du « père de la préhistoire », qui,
au contraire, angoisse le garçon en le renvoyant à la castration et à la
passivité. La fille idéalise cette tiercité bivalente paternelle et ses
valeurs ; mais, aimantée par la mêmeté-intimité maternelle de l'Œdipe prime,
elle adhère à l'ordre phallique comme étrangère au phallus, en percevant
sa sensorialité et son excitabilité clitoridienne comme moins visibles et moins remarquables, même et surtout si elle se risque à s'en défendre
en s'érigeant dans une posture phallique.
À
moins qu’elle n’épure son Œdipe prime en révolte et en insoumission, en
« éternelle ironie de la communauté » (selon Hegel), ou en insatiable
curiosité de chercheuse.
À
suivre les torsades qu’imprime dans le sujet femme son accession à l’Œdipe
bis, nous comprenons l’irréductible étrangeté qu’une femme éprouve dans
l’ordre symbolique-phallique.
En
revanche, lorsque une femme parvient à accomplir le tourniquet complexe que
lui impose l’Œdipe prime et l’Œdipe bis, elle peut avoir la
chance d’acquérir cette solide maturité dont l’homme manque si souvent,
ballotté qu’il est entre la pose phallique du « macho » et la régression
infantile de l’« impossible
Monsieur Bébé ». Pour avoir assumé et élucidé les multiples facettes de
son Œdipe biface, tel un portrait de Picasso, le sujet femme obtient une
étonnante plasticité psychosexuelle.
Pyschisation
du lien
Cette psycho-sexualité d'interdépendance
est codée dans le flux sensoriel, les gestes, les images et les écholalies
(investissement des vocalises pré-linguistiques : intensités, fréquences
et rythmes), que j'appelle un réceptacle (chora) sémiotique, qui ont déjà du sens sans avoir de la signification, cette
dernière s’élaborant avec l’acquisition des règles symboliques (de la phonétique, de la grammaire et de la logique).
Les
premiers gestes pré-symboliques se colorent de rejet :
attraction et répulsion, fascination et dégoût, ni
« sujet » ni « objet », ce que j’ai appelé l'ab-jection qui est plus violente entre la fille et la mère.
Ce
féminin, potentiel otage du maternel pré-objectal, s’installe plus tard dans la triangulation oedipiennne, que j’ai appelé l’Oedipe bis, et qui devient alors l’organisateur central de la coprésence
sexualité-pensée chez les deux sexes : découverte de la différence
sexuelle et accès au langage et à la pensée.
Comme je l’ai noté précédemment, favorisée
par le féminin du « père
préhistorique », la fille idéalise cette tiercité paternelle; Figure tierce, séparatrice et régulatrice de la
dyade sensorielle mère-enfant, le père devra se poser plus tard en père symbolique, instance de l’interdit et de la loi, raison, pouvoir et codes moraux. Processus du Surmoi qui
bouscule la mêmeté-intimité maternelle de l'Œdipe prime dans la
rencontre avec le Phallus – un signifiant du manque et du désir.
Le féminin doit ainsi combattre aussi bien
l’emprise maternelle de l’Œdipe prime que le père du Surmoi dans l’Œdipe bis. Mais l’intériorisation féminine de ce kaléidoscope psychosexuel – que je viens d'esquisser
schématiquement – faite de cette intimité intrapsychique avec le vide, le creux et la pulsion de mort (dans sa version
masochiste) donne accès, dans la rencontre érotique et maternelle, à une
cascade de sensorialités, traces mnésiques, fantasmes et idéaux qui emporte le
plaisir d'organes dans la jouissance féminine. « Toute ma peau a
une âme », écrivait Colette. J'ajoute : toute ma chair a une âme.
Complétude détotalisée et éclipse de soi : vitalité absolue et mortalités
croisées des deux partenaires.
Reliance
L’expérience
maternelle est une autre composante du féminin transformatif, que j’appelle une reliance.
Originairement expérience biopsychique, la reliance maternelle – de la femme et de l'homme – peut être refusée ou transposée dans
les métiers de l'éducation et des soins, ou dans divers engagements sociaux.
Mais elle s'inverse en mère-version, quand la libido de l'amante
détourne sur l'enfant les pulsions insatisfaites.
Avant qu’il ne devienne un
« contenant », dont se détachera la création des liens psychiques, l’érotisme maternel est un état : un
« état d’urgence de la vie » dû à l’expulsion de soi, la séparation,
l’effondrement. L’érotisme maternel est une qualité d’énergie toujours déjà
psycho-somatique, donnée et reçue pour « être à la mesure nécessaire à la
conservation de la vie ».
Mais tandis que la libido de l’amante est dominée par la satisfaction des pulsions, l’érotisme maternel déploie la poussée
libidinale en tendresse ; par-delà l’abjection et la séparation,
la tendresse est l’affect élémentaire de la reliance.
Deux facteurs internes à l’intersubjectivité
maternelle favorisent ce métabolisme de la passion
destructrice et reliante :
un état d’urgence de la vie, ET tendresse, identification reprises dans le
rapport maternel au langage. L’Œdipe biface de la femme revécu et remanié dans le nouveau couple parental
RELIANCE, donc, dans la séparation et
la transitionalité selon Winnicott, et folie
maternelle selon Green, il me paraît important d’insister
aussi sur ce versant maternel qui maintient l’investissement et le
contre-investissement de la liaison et de la déliaison dans les liens
psycho-somatiques, qui se créent et se défont et se rejouent. Cet érotisme
spécifique qui maintient l’urgence de la vie jusqu’à ses limites, je l’appelle
une reliance.
Un temps spiralé et en rebonds s'ensuit : le temps maternel comme commencement et recommencement.
II - Une acquisition tardive : l’hétérosexualité
Quant à l’hétérosexualité, elle est une
acquisition tardive dans l’histoire des hommes et des femmes. Il a fallu
introduire l’amour dans l’alliance contractuelle entre deux personnes de sexes
différents responsables de la reproduction de l’espèce et la transmission des
biens.
Quel amour? (Histoires d’amour, 1985)
L’amour platonicien du Vrai et du Beau sublime l’homosexualité grecque. Le Cantique
des cantiques des Hébreux qui fut le premier à promouvoir l’amour d’une
femme, la Sulamite, amoureuse de son berger-Roi qui la fuit, et qui n’est au
fond que l’irreprésentable amour pour Dieu et de Dieu, de l’Altérité.
Ensuite, la littérature courtoise des troubadours (avec des greffes, parait-il
d’influences taoïstes, transmises par les arabes musulmans) ouvre la voie de
l’Occident chrétien amoureux, libertin, moderne et post-moderne.
Le couple hétérosexuel marié continue de
fasciner les imaginaires, imposé jusqu’à la nausée par « les opéras de
savon » américains ; il survit en sourdine dans les couples
homosexuels ; quand il n’explose pas dans « la comédie hétérosexuelle »
(Lacan). Il s’agit d’une passion qui défie toutes les autres et s’assume dans
l’espace social. C’est seulement sur la base de cette maturité que l’acte
juridique du mariage, quand il s’y ajoute, protège la génitalité du couple
hétérosexuel, dont Freud pensait qu’elle « rompt la liaison de masse
propre à la race et à la communauté » et « accomplit des
opérations culturellement importantes ».
Avons-nous tendance à refouler et dénier
cette génitalité qui « rompt la liaison de masse » et « accomplit
des opérations culturellement importantes » ? Écoutons les
désirs qui se sont exprimés pour défendre le mariage pour tous. Et si le
couple hétérosexuel et sa famille en étaient le point de mire, précisément
qui se profile comme souci de parer à la solitude, de se prolonger et
transmettre ? La morale conventionnelle a beau les banaliser, nos programmes
téléglobalisés les représenter jusqu’à la caricature, nos fantasmes
convergent vers eux : éprouvettes, congélations d’ovocytes, dons de spermes,
jusqu’à ces ventres féminins que l’on achète le temps d’une grossesse. Les
« tradis » comme les « modernes » savent bien que « ce n’est pas ça
», ce n’est jamais ça : rien n’y fait, c’est bien à papa et maman que l’on
joue en légitimant le mariage pour tous. On le voit, l’hétérosexualité ne
réside pas dans la seule différence anatomique entre le mâle et la femelle.
L’hétérosexualité ne peut pas non plus être invoquée comme le plus sûr et
le seul moyen de transmettre la vie ou de garantir la mémoire des
générations. Elle révèle l’extrême intensité de l’érotisme et recèle de
ce fait une insoutenable fragilité.
Il fallait le génie de Freud pour formuler
ce que tous savaient intimement : la procréation qui hante les humains n’est
pas un acte naturel. Dans le contexte social chaotique que nous traversons
actuellement, la différence sexuelle s’affirme dans l’hétérosexualité qui
transgresse les identités sexuelles et les codes conventionnels autrement que
ne le fait le genre. Le duo hétérosexuel est cet accordage qui n’évite ni
l’identité conflictuelle ni le désir à mort, mais les résorbe dans la
jouissance : cascade de fantasmes, foyer de la psychisation, de la
créativité. Et qui assurent la longévité de l’espèce humaine.
Quoi qu’il en soit, l’hétérosexualité est et
sera le problème. Dès lors à partir et avec le féminin transformatif, infinies
sont et seront les métamorphoses de la parentalité, que la psychanalyse se
prépare à accompagner.
Julia Kristeva
Questions
Rachel Boué-Widawsky - I
would like to come back to some aspects of your presentation which, I think,
are rarely acknowledged in the psychoanalytic literature and in our clinical
practice.
I will start with the idea of
estrangement to the phallus within which women live their lives. You observe it
in your practice, you wrote about it. In one of your books, Hatred and
Forgiveness (2005, tr. 2010), you call it a “constitutive exclusion”, “an irreparable”,
(p119) solitude. What is for you the
estrangement to the phallus and how women cope or don’t with it?
JK - La fabuleuse adaptabilité sociale féminine
recouvre, obstinée cicatrice, cette dissociation constitutive qui s'exprime
comme étrangère à l’ordre phallique.
D’une part, intense investissement du lien et de l’altérité étayante, mouvement
psychosexuel qui se révèle dans le besoin
de croire :croire à l'enveloppe maternelle, au père
imaginaire. Cette croyance mais aussi
cette identité s’éprouvent dans le registre de l’illusoire, quand ce n’est pas
celui de l’imposture : c’est du jeu, « j’en suis mais je fais
semblant ». Illusionné, le féminin est tout autant désillusionné,
déçu : d'une déception radicale, plus intraitable que la mélancolie, car
elle/il se confronte non pas au non-sens de l'être, mais à l'absence d'être. Le féminin assume cette ab-sence et revit avec elle. Redoutable
région où la force (de vivre) côtoie l'indifférence. Ce féminin réprimé,
maltraité, retranché dans son étrangeté et son absence, ce féminin
désillusionné fait aussi les plus aguerries des athées.
L’apparent réalisme féminin se soutient aussi
de cet illusoire : les femmes ne cessent pas de faire et de tout faire,
parce qu’elles n’y croient pas totalement : elles croient que c’est une
illusion… à refaire.
Q2-
This Feminine which is constantly in the making, which is transformative,
oscillating btw attachment/separation through the two oedipal phases (biface),
through the duality of the imaginary and real father, through motherhood,
predisposes women to a constant maintenance of the links to an other, thus
weaving the reliance. Do you see in this Feminine as providing an ethical
foundation for psychoanalysis and perhaps for the future of our humanity?
JK - Le féminin comme l’éthique demandent à être
abordés avec précaution et délicatesse, tant les stigmates de la métaphysique
et de la politique les alourdissent et les déforment. Lacan avait déjà la
prudence de ne pas employer l’article défini féminin, in French, LA, avec le
substantif « femme ». « La femme n’existe pas » disait-il,
pour ne pas essentialiser cette « notion » ni bloquer son pouvoir de
transformation. Sans être désormais une « énigme » comme le pensait
Freud, le féminin m’apparaît aujourd’hui, dans mon expérience clinique et dans
la percée socio-politique des femmes dans le monde, comme un constituant aussi
radical qu’incernable de nos identités psychosexuelles, tel le boson de Higgs.
Insaisissable et cependant indispensable, le boson de Higgs est une des clés de
voûte du modèle standard de la physique des particules, et à ce titre il est
parfois dénommé la « particule de Dieu ». Le féminin serait-il le
boson de l’inconscient pour les deux sexes ?
La
subtilité du féminin ainsi comprise ne saurait convenir aux grilles rigides,
des valeurs transcendantes – le bien et le mal, la loi, le devoir, le jugement
– et aux impératifs contraignants de la morale. L’éthique qui se substitue à la
morale dans une ontologie immanente (avec Spinoza, Nietzsche et Deleuze) prend
comme modèle les « puissances » et les « limites » du
corps, avec ses aptitudes aux affects, et leur capacité d’affecter d’autres corps, ou bien celle d’être affecté par eux.
La
psychanalyse freudienne participe de cette éthique qui « suspend » le
jugement pour analyser les singularités constituées et constitutives, et les
actualiser dans la pratique du transfert à travers le temps. C’est une tâche
éthique en somme, qui se donne une direction : « Là où C’était je dois advenir », avec deux
principes qui s’opposent, « le principe de plaisir » et « le
principe de réalité ». Le processus analytique est un geste éthique, et
non moral, parce qu’il ouvre à une tension interprétative basée sur les capacités
pulsionnelles, leur puissance et leur limites, aussi bien que sur le sens
questionnable et le besoin de reconnaissance réciproque.
Ainsi la « structure ouverte » qu’est le
Féminin participe du dépassement et de la légitimation en cours des
identités sexuées et genrées, de leur devenir singulier et partageable. La
portée libératrice du genre participe de l’accélération anthropologique en
cours, en tant que les désirs sont favoriés par les avancées scientifiques, il
est vain de les récuser. S’impose en revanche de répondre aux demandes et aux
symptômes dans leur singularité pour accompagner ces
« êtres-autrement » vers la créativité. Cette bisexualité psychique polyphonique
révèle les zones traumatiques de la subjectivité où se fissure ce lien
primordial à la vie qu’est la sexuation. Celle-ci peut être source
d’angoisses, facteur de symptômes qui en appellent, parfois, à la manipulation
hormonale ou génétique, en neutralisant ce féminin transformatif et
dévitalisant sa fonction liante et créative.
Freud a médité, jusque dans son Abrégé (1939-40), sur le
« trauma » de la différence des sexes qu’il ne faut pas perdre de vue
dans la revendication identitaire passionnelle. Il ne faut pas oublier que la
sexualité avec laquelle la théorie de l’inconscient a « dynamité » la
morale normative, est une sexualité « dénaturée » parce que d’emblée
et toujours, elle est biologie-ET-sens, organes-ET-parole,
excitation-et-psychisation.
Je conclurai en disant que Transformabilité
et Reliance, qu’est le Féminin - apanage
des deux sexes - constituent la base d’une éthique à venir dont la
psychanalyse, par sa plasticité théorique, ne peut que contribuer à développer.
Q3- You have also addressed the question of the
feminine outside psychoanalysis proper by writing a trilogy, called the
Feminine Genius, on Hannah Arendt (1999), Melanie Klein (2000), Colette (2002). First, Why did you choose this term “genius”?
JK - Pourquoi
cette hyperbole provocante de « génie » ? Notre époque a
désormais les moyens de porter attention à la singularité, d’accorder soin à son épanouissement, de développer le souci pour l’advenu de « qui » dans le « quelconque »
- le « génie » étant la version la plus complexe de cette
singularité, la plus séduisante, et qui à ces conditions seulement s’inscrit
dans la durée et dans l’universel.
Par-delà
les incommensurables différences et l’originalité des œuvres de Arendt,
Klein et Colette, quelques traits
communs émergent : la permanence du lien et de l’objet ; le souci de
sauvegarder la vie de la pensée parce que la pensée c’est la vie ;
l’insistance sur le temps de l’éclosion et de la renaissance.
Arendt
a fait de sa lutte politique contre le totalitarisme un
combat philosophique non pas pour la pensée-calcul, mais pour la
pensée-interrogation, la pensée-goût, la pensée-pardon.
En
fondant la psychanalyse des enfants, Melanie Klein ne troque pas
l’érotisme, placé par Freud au fondement de la vie psychique, contre la douleur
du nouveau-né qu’elle suppose schizo-paranoïde, puis dépressif, comme on l’en a
souvent accusée. En se focalisant sur la psychose infantile qui handicape
la faculté cognitive, Klein fut la première à faire de la psychanalyse un art
de soigner la capacité de penser.
Colette,
quant à elle, exerce l’art des mots non comme une rhétorique ou une pure forme,
et moins encore comme un message d’idées. Si elle pense en écrivant, c’est que
cette pensée écrite est immédiatement une nouvelle vie qu’elle transporte
dans son écriture sensuelle, gustative et sonore, parfumée et tactile, est
une pensée faite chair.
Chacune
différemment, ces trois femmes identifient la vie et la pensée. Pour elles :
vivre c’est penser-sublimer-écrire. Dans le talent de ces femmes, je reconnais
la psychosexualité féminine par
excellence là où le sens s’enracine dans le sensible, où les représentations de
mots côtoient les représentations de choses, où les idées font leur place aux
pulsions.
Enfin,
ces trois femmes vivent et pensent la liberté comme une naissance et
renaissance. Sans avoir fait l’expérience de la maternité, Arendt assigne au
fait d’être au monde l’expérience ontologique d’un nouveau commencement, d’un
nouveau sens, d’un nouveau monde. Klein, la dépressive, renaît comme analyste,
grâce à deux analyses avec Abraham et Ferenczi et l’abandon de l’Allemand pour
l’Anglais. Elle renaît dans le contre-transfert de ses cures d’enfant – ce qui
a pu lui être reproché. Enfin pour Colette, l’écriture est un perpetuel
recommencement : « Faire peau neuve, reconstruire, renaître, ça n’a
jamais été au-dessus de mes forces ».
J’ai
trouvé dans les œuvres de Arendt, Klein et Colette, des traits spécifiques de la psychosexualité féminine, qui ne mènent
pas à la guerre des sexes, mais insistent sur l’irréductible différence entre
le féminin et le masculin. Une différence que j’entends dans la particularité
spécifique à l’homme et à la femme de penser et de vivre la pulsion de mort, et
qui ne m’a jamais été aussi claire qu’en lisant Freud et Sabina Spielrein, –
Freud stipulant que « le principe de plaisir est tout simplement au
service de la pulsion de mort » (De
la sexualité Féminine 1931) ; tandis que pour Spielrein qui l’avait
théorisée en 1912, avant Freud, c’est l’inverse : « Le besoin de destruction est inhérent
à l’instinct sexuel » mais « la destructivité [n’] est [que] la
condition de tout devenir » (La destruction comme cause de devenir (1912).
Lire
Arendt, Klein et Colette nous aide à maintenir ces différences, mais aussi à
rendre possible leur harmonisation créative.
- Thank you very much JK for this rich and deep
conversation that opens and frees so many psychoanalytic new thinking
perspectives which the audience is
probably now eager to explore with you.
30 mars 2025
|