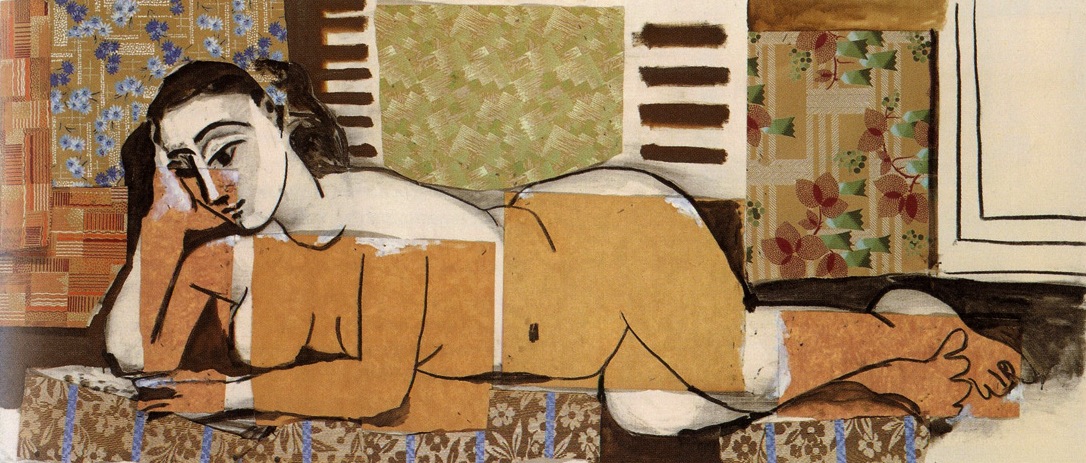La
chair des mots
L’interprétation en psychanalyse n’est ni un
instrument technique ; ni cette opération commune inhérente à la pensée
humaine qui accompagne la conscience de soi ; ni une herméneutique qui,
depuis Platon et jusqu’à la phénoménologie cherche le sens ultime, le « dire
vrai », « au-dessous » d’un texte primitif. Piégés par l’homonymie ou la
polysémie du terme « interprétation », nous ne sommes sans doute pas
suffisamment conscients de la nouveauté radicale, souvent scandaleuse, de la
découverte freudienne d’une INTERPRETATION spécifique, inséparable de celle de
l’INCONSCIENT. J’aimerais insister sur l’irréductible originalité de
l’interprétation psychanalytique, en l’appelant d’abord une a-pensée ( avec
le préfixe a-privatif, qui met en
abîme le mot « pensée ») en ce qu’elle creuse,
déconstruit, analyse (au sens étymologique du terme) le raisonnement et le jugement conscienciels,
à la recherche de l’« autre scène ». Sans être pour autant une fiction ou un
jeu spéculatif, l’interprétation est un questionnement de l’acte de penser
lui-même.
I. A-pensée
Une a-pensée qui se tient dans le questionnement
de l’inconscient, et dont je résumerai l’extraordinaire ambition ainsi :
A-pensée, l’interprétation l’est parce que l’objet de notre interprétation- si différente des autres- est cette étrange « réalité psychique » : aussi réelle que reconstructible, définitive que cataclysmique, dont Freud nous invite à relever la vivacité et l’incoercibilité dans le désir inconscient. C’est dans le transfert et le contre-transfert – qui ne sont pas une interlocution mais une allocution dissymétrique- que se reconstruit indéfiniment cet objet psychique vivant dont
l’association libre est une proto-interprétation.
Ces deux objets, le désir inconscient et le
transfert – contre-transfert, posent une question radicalement nouvelle :
quel langage vais-je construire pour accueillir le désir de l’association libre
?
Il existe donc une « maïeutique » de l’interprétation psychanalytique qui découle
du principe suivant : la vie psychique est reconstructible. Mais ce « reconstructivisme » n’a rien d’idyllique :
l’interprétation est habitée par la violence (elle fait effraction dans
vos défenses, même si nous savons que vous êtes venus chercher cette agression
libératrice) ; elle ne manque pas de perversion (je prends plaisir à
partager vos angoisses, traumas ou jouissances) ; et ne va pas sans scepticisme : l’interprétation travaille tout contre (c’est-à-dire avec) la répétition et la déliaison. Cependant, elle
respecte et favorise les voies singulières, aussi modestes soient-elles, par
lesquelles se construit la re-naissance psychique,
toujours au singulier.
Ainsi comprise, l’interprétation n’est pas une
réponse à une demande : le dispositif transfert/contre-transfert n’est pas une
interlocution, n’en déplaise à P. Ricoeur.
L’interprétation n’est pas non plus une simple réhabilitation des fantasmes
originaires (Viderman) ; ni un retour à un absolu
archétypique (Jung) ; ni une exigence à accéder au «pur signifiant» de l’Autre
(Lacan). Décrire l’interprétation comme un « jeu » qui crée un « espace
transitionnel » (Winnicott) ouvre
incontestablement une respiration entre la mère et l’enfant, l’analyste et
l’analysant, mais risque de laisser dans l’ombre
l’impact incisif, décapant, révolutionnaire du dire interprétatif.
[1]
L’acte analytique dit d’interprétation est une économie spécifique de l’énonciation (dont le silence fait partie), qui installe le sujet parlant, l’analyste, dans le questionnement. Mais qu’est-ce précisément que le questionnement ? Freud, théoricien de l’affirmation et de la négation, nous invite à penser que le prototype de l’analysant serait l’enfant qui demande « d’où viennent les enfants ». Mais il n’a pas théorisé le questionnement comme acte d’énonciation. II. Le questionnement
Le questionnement ne se confond pas avec l’interrogation. Damourette et Pichon en décrivent la dynamique psycho-linguistique ainsi: par le questionnement, le je se retire de l’allocution et le vous est placé au premier plan de
ce transfert de parole que je décide d’appeler précisément une allocution et qui constitue le degré zéro du transfert. Par le questionnement,
j’admets implicitement que vous avez des émotions et des tendances actives. Je
ne vous accorde pas le même savoir que je m’attribue comme locuteur. Mais je répartis
nos psychés : je suppose une part de moi en vous, et j’attends d’elle la
réponse à l’interrogation que l’autre part formule. Vous ne me répondez pas
nécessairement comme je m’y attends, vous me décevez, me surprenez (parfois),
me devinez (rarement), ou encore me comblez (attendons de voir).
[2]
La capacité du questionnement n’advient qu’à
partir d’une certaine maturation de l’infans dans la triangulation oedipienne, après l’affirmation et la négation. Pensons à cette étape de l’apprentissage du langage où
l’enfant éclate en questions : le désir est devenu moins recherche d’une
réponse (car d’autres questions suivent immanquablement chaque réponse) que quête
de sens, car l’étonnement insatiable ne vise pas tant le « vrai » que le
fait de sonder le dire lui-même : « Comment se fait-il que ça signifie ?
Comment fais-tu pour faire du sens, pour dire ce que ça veut dire ? » - semble
dire l’avidité de l’enfant questionnant. Le questionnement porte moins sur l’objet
ou le référent de la parole que sur le processus ou l’émergence du sens : moins
sur le sens que sur la signifiance.
Questionner le sens acquis, consensuel, celui du
refoulement dont Freud a esquissé la genèse entre « affirmation » et « négation
», dans le « travail du négatif » : c’est bien ce que fait l’inventeur de la
psychanalyse lorsqu’il interprète et nous transmet le concept
d’inconscient. C’est bien cette curiosité psychique qui conduit
l’analysant à l’analyste, et que l’analyste accueille mais aussi devrait
optimaliser er perlaborer par son être et son dire.
Il nous reste à éclairer le site de l’interprétation comme expérience du
questionnement, à la lumière de divers concepts que Freud nous a légués et qui
balisent la genèse ou le géno-texte de la capacité symbolique des êtres parlants. J’aimerais rappeler quelques
uns de ces repères théoriques :
-L’investissement de l’investissement, tel
qu’il apparaît dans l’identification primaire avec le père de la
préhistoire individuelle, possédant les qualités de deux parents….
-La castration, et en particulier sa
perlaboration dans la castration symbolique ( j’y reviendrai) ;
-La capacité
imaginaire, telle qu’elle se présente déjà dans le récit du fantasme : cette fiction qu’est
l’association libre, installant l’analyse dans la réalité psychique, et que
notre interprétation est appelée à la fois à authentifier et à déplacer vers la
reconstruction des vérités refoulées (au pluriel).
J’entends votre question : en mettant en avant la
question de la question, ne suis-je pas en train de dire simplement que
l’analyste est celui qui, capable de régresser, parvient à nommer sa régression
? Bien sûr. A ceci près que le plus difficile, dans ce site interprétatif du
questionnement, n’est pas de régresser avec le patient, mais de nommer
l’identification/dés-identification questionnante.
Aussi voudrais-je lier l’aptitude au questionnement
spécifique dont il s’agit, à la castration symbolique. Qu’est-ce que la
castration symbolique ?
S’il est
vrai qu’en parlant ego renonce à jouir de la mère et s’identifie à la
position tierce, celle symbolique du père, cette mutation équivaut à une
castration : je renonce à l’affect, et mon langage ne pourra jamais combler le
manque de la plénitude sensorielle ou affective à laquelle je renonce. Pour le
dire autrement : l’accès au symbolique( et/ou au
langage) s’étaie sur et de la castration. Pourtant, il ne suffit pas que je
me soumette au NON de l’injonction paternelle, à la valeur symboliquement
castratrice de ses interdits ou de sa loi. Il faudrait que le Père de la Loi se
reconnaisse lui aussi marqué par la castration : mortel (Lacan), mais non moins
aimant (avait dit Freud, en évoquant dans Le Moi et le ça
[3]
un « père de la préhistoire individuelle »). C’est bien cette paternité
symbolique- et- aimante, d’une bisexualité psychique prononcée (ayant « les
qualités des deux parents »), qui me reconnaît et que je reconnais en me
portant vers elle lorsque j’éclate en questions. Ni « objet du désir », ni
seulement instance de la loi et son cortège de « travail du négatif », mais
tout autant pôle d’investissement psychique et/ou comme pôle
d’investissement de la tiercité : ce père de la
préhistoire est un « accoucheur » de ma capacité de faire sens.
Peut-être se sert-il de l’ironie pour atteindre le
vrai à la façon de Socrate ? Freud n’ignore pas cette voie, mais il
l’accompagne d’une autre, lorsqu’il
reconnaît l’« attente croyante »
[4]
de l’enfant : à moins que le père (et l’analyse) ne l’ait initiée. Et il s’autorise à parler le langage du
rêveur quand ce n’est pas celui du bébé, lorsqu’il interprète cette attente
même.
L’interprétation est cette manière d’habiter l’énonciation qui, au
sein du transfert/contre-transfert, ouvre
le refoulement dans la trame même des signes, de la grammaire et du
raisonnement. Puisque l’économie
subjective de l’interprétation est celle du questionnement du refoulement
lui-même, l’interprétation oriente le langage vers l’extra-linguistique : sensation, affect, pulsion. De ce
fait, la formulation analytique n’est pas une explication. Héritière de la Verneinung qui produit les signes, elle se retranche
de ce retranchement qu’est la négativité freudienne
[5]
; et, telle une double négation, l’interprétation transforme le « travail du
négatif » qu’est le symbolique en un questionnement indéfini. C’est dire
qu’en nommant l’informulable, je ne le définis pas : je le problématise. Je fais
une question de l’affect, j’élève la sensation à l’entendement d’un signe, en
même temps que j’introduis le traumatisme secret dans l’allocution. En faisant
question pour l’analyste, l’informulable (sensation ou affect) obtient une
chance de s’articuler, de se déplacer, de s’élaborer : à la manière singulière,
spécifique à chaque analysant, et sans fin.
On comprend que j’entends la castration symbolique
et l’investissement de l’investissement dans l’a-pensée interprétative, moins comme une ascèse (comme il me semble que ce terme l’induit
dans la terminologie de Lacan), que comme l’ouverture - au travers de l’ascèse
et avec elle - à une poïesis sans fin.
Prenons à présent quelques exemples : Paul aux
frontières de l’autisme ; Anne dans la dépression innommable ; Martine et la
non-congruence hystérique entre langage et affect, qui me permettront de faire
apparaître quelques variantes de ces questionnements par lesquels
l’interprétation psychanalytique se confronte directement à la profondeur des
mots, à ce que je voudrais appeler leur chair.
III.
Paul et l’opéra
A l’âge de trois ans, le petit Paul ne parvenait à
proférer aucune parole si ce n’est des écholalies vocaliques où l’on discernait
mal des pseudo-consonnes non identifiables. Refus oedipien d’échanger entre papa et maman, mais aussi perception douloureuse d’une
certaine incapacité motrice qui le déprimait, l’inhibait. J’ai décidé de
communiquer avec lui en utilisant le moyen qui était à sa disposition : le chant.
Les opéras que nous improvisions, et qui devaient paraître ridicules aux
éventuels auditeurs, comportaient la signification que je voulais ou que nous
voulions échanger. Mais d’abord ils comportaient le sens des
représentants d’affects et de pulsions codés dans les mélodies, les rythmes et
les intensités qui étaient davantage accessibles à Paul, sinon les seuls à
l’être. « Viens me voir » (do-ré-mi) ; « Comment allez-vous » (do-si-la), etc.
Peu à peu, par ce jeu vocal mais en réalité
pluridimensionnel, l’enfant sortit de son inhibition et se mit à étendre le
champ de ses vocalises. Parallèlement, il commença à écouter beaucoup de
disques et à reproduire les mélodies. Une fois assuré de savoir prononcer en chantant – donc avec son souffle, ses sphincters,
sa motricité, son corps –, Paul accepta d’utiliser désormais les phonèmes acquis par l’opéra dans la parole
courante. Et ceci avec une précision articulatoire que peu d’enfants possèdent.
Le chanteur était devenu « parleur ».
« Je viens, papa »
Les difficultés qui sont apparues aux stades
suivants ont pu être levées une fois de plus par l’imaginaire. Par exemple,
l’indistinction des pronoms personnels de 1 re et de 2 e personne, je/tu, moi/toi qui
trahissait la dépendance de Paul vis-à-vis de sa mère. Cette distinction entre
le je/tu put s’opérer grâce à
l’identification de Paul au personnage de Pinocchio. En particulier dans
l’épisode où le petit garçon sauve son père Gepetto des mâchoires de la baleine Monstro. « Au secours,
Pinocchio », implore le vieux père. « Je viens, papa, attends-moi, n’aie pas
peur, je viens avec toi », répondait Paul. Cette histoire permettait à l’enfant
d’échapper au pouvoir de la dévorante baleine, de ne plus être la victime. De
plus, Paul prenait sa revanche sur le père en accédant au rôle de héros. A cette
condition seulement, il pouvait se désigner par un « je » et non par un « tu »
sorti de la bouche de sa mère. Le « tu » obtenait ainsi une place qui ne se confondait plus avec
le mauvais « je » (celui de la « mauvaise mère » de l’identification
projective kleinienne). Le « tu » s’appuyait désormais sur la place de d’un Tiers (Gepetto) qui pouvait subir des épreuves (comme un alter-ego de Paul) sans être non plus un enfant impotent.
L’imaginaire (ici le conte) est auxiliaire de l’interprétation, au sens où il permet de questionner l’acte de penser. Pourquoi ? Parce que le temps de l’imaginaire n’est pas celui de l’interlocution. Il est le temps d’une histoire, de la petite histoire, du « muthos » au sens d’Aristote : ce temps du fantasme où se noue un conflit et se dénoue une solution. Fantasme, conflit et solution partageables. Le muthos est ce chemin d’épreuves partageables dans la présence du cadre transfert/contretransfert, et grâce auquel se questionne et se tient le sujet de la parole : avec Paul, nous l’avons reconstruit par le truchement de l’opéra et du conte. Anne ou le langage secret de la
mélancolie
La dépression se complait dans le narcissisme
primaire, où se constitue l'image du moi et où, précisément, l'image du futur
dépressif n'arrive pas à se consolider dans la représentation verbale La
raison en est que le deuil de l'objet n'est pas fait dans cette représentation.
Au contraire, l'objet ( qui n’est pas vraiment un « objet » séparé du
« sujet » mais une Chose), est comme enterré — et dominé — par des affects jalousement gardés
et, éventuellement, dans des vocalises : la Chose du dépressif résiste à la castration symbolique. L'interprétation
analytique se doit alors d’ouvrir un questionnement de la parole elle-même,
jusqu'au niveau vocal du discours (le « sémiotique ») – sans être
intrusive et en ménageant l’identification primaire (la reconnaissance
aimante par le « père de la préhistoire » possédant les qualités des deux
parents).
Un exemple extrait du discours d’une patiente
dépressive, Anne, montrera combien une destruction apparente de la chaîne
signifiante (que l’analyste va opérer) peut soustraire celle-ci au déni dans
lequel elle se trouve bloquée- à force de haine innommable avec une mère
archaïque, et ce baby-talk confère au discours dépressif, désaffecté, les
inscriptions affectives que la dépressive meurt de tenir secrètes.
De retour de vacances, Anne me raconte un rêve : il
y a un procès, comme le procès de Barbie : elle mène l'accusation, tout le
monde est convaincu, Barbie est condamné. Elle se sent soulagée, comme si on
l'avait libérée elle-même d'une torture possible de la part d'un tortionnaire.
Mais elle n'est pas là, elle est ailleurs, tout cela lui semble creux, elle
préfère dormir, sombrer, mourir, ne jamais se réveiller, dans un rêve de
douleur qui cependant l'attire irrésistiblement, « sans aucune image »... Je
perçois l'excitation maniaque autour de la torture qui saisit Anne dans
ses relations plus que conflictuelles, « tuantes »- dit-elle, avec sa mère et,
parfois, avec ses partenaires, dans les intervalles de ses « déprimes ». Mais
j'entends aussi : « Je suis ailleurs, rêve de douleur-douceur sans image », et
je pense à sa plainte dépressive d'être malade, d'être stérile. Je dis :
« A la surface : des tortionnaires. Mais plus loin, ou ailleurs, là où est
votre peine, il y a peut-être : torse-io-naître/pas
naître. » Je décompose le mot « tortionnaire » : je le torture en somme, je
lui inflige cette violence que j'entends enterrée dans la parole souvent
dévitalisée, neutre, d'Anne elle-même. Cependant, cette torture que je fais
apparaître au grand jour des mots provient de ma complicité avec sa douleur. Le
torse, le sien sans doute, mais lové à celui de sa mère dans la passion du
fantasme inconscient; deux torses qui ne se sont pas touchés quand Anne était
bébé (la patiente a été longuement plâtrée, suite à une luxation de la hanche)
et qui s'éclatent maintenant, dans la rage des paroles au moment des disputes
des deux femmes. Elle — io —
veut naître par l'analyse, se faire un autre corps. Cependant, sans contact et
sans représentation verbale, « plâtrée » au torse de sa mère, elle ne parvient
pas à nommer ce désir, elle dispose du sens affectif mais pas de la signification
de ce désir. Or, ne pas avoir la signification du désir, c'est ne pas avoir
le désir lui-même. C'est être prisonnier de l'affect, de la Chose archaïque,
des inscriptions primaires des émotions. C'est là précisément que règne
l'ambivalence, et que la haine pour la Chose-mère se transforme
immédiatement en dévalorisation de soi... Anne enchaîne en confirmant mon
interprétation : elle abandonne la problématique maniaque de la torture et
de la persécution pour me parler de sa source dépressive. En ce moment, elle
est envahie par la peur d'être stérile et par l'envie sous-jacente de donner
naissance à une fille: « J'ai rêvé que de mon corps sortait une petite
fille, le portrait craché de ma mère, alors que je vous ai souvent dit que
lorsque je ferme les yeux je n'arrive pas à me représenter son visage, comme si
elle était morte avant que je naisse et qu'elle m'entraînait dans cette mort.
Voilà maintenant que j'accouche et c'est elle qui revit... »
Martine : le passage à l’acte intellectuel
Quand Martine vient me voir, elle approche la
quarantaine et enseigne le français à des étrangers. Célibataire, Martine a
vécu avec une collègue, Edith, qui est morte dans un accident de voiture à l’étranger
où elle avait été amenée par Martine. Ce souvenir pénible et culpabilisé est
évoqué avec beaucoup de réticences par la patiente qui l’écarte avec des larmes
et des gestes de colère.
Deux faits traumatiques liés à l’enfance
apparaissent dès le début de l’analyse. La patiente y insiste dans un discours pauvre et répétitif, mais très investi de colère. Le père de la patiente
meurt pendant la grossesse de la mère. Cette tragédie est suivie du deuil
inconsolable de la mère, qui désirait remplacer son mari par un garçon :
Martine devait se prénommer Martin, et d’ailleurs sa mère continue de se
tromper en l’appelant souvent Martin.
A cette violence qui efface l’identité sexuelle de
Martine pour lui greffer celle d’un homme, s’ajoutait une intrusion sadique,
cette fois sensorielle et érotique. Suite aux problèmes intestinaux de sa
fille, la mère se livrait à de longs lavements, des clystères, sur l’anus de
Martine. Cette occupation semble avoir rempli et bloqué la mémoire de la
patiente, devenant le souvenir essentiel qui avait chassé toute autre
image de l’enfance pendant un bon moment de l’analyse.
Au cours de l’analyse, ces symptômes se sont
manifestés et aggravés, surtout pendant les périodes de ce que je ne peux
appeler autrement que des « passages à l’acte intellectuels » : ruée
vers les cours, participation à des séminaires analytiques pour présenter une
théorie qu’elle savait opposée à celle du directeur du séminaire, et engouement
pour l’écriture théorique.
Ces passages à l’acte intellectuels qui m’étaient
évidemment destinés, visaient à maintenir le discours de Martine au niveau de
la mentalisation et de la rationalisation consciente : à empêcher en somme
l’association libre.
L’idéalisation à laquelle j’étais vouée renforçait l’inhibition pulsionnelle et affective mais aussi intellectuelle. Martine
se contentait de compilation et d’agressivité dans ses digressions sur le
divan, mais aussi dans ses publications qu’elle m’apportait et que je ne
commentais pas. L’idéalisation empêchait en outre la traduction des
traumatismes en mémoire sensorielle et émotionnelle.
Le tournant de cette analyse est survenu lorsque la séparation pensée/affect a évolué vers un clivage. Martine me fait ce récit :
elle attend une amie devant un restaurant, l’amie tarde. Martine sort, voit un
taxi et décide de le prendre pour s’en aller. Une personne descend du taxi,
paie, Martine s’impatiente, bouscule presque la personne qu’elle fixe avec
colère et, après quelques instants « blancs » d’aveuglement, s’aperçoit (ou
plutôt la personne s’écrie et la secoue pour la sortir de sa torpeur) que la
femme descendant du taxi n’était autre que son amie. Hallucination négative,
suspension de perception-sensation par freinage de l’agressivité et de
l’ambivalence passionnelle pour cette amie. Sans transition, elle enchaîne
brusquement en me décrivant les idées qu’elle développera dans les articles
qu’elle est en train d’écrire, et j’y reconnais sans peine mes articles. Je lui
dis : « Par la pensée, vous souhaitez vous rapprocher de moi. L’envie d’être
à ma place, vous épargne de penser que vous voulez me toucher, toucher mon
corps ? » Elle se met en colère, crie, grimace, et de nouveau « théorise »
comme à son habitude : « Vous me reprochez toujours mon registre homosexuel. Je
ne comprends pas ce que vous voulez dire. »
Seulement deux séances plus tard, elle me dit
qu’elle n’avait pas réalisé — en écrivant et en m’en parlant —
qu’elle avait plagié mes textes... Que l’amie qu’elle attendait et n’a
pas vue tout en la touchant s’appelait Christine, « comme vous », me
dit-elle, « d’ailleurs, ma chef que je ne peux pas blairer est aussi une
Christine. »
Je me mis alors à insister sur le toucher, le goût,
la vue, l’odorat, l’ouïe. J’ai renoncé aux enchaînements et aux liaisons
logiques inconscientes. Mes interprétations ne devenaient des
questionnements déclenchant l’association libre que quand je relevais, dans les
propos théoriques – ou explosifs- de Martine, les indices sensoriels. Et je ponctuais son discours intellectuel défensif – ou débordé par
l’émotion- en repérant ces lieux d’inhibition de la sensorialité en même
temps que du discours (elle n’en parlait pas, elle ne sentait pas, elle
s’agitait ou souffrait).
Le fait de nommer les sensations et le désir de mort
a ouvert le temps du souvenir. Elle m’a confié des détails de sa
relation amoureuse avec Edith, morte dans un accident de voiture, Martine étant
la conductrice. De nommer le ressenti et l’affect en ma compagnie, et en
reliant la douleur et la honte dans le transfert à ma personne, a déverrouillé
sa mémoire. Une mémoire où ont pris place Edith, la chef de service, moi-même,
et, en arrière-plan, le souvenir désormais sensoriel et déculpabilisé des
relations entre Martine et sa mère. Les lavements, les haines, les amours, les
rages sadiques de Martine contre sa mère.
La capture du souvenir traumatique ne peut se faire
sans que nous ouvrions la généalogie des signes cognitifs, sans faire
basculer le cogito vers la sensation.
L’interprétation requiert l’aptitude de l’analyste à
la castration symbolique : en
renonçant à l’interprétation explicative- à cette rationalisation qui nous
guette lorsque nous cédons à la toute puissance de la construction verbale, il
s’agit de ponctuer le bavardage défensif avec du silence, mais aussi à
infléchir les mots du signifiant vers la pulsion. Par notre souplesse à refaire le trajet
hétérogène de la psychisation :
affect-langage-demande-négation-question, ceci dans les deux sens : aller et
retour, depuis les traumas indicibles jusqu’à leur connaissance, et vice
versa,- l’interprétation offre
tout un étayage à l’investissement
primaire sur lequel s’étaie la curiosité psychique. Par l’anamorphose
des affects en questions et des questions en affects, indéfiniment,
l’interprétation apparait comme une expérience parallèle à l’analyse
personnelle, à l’auto-analyse : elle ne se confond pas avec l’analyse sans fin
de l’analyste, mais la transpose dans l’acte même de penser, dans une a-pensée
spécifiquement analytique.
Il est impossible de tenir ce rôle dans le monde,
sauf à être un stoïque ou un humoriste. Mais c’est bien cet impossible que
Freud a abrité dans l’intimité de l’expérience analytique qui nous restitue
“l’intense profondeur des mots” (Baltazar Gracian) ou
ce que j’appelle “la chair des mots”. Il nous revient à l’approfondir plus que
jamais aujourd’hui, à contre-courant de la transparence hyperconnectée qui nous entoure.
Julia
Kristeva
Colloque "Interprétation"
de la SPP, le 19.11.2011 Palais Brognart,
Paris
[1]
J’emploie « révolution » au sens étymologique de la racine
sanscrite « vel »- retour en arrière et découvrement, retournement, perpétuel remaniement des
catégories binaires de la métaphysique qui sépare le « corps » de l’ « âme »,
l’ « esprit » de la « chair », etc.
[2]
Des mots à la pensée, t. IV, p. 1383.
[3] Le Moi et le ça (1923), in Essais de psychanalyse, trad.fr. 1981.
[4]
« gläubige Erwartung », cf. S. Freud, « Traitement psychique » (1890)
in Résultats, idées, problèmes, t. I, PUF, 1984, p. 8.
[5] Cf. Die Verneinung (1925), trad.fr ; in Le Coq Héron,
|