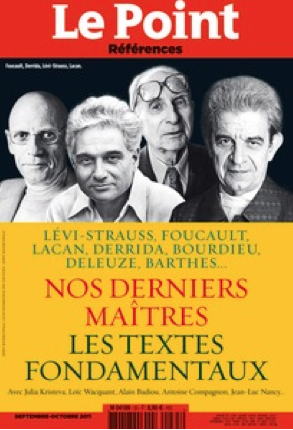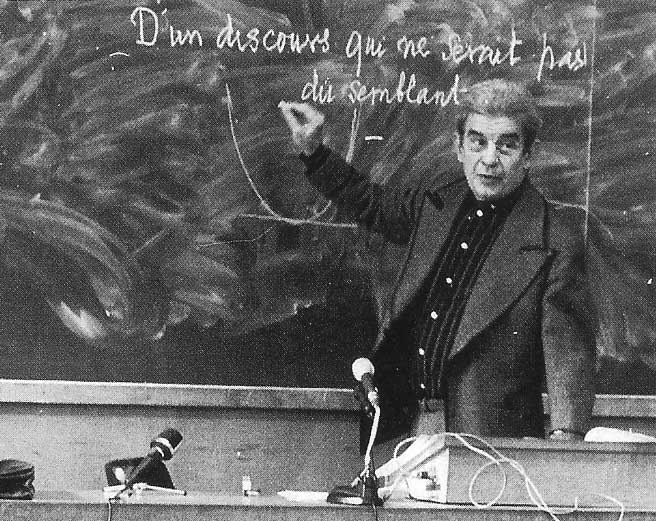|
entretien avec Julia Kristeva
version complète de l'entretien paru dans Le Point Références Vous arrivez en France en 1966. Que
représente alors pour vous Lacan ?
Un
événement qui, comme la psychanalyse, fascine et dérange. Je préparais une thèse sur le Nouveau
Roman et j’ai rencontré Philippe Sollers qui m’a emmenée aux séminaires de
Lacan. Lévi-Strauss avait « structuré »
les mythes et l’échange des femmes dans les sociétés dites primitives.
Benveniste confrontait la linguistique structurale et générative à
l’inconscient freudien et au panthéon indo-européen ; Goldmann remontait de Marx à Hegel ; la
délicatesse de Barthes, attentif à Tel
Quel, énervait beaucoup la Sorbonne; Derrida, lui aussi à l’écoute de ces expériences de langage, réécrivait la phénoménologie de Husserl
et Heidegger en grammatologie. Mais l’événement c’était Lacan. Il ne professait pas les classiques, ne
récitait pas du préfabriqué, mais prêtait sa présence et sa parole aux rêves et
aux angoisses de son auditoire,
pour les transformer en pensée. Et cette pensée se construisait à haute voix
devant nous, dans la chair d’une langue française aussi exigeante
qu’onirique. J’avoue qu’au début le rituel théâtral, mi-surréaliste
mi-catholique, de ce grand bourgeois me soulait. Mais puisque j’ai un seul
vice, la curiosité, j’ai essayé de comprendre. Je me suis donc accrochée, et toujours
avec les lumières de Sollers j’ai
suivi son séminaire à l’Ecole normale, puis à la Fac de Droit.
Vous vous êtes alors lancée dans la
psychanalyse ?
Pas
toute de suite. J’ai d’abord commencé par lire Freud puisque son enseignement
s’intitulait « Retour à Freud ». Mon éducation en Bulgarie m’avait
orientée vers la philosophie allemande, mais ma connaissance du freudisme se
limitait à la traduction bulgare de L’interprétation
des rêves que mon père avait pris soin de me faire lire, non sans l’avoir
caché dans « l’enfer » de la bibliothèque familiale, car la
psychanalyse était à l’Est considérée comme une science bourgeoise…
Lacan est devenu l’ami du couple que
vous formez avec Philippe Sollers. Comment se comportait-il avec la jeune
intellectuelle que vous étiez.
« Ami » c’est trop dire et
quant au « couple», la
psychanalyse en fait une perpétuelle refondation. Chacun de nous entretenait
avec Lacan des amitiés fondées sur
une réelle séduction intellectuelle. La mienne a commencé à l’occasion d’une
interview que je devais faire pour une revue de sémiologie : puisque sa
théorie de l’inconscient « structuré comme un langage » semblait s’opposer à l’inconscient
freudien compris comme un réservoir de pulsions, il fallait bien que la
recherche sémiologique après Pierce et Saussure s’empare de ce renouveau !
Nous avons dîné ensemble à la Calèche, son restaurant habituel, et s’est
immédiatement installée entre nous une très forte proximité fondée sur un
respect réciproque. A la sortie du restaurant Lacan m’a demandé quel était le
prénom de mon père. Je lui ai dit
qu’il s’appelait Stoyan (variante bulgare de
Stéphane), un « signifiant » dont mon père s’amusait à faire remonter
l’étymologie à la racine latine « sto-stare » : « il
tient ». Lacan s’est arrêté, contempla quelques longues minutes la lune,
et finit par me dire: «Je vois que cela tient ». Je me souviendrai
toujours de son regard, curieux, enveloppant et très respectueux. Finalement,
je n’ai jamais fait l’interview, mais les échanges se sont poursuivis.
Pourtant, vous n’avez pas voulu qu’il soit votre analyste? Nous nous connaissions trop pour qu’il devienne mon analyste. Au retour de notre voyage en Chine auquel il a renoncé au dernier moment pour des raisons personnelles, je suis allée le voir quand même, lui demandant de me conseiller quelqu’un de son école. Et le nom qu’il m’a suggéré était justement celui de l’ami intime… de son amie intime de l’époque. Pourquoi ? Je
me le suis demandé. Peut-être parce qu’il avait besoin de me faire entrer dans
son clan, son cercle érotique, comme si l’adhésion à sa pensée passait par une
sorte d’inceste. Peut-être considérait-il que cela n’avait aucune importance,
au fond, qu’une analyse devait dépassionner tout ça pour atteindre le vrai…
Qu’est-ce qu’un psychanalyste ? Quelqu’un qui est en contact avec son
inconscient et entretient en permanence un certain rapport avec la culture.
Mais un grand psychanalyste ? Il est libre avec son
inconscient, et s’approprie si bien la culture ancienne et moderne que sa
clinique et sa théorie sont capables de penser le présent…Toujours est-il
que j’ai refusé de participer à ce jeu que Lacan me proposait, et j’ai
intégré une autre formation, la Société psychanalytique de Paris.
Et il ne vous en a pas voulu ?
Comment serait-ce possible ? Vous savez, quand on passe comme moi du
totalitarisme à Saint Germain des Prés, on est constamment dans une logique de
mort et de résurrection : tu marches ou tu crèves. Pour marcher, j’avais
trouvé ma solution : essayer de transformer la curiosité en créativité.
D’interroger les situations et les idées qui me paraissaient intéressantes et
d’en donner ma version. J’étais d’autant plus libre que je
n’appartenais à aucune communauté, qu’elle soit celle des normaliens,
des agrégés ou des militants en tout genre. Il me semble que Lacan respectait
cet état de liberté. Et qu’il m’a même, d’une certaine manière, encouragée à
persévérer dans mon indépendance.
Lors
de la publication de mon livre Polylogue, en 1977, il a été intrigué par mon choix de la couverture : un essaim
d’anges volants de Giotto. Je lui ai dit qu’il représentait la logique
plurielle de l’imaginaire: le soi-disant « individu » éclate dans
les variantes de ses sublimations,
pas vraiment des expériences asexuées, mais des sexualités singulières et singulièrement
traversées.
« Je
vois, m’a-t-il dit en souriant, le contraire des membres d’une école, ils ne
sont pas vraiment singuliers, hélas… Mais vous, vous n’avez pas besoin de tout
ça ». Il a dissous son Ecole vers cette période. Il avait peur qu’on
transforme sa pensée en pansement.
Mais vous-a-t-il influencée dans votre
pratique analytique ?
Je pratique des séances longues, dans
les meilleurs des cas trois fois par semaine, avec des interprétations de type
freudien. N’est-ce pas l’attention
freudienne au langage, telle que le fondateur de la psychanalyse l’impose dès
ses premières analyses des rêves,
que Lacan reprend et amplifie dans le contexte de la linguistique
structurale ? Cette puissance
du langage à verrouiller - mais
aussi à déverrouiller- l’inhibition, le symptôme et l’angoisse, Lacan l’a mise en valeur en prétendant qu’il s’agit d’un simple « retour à
Freud ». Modestie rhétorique ou déviation qui se protège ? J’y vois surtout une extrême attention
portée à la langue maternelle, le français en l’occurrence, que Lacan installe
au cœur de l’écoute psychanalytique. La langue maternelle, insiste-t-il en
substance, est la voie royale pour entendre le singulier de chaque analysant.
Et pour faire de chaque cure une expérience « poïétique », au sens
incommensurable de ce mot, qui révèle l’incommensurable de chaque être parlant.
C’est ici que réside, me semble-t-il, le secret de cette étrange séduction
qu’exerce la théorie lacanienne, totalement impénétrable pour ses divers détracteurs. A contre-courant des tendances
de la psychanalyse globalisée qui réduit l’inconscient à des schémas abstraits
voire « cognitifs », Lacan passe pour « frenchy »,
baroque ou littéraire…
Dans l’Etourdi, Lacan affirme que le
psychanalyste est un linguiste…
Oui, mais il adore aussi les
« mathèmes » qui tracent des dispositifs intra- et inter-psychique
transversaux au langage. Et n’hésite pas à modifier ses positions d’inspiration
structuraliste pour recommander, à la place de la « linguisterie »,
ce qu’il appellera « lalangue » : la « lalation »
des bébés, le pré-langage infantile, les écholalies, mais aussi « la
musique dans les lettres » à la façon de Mallarmé. Les limites de ces
approches apparaissent lorsque
l’interprétation psychanalytique s’enferme dans les jeux de mots, pures déconstructions formalistes de sons, voyelles et syllabes, ignorants les affects
et les pulsions. Au contraire, l’originalité spécifique de la psychanalyse réside
précisément dans la conception « hétérogène » de l’activité
signifiante chez l’être humain : à la fois énergie et sens, pulsion et signifiant.
Vous avez donc été finalement plus loin
dans l’analyse du langage que Lacan ?
La recherche en psychanalyse existe, n’en
déplaise à ses détracteurs, y compris sur la coprésence entre la sexualité et
la pensée dans le langage. Après Melanie Klein, Winnicot et Bion
en Angleterre. En France, les travaux de Piera Aulagnier, et surtout ceux d’André Green sur l’hétérogénéité
du signifiant, ont orienté aussi mes propres travaux de sémioticienne et de
psychanalyste attentive à Lacan. Je suis tout particulièrement intéressée par
cette dimension du sens que j’appelle « sémiotique » et qui est de
l’ordre du pré-langage, des mélodies et des intonations, dans lequel
s’impriment les affects et des sensations propres aux relations pulsionnelles précoces mère/enfant. L’analyste l’entend aussi bien dans la parole des déprimés,
que chez des personnes qui, dans la société de l’image, réduisent leur
expression verbale à des « éléments de langage », tandis que la
vérité de leurs inconscients se dérobe, comme encryptée, dans ce registre plus archaïque.
Que reste-t-il de Lacan d’un point de
vue théorique aujourd’hui ?
Trois
ouvertures dont nous n’avons pas encore pris la mesure.
Il a rouvert les passerelles entre
la psychanalyse et le vaste continent de la pensée : la philosophie, mais
aussi la théologie, évidemment les
sciences humaines, les autres sciences aussi. Sans cette respiration dont la
psychanalyse s’origine,- n’oublions pas qu’avec Freud elle est un enfant des
Lumières et de leur encyclopédisme,- la psychanalyse est condamnée à se réduire
à une gouvernance psychologisante.
En invitant les analystes à entendre l’inscription
des traumas, joies et douleurs dans les plis du parler infantile, il redonne une
vigueur inattendue à la diversité
culturelle qui en a vraiment besoin aujourd’hui: la vérité de nos corps
banalisés et globalisés passe par la langue native, c’est là que s’inscrit
l’empreinte singulière de chaque sujet parlant. Et c’est donc par le multilinguisme qu’il pourra développer des créativités
inattendues.
Sans avoir systématisé sa pensée sur le
féminin ni sur les religions, les apports de Lacan sur la « jouissance
féminine » ou la « jouissance autre », s’ajoutant à son
insistance sur la « fonction paternelle » et le « Nom du Père »,
constituent des fondements précieux
pour penser l’histoire des religions, mais aussi la religiosité (en deçà et au-delà des
religions, pas seulement monothéistes), et jusqu’au « besoin de
croire » comme composante universelle des êtres parlant. Je dialogue avec
ses positions dans mon livre Thérèse mon
amour consacré à Thérèse d’Avila, cette carmélite espagnole que j’ai
découverte dans le séminaire de Lacan intitulé Encore.
Ses avancées redonnent à la psychanalyse sa portée historique et politique qui me parait être un enjeu essentiel de la découverte freudienne, mais que la psychanalyse actuelle tend à ignorer ou à occulter quand elle devient trop ésotérique ou simplement vulgarisée.
Le philosophe Slavoj Zizek a présenté Lacan à travers le prisme du cinéma hollywoodien : aurait-il apprécié ? Comme tous les « ismes »,
le lacanisme se laisse étrangler
par ses écoles et disciples. Mais en semant à tous vents comme il l’a fait,
l’événement Lacan invite aussi à être lu dans le texte, et il est important que
la recherche en psychanalyse, ainsi que les analysants d’où qu’ils viennent, développent la polyphonie de son
enseignement. Avec le risque que cela s’empile au Big mall de la marchandise psycho-spiritualiste, où tout se
vaut et rien ne vaut rien. Pourtant la rigueur existe : elle consiste à
s’en tenir aux fondamentaux de la théorie freudienne, selon laquelle la
sexualité – qu’elle soit une tragédie ou une divine comédie- est accessible au langage, à condition
de respecter le jeu du transfert et du contre-transfert. Un seul critère :
la clinique. C’est elle qui nous protège des divagations somnambuliques des
nouveaux gourous.
JULIA KRISTEVA Le Point Références |