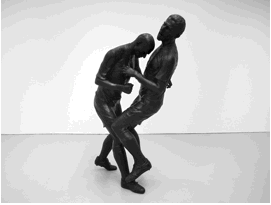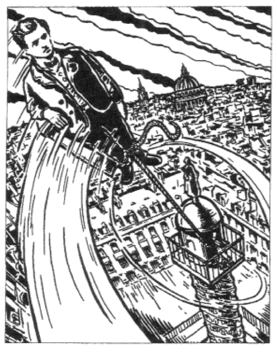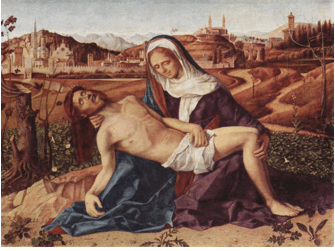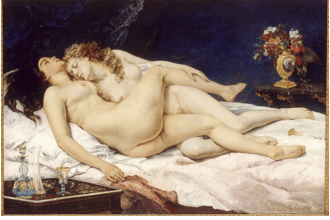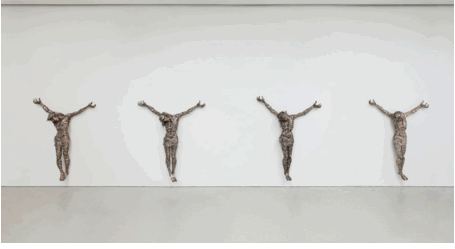|
|
Le corps d’Adel
(Conversation)
1.
Regarder
En
sortant de leur espace traditionnel les empreintes et réceptacles du sacré pour
en faire des œuvres d’art, la Renaissance, la Réforme, l’humanisme des Lumières
et la sécularisation en cours ont rendu l’image à l’espace social. Les corps
des hommes et des femmes, devenus visibles, ont accompagné et accéléré la
libération des mœurs et des esprits. Chairs et âmes se donnent à voir, la
représentation psychique - intime et secrète - se reconnait dans l’image, et
cette extériorisation accélérée de l’expérience intérieure affine les passions,
enflamme la pensée, du récit aux poèmes. L’image et l’érotisme s’attirent ou se
fuient : les « œuvres d’art » sont la « voie royale » :
elles ouvrent celle des sciences de l’esprit. « Votre œil me fait une
beauté dans l’âme », écrit Ronsard qui fait du regard le pivot de
l’esprit. La beauté serait l’âme devenue pleinement visible, comme une fleur
dans la lumière de l’été. L’artiste se projette dans l’image portrait ou paysage
- impressionnistes, surréalistes, cubistes, abstraits, conceptuels, pop et j’en
passe : l’image est une néo-réalité, elle devient la réalité, celle qui
accompagne et supplante l’ «autre », brute et impossible. Avant que
les techniques ne s’en emparent, photographie, cinéma, télévision, société du
spectacle, NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la
communication), monde virtuel et finance ad
hoc… L’image n’a plus de corps mais a-t-elle encore du sens ?
« On est prié de fermer les yeux », avertissait déjà Levinas, en
enseignant que « la meilleure façon de rencontrer l’autre c’est de ne même
pas rencontrer la couleur de ses yeux ».
Pendant
ce temps, ces corps singuliers qu’on appelle des artistes n’ont pas cessé
d’utiliser les images pour représenter les énergies invisibles qui les font
vivre. Extravagants manipulateurs du visible, ils le tordent dans tous les sens
- aussi improbables qu’imprévisibles -, et lui font traduire nos excitations et
angoisses, fureurs du sang et de la chair, vitesses et turbulences de la
pensée. « Œuvres d’art »
insolites, avant-gardes et iconoclastes, dadaïstes, vidéastes, installations en
tous genres : les méga-collectionneurs et les méga-markets en raffolent,
ça n’a pas de sens donc ça coûte cher.
Ne
nous y trompons pas : la marchandisation à outrance de l’imagerie
contemporaine ne l’éloigne pas définitivement du « sacré ». La quête
de l’invisible reste le moteur d’une marchandise désormais sacralisée par les
narcotrafiquants et/ou les pétrodollars. D’ailleurs, ces représentations qui
séduisent ou déconcertent, mettent inévitablement en analyse le spectateur ordinaire, et plus encore les
« spécialistes ». Reconnectés à leur intériorité, les internautes qui
passent l’essentiel de leur temps à naviguer sur la toile, plongent soudain en
eux mêmes et se découvrent une profondeur : de rêveries en hallucinations
personnelles, tous les fans du savoir immémorial – éclats du divin rappelant la
source originelle – viennent à la rescousse pour « donner du sens ».
Ce sens qui manque cruellement au scandale, à la réalité sociale et à
l’imagerie politique ambiante.
Je ne
déteste pas cette cacophonie interprétative. Elle me rappelle les dernières
pages de Hannah Arendt rêvant d’un espace
politique qui serait pareil à un
public sortant d’un concert. Avec pour seul critère celui du goût, le plus ancien de tous les sens, le plus singulier et
incommensurable. Et pourtant, une effervescence
de pensée – à ne pas confondre avec la « communion » unifiante –
réunit ces singularités soudain libérées : elles ont incorporé l’œuvre,
chacune à sa façon.
Je
palpe le corps de l’œuvre par l’œil, comme je peux le palper par l’oreille ou
par la langue. Cette interpénétration charnelle, cette « scène
primitive » n’est certes pas accessible à tous les interprétants, spécialistes
ou profanes. Mais elle est l’horizon auquel ils aspirent, devant lequel l’œuvre
se présente. Car elle est l’envers réciproque, du point de vue de la réception,
de l’acte artistique, du point de vue de la création.
Je
suis appelée à traverser l’image pour me couler dans les énergies qui la
génèrent, pour participer à cette
excitation de vie et de mort qui porte le corps. À réinventer ce corps qui
signe à ma façon. À le rencontrer. Quel corps ?
2.
« Je n’ai
pas de style ». Le mouvement.
Vous
prononcez ces mots lors ma première visite dans votre atelier. Les échos des
médias étaient arrivés jusqu’à moi, je m’attendais au « Cri », au
« Razor wire », au « Coup de boule de Zidane », à
« Taxidermy », à l’« enfant terrible » de l’art
contemporain.
Première
surprise : la diversité des œuvres à travers lesquelles vous me faites
voyager. Des croquis noirs de têtes de femmes. Des sculptures en métal coupant.
Des squelettes blancs ou en verre aquatique. Des tortues-kamikazes portant des
paquets d’explosifs sur leur carapace. Et vous, souriant, rapide, courant,
évoquant Nietzsche, Foucault, Deleuze, Kristeva et j’en passe : ni
« maîtres à penser » ni « citations en bas de page ».
Plutôt des installations, parmi les autres. J’allais apprendre plus tard votre
« credo esthétique » car vous maniez à merveille le vocabulaire
universel de l’art moderne : votre travail n’est qu’une « perpétuelle
remise en forme du sens », « traduisant une certaine cruauté »,
certes, mais « sans idéalisme ni passion », afin d’« établir des
liens conceptuels ».
C’est
votre énergie qui m’a surtout saisie. Je retrouve en vous l’arrachement de l’étranger : « ça me parle », une
héroïne de mes romans a pour devise « Je me voyage ». Je pensais à la mobilité extravagante de Francis
Bacon, qui prétend être « incapable de rester assis », ne rien
comprendre « à cette histoire des gens qui relaxent leurs muscles et
relaxent tout ». « J’essaie de me donner de l’excitation »,
dit-il, et de faire des images qui « piègent la réalité » dans cette
excitation qui « concentre et ramasse » le maximum de réalité, mais
ne l’illustre pas. Au coeur de votre atelier, j’apercevais des pièges vivants (le squelette, le rasoir
coupant, Zidane innocent et déséquilibré…), dans lesquels votre énergie capte
une « scène », une « représentation », une
« image », et ne s’apaise pas mais transite pour en piéger une autre.
Ce que vous appelez un « lien » ou une « perpétuelle mise en
forme » me frappe par l’intensité de
votre implication dans chacune des stations de votre tourbillon :
elles me touchent car elles vous ont touchées. Mobilité donc, le perpetuum mobile de l’étranger, qui
module sa sortie du foyer natal, son EXIT,
en un EXIL structurel, permanent : la
traversée de tout. Rien à voir avec le corps de Francis Bacon. Son excitation
tendue est une souffrance : « J’ai souffert toute ma vie d’une forte
tension artérielle ». Au contraire, diversité et mobilité, votre
imaginaire incorporé est un feu follet : vibration et fragmentation. Il
concentre et conduit des énergies et des récits pluriels sinon contradictoires,
mais pour mieux les dépassionner, et avec eux, désidéaliser, alléger et donner
à penser.
Le corps dans lequel vous piégez la réalité
pour y déposer la vôtre et la réveiller en nous est un corps déséquilibré,
flottant, volant : son mal-être cohabite avec
la grâce. Vous n’êtes pas un tragédien, vous
déséquilibrez le tragique et le faites vaciller dans un sourire désabusé.
Prenons Le Cheval de Turin. Les historiens le
renvoient au cheval férocement battu par un cocher ivre : la scène frappa
Nietzsche si violemment qu’elle déclencha la folie de sa fin de vie, dix ans
durant. Vous invitez vos commentateurs à interroger vos poussées énergétiques
lorsque vous vous revendiquez modestement ce « bâtard universel »
dont l’art puise dans « la source profonde de l’Occident ». Y
ajouterais-je, dans la même veine, la « phobie des chevaux » dont
souffrait le petit Hans, célèbre « cas » qui attire l’attention de
Sigmund Freud ? L’enfant voit (comme Nietzsche) un cheval fouetté par un
cocher, mais dans sa phobie, il associe le cheval au cocher et ce dernier à son
propre père ! En conséquence de quoi, la bête devient un monstre qui
menace de le punir et pour cause : le petit garçon avait observé ses
parents, leur « charivari avec les jambes » et pris l’habitude de se
donner lui-même du plaisir en se masturbant ». Moins noble que le cheval
de Nietzsche, le cheval du petit Hans n’est pas si loin de la fantasmagorie du
petit Adel, ni même de la nôtre.
Et je
n’oublie pas le Cheval de Troie, qui fait partie de votre « source
profonde de l’Occident ». Laissant le cheval dans l’ombre des souvenirs,
vous ne retenez de l’histoire de Laocoon (celui qui ‘comprend le peuple’ - le
père du peuple ? nous y reviendrons) que les serpents qui démembrent les
corps des deux fils avant de s’attaquer au père.
Ce
qui me captive dans le cheval d’Adel,
c’est cette charge de libido aussi excitante que destructrice (condensant
l’orgasme avec la phobie et la mort) qui se métamorphose en bête tenant à peine
sur ses deux pattes de devant, queue en l’air, bride abattue,
prêt à s’envoler. Rien à voir avec la puissante bête de Velasquez qui conclut
l’exposition au Grand Palais, symbolisant le pouvoir du pinceau et sa pulsion
phallique. La croupe de votre cheval s’envole, serait-ce une jument ? Un
poney, un mulet, un animal empêché, frappé d’une anomalie génétique ? Hors
norme, il est aveuglé par quelques barres de dynamite attachées au front, et
prêt à rejoindre le ciel dans lequel flotte « la grande parade » des
animaux (tortues, hérissons, souris, lapins et une multitude de volatiles)
condamnés à exploser eux-aussi (Cf. Pierre noire sur papier, 2011-2012).
Je
saisis l’élan qui anime l’étreinte de Zidane avec Materazzi. Les corps musclés
et métalliques sont fidèles aux vidéos que tout le monde a vues, mon fils
David, admirateur de Zidane, me les a souvent projetées et nous avons dès le
début disculpé notre idole. Vous ne sculptez pas l’innocence des footballers
mais le déséquilibre des corps, emportés par des passions contraires et
mutuelles : c’est lui, qui vous intéresse. Avec eux, vous décollez du sol
– qu’il soit pelouse ou raison. Exposée à Dubaï (Qatar), l’apesanteur de ces
hommes musclés est plus saisissante que celle des images filmiques, ce
« coup de tête » est un envol.
Les
pieds - organes sensibles à tant d’égards, points d’équilibre – sont un élément
récurrent parmi les oeuvres que vous m’envoyez. Foulant le serpent (Zéro tolérance) écrasant un fruit ( ?)
(Pressoir, fais-le) caressant-foulant
des dalles et des pétales ( ?) (Ayaï),
giclant au contact d’une canette de coca-cola (Foot on). Pied plaisir et douleur, pied stabilité et menace. La
vitesse au pas, la vie marchera, ou ne marchera pas. Quelle vie ?
La
vie d’Adel, bien sûr. Et voici que votre corps lui-même assume ce que ses
« pièges d’énergies », ses « scènes », ses
« protagonistes », ses « œuvres », ne peuvent lui
offrir : il s’exile seul dans l’air. J’aime votre vidéo Hélicoptère et les dessins qui
l’accompagnent. Nulle surprise pour moi car j’en suis convaincue : si
« votre » corps n’a pas la capacité de flotter, vos mains le font
voltiger dans vos sculptures, dessins et installations. Ni cascadeur, ni Tom
Cruise dans Mission impossible, Adel
sillonnant le ciel accroché à une corde en rotation n’est pas une
métaphore : l’expérience et l’œuvre qui la fixe réalisent le corps baroque, elles exposent le risque de la
diversité et de la mobilité qui façonnent votre voyage. Il est en effet inutile
de chercher ici un « style » au sens où le veulent l’Histoire de
l’art et les modes d’emploi du marché. Vous réhabilitez le corps baroque, mais
dans une autre acception : telle qu’engendrée par la globalisation.
On
connait les grâces des extases chez Tiepolo. Les artistes voltigeurs s’y exilent vers le Très
Haut. Plus proche des frayages et frayeurs des temps modernes, plus sèche dans
son expression verbale, je préfère l’autoperception de la motilité dans le
corps intérieur chez Antonin Artaud :
« Tout est
dans la motilité
dont comme le
reste l’humanité n’a pris qu’un spectre. […]
Il n’y a pas de
tissu,
la conscience ne
vient pas de la trame,
mais du couloir
des coups de canon pariétaux [...]
et où tout n’a de
valeur
que par le choc
et l’entre-choc
sans qu’un puisse
attribuer à quoi que ce soit une vertu logique ou dialectique caractérisée
car le motif
Repousse la vue
de l’esprit et l’emprise de l’esprit,
D’où il prend
forme, volume, ton, éclat
[1]
… »
« … la
rotation
verticale
d’un corps depuis
toujours constitué,
et qui dans un
état au-delà de la conscience
ne cesse de se
durcir et de s’appesantir
par l’opacité de
son épaisseur et de sa masse.
[2]
»
Ou, plus
spectaculaire, la rotation de Mervyn dans les Chants de Maldoror de Lautréamont. Cet anti-héros s’extrait du
« centre » et défie le ciel dans un ex-centrement tournoyant :
« Ils sont arrivés dans l'enceinte circulaire de la place Vendôme… La
fronde siffle dans l'espace; le corps de Mervyn la suit partout, toujours
éloigné du centre par la force centrifuge, toujours gardant sa position mobile et
équidistante, dans une circonférence aérienne, indépendante de la matière. Le sauvage civilisé lâche peu à peu,
jusqu'à l'autre bout….et son
corps va frapper le dôme du Panthéon. »
Illustration à
Lautréamont, Les chants de Maldoror, Le
vol de Mervyn
Sacré corps
d’Adel : extatique, schizophrénique, sauvage, civilisé. Emporté par la
force excentrique des réfugiés, vous frappez de plein fouet les globalisés
scotchés à leur toile.
3.
Corps sans organe
ou corps sémiotique
La fascination
qu’exerce la schizophrénie sur les philosophes et les psychanalystes a donné
naissance au culte du « corps sans organes ». « Usine »
produisant sans cesse des « agencements », ce corps ne serait pas un
organisme mais un territoire sillonné de flux, vecteurs et intensités qui le
labourent, le font vivre et mourir, « reterritorialisent » ou
« déterritorialisent ». Le tout, sans se plier aux limites du Moi, ni
aux codes, « signifiants » et autres « valeurs ».
Trouvaille sensible sous la plume de Deleuze, le « corps sans
organes » a le mérite de bousculer une psychanalyse souvent trop attachée
à l’idée de l’emprise structurante du langage sur le psychisme : Deleuze a
réhabilité la singularité du schizophrène. Devenu un culte théorique, le corps sans organes prétend faire du
schizophrène un poète et inversement; ou encore, imaginé comme étranger à la
culture, on lui revendique une affinité avec Spinoza (Deus sive nature), pour le poser comme coextensif à la Nature.
J’ai cohabité
avec les « coups de canon pariétaux » d’Artaud, la « musique
dans les lettres » de Mallarmé, les rotations de Lautréamont. J’ai vécu le sens de cette motilité fracassante et
jubilatoire qui, rebelle à la signification du langage, le modifie, le
détruit et le recompose pour le faire revivre et me faire renaître. J’ai nommé sémiotique cette intensité pulsionnelle
et éruptive du corps-parlant,
refoulée par la scène symbolique où,
accrochés à la chaîne signifiante du langage, mon « Moi » et les
vôtres échangent des significations.
À la dichotomie
corps-âme que nous a léguée la métaphysique, la démarche psychanalytique oppose
désormais l’hétérogénéité des
mammifères parlant : notre hétérogénéité.
Ni pure énergie, ni pur sens. Les intensités de pulsion sémiotique sont
chargées d’un sens qui échappe au Moi
et à son langage, mais fait écho à leur logique. Tandis que les stratégies symboliques de la signification qui argumentent et évaluent se laissent infiltrer et
moduler par les flux sémiotiques.
Platon fut le
premier à formuler ce sens énergétique, modalité préalable à la signification,
en le décrivant comme un « espace » avant l’espace : préalable à
l’Un, au Père et à toute « identité » solide ;
fluctuant-frayant-amorphe-embrasé, tout en mutation et en
devenir. Nourricier cependant, maternel et non divin : « Dieu en
est absent », inqualifiable donc, « bâtard » de la raison,
Platon prend toutefois le risque de le nommer « chora » - un
réceptacle :
« Une place
indéfiniment ; il ne peut subir la destruction, mais il fournit un siège à
toutes choses qui ont un devenir, lui-même étant saisissable, en dehors de
toute sensation, au moyen d’une sorte de raisonnement bâtard ; à peine
entre-t-il en créance ; c’est lui précisément aussi qui nous fait rêver
quand nous l’apercevons, et affirmer comme une nécessité que tout ce qui est doit
être quelque part, en un lieu déterminé.. .»
« Et comme
il est juste, il convient de comparer ce qui reçoit à la mère, l’original au
père, la nature intermédiaire entre les deux à l’enfant… » ;
« Or précisément, la nourrice se mouillait, s’embrasait, recevait les formes
de la terre et de l’air, et subissait toutes les affections qui
s’ensuivent. » […] Aucune de ces parties n’était en équilibre, mais,
irrégulièrement de partout balancée, secouée qu’elle était par ces forces, dans
son mouvement à leur tour elle les secouait. Mais, ainsi agitées, les qualités
sans cesse se portaient chacune de leur côté et se séparaient, tout comme les
vans et instruments à nettoyer le blé […] plus ils étaient dissemblables, plus
elle les détachait les unes des autres ; plus ils était semblables, plus
elle les pressait ensemble ; c’est ainsi que les uns et les autres ont
occupé respectivement une place, avant même que l’Univers constitué par leur
arrangement ait pris naissance […] mais ils se trouvaient, certes, tout à fait
en état où l’on peut s’attendre à trouver toute chose, quand Dieu en est
absent. »
[3]
Nous avons tous
un corps – chora sémiotique – que
nous refoulons ou traduisons plus ou moins fidèlement. Le schizophrène, lui, en
est envahi. Je ne symbolise pas les
flux de cette « chora agitée » en mots-signes, séparés de la chose éprouvée. Son corps sémiotique
embrasé d’intensités reste muet, vocifère d’horreur ou jubilation, il délire
(confond les mots avec les choses, perd le sens du réel, déforme le discours),
s’effondre dans le crime. Crise-crime.
En revanche,
certains hyper-sensibles ou ultra-traumatisés, munis d’un héritage biologique
spécifique ou forgé au hasard de la filiation et de l’histoire, surdoués en
intensités ou prédateurs qui s’ignorent, ces êtres – ces artistes – parviennent
à donner une signification et une forme à leur corps sémiotique.
L’innommable poussée énergétique qui vibre dans tous les sens, capture un
élément, un objet, une personne, une situation dans l’environnement qui
l’appelle et sur lequel ses vibrations s’accordent ou débordent. Le vibrant s’y
reconnait : le rapt devient « accouplement chaste et hideux »
avec cet autre qui devient provisoirement une sorte de moi ;
« je » le forme et le déforme : condensation et brasier de
significations. Un « langage » provisoire se cristallise, ni cri ni
crime, éphémère adoption des codes de la communauté environnante.
Cette expérience
n’a rien à voir avec la communication d’informations ou de données. Elle
explore la violente appropriation du mirage d’un
autre désiré, que je deviens, et
dans lequel « je » se consume. Transsubstantiation
et jouissance, avoue Marcel Proust qui s’y connait. « L’imagination,
mon seul organe pour jouir de la beauté ». Cette jouissance dans la
création-décréation infinie de nouveaux corps-langages, est-elle un jeu avec la
folie ?
« Nous
sommes tous obligés pour rendre la réalité supportable d’entretenir en nous
quelques petites folies », écrit Proust dans À l’ombre des jeunes filles en fleurs. À la recherche du temps perdu s’ouvre sur l’image d’un homme qui tente de s’endormir. En avançant dans son
écriture, l’écrivain parvient à mettre en mots un rêve profond et paradoxal,
qu’il appelle le rêve du « second appartement » : monde à part,
descente en soi dans laquelle le moi perd ses limites. Une hallucination sans
objet, sans personne, au cœur de laquelle le dormeur est dans un état de
quasi-mort psychique. Le sommeil proustien évoque ici la caverne sensorielle de
Platon, ce lieu où l’homme, enfermé, est privé de toute présence humaine, d’interaction
avec l’extérieur. Le narrateur utilise souvent les métaphores de l’attelage, du
soleil, de la lumière, qui suggèrent ce non-être, cet irréel. Sans alter ego, sans dialogue, sans
communication, seules quelques ombres apparaissent, qui nous détachent de la
« réalité ». Il n’y a pas de « réalité ». « La
réalité, ce déchet de l’expérience », assène le rêveur.
Les personnes
atteintes d’autisme éprouvent un débordement de sensations qui les annule au
point qu’elles ne peuvent ni se les approprier, ni en parler. Dans leur
catastrophe psychique, il n’y a pas de moi : ni compréhension ni souvenir,
ni espace ni temps. Au contraire, Proust explore ces états limites et leur
offre des mots. En nous faisant partager l’innommé, il parvient à rendre
communicable ce que la psychanalyste anglaise Frances Tustin appelle un
« autisme endogène » qui nous habite tous et nous fragilise, mais que
de rares œuvres d’art parviennent à contacter et traverser.
4.
Métaphores
métamorphosés
Quand vous, Adel,
écrivez qu’une « œuvre qui compte est un cri de solitude », le
« cri » n’est pas ici une comparaison ni même une métaphore pour
évoquer la solitude, l’état de détresse ou une limite intraduisible. Vous
nommez selon moi ce qui, pour Baudelaire, est une véritable métamorphose, et que le célèbre
« assassin » (haschichin) du Paradis artificiel décrit
ainsi : « Votre œil se fixe sur un arbre […], ce qui ne serait dans
le cerveau d’un poète qu’une comparaison fort naturelle deviendra dans le vôtre
une réalité. Vous prêtez d’abord à l’arbre vos passions, votre désir ou votre
mélancolie ; ses gémissements et ses oscillations deviennent les vôtres,
et bientôt vous êtes l’arbre. […] Cause et effet, sujet et objet,
magnétiseur et somnambule. »
Vous êtes le
« cri », ça crie en
vous ; mais de quel cri s’agit-il ? Celui de la victime ou du
bourreau ? Jubilation ou délectation ? Vos œuvres polymorphes nous
invitent à vous entendre crier, et à crier avec.
Dans quel support
significatif faites-vous résonner ce cri, l’incarnez-vous ? En qui vous métamorphosez-vous? Comment
composez-vous les résonances de ce
« cri » paradigmatique, de ces cris que vous fabriquez avec vos
mains, avec votre corps propre, et qui fait vivre votre corps-chora sémiotique,
frayage d’énergies insoutenables ?
Les membres du
Comité Nobel m’avaient invitée avec le poète Joseph Brodsky, pour leur
expliquer comment les ‘modernes’ font et accueillent la poésie. Brodsky leur
parla en métaphores de la métaphore,
outil et cœur de son expérience. L’assemblée fut déçue : les questions ne
recevaient que des métaphores de réponse. Mon intervention ne les combla pas davantage; pire, elle ne fit que complexifier le problème, évoquant
l’expérience sensible de Proust, encore lui, qui assimile la métamorphose subjective générant
« l’œuvre d’art » à la transsubstantiation célébrée par la messe catholique où le vin et le pain ne sont pas
« comme » le corps du Christ, ils sont le corps ici présent. Dans une lettre, Proust évoque une manière d’écrire, la
sienne, « ou s’accomplit le miracle suprême, la transsubstantiation des
qualités irrationnelles de la matière et de la vie dans des mots humains.
L’œuvre d’art (texte ou image) serait en somme une transsubstantiation de la
chair et de la vie de l’écrivain dans son « œuvre ». Par
l’analogie-comparaison et par la métaphore-métamorphose, l’artiste sort de la
pénombre ce qu’ [il] avait senti, [pour] le convertir en équivalent
spirituel ».
Le feu qui embrase Adel (Cf. Je suis innocent, 2012, C-print) rappelle l’immolation par le feu du jeune tunisien
Sidi Bonaziri qui lança le « printemps arabe ». Il me renvoie aux
immolations par le feu des femmes afghanes soumises au mariage forcé, et
auxquelles j’ai dédié mon Prix Hannah Arendt (2006). Et aux nombreuses victimes
d’oppression et injustice en tout genre. J’y perçois aussi, parce que c’est vous qui faites cette expérience-image,
que le feu « Je suis innocent » révèle la transsubstantiation de votre identité corporelle : vous en corps-flux pulsionnel avec ses
équivalents spirituels et ses révoltes éthiques. Une combustion permanente qui
nous rend brûlantes vos métamorphoses car « tant qu’il n’y a pas en cela,
il n’y a rien » (Proust).
L’Exit de l’Exil trouve une autre métaphore-métamorphose : l’eau. Dans The Sea (2008) vous flottez sur une planche au gré des vagues. Réplique
aquatique de la rotation aérienne par hélicoptère. Jusqu’à ce que l’image du
corps disparaisse elle-même, et ne laisse derrière elle qu’un amas de déchets
en sacs poubelles, entassés dans une barque échouée à sec. Nul mouvement, fin
de l’hypnose et du rêve. Plus aucune envolée baroque. Il ne reste au corps de
l’artiste qu’à tourner en rond dans le minimalisme enroulé d’un fil de
barbelé : Salam Europe (2005).
Cette tornade
sensuelle joue avec la mort. Corps mortel et qui provoque la mort :
serpent au cou (Dead or Alive, 2008)
et fontaine-cactus, faisceau de couteaux aiguisés (Knives, 2007).
5.
Mon enfant. Le
cri politique
« Cette
réplique est en ivoire », m’avez-vous prévenue, alors que je contemplais
« Mon enfant. » Vous y tenez, à cet ivoire. Moi aussi. La substance
blanche, lisse et aveuglante du lait cristallisé, une lumière solide, me rend
cet enfant du ghetto de Varsovie, devenu symbole de la Shoah, d’une proximité
singulière. La photo prise par un SS et qui témoigne de la brutalité nazie, fut
une pièce à conviction au procès de Nuremberg. Elle révolte, éveille amour et
compassion, condamne. Votre réplique ne ressuscite pas l’enfant. Sa blancheur
installe l’immortalité du corps. La casquette trop grande, le regard terrorisé
et absent sont déjà dans la photo. Mais le corps refait par Adel n’est plus la
photo du SS. La blancheur vivante de ce petit garçon grandeur nature (votre
sculpture fait 133 cm), ne l’arrache pas à la tragédie, elle l’inscrit dans un
hors-temps, blanc sur blanc, ses pieds foulant le sol rouge. Cet éclat, aussi
aveuglant que mate et profond, n’est ni de marbre ni de mastique, de quoi
est-il fait? D’ivoire. Est-ce lui, dents et défenses d’éléphants, hippopotames,
mors et autres cachalots, l’endurance de la vie dans l’os, qui s’empare de moi
et m’emporte ? La colonne vertébrale et tous les squelettes ont résorbé la
chair périssable, l’os transmué en corps, plénitude imputrescible, rassurante.
J’ai compris de
votre sculpture, que la langue arabe appelle le squelette « habibi », « mon chéri »,
« mon cher ». Pour l’éternité, « mon » enfant. Le prénom
possessif m’interpelle. Vous adoptez cet enfant, vous prenez ses mains levées
et apeurées. Vous êtes lui et son sauveur. Je bute cependant sur la possession:
la propriété, fut-elle pavée des meilleures intensions, je m’en méfie. Cet
ivoire de dents et de défenses dont je perçois la vitalité, inverse la
vulnérabilité en puissance animale, prête à se défendre et à attaquer. Tant
mieux : « votre » enfant va se défendre. Mais combien d’éléphants
aura-t-il fallu édenter ou massacrer pour recréer votre enfant ? Je ne suis pas une inconditionnelle des amis
des bêtes, mais quand même, préservons les espèces menacées, au moins…
Je continue à le
contempler et je constate que vos pulsions orphelines ont apprivoisé
l’enfant : emblème de tous les corps gazés, votre révolte vagabonde de
« bâtard » exilé s’attaque à la matière de l’art elle-même.
Peut-être. Combien coûte-t-il de
s’adonner à ces transsubstantiations qui
font sentir et penser, pour nous rendre « plus humains »?
Sommes-« nous » si pacifistes que « nous » le prétendons
quand nous détruisons la faune, fût-ce dans un but « spirituel » ou
« esthétique »?
Et je n’ai pas
fini avec les questions que vous ne posez pas car, comme Picasso :
« Si l’on sait exactement ce qu’on va faire, à quoi bon le
faire ? ». Mais je cesse mes interrogations et garde la brillance
jade de cet être en lumière concentrée, comme le blanc des yeux qui me
regardent, et avec lesquels je le regarde. Au-delà des espèces et du temps,
« Mon enfant » nous invite, nous autres spectateurs, concrétions de
la première lumière du monde, à un toucher intérieur mutuel.
Le Cri (2012, ivoire de mammouth) décuple cet
éblouissement. L’enfant juif de 1943 s’est mué en une petite vietnamienne de 9
ans, Kim Phuc, qui fuit une attaque au napalm. De nouveau, vous vous emparez
d’un cliché, du photographe Nick Ut cette fois-ci. La presse est-elle supposée
neutre? Le crime de guerre n’est pas l’Holocauste, certes, mais la brutalité
des humains n’épargne jamais les enfants : abusés, violentés, traumatisés,
tués. Les lèvres mortifiées du jeune varsovien ont cédé la place à la bouche
béante de la petite asiatique, les mains ne sont plus en l’air mais flottent
ici en croix, sans clous christiques, comme pour se débarrasser du napalm,
après avoir rejeté tous ses vêtements. La blancheur d’ivoire s’irise, plus
étincelante encore sur la peau de cette poupée : serait-ce parce que les
défenses viennent désormais de mammouths, certainement plus vielles et plus
chères que celles des éléphants ? Plus violent que votre « cri de
solitude », indispensable à « une œuvre qui compte », le cri de Kim Phuc est un cri de
douleur et d’horreur aux portes de la mort. Placés devant des soldats prêts à
tirer dans des croquis en pierre noire, le visage et la bouche projettent alors
vers nous moins l’abjection de
l’assassinat que la résistance de la
vie face à la mort. Un cri de révolte.
Ces enfants
criants et abusés méritent la matière la plus précieuse : vous sculptez
ces corps jadis d’anges dans des substances hors-de-prix. Sans ménagement
aucun, l’humanité ne doit pas oublier qu’on l’a traitée plus bas que terre (Shams, 2013), mais aux petites victimes
de nos prétendus âges d’or, vous faites un bas-relief en cuivre plaqué or.
L’expressionnisme
d’Edvard Munch rend la désespérance abyssale, et la solitude à ciel vide parait
d’une modernité sans transcendance ni Histoire. En rupture avec cette
tradition, la polysémie de la détresse que vous installez - qu’il s’agisse de Mon enfant ou Cri, en passant par The Sea, Je suis innocent-le feu et Salam Europe - s’appuie sur des corps politiques. Vous mobilisez la
Shoah, la guerre du Vietnam, la globalisation après le 11 septembre, les flots
irrépressibles de migrants. Le sens
pulsionnel sémiotique de votre corps baroque se marie avec le registre symbolique de la signification politique et éthique. Le corps d’Adel
qui se dispose dans cette polysémie ne prend pas parti, ne propose pas de
« feuille de route », ni morale et encore moins politique. Il se
contente de capter le maximum de sens et significations. Il n’y a pas de
solution, vous êtes libre de sentir et penser : telle est la consistance
du monde qui émerge dans votre expérience.
« L’innocence »
que vous ressentez (comme pour vous déculpabiliser ?) n’est donc ni une
prétention à la neutralité ni un aveu de naïveté. La polyphonie érotique et
politique confère à vos œuvres cette consistance plurielle qui innocente ;
au sens étymologique : qui « ne nuit pas ». Tout compte fait,
les métamorphoses du corps d’Adel me fond penser à ce « kleptomane de
volupté » dont parle Louis Aragon dans Le
Paysan de Paris, jouissant sans pathos dans le « vagabondage de
l’incertitude ».
6.
Telle mère tel
fils
Le corps d’Adel
dans les bras de sa mère Nafissa (2006), visiblement un clin d’œil ironique aux
innombrables Pietà, parmi lesquelles je vous propose celle de Giovanni Bellini
(1505).
Hommage
carnavalesque à la chrétienté et à sa peinture. Davantage que la reconnaissance
que vous exprimez à la « source », c’est la persistance du corps
baroque que je repère. L’axe de reliance n’est autre que le regard : mère
et fils sont soudés par les prunelles. Sans cela, l’ajustement tient à peine,
déséquilibré, incertain. Le corps tient autant sur les bras et l’épaule maternels
qu’à la tension musculaire et nerveuse de ce fils raidi en équilibre - à moins
que cette fugace stabilité ne dépende du mur qu’effleurent ses pieds et du
rétroviseur de la voiture, cachée derrière sa tête ? Visiblement, cet Adel
n’est pas un Christ mort, serait-il déjà ressuscité ? La prise de vue doit
aller vite, l’équilibriste défie les lois de la pesanteur et s’il ne tombe pas
dans un quart de seconde, il va se lever et reprendre son auto. A peine
esquissé, cette furtive évocation de la mortalité du corps et de sa dette à la « mère qui tient debout » (Stabat Mater) s’éclipse dans le sourire,
qui n’a rien d’une gloire non plus. Juste une innocente tendresse, car
polyphonique et souriante.
Plus insolite,
car plus érotique, l’étreinte mère-fils en vol. C’est ainsi que je reçois les
deux corps d’avions – avant ou
après le vol – enlacés sous le titre « Telle mère tel
fils » (2008). La tête à queue surcomposée s’achève en un nœud entre
deux serpents. Deux tuyaux
immenses, exubérants phallus ? Ou les jambes mêlées des deux lesbiennes
dans le Sommeil de Courbet ?
L’allusion érotique est rarement aussi explicite dans les métamorphoses du
corps d’Adel. La version de 2012-2013 au Centre Pompidou, où les jambes se
mêlent davantage encore, porte le titre ironique d’ « Innocent ».
L’Eros mère-fils
laisse présager son contraire : comment s’en détacher ? Voici le
fuselage d’un avion Aerojet Commander, star des super statoréacteurs, qui
semble avoir souffert en atterrissant. Il porte le nom savoureux de « Borek ». Comme les friandises que
Nafissa faisait à son petit Adel ? Toujours superstar, mais abîmée par son
fils, une mère est faite pour qu’on s’en débarrasse. J’aime à croire que
Nafissa est une excellente cuisinière, et j’ignore si Adel fait de meilleurs boureks
que sa mère, mais je peux attester que le méchoui d’agneau préparé par Adel est
incomparable.
Le Sommeil (de
Courbet)
En vis-à-vis de Nafissa-Pietà, Lincoln (2009). Plus désinvolte encore, avec le même pantalon bleu
et pull marron, le corps du fils se pose nonchalant sur les bras du père
Lincoln. Pourquoi lui ? Le Président des Etats-Unis fait ratifier le XIIIe
amendement de la Constitution et abolit l’esclavage. Sorte de Dieu de la
démocratie moderne, il l’est forcément pour notre « bâtard universel ».
On ne badine pas avec un père pareil, pas question de jouer les Œdipes. Le
voltigeur baroque ose néanmoins se montrer rêveur, peut-être sceptique.
Innocent, mais toujours fidèle à son vagabondage politique.
Sans connotation
personnelle, sans nom propre mais plus proche de la misère de l’homme : le Joueur de flûte. Oubliés, Sainte Mère
et Père Président statufié. Un vieil homme nu et bedonnant, au pénis minuscule
à peine visible, mordille tristement sa flûte démesurément longue comparée à
son sexe. Où est passé le corps baroque ? Inattendu, surpris ? Le
regard métamorphique d’Adel (vidéo, 1996) se fait ici étrangement
compassionnel, résigné, amnistiant.
Mais ses
rotations le reprennent, et le voilà revenu à l’univers des Madones. Mona-Lisa,
Lise. Déshabillé, un porcelet au sein : la vidéo est scandaleuse, elle
sera censurée. Blasphème grossier, rejet de ces hommes - porcs mangeurs de
porcs -, vengeance d’un ex-colonisé ?
Je préfère
retenir la tendresse qui parle dans ces images. Aux mille et unième tour de son
manège, « tourbillon d’hilarité et d’horreur », le corps polysémique
d’Adel doit savoir que le porcelet c’est lui, comme il est le sein aussi.
Alors, sa caméra s’est rapprochée de la lumière et de cette absurde
nativité : tous les censeurs et toutes les religions s’effacent de honte
dans cette ombre au sourire. Je partage le mystère de Lise. Inopiné hommage aux
mangeurs de porc !
7.
Dessin et
Habibi : la vitesse de la pensée
Nulle distance
entre la pensée et la main : leur unité instantanée saisit et retrace,
dans les corps visibles, l’intériorité la plus concentrée. Nul
tâtonnement : l’esprit de l’artiste, identifié au geste, taille l’étendue,
découpe ombres et lumières, et, sur l’extériorité plane d’un support, tel le
papier, fait surgir le volume d’une intention, d’un jugement, d’un goût. Par la
seule justesse des traits, de leur placement, de leur mouvement, de leur
accumulation noire, et de leur espacement lumineux. Le dessin m’a toujours
semblé la preuve d’une concentration maximale, par laquelle l’intelligence la
plus subjective et l’abstraction la plus aiguë donnent à voir un dehors soudain
sensible à l’artiste, et pourtant si intimement associé au spectateur, qu’il
s’impose comme une évidence aussi absolue que singulière. Le dessin ou la vitesse
de la pensée.
Peut-être cette
idée me vient-elle de ma mère. Un visage, un paysage, un animal, une fleur, un
objet, tous revivaient à l’improviste sous son crayon: ma mère dessinait comme
d’autres respirent ou brodent.
Un dessin reste
gravé dans ma mémoire. C’était un de ces hivers blancs et froids qui congèlent
les Balkans, je réchauffais mes joues et mes doigts glacés autour du poêle à
charbon, en écoutant distraitement une émission de radio destinée aux
enfants : « Quel est le moyen de transport le plus rapide au
monde ? Envoyez-nous votre réponse, avec le dessin correspondant… »
« L’avion », s’empressa de répondre ma jeune sœur. « Pas du
tout, la fusée », avançai-je. « Je dirais plutôt que c’est la pensée »,
ajouta maman. « Peut-être, mais on ne peut pas dessiner une pensée, c’est
invisible », je contestai, de ma coutumière insolence. J’ai encore, si
distincte dans ma mémoire, la carte qu’elle dessina en mon nom et qui me valut
le premier prix du jeu radiophonique. Un grand bonhomme de neige est en train
de fondre dans la partie gauche, la tête tombante, comme tranchée par
l’invisible guillotine du soleil. À droite, le globe terrestre sur son orbite
interstellaire propose ses étendues imaginaires à des voyages immobiles.
Ce dessin n’avait
rien d’exceptionnel. Mais à mes yeux d’enfant, il donnait à voir : aussi
bien par la concision de son concept (un corps périssable se transcende et se
transfère par la puissance du raisonnement) que par la rapidité enjouée du
contour (sans tomber dans la caricature, le tracé nerveux et plein d’esprit
trahissait la mélancolie de notre condition de mortels, en même temps que
l’ironie triomphante d’une intimité qui réfléchit).
Contrairement à
d’autres artistes modernes qui installent à défaut de savoir dessiner, vous, Adel,
maitrisez cet art. La pierre noire découpe la féroce raideur des soldaten qui
braquent leur fusil sur Kim Phuc, même férocité en vrille chez ceux du ghetto
de Varsovie ou d’ailleurs. Votre poignet se relâche pour tracer l’ennui
appliqué du père de famille – homme d’affaire courbé ou raide sur sa journée (Park, 2014). Le trait effleure le papier
et fait flotter la petite vietnamienne napalmisée.
Vous ajoutez du
chewing-gum pour adoucir et attendrir la capture des visages de femmes, et
votre pierre noire devient psychologue. Elektra (2014) : la tristesse arrondie, en attente ; Rio (2014) : espiègle et sensuelle, elle provoque ; Elle (2014) : trouble,
fatale ; Ksu (2014) élégance
hautaine, plaisir froid. Bec rapace de la pensée, le dessin fait sienne leur
intimité, il la recrache mais en fait la possède, la fixe à plat, sans
punaises, doucement, avec des chewing-gums.
Est-ce la raison
pour laquelle Julie (2015), l’épouse
et mère de vos filles, échappe au croquis ? Peut-être apparait-elle dans
un dessin que je ne connais pas. Je la vois surtout se dresser, seule, auguste,
telle Athéna, en statue de sel sur un rocher. Le corps d’Adel goûte ici, avec
l’amour, le sel de la vie, le temps passager. Absolus, indiscutables,
souverains.
A côté du corps
en vidéo de Julie, un dessin blanc se presse: le squelette (Mes amis, 2005), Habibi, personnage
central des métamorphoses d’Adel, qui ne cesse de revivre en versions variées.
Ici, enlacé avec le jeune corps de l’épouse. La scène confirme l’impression qui
se dégage de toute la série de vos squelettes : les spectres n’ont rien de
lugubre ou de fantomatique, ils ne révulsent pas plus qu’ils ne réduisent à
néant la légèreté des spectateurs.
Les autres
humains veillent à ce que leur squelette tienne débout : ils accomplissent
leur devoir, aussi longtemps que possible. Le squelette façon Adel est une
continuation du dessin avec d’autres moyens. Cruel, incisif, évident, il révèle
l’intériorité la plus concentrée.
Que restera-t-il
après ma mort ? – se demande l’artiste. La question sans réponse accélère
sa pensée. Que des os, répond Adel. Aucune vérité dedans, au-delà ou en dessous
des images, seul le squelette – qui révèle le temps. Il s’intègre dans les
rotations du corps vivant et de l’imagerie incorporée. Blanc dessin des côtes,
des tibias, des osselets. Sèche densité du crâne, dure clarté de la mort. La
chair s’est faite os, qui la dessine et la pense dans le temps : c’est le
squelette. L’être est peut-être le néant, mais le néant n’est pas rien, ça se voit.
Adel n’avoue-t-il
qu’à la femme aimée son alliance avec la mort apprivoisée? Une possibilité.
L’épouse-héritière, amante de l’œuvre survivante ? En quelque sorte. Et
l’artiste, d’emblée homme posthume ? Evidemment, « peu profond
ruisseau, la mort », écrivait Stéphane Mallarmé. Eclatante évidence, ce
dessin qui la porte, détaille Adel. Ou, si vous préférez, une bouteille à la
mer ? Le squelette en verre marque la mort au sourire aquatique.
Ni Faucheuse, ni
Vanité, ni Amante pathétique, la mort, chez Adel, est comme le squelette :
simplement Habibi - « mon chou », « chéri », mon
« squelette ». Déconcertante simplicité de la langue arabe. Les
islamistes intégristes en profitent-ils pour envoyer leurs kamikazes se faire
sauter les os au paradis de vierges ? Au contraire, la mortalité sereine
que dessinent les squelettes d’Adel ne banalise pas la mort. Dénudée et
implacable, ils la sortent des tombes, nous la présentent : mais nous ne
savons toujours pas comment vivre avec elle.
D’attitude
toujours « mobile et équidistante », le corps d’Adel ne pouvait pas
éviter la Passion du Christ. Et c’est sur la douleur des entailles, coupures et
fentes du Corps glorieux, que l’imaginaire incarné de l’artiste parvient à
enrouler. (Décor, 2011-2012)
Il serait tentant
d’aborder cette série magistrale, en la mettant en perspective avec le Christ
de Grunwald, ou en convoquant les Exercices
spirituelles de Loyola qui éveillent et apaisent les sens. Ou de la
comparer aux artistes modernes (Otto Dix, Arnulf Rainer, voire Warhol) qui
n’ont pas manqué d’habiller de fer l’homme de douleur, de s’identifier à son
agonie ou au contraire de s’en écarter. On pourrait aussi les ignorer et se
contenter d’évoquer les plaies de la globalisation. Ce serait oublier la
spécificité du corps d’Adel qui s’expose dans cette œuvre centrale avec son
intensité maximale, pire : ce serait ignorer l’incision métaphysique qui
caractérise son parcours et sa modernité.
Où est passé le
corps du Christ ? Il ne reste qu’une matière métallique coupante, lanière
barbelée de rasoir en acier galvanisé, qui s’enroule autour d’elle-même et
sculpte un volume vide, réplique du chef d’œuvre à Issenheim. L’artiste ne représente pas le corps de Jésus,
c’est la douleur trans-humaine et divine qu’il empoigne. Il la multiplie à
l’infini : les cinq plaies et la peau perforée par la couronne d’épines ne
sont que des particules élémentaires au regard de cette bande de rasoir coupant
par laquelle Adel transcende le
corps jusque dans sa dimension divine. Elle se plie et se tortille, tisse et
brode, n’épargne aucun organe, muscle, vaisseau, nerf, hormone ou ossature.
Aucun corps de chair n’est épargné par une lame externe.
La « plaie
et le couteau » font Un : jouissance et angoisse de la Passion. Cette
vérité baudelairienne de la perception-création christique est lourde de
conséquences. Elle contraste cruellement avec les interprétations théologiques
d’hier et d’aujourd’hui. Sa résonance anthropologique interpelle.
Fait de cette
lame, l’homme de douleur est, fut et sera tout autant une victime-hachée menue,
qu’un redoutable attaquant face à ses adversaires. L’abandon à la souffrance
côtoie l’ardeur de la vengeance contre les déicides, pogroms et inquisitions.
Les interminables
couloirs de brûlures qui composent ce dé-corps n’ont pas moins la froideur glacial de l’acier : l’accoutumance à la
souffrance vaccine contre l’émotion en soi, et nourrit l’indifférence envers
autrui.
Figure mystique,
Sujet Absolu, cette expérience - installation est appelée à susciter adhésions,
passions. L’homme de foi s’élance vers elle, n’y arrivera jamais, il essaiera
toujours. Il convient donc de multiplier les spécimens, quatre Christ, 3+1, et
la chaine des nombres s’ouvre à l’infini. L’Unique essaime, couvre
l’espace : son espace de fidèles. Quand ils deviennent des fans, la scène du sacrifice s’appelle un
théâtre, et alors tout devient décor.
La coupure du
rasoir est absolue. La coupure magnifiée dans l’expérience christique s’impose
à l’imaginaire comme la station privilégiée, indispensable aux métamorphoses
auxquelles nous convie l’artiste. Sigmund Freud avait déchiffré dans cette
obsession la peur mâle de la castration. J’y verrais aussi, après Mélanie
Klein, l’enfant voulant couper la tête de Méduse, la « mauvaise
mère », pour ne plus en avoir peur, mais se l’approprier en rêve et lui
donner, par delà la passion-émotion, un nom : « maman ». Je l’ai
introduite au Louvre, dans mon exposition sur la décapitation « Visions capitales » (1998,
2014).
Ces
incorporations de la divinité découpée et coupante sont aujourd’hui au cœur de
l’actualité politique, leur tranchant n’épargne ni les actuels fous de Dieu ni
les nouvelles formes de totalitarisme : ces rituels gangstéro-intégristes
auxquels se livrent des hommes de Dieu contre des infidèles, parmi lesquels les
chrétiens.
La lame de rasoir
qui esquisse l’agonie du Christ chez Adel, c’est celle de Guantanamo, qui
dissuade les prisonniers de franchir les frontières du camps. Tandis
qu’ailleurs, on l’utilise pour maintenir les animaux dans leurs clôtures ou
protéger les propriétés de luxe.
Ni d’un côté ni
de l’autre, le corps d’Adel, son art en somme, n’invite à éprouver et à penser
les plaisirs et les abjections de
l’Absolu et du fanatisme.
Dans la même
logique d’hainamoration, deux corps d’hommes en nylon et graffiti, lames de
bistouri cette fois-ci : un tueur et sa victime. Titre : Untitled. Pas de mot pour ça. Last but not least, une sobre évocation
d’Allah se faufile dans les figures abstraites, ornements et arabesques,
géométrique évocation de l’invisible (God
is design, 2006). Suis-je un « mauvais œil » ? Je déchiffre
dans les tressages de la lame de rasoir de Décor un pressentiment d’arabesques. Une invitation à ouvrir les yeux sur les
diverses configurations du divin… Jusqu’au prochain big-bang ?
La formule
« Dieu est mort » veut tout dire, sauf qu'il n’y a pas de Dieu. Hegel,
repris par Heidegger l’a affirmé, et il n’est pas nécessaire qu’Adel l’ait lu. Décor (2011-2012) témoigne que, même
mort, Dieu ne disparait pas, il ne cesse de recommencer (quatre Crucifix, et
ainsi de suite) : pensez-y ! Le « Vendredi Saint Absolu »
existe, il est à l’œuvre. Pas nécessairement comme une délivrance. L’absolu
tranche. Prenez garde au sadomasochisme, cette fine lame du fanatisme.
9.
Bêtes et hommes
« Séparation » : voici la
première impression du dossier que vous m’avez remise, pour témoigner du
« corps métamorphique ». Vous êtes penché sur le lion, à bonne distance,
la scène capte le mouvement, le fauve vous attire, vous allez l’attraper et
l’enlacer. Je trouve que ce lion vous ressemble: les traits du visage et de la
gueule ; le regard ambré et absent de l’animal, vos yeux concentrés sous
les paupières ; votre élan à palper l’énergie sous la crinière et le
pelage. Par delà la séparation millénaire des espèces, l’évidence d’une
complicité retenue s’impose, qui laisse pantois le gardien vigilant. Je
perçois, comme l’écrivain Colette, que vous pourriez étonner les dompteurs en
glissant sans dommage votre main dans la cage des fauves. Et, comme elle aussi,
compatir à la douleur d’un oiseau malade au point de lui tordre le cou pour
l’aider à mourir. En osmose totale avec le refoulé le plus archaïque, avec le pré-psychique qui habite nos pulsions et
nos sensibilités, sous la frêle pellicule des mots qui les recouvre, vous ne
pouvez pas supporter d’en être séparé. Solitude
irréparable.
Vous percevez
dans le règne animal cette vivacité indomptable avec laquelle votre solitude garde le contact. « Les
animaux sont des présences et non des symboles, des icones et des signes. Ils
ne sont pas là pour remplacer quelque chose, ils sont là vraiment »,
insistez-vous.
Je vous suis et,
en prolongeant indiscrètement la vidéo, je vous vois transféré littéralement dans cette animalité pulsionnelle que
Colette appelait un « ancien moi-même ». Non pour vous l’approprier,
le domestiquer et en faire un semblable, mais pour réhabiliter ce sens sensible
qui, échappant aux conventions sociales, est perçu comme
« monstruosité » ou « sauvagerie ». « Quand j’entre
dans la pierre où tu es seule avec les bêtes, disait Jouvenel, le second mari
de Colette, j’ai l’impression d’être indiscret. Tu te retireras un jour dans
une jungle ». Pire encore, puisque votre moyen de contacter « la
jungle » ne sont pas les mots, si sobres, mais des matériaux bruts et des
visions malléables, je vous sens capable d’entrer sous la peau des bêtes comme
Colette entrait dans un jardin, selon Goudeket, son dernier mari cette fois-ci.
« Sa prise
de contact avec les choses se faisait par tous les sens. Elle ne se contentait
pas de les regarder, il fallait qu’elle les flairât, qu’elle les goûtât. Quand
elle entrait dans un jardin inconnu, je lui disais : « Tu vas encore
le manger ! » et c’était extraordinaire de la voir se mettre à
l’œuvre. Elle y apportait de la hâte et de l’avidité. […] Elle écartait les
pétales des fleurs, les scrutait, les flairait longuement, elle froissait les
feuilles, les mâchait, léchait des baies vénéneuses, des champignons mortels,
réfléchissant intensément sur ce qu’elle avant senti, goûté. […] Enfin, elle
quittait le jardin, [.. .] la démarche titubante et le souffle court, elle
était tout pareille à une bacchante après des libations ».
Goûter la bête,
la consommer, l’incorporer : vous accompagnez cette avidité non seulement
en cuisinier raffiné mais vous plantez la caméra et la main dans la cruauté de
cette assimilation animale qui participe de la culture humaine, une sorte de
cannibalisme avec nos frères les bêtes. Qui perdure sous le calme vernis de
recettes composant le « cru » et le « cuit » pour
structurer les logiques élémentaires de la parenté et des mythes. Et vous vous
en séparez en les transportant –
avidité et cruauté compactés, inséparables, choquantes – dans ce que nous
prenons pour des « représentations ». Mais ces installations animales
sont pour vous des présences réelles, des actes chamaniques.
Je serais tentée
de rapprocher votre symbiose avec les bêtes de celle qui anime l’art des peintures
pariétales.
Dans la grotte de
Chauvet (datée de 26 000-27 000 BP et de 30 000-32 000 BP),
l’artiste préhistorique représente à l’intérieur de la grotte, et non à
l’entrée, des animaux qu’il ne chasse pas, et qu’il ne mange donc pas. Sans
effroi, avec une majestueuse empathie, il détaille la dramaturgie de leurs
forces et mouvements. Et, en apposant une multitude d’empreintes
« positives » ou « négatives » de ses propres mains, semble
signifier plus qu’une simple possession de l’univers qu’il habite. Selon les
paléontologues, il s’agirait d’une « transmutation entre les catégories
d’êtres vivants : l’homme et l’animal ». « Perception
fusionnelle de l’homme et du règne animal », cette « représentation
zoomorphe » me paraît sous-tendue par une identification avec des étrangers – mammouths, rhinocéros, ours ou
chevaux – comme autant d’alter egos qui
« parlent le même langage et se comprennent ». L’artiste s’y projette
et apprivoise les figures animales pour créer sa propre figurabilité. Celui de
Chauvet maîtrise pleinement la richesse dramatique de cette figurabilité
originaire, et cela, bien avant de pouvoir figurer l’humain à proprement
parler. En effet, les parois de la grotte ne laissent apparaître que la forme
d’une vulve surmontée d’une tête animale, représentation qui semble elle-même
en transmutation avec la caverne que l’artiste pénètre et qu’il orne.
Cette
figurabilité animale de soi-même à l’aube du soi-même ne serait donc pas une
simple reproduction du cosmos animalier, ni même son humanisation secondaire.
Mais une véritable appropriation chamanique de la figure animale, cherchant à
figurer l’intériorité humaine qui s’appréhende comme telle : cette figurabilité animale-là ne serait
autre que la figurabilité originelle du désir humain.
10.
« Who is afraid… » ou Qui a peur du
« principe de délicatesse »
La complicité
avec la bête - par delà la défiance irréconciliable qui sépare les deux
espèces, humaine et animale, parce qu’elle donne sens et corps à nos étrangetés
innommables - ne vous conduit guère à une idéalisation mystique du règne
animal. Au contraire - autant la sauvagerie bestiale dont les humains se
distinguent tant bien que mal, que la monstruosité que nous infligeons aux
animaux pour satisfaire nos appétits ou pour nous purifier, se présentent comme
des stations privilégiées dans vos
œuvres récentes :
Une vidéo tournée
au Mexique avec des animaux : pitbulls, python, scorpions, souris, boas,
coqs, araignées, et un crapaud mort. (Usine,
2009). Vous commanditez l’abattage à coup de massue de sept mammifères et
filmez la tuerie : chèvre, cochon, mouton, bœuf, cheval, faon.
Monstrueuse
culture de l’égorgement. (Don’t trust me,
2012). Vous compactez dans une malle des animaux empaillés, assemblés avec
des fils de fer brûlé : érotisme du toucher, orgasme de la peau -
frontière entre les pulsions et l’image, ou abjection de l’art « qui
empaille, conservatoire du vivant en fétiche ? (Taxidermy, 2010)
Enfin, la plus
morbide des compositions, au titre infantile et prétendument comique de « Who is afraid of the big bad Wolf » (2012)
Cette insulte aux
gobelins est un fatras de très mauvais goût. L’esthétique ne nous a-t-elle pas
appris à chercher dans l’art la catharsis, la purification, le beau et le
vrai ? Vous prenez d’autres voies ! Seriez-vous un pervers, un
criminel, un « enfant terrible », un « plasticien enivré »,
« détesté et adulé » ?
Vous ne décorez
pas l’abjection. Vous sondez l’abcès, et, ce faisant, vous le goûtez et vous le
rejetez : plaisir et horreur, jamais l’un sans l’autre.
La sonde est
coupante, comme la lame à double rasoir : elle tranche dans l’insoutenable
sens pour mieux le retrancher. Vous n’êtes pas moraliste. Vous ne montrez pas
la voie et n’avez aucune feuille de route. Vous nous introduisez dans votre
laboratoire - à nous de jouir, de nous angoisser, de penser - sans même
nous aider à nous en sortir.
J’ai eu affaire
aux loups, moi aussi, deux mois avant la chute du Mur de Berlin. Mon père fut
assassiné dans un hôpital bulgare, où l’on faisait des expérimentations sur les
vieillards. On ne donnait de tombes qu’aux communistes, par peur des
attroupements populaires. J’ai voulu acheter une sépulture. « Si vous
mourrez, d’accord, on enterre votre père avec vous » m’a-t-on rétorqué. Il
fut incinéré, contre ses dernières volontés de croyant. Deuil impossible.
Jusqu’à ce que la nécessité d’un « polar métaphysique » s’impose à
moi, sous le titre « Le vieil homme
et les loups ». Lambeaux du Goya noir et de l’Ovide des Métamorphoses, je les ai télescopés à ma
douleur sans nom, à ma solitude abjecte. Mon père m’est apparu dévoré par la
meute de loups, j’ai donné à son pays le nom de Santa Barbara, le village
planétaire. Dans les époques de transition, les humains se changent en animaux
ou vice versa. Un « personnage » d’Ovide, Hécube, se transformant en
chienne chez Ovide, m’offrit ses traits pour dessiner le carnage subi par le Viel Homme. « Mais elle, avec un rauque
grondement, poursuit, en tentant de le mordre, le morceau de roc qu’on lui a
jeté, et, de sa bouche ouverte, au lieu des mots qu’elle s’apprêtait à dire,
comme elle faisait un effort pour parler, sortirent des aboiements. » Une
chienne. L’endroit existe encore, et tout le monde peut voir, sur l’Hellespont,
dans le voisinage d’Abydos, le « tombeau ou le monument de la
chienne ».
Ovide n’est pas
un fabuliste qui fait réciter aux animaux les codes moraux des humains. Ce
poète épique injecte sa perception de la sensibilité animale sous la peau des
humains, ses semblables, pour palper leur sauvagerie et faire exploser
l’hypocrisie.
Il y a de la
jouissance à entrer dans la peau d’un pitbull, python, loup et autre vorace.
Une jouissance sadique révélée, traversée, qui permet de décomposer les
logiques d’actes abominables. Celles du mal
radical qui extermine ces êtres humains qu’il estime superflus. Si l’on ne
se contente pas de nier, de pardonner ou moraliser, il est dès lors
indispensable de passer par cette compromission.
L’art
« classique » qui nous a légué des valeurs « esthétiques »,
aussi évolutives furent-elles, n’avaient ni les moyens techniques ni les
matériaux qui permettent aujourd’hui aux forces centrifuges et aux perceptions
fusionnelles qui sont les vôtres, d’aller au corps à corps avec l’abjection,
sans sombrer ni dans la pathologie, ni dans le crime.
Le bord-à-bord
avec ce corps-à-corps n’est pas moins incertain et risqué que votre rotation en
hélicoptère, la rotation de Mervyn autour de la Colonne de Vendôme, la danse
des « derviches tourneurs ». Il est nécessaire d’endurer le vertige
et la nausée, et sans prêcher le bien – car il n’y a pas de solution univoque
à ces étrangetés abyssales – de suggérer qu’elles sont tout à la fois
constructibles et déconstructibles. En les fragmentant, et en les multipliant.
Cette manipulation de l’horreur ne
l’allège pas. Mais elle se libère de son emprise absolue et ouvre la voie de la
non-soumission. C’est le degré zéro du dépassionnement et de la liberté. Voilà
où nous en sommes.
Votre « Who is afraid… » évoque la
peur infantile du loup, la niaiserie maternelle et les raison de son déni.
Tapisserie monumentale d’animaux sauvages calcinés et empaillés, fourrures
puantes, bestiaire brûlé, odeur musquée. Entre analité nauséabonde et
l’évocation du Guernica de Picasso
(même taille : 8 mètres sur 4) dénonçant le massacre des populations civiles
ordonné par les nationalistes espagnols lors de la guerre d’Espagne (1937), –
votre Who is afraid impose au visiteur écœuré la réalité de
600 bêtes brûlés vives au chalumeau, agglomérées, entassées, dépiécées et
torturées. Ces animaux dont nous sommes séparés, certes, mais dont la puissance
torturante et torturée n’a rien d’une métaphore sont « vraiment là »,
corps et couleur, sinon corps et âme. Ils réveillent notre mortalité et la
puissance de la pulsion de mort. Au centre du tableau, le hennissement de la
jument violée par un taureau mythique révèle que la pulsion de vie s’imbrique
avec la mort. Silencieuse et muette, en lutte éternelle avec Eros, elle pousse
à délier, détruire, ramener le vivant à la décomposition. Plus énigmatique,
exempte de l’agressivité-jumelle de la séduction, la noire jouissance de la
pulsion de mort se rappelle à nous dans ce violent sursaut contre l’impensable.
Les religions
l’utilisent dans leurs rites sacrificiels et Who is afraid représente aussi bien les crimes et guerre auxquels
se livrent les hommes, que les sacrifices d’animaux que célèbrent l’islam, les adeptes de Gadhimai et
autres religions. L’artiste qui investit si méticuleusement le massacre, la
pulsion de mort ou le crime superficiel ne les condamne pas plus qu’il ne les
approuve. Il jouit aussi bien de sa peur des loups, sangliers, renards,
chevreuils… que de son empathie avec leur sauvagerie. Il ne les célèbre pas non
plus. Il expose l’état incandescent de son corps pulsionnel métamorphique, au
carrefour de ses intensités centrifuges. Un témoin, un martyr ? Pas
vraiment ! Vous décomposez et recomposez ces figures aussi. Comme cette
tortue qui est tentée de se retirer dans « sa grotte » sous carapace,
mais s’attache des barres de dynamite au dos pour explorer le monde… Comme
cette colombe – kamikaze elle aussi –, qui se pose sur un concentré d’horreur
quel qu’en soit le risque… Comme un vase élégant qui serait abominable s’il ne savait pas qu’il pose
sur une male d’explosifs.
Le marquis de
Sade, dans son délire maîtrisé, diagnostique cette permanence de la
destructivité, jusqu’à la pulsion de mort désormais livrée à son libre
cours : car la religion qui tente de l’encadrer recule. Deux siècles plus
tard, les religions ne reculent plus, certaines d’entre elles explosent. En
détaillant les mille et une nuits de la pulsion de mort, l’écriture de Sade
n’est pas sadique : elle témoigne du sadisme. Roland Barthes, lecteur
subtile, constate qu’on peut lire Sade selon un projet de violence, « mais
on peut le lire aussi selon un principe
de délicatesse ». De quoi s’agit-il ? Ni d’une attitude de
classe, ni d’un attribut de civilisation, ni d’un style de culture.
« C’est une puissance d’analyse et
un pouvoir de jouissance » qui
se réunissent dans une exaltation, une sorte d’utopie pour nos sociétés. Elle ne retourne pas la violence, parce que « retourner la violence,
c’est parler encore le même code ». Le principe de délicatesse consiste à
inventer une « langue », une « esthétique » inouïe, appelée
à subvertir « le sens même de la jouissance ». Comment ? En
essayant de fragmenter, pluraliser,
pulvériser le sens de la jouissance ».
Votre sens de la
jouissance sadique, cher Adel, vous le fragmentez dans 600 corps d’animaux
abattus, innombrables têtes, pattes, croupes et crinières et, en la pluralisant
vous la pulvérisez.
Le même geste se
saisit de l’Age d’or de
l’esclavage : corps tourmentés, exploités, écrasés de fardeaux et de
honte. (Shams, 2012). La minutieuse
patience qui se love dans ces corps de poussière torturés, pulvérise l’atrocité
morcelée, éparpillée. L’Age d’or n’était qu’un simulacre, une imposture, un
« sham »…
Il nous reste
toute une histoire de cultes, de valeurs, de certitudes à fragmenter,
pluraliser, pulvériser, cher Ami ! Ce principe
de délicatesse n’a rien de tendre. Il est monstrueux. Cocteau disait, même
de Colette qu’il adorait, que si « elle n’était pas un monstre, elle ne
serait rien ». Le principe de délicatesse vous rend suspect à vos
semblables. N’essayez pas de le faire accepter par les fidèles des religions,
esthétiques ou non. Vous n’avez ni la sensualité de Colette ni l’intransigeance
de Sade ? Vos intensités vous suffisent pour mener votre rébellion
innocente face à ceux qui se révèlent inaptes au « principe de
délicatesse » : au carrefour des hommes et des bêtes, des corps et
des mots, du sens et des images. Chercheur fougueux de l’invisible (State, 2013, Projection vidéo), votre
art nous confronte aux états limites qui constituent nos intimités secrètes.
Vous nous obligez à repenser délicatement l’insoutenable, avant que ne
s’éteigne la vitesse de la lumière (Schnell,
2005).
Schnell (2005)
|
 |
|---|