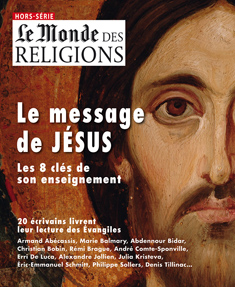Marc, 5 : 25-34 : « Et une femme, qui avait un
écoulement de sang depuis douze ans/…/toucha son manteau./…/Et
aussitôt la source de son sang sécha./…/ Aussitôt Jésus reconnut en lui même
qu’une force était sortie de lui. /…/Alors il lui dit : « Ma fille,
ta foi t’a sauvée .»
Après
la journée des paraboles, Jésus en voyage accomplit quatre gestes de puissance qui
mettent en évidence une nouvelle économie de la parole. La formule de Jean « le Verbe s’est
fait chair» (1,14) résume cette
révolution du parlêtre qui va marquer l’histoire des humains. Mais
c’est Marc, dans ce que les commentateurs appellent la « structure
enveloppante de son texte, si caractéristique de la pensée sémite », qui
analyse finement son impact
anthropologique.
Jésus
le guérisseur de l’étape antérieure avait déjà attiré l’attention sur sa
manière de s’exprimer : il n’explique pas, mais procède par « images»
qui culminent dans la parabole du SEMEUR. Comme le grain « donne
des fruits en montant » (en écho à Isaïe 55,10-11), SA parole à lui va
FERTILISER l’auditoire, à condition que celui-ci l’écoute d’une certaine façon.
Il ne s’agit pas de comprendre un
message comme une « com », mais de se laisser d’abord ébranler par le paradoxe : les mots
sont des grains, le Maitre est un semeur. Vous êtes sidérés, cascade
de rêveries, de sensations. Puis
vous transformez la sidération en curiosité, en désir de sens. Vous associez votre vie à la parole
entendue, vous racontez, vous vous raconter, c’est vivre, c’est agir. En hébreu, DIBBER veut bien dire
simultanément « Dire» et « Faire » ! Mais c’est dans l’intimité la plus secrète, la plus
tempétueuse, que Jésus va
distiller cette dynamique du dire/faire.
Ses paraboles atteignent l’homme et la femme dans les catastrophes
psychiques, physiques, mortelles de
leur vie. Comment ?
Après avoir « clôt la bouche » de
la mer démontée, au point que la puissance de ce miracle effraye ses disciples
(le Maître ne serait-il pas le Béelzéboul (3,20-35), il calme un aliéné qui habite les tombes en chassant la
légion de ses démons hors de cet
homme, dans « deux mille porcs ».
Et c’est dans le
contact avec deux femmes que se dévoile l’intense profondeur affective sous-jacente
à sa puissance verbale. Le toucher,
la levée et la force structurent ici le récit de Marc.
Alors que la foule se presse autour de Jésus jusqu’à l’écraser, après
qu’il ait guéri l’aliéné, une femme
affligée depuis douze ans ( 12
comme les apôtres) d’incurable
écoulement de sang, s’approche « de derrière » et « touche son
manteau ». Geste singulier s’il en est, impur et lourd de désir
(l’hémorragique est attirée par le
pouvoir de cet homme qui excite l’opinion), de défi obscène (toucher le Maître
alors qu’elle saigne : double transgression), de peur et de confiance.
Comme il a sorti des tombes le déséquilibré en l’appelant à s’identifier (« Quel
est ton nom ? »), Jésus formule en mots le trouble rapport charnel que la femme hémorragique tente avec lui : « Qui a touché mon vêtement? » La question amorce déjà une
interprétation du contact entre une
personne inconnue (Qui êtes-vous ?) et, non pas le Maître, mais un élément de
son intimité : « mon vêtement ». Va-t-il se dénuder ?
Surprenant
pour les disciples, cet appel qui
nomme le désir confus de l’impétrante fait plus que la sortir de la foule. Acte
de reconnaissance d’autrui, la parole de Jésus révèle aussi la puissance de son
propre ressenti qui le transcende. « Une force était sortie de lui. » , commente Marc en révélant le secret de cette séquence en quatre
gestes de paroles.
De quelle
« force » s’agit-il ? Dynamis grecque, virtus latine ? En hébreu, la racine shadad , « être puissant »,
« capable », évoquant l’akkadien « montagne , désigne la
« montée », l’ « élévation ». Le Dieu des
patriarches et de Job est shaddaï, « Tout-puissant ». La virilité fertilisante du semeur (4.2-23)
en passe de devenir élan psychique,
signifiance, élévation subliminale ? Et transmissible. Une Foi qui sauve.
La sienne, la mienne, la nôtre. Omnipotens Deus. « Ta foi t’a sauvée. »
La « force » (montée, la semence) de
Jésus partage donc l’excitation de
ceux qui se portent vers lui. Sans
satisfaire leur désir en panne, il se
contente de le nommer avec une justesse telle que la pulsion se transmue en curiosité psychique, en
quête de rencontre et de survie, en amour. L’excitation muette et sans emploi disloquait l’aliéné. Elle s’écoulait dans
l’impuissance esseulée de la femme intouchable. Elle saturait d’angoisse la supplication paternelle de Jaïre et sa
fille pubertaire de douze ans (encore 12) que Jésus fera se lever de son coma (épileptique, incestueux ?) en lui
« tenant la main » (encore le contact) et en lui enjoignant tendrement : « Talitha, koumi », « Fillette, je te dis de te
lever ». Comme le grain, comme une plante qui pousse, qui lève, qui monte… Moi et Toi,
moi et vous : dans la rencontre entre votre poussée insensée et la mienne/la
nôtre que je formule. Par ce contact nommé, la jouissance dévastatrice devient
un tact, le degré zéro de la communion, une force de l’amour.
Au
carrefour de l’excitation sans nom et de la puissance sublimatoire : le
toucher. Aristote
savait que, générique de tous les
sens, le toucher les fonde et les dépasse. Tandis
que les disciples de Loyola
devaient en faire une
conséquence de l’amour (« De
l’union de la charité vient le toucher, de la joie qu’elle procure vient le
goût »), Thérèse d’Avila parvenait à le diffracter en subtiles immersions dans pas moins de quatre
espèces d’eaux (la pluie, la rivière, la noria, le puits), pour transmuer le
trop plein de désir en baptêmes extatiques.
Touchant la peau qui touche la chair, le manteau : protection ou
passerelle de ces plaisirs qu’on nomme à la légère physiques ? Proust
semble amplifier le ressenti de la femme hémorragique palpant l’étoffe du
Maître, et/ou celui de l’homme qui
sent monter en lui sa
jouissance : il regarda « le
manteau/…/son velouté encore doux/…/sentit le velours fondre sous sa main et crut qu’il embrassait sa
mère. » Et Joyce le diabolique, complice de Molly Bloom, à moins que ce ne soit de Jésus lui-même : « est-ce que nous
avons trop de sang dans le corps ou quoi O sainte patience c’est comme une mer
qui coule en moi/…/ O Jésus que je me lève /.../ de ce vieux lit infernal aussi
qui fait une musique de diable.»
Plus qu’un Maître guérisseur, Jésus est en train d’inviter les communautés juive et païennes à une
nouvelle vie de l’esprit fait corps, du corps fait esprit. Par l’intensité de
l’investissement réciproque dans ce
lien que sera la Foi où le Verbe est Amour. Il ne l’accomplira pleinement qu’au
Golgotha et par la résurrection. Fin de l’histoire.
Freud fonde la psychanalyse sur ce geste de la
parole qu’il appelle un amour de transfert. Une autre histoire, sans fin.
JULIA KRISTEVA
Le Monde des religions, hors série, décembre 2011 - Le message de Jésus.
|