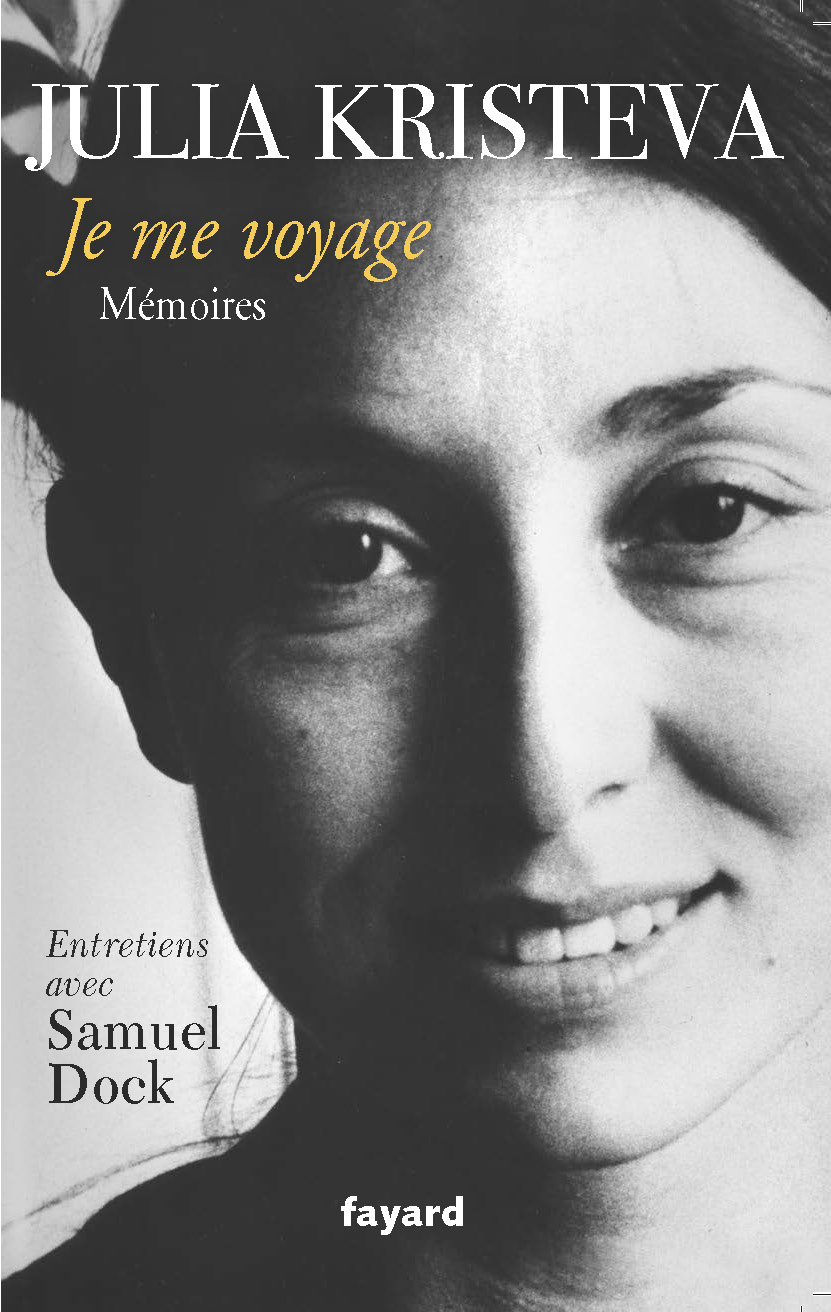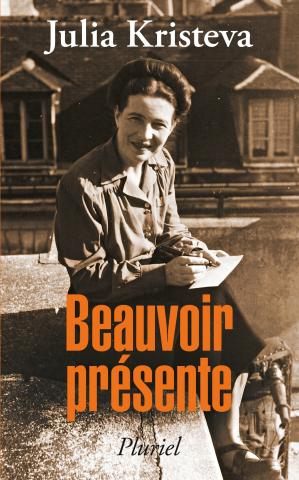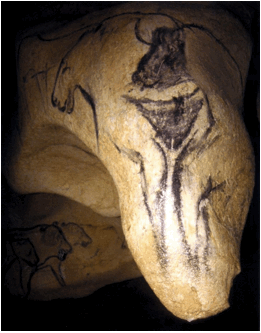|
|
Julia Kristeva et #balancetonporc : “La parole libre est encore à venir“
PAR
Les Inrockuptibles 29 décembre 2017
Evénement majeur de l’année 2017, la “libération“ de la parole des femmes pose encore des
questions, au-delà de l’évidente avancée qu’elle apporte dans l’histoire de
l’émancipation féminine. Discrète jusqu’ici
sur ces débats, la psychanalyste Julia Kristeva, sensible depuis des décennies
à la cause des femmes défendue par des auteurs chères à son cœur, comme Simone
de Beauvoir, Hannah Arendt ou Mélanie
Klein, met en lumière l’importance de ce nouvel élan féministe, tout en
soulignant ses ambivalences et les questions sans réponse qu’il soulève. Sans
confondre la parole prise et la parole libérée, elle invite à bâtir des passerelles entre politique de
l’émancipation et connaissance de l’expérience sexuelle.
Qu’est-ce que l’explosion de
paroles de femmes, suite à l’affaire Weinstein, vous inspire ?
Traverse-t-on, selon vous, une nouvelle étape de l’histoire du féminisme, sur
laquelle vous avez beaucoup écrit, en saluant notamment trois moments clé :
l’égalité politique avec les suffragettes, l’égalité ontologique avec la
contraception et l’IVG, la recherche de la différence entre les sexes ? Ce
moment de dévoilement des abus sexuels infligés aux femmes faits aux corps des
femmes est-il le prolongement de l’histoire de cette émancipation ?
Julia Kristeva - En effet, c'est une nouvelle étape de l’histoire
de l’émancipation féminine. Des femmes prennent la parole aujourd’hui pour dire
qu’elles ont subi des actes sexuels sans consentement, abus abjects,
destruction psychique et mise à mort du soi. De telles exactions ne sont-elles
pas perpétrées depuis la nuit des temps ? Et si l’on en parle ouvertement
aujourd'hui, si tout “se balance“ sur le Net, y compris des secrets qui n'en
sont pas, ne serait-ce pas l'effet de notre nouvelle religion, la transparence ?
Pourtant, quelques parleuses (comme se désignaient elles-mêmes
Marguerite Duras et Xavière Gauthier dans Les Parleuses) ne se “posent“ pas
pour autant en victimes, mais osent se revendiquer sujets de droit. Face à
elles, le “bon sens“ prévient qu’on risque d’ouvrir la porte à la délation, à la guerre des sexes, voire à la déshumanisation.
Embarrassée, désorientée, la justice… grommelle et joue les
prolongations. L'intime extime bouscule deux
défis majeurs de la globalisation : le retour des religions et la
recomposition de la différence sexuelle. Il ne suffit pas de confiner
respectueusement le religieux dans la sphère privée : kamikazes et
décapitations nous imposent de sonder la croyance et la violence aussi bien
dans l’intimité qu’en politique. En même
temps, la mise en question des identités sexuelles, émancipées du biologique
par l’accélération des avancées biotechniques et
sociales (contraception, avortement, PMA, GPA, parité, mariage pour tous –
malgré les résistances…) et par l’hyper-connexion, imprègne immanquablement l’expérience sexuelle. Et modifie les figures, les intensités et
le sens même de l’érotisme pour chacun des sexes et dans les divers couples. Le
corps social peut-il entendre comment “ça jouit“ ou comment “ça empêche de jouir“ ?
Les sociétés ont l’habitude d’écarter la jouissance – scandaleuse,
sale ou purifiée – dans les coulisses du sacré, tabous ou hérésies, ou de
la sublimer en arts. Aujourd’hui, en dénonçant des hommes de pouvoir, financier, politique, culturel,
qui les ont brutalisées, soumises et violentées, des femmes exigent, en
substance, que la jouissance féminine fasse partie intégrante des droits
humains. Par-delà la plainte et l'accusation, leur acte transgressif, révolté et libérateur, est surtout un acte fondateur d’une
nouvelle identité, qui énonce de nouveaux droits universels. C’est l’urgence de
vivre, de sur-vivre, de revivre qui s'exprime dans cette prise de parole
publique. C’est ainsi que je l’entends, avant toute procédure de réparation
nécessaire pour se recréer soi-même à neuf.
Vous semblez avoir néanmoins quelques réserves sur
cette prise de parole. Qu’est-ce qui pourrait vous gêner dans ce mouvement ?
JK - Je partage la souffrance et j’adhère au combat. C’est
le point de départ de la liberté. Le plus difficile reste à faire. La parole
prise fait exploser l'omerta, elle traverse le trauma, elle frappe, elle se
venge, et demande des comptes ; elle se dresse dans l'espace public,
médiatique, juridique, politique. C'est énorme. Simone de Beauvoir, protégée
par ses origines et sa trempe d’intellectuelle majeure, n'a pas eu à mener
cette bataille pour prendre la parole ; à travers toute son œuvre, la
philosophe invite les femmes à comprendre le sens de la liberté, qui est la “seule
capable de fonder la valeur d’une vie“, mais qu’elle reste “toujours
à conquérir“ ; elle consiste à nous transcender : au sens de nous dépasser vers un
ailleurs, une altérité qui se trouve au sein de notre condition humaine. “Seul
ce dépassement rend possible la parole“.
Quel lien faites-vous entre la parole prise et la parole libérée ?
JK - La prise de parole contre les délits sexuels et sexistes
nous appelle à repenser et à réinventer la liberté sexuelle dans les couples,
quels qu’ils soient. La rencontre érotique, où la bisexualité spécifique se dépense et s’ajuste – ou non – avec celle de l’autre, est une expérience unique. La parole libérée construit un langage en mouvement, infiniment ajusté,
incisif et approfondi, aussi risqué et coupant que subtil, qui demande du tact,
de l’écoute, du temps, pour s’affranchir de la censure, de l’autocensure, des
discours préfabriqués, des “éléments de
langage“. Il ne s'agit pas de demander aux femmes traumatisées d'écrire de
l'autofiction.
Dans Les Parleuses, deux femmes se livrent-délivrent à
bâtons rompus, éclats décousus-recousus, qui jettent une nouvelle lumière sur
la “star“ Duras elle-même… Est-ce que le streaming virtuel des “me too “ suffit à nous libérer des outrages, au sens de les dépasser ? J'en doute. Le partage avec une présence vivante, le
face-à-face complice et lucide, s’imposent pour amorcer, après le cri de la maltraitance,
le long parcours de la renaissance, forcément spécifique, de la personne
humiliée et offensée. Car tel est le vrai enjeu : de longue haleine et
pour tous les sexes.
Ce parcours personnel est-il menacé par l’accélération de l’information ? Par l’intégrisme ?
JK - L’insistance sur la liberté comme dépassement
de soi s'est imposée à moi, parce que, trop souvent, des femmes, et des
hommes aussi, définissent la liberté comme un choix : “C’est mon choix de
porter le voile et de rejoindre Daesh“. Telle cette adolescente, dont on a
rappelé les épreuves au séminaire “Le besoin de croire“ (Maison des
adolescents, hôpital Cochin, où l’on accueille
aussi des adolescents en voie de radicalisation), qui déclarait : “Je suis
féministe, les hommes ne m’intéressent pas, seul Allah dit la vérité, et je
veux lui donner beaucoup d’enfants“.
Il a fallu le long et patient travail d’une équipe
multiculturelle, mixte et interdisciplinaire (sociologues, psychologues,
philosophes, psychanalystes), qui ne jugeait pas la croyance de la jeune fille,
mais s’adressait à sa détresse
secrète, pour qu’elle s’autorise à parler librement –
d'abord de ce qui avait été jusqu’alors indicible, et ensuite de ses désirs. Liberté de se raconter, de rire et jouer avec
l’équipe, de reprendre ses cours de français et de philo
(“langages de colonialistes“) qu’elle séchait, de faire confiance à une thérapeute femme, de lire les poèmes d’amour des
mystiques musulmans… Accepter que la liberté de jouir de son corps est un droit
inaliénable et partageable. Et renoncer à la maternité prolifique, envisager
une formation d’infirmière.
Dans le cadre du prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes, nous avons
pris l’initiative, avec Sihem Habchi, qui en est aujourd’hui la présidente, de
demander à l’Académie de Paris puis au ministère de
l’Éducation nationale, de mettre aux programmes des collèges et des lycées des
extraits choisis de Beauvoir sur la liberté des femmes. La réponse était positive, évidemment le projet est resté dans
les tiroirs.
Avez-vous quand même été surprise par la dureté des
témoignages exprimés depuis des semaines ?
JK - Ce n’est pas tellement la dureté des témoignages qui m’a
surprise – les divans des psychanalystes ne sont-ils pas faits pour
entendre l’insoutenable ? - mais plutôt l’ampleur de leur résonance dans
les médias et auprès de tant de femmes qui s’y sont reconnues. A se demander
comment une minorité d’entre nous ont pu échapper à cette barbarie ! Pourquoi “ça“ ne m'est pas arrivé à
“moi“ ? Sexisme, xénophobie, je connais, l'étranger, l'étrangère supporte ce que personne n'accepterait à sa
place ?
Dans mon pays natal la Bulgarie, ayant commencé à travailler
comme journaliste pendant mes études au lycée puis à l’université, j’étais exposée à des milieux socioprofessionnels
dominés par une oligarchie masculine qui usait et abusait de ses pouvoirs et désirs ? Aucune “philosophie dans le boudoir“, qui
reste une célèbre exception française des
Lumières, aucun enseignement laïque de la
morale, et encore moins d’éducation sexuelle des filles et des garçons n’était imaginable et susceptible de me protéger. Il est
vrai qu’avec une mère darwinienne qui me soutenait en douce, et un père croyant
orthodoxe que je traitais de dinosaure conservé dans la naphtaline des
religions, j’avais été initiée dès le plus jeune âge à “prendre la parole“.
A défier le “pouvoir phallique“ qui se fâchait
tout rouge, mais qui m'emmenait toujours avec lui pour assister aux matchs de
foot. Féministe sans le savoir, mon père était fier de ses deux filles et, tous
les dimanches à table, il nous offrait un peu de vin dans deux verres à
liqueur, pour que l'on apprenne à “ne pas se
laisser berner un jour par on ne sait quoi “, et à “prendre du plaisir avec goût“. Mais c'est le docteur Freud qui m'a tout
appris.
L’éducation sexuelle est-elle donc une question politique à réactiver ?
JK - Bien sûr ! Pendant la campagne présidentielle, dans
l’émission au titre légèrement satirique sur France Inter : Moi Président,
j’avais suggéré de commencer par prendre au sérieux l’apprentissage de la
parentalité : relancer l’école des parents, sensibiliser pères et mères à l’égalité
des sexes, à la sexualité infantile et
adolescente, à la place de l’autorité et du respect dans l’échange des humeurs,
des émotions et des langages. L’accompagnement personnalisé de la
psycho-sexualité, adapté à l’âge, s’impose
évidemment à l’école.
La culture du marketing hyperconnecté, qui favorise la pensée
calcul et l’isolement, exerce si bien son emprise sur les relations sexuelles,
que beaucoup les considèrent elles aussi comme des prestations ou des transactions.
L’espace intérieur de la
personne se délite et se dissémine dans la Toile, une anxiété liquide s’ensuit,
livrée aux promesses virtuelles de satisfactions absolues, paradis du hard sex
ou d’une guerre sainte mortifère.
La médiation d’adultes est nécessaire entre
le jeune internaute et les réseaux, pour reconstituer l’intériorité psychique. Il faudrait un “corps enseignant“ revalorisé et mieux formé, accompagné de tuteurs ou référents. La sécularisation est la seule
civilisation qui manque de rites d’initiation pour les adolescents. Il ne s’agit
pas de diffuser les traditions religieuses, mais de les interpréter. Et de
cultiver le désir de savoir, d’assumer et d'élucider ses pulsions et ses désirs.
Mais comment les mouvements féministes, aujourd’hui,
divisés peuvent-il s’ajuster à ces questions ?
JK - L’émiettement du féminisme fait partie de l’émiettement
du politique lui-même. Cependant, un autre mouvement accompagne cette dépolitisation
générale. Des geeks “sans parti“ se
découvrent humanitaires et lèvent des milliards pour distribuer de l’eau
potable en Afrique… D’une autre façon, beaucoup de
femmes, qui ne se reconnaissent pas dans les féminismes officiels, s’inventent
leur “féminisme personnel“, en défendant leurs
droits, en famille et dans l’entreprise, en développant leur créativité, en innovant les mille et un sentiers de
l’émancipation.
Le féminisme a impulsé la recherche, notamment
psychanalytique, et l’écriture d’hommes et de femmes, qui éclairent plus que
jamais dans l’histoire le “continent noir“ de la sexualité féminine : l’érotisme de l’amante n’est pas le même que celui de la mère ; la bisexualité
est plus développée chez les femmes que chez les hommes ; excitabilité et homo-érotisme, frigidité,
masochisme et sadisme – au féminin ; pas plus narcissique que les
hommes, mais avec un besoin impératif d’objet, de lien, de monde ; et une
jouissance qui n’est pas seulement phallique mais implique tous les sens, exil
et perte de soi dans l’autre, dans rien…
Cette écoute, ces explorations qui ne cessent de s’affiner
restent hélas méconnues par l’opinion et la
culture dites générales, fussent-elles féministes. Le courant féministe “Psychanalyse
et politique“ avait créé des groupes de parole où les femmes échangeaient sur le plus intime, échecs ou prouesses, et s’entraidaient
pour affronter les aléas de la vie socioprofessionnelle. Davantage que les
forums virtuels, ces rencontres – ni psychothérapies de groupe ni
revendications sociales, mais laboratoires de la parole libérée – ne
seraient-elles pas à réinventer, à repenser ? Après et par-delà la plainte
et sa juridicisation, le temps est venu de rebâtir les passerelles entre la politique de l’émancipation et la connaissance de l’expérience sexuelle. Mais aussi d’ouvrir la parole sur un “autre continent“,
lui aussi en mutation : la sexualité masculine.
La sexualité masculine
serait-elle en crise ?
JK - On a fait l’événement, en tout cas, en soutenant que le
désir masculin n’est pas irrésistible ! Disons
qu’il est analysable. Il se signale, dès les premiers vestiges du sacré préhistorique,
comme une ambivalente dévotion au féminin maternel. La grotte Chauvet exhibe
une vulve géante surmontée ou accouchant d’une tête de bison : le visible de l'invisible,
fascination/identification, attaque et emprise, assimilation/domination de “l’origyne“.
Par la pureté des couleurs et des traits, le peintre-chamane maîtrise ardemment
cette première scène primitive léguée par nos ancêtres,
et seule l’irrésistible course des bêtes sauvages
chassant/chassées trahit les pulsions foudroyées du chasseur qu’il est aussi. Où est passé le mâle ? Disparu, résorbé dans quelques
tracés minuscules. Du fond des âges, il nous signifie que le bison, c’est lui.
Tout au long de l’histoire, les religions encadrent et utilisent ces affects : en imposant des rites de purification et des interdits différents selon les sexes, en utilisant l’homo-érotisme des frères au détriment des femmes-objets d’échange, en exaltant les motions destructrices, le sacrifice et le meurtre. Les dérives fondamentalistes aujourd’hui dévoilent, devant les caméras globalisées, que ces tendances demeurent toujours (à côté et sous les messages pacifistes) : le désir ainsi structuré est un désir de mort. En même temps, et à contre-courant, dans la mixité à l'école et grandissante au travail, l'émancipation des femmes perturbe les hommes, qui ressentent auprès d'elles un “danger d’homosexualité“ (disait Colette) - à moins que ce ne soit un espoir, - et leur sadisme contre elles explose. La liberté au féminin met à mal la puissance patriarcale avec sa superbe virile montée sur viagra, coccaïne et pornographie; elle lui impose, elle lui impose de s’adapter, de se réinventer.
La sécularisation, qui fait face à cette
modernité, souffre d’une disjonction : d’une part, la “mort de Dieu“, avec les valeurs et la justice des Droits
humains, représentent "la seule limite opposable" (Georges Bataille)
à la tyrannie des pulsions et aux outrages des personnes ; de l’autre, il
revient aux sciences humaines, aux “cellules psychologiques“ et à la psychanalyse en particulier de “prendre en charge“ les
cas pathologiques, “porcs“ compris, d'élaborer des soins et de sécuriser la
paix sociale. Les savoirs ne manquent pas. Mais il reste beaucoup à faire pour
libérer la parole sur le malaise de l’identité masculine aussi. Et puisque les
démocrates sécularisées manquent de
“lien unifiant“ qui puisse étayer et éclairer la refonte en cours de la
virilité - et c’est peut-être tant mieux ! - ce sont les arts et les
lettres qui, communions fugaces, comblent par intermittences le manque à être
un homme libre.
Hannah Arendt
Mélanie Klein
Le “phénomène
Johnny Hallyday“ en serait un exemple ?
JK - Le rock and roll vrillé au corps du
désespoir et des envies mâles ne détruit pas le héros viril. Il s’en empare, il
en joue, il rend sa démesure aimable. Et nous sommes tous des bêtes de scène,
le temps d’une chanson. Le temps d’une vie, c’est autrement plus compliqué.
Comme ses obsèques ont rappelé, ses disques ont
accompagné la vie de beaucoup de personnes et de couples de plusieurs générations
différentes.
JK - En effet, et puisqu’on parle de couple, ce mot, sans
nuances, ne me convient pas. Je cherche un couple différent de ce Couple, qui
grandirait dans l’ombre même du Couple.
Quand la parole se libère pour de bon dans la séduction des regards, des voix
et des peaux, charme des chairs, galanterie et trouble des jeux érotiques :
chacun est double, homme et femme, et la volupté advient à quatre ; chacun
se fait tour à tour bébé, enfant, parent ; surprenants seniors aussi, qui
n’aspirent pas à s’archiver mais à se prodiguer des soins sensibles,
tourbillons de jouvence.
Soucieux de nous affranchir des normes et des conventions,
nous oublions que l’hétérosexualité, au sens d’une expérience amoureuse entre une
femme et un homme, est une création historique récente, fragile. Je ne parle
pas de l'acte sexuel, programmé dans notre ADN de mammifères. Il ne s’agit pas non plus du mariage, qui a longuement désigné l’alliance entre hommes, familles et clans
(selon Lévi-Strauss, étudiant les
systèmes de parenté dans les sociétés dites primitives). Avant qu'on en fasse
explicitement un instrument de la procréation (dans le monde indo-européen, maritare renvoie à
apparier les guerriers, et c’est très tardivement que le mot se confond
avec matrimonium, spécifiant
que ce n'est pas une femme qui est “prise“, mais une matrice pour enfanter).
Enfin, le principe d'égalité induit par le contrat social des démocraties
avancées (mariage pour tous) “neutralise“ (plus qu il ne “naturalise“) le mariage.
Il a fallu des millénaires pour que l’intimité entre deux personnes incommensurables, le corps-à-corps des
pulsions de vie et de mort puissent être nommés, partagés et revendiqués par
les hommes et par les femme. Pour que l’amour s'introduise dans le lien
homme/femme et dans l’espace familial : après l’amour platonicien du Vrai et du Beau qui
sublime l’homosexualité grecque, le Cantique
des cantiques des Hébreux valide pour la première
fois la parole amoureuse d’une femme, la Sulamite, pour son berger-roi. Avant
que le fin' amor courtois n’ouvre la voie à la grande littérature de l’Occident
amoureux, libertin, romantique, moderne et post-moderne. Tandis que le yin-yang
du taoïsme, en écho aux sociétés matrilinéaires,
revendique une égalité entre les sexes, mais sans trop fouiller le psychique.
Le couple hétérosexuel, marié, continue
donc à fasciner les imaginaires. A la fois banalisé et caricaturé jusqu’à la nausée (dans les opéras de savon américains, le vaudeville bourgeois), ringard voire obsolète (à
la longue, au regard de la PMA, GPA, le clonage, etc.), carrément impossible
(avec des humains androgynes, ou porcs, en transit dans leurs prestations-
transactions), et cependant point de mire en lieu et place de “nos valeurs“,
– il se profile avec le désir de parer à la solitude, de se prolonger et
de transmettre.
Oui, les témoignages #balancetonprorc nous renvoient à la sexualité masculine, et plus encore à l’hétérosexualité. Qui ne réside pas dans la seule
différence anatomique entre mâle et femelle, et n’est pas non plus le seul
moyen de transmettre la vie ou de garantir la mémoire des générations. Mais une
expérience érotique d’une extrême intensité et qui recèle de ce fait une
insoutenable fragilité.
Julia Kristeva
Pourquoi considérez-vous le mariage comme un des beaux arts ?
JK - Il s’agit d’une
passion qui défie toutes les autres et s’assume dans l’espace social. C’est
seulement sur la base de cette maturité que l’acte juridique, quand il s’y ajoute, protège la génitalité du couple hétérosexuel, dont Freud pensait qu’elle “rompt la liaison de masse propre à la race et à la
communauté“, “à la partition en nation et à l’organisation en classes de la
société et accomplit des opérations culturellement importantes“.
L’hétérosexualité ainsi vécue n’est pas un fleuve tranquille,
puisqu'elle est d’emblée un estrangement, une
discontinuité : “je suis autre, seul/e face à cet autre radicalement différent“.
Fusion et confusion de l’homme et de la femme, pères et mères séducteurs
interdis ; perte exubérante d’énergies et d’identités ; affinité de la vie avec la mort ; et la procréation, au zénith.
Elle transgresse les identités sexuelles et les codes conventionnels, mais ne
procède pas de l’effroi, ça et, au sommet
de la dépense, l’angoisse, le désir et le plaisir s’élèvent en jouissance qui
les annule. Le duo hétérosexuel est cet accordage qui n’évite ni la densité acérée
(une tauromachie) ni les abîmes du désir à mort (assassinat, suicide). Comme un
des beaux-arts. Le mariage pourrait-il en être le lieu ? Oui, à certaines
conditions : faire du couple un espace de pensée, avec le droit de dire “je
ne suis pas de ton avis“ ; et de “se voyager“ : investissements
personnels et trajectoires avec des tiers, ajustements permanents,
libertés réciproques et fidélité fixée au tiers absolu, notre enfant.
Au fond, seriez-vous une féministe atypique ?
JK - Je ne me reconnais pas dans les mouvements militants :
réaction phobique résiduelle de mes jeunes années dans un pays totalitaire ?
Exigence de singularité que la pratique psychanalytique consolide ? En mai
68, un peu plus de deux ans après mon arrivée en France, les manifestants
entonnaient l'Internationale sur les barricades : “Nous ne sommes
rien, soyons tout“, et moi j’entendais L’Homme du sous-sol de Dostoïevski : “Je suis seul et ils sont tous“, et je me
disais : “Je suis seule, AVEC tous et toutes“. Et cela continue, à
la recherche des diversités… à diversifier… Liée d’abord aux féministes
ouvertes à la psychanalyse, on me définit maintenant comme “différencialiste“ (attentive à la différence entre les sexes) plutôt que comme “universaliste“ (adepte
de l’ « égalité
ontologique »). J’ai vite repéré les
tendances dogmatiques, l’uniformité idéologique
cimentée autour de LA chef. Le féminisme m’est apparu comme le dernier des
mouvements d’émancipation hérités de la Révolution française, qui voulaient libérer tous les bourgeois, tous les
prolétaires, tout le tiers-monde, et maintenant toutes les
femmes. Avant de sombrer dans le totalitarisme, parce qu’ils avaient oublié que
la liberté est une chance au singulier.
Sous le titre provocant Le Génie féminin, j’ai essayé de sonder l’existence et les œuvres de trois
femmes qui incarnent cette liberté au XXe siècle : Hannah Arendt pour la philosophie, Mélanie
Klein pour la psychanalyse, et Colette pour la littérature. La vie, la folie,
les mots. En invitant chacun, chacune à mettre en question la pensée, le
langage, le temps et toute identité qui s’y abrite. Par le polymorphisme sexuel
qui se dessine dans l’ère planétaire,
chaque personne réinvente son sexe spécifique en rencontrant les autres. C’est
là que réside sa parole libérée, qui est
tout simplement sa créativité.
Derniers livres publiés :
Julia Kristeva, Je me voyage,
Mémoires (entretiens avec Samuel Dock), Fayard, 2016.
Julia Kristeva et Philippe Sollers, Du mariage comme un
des beaux arts, Fayard, 2015.
|
 |
|---|