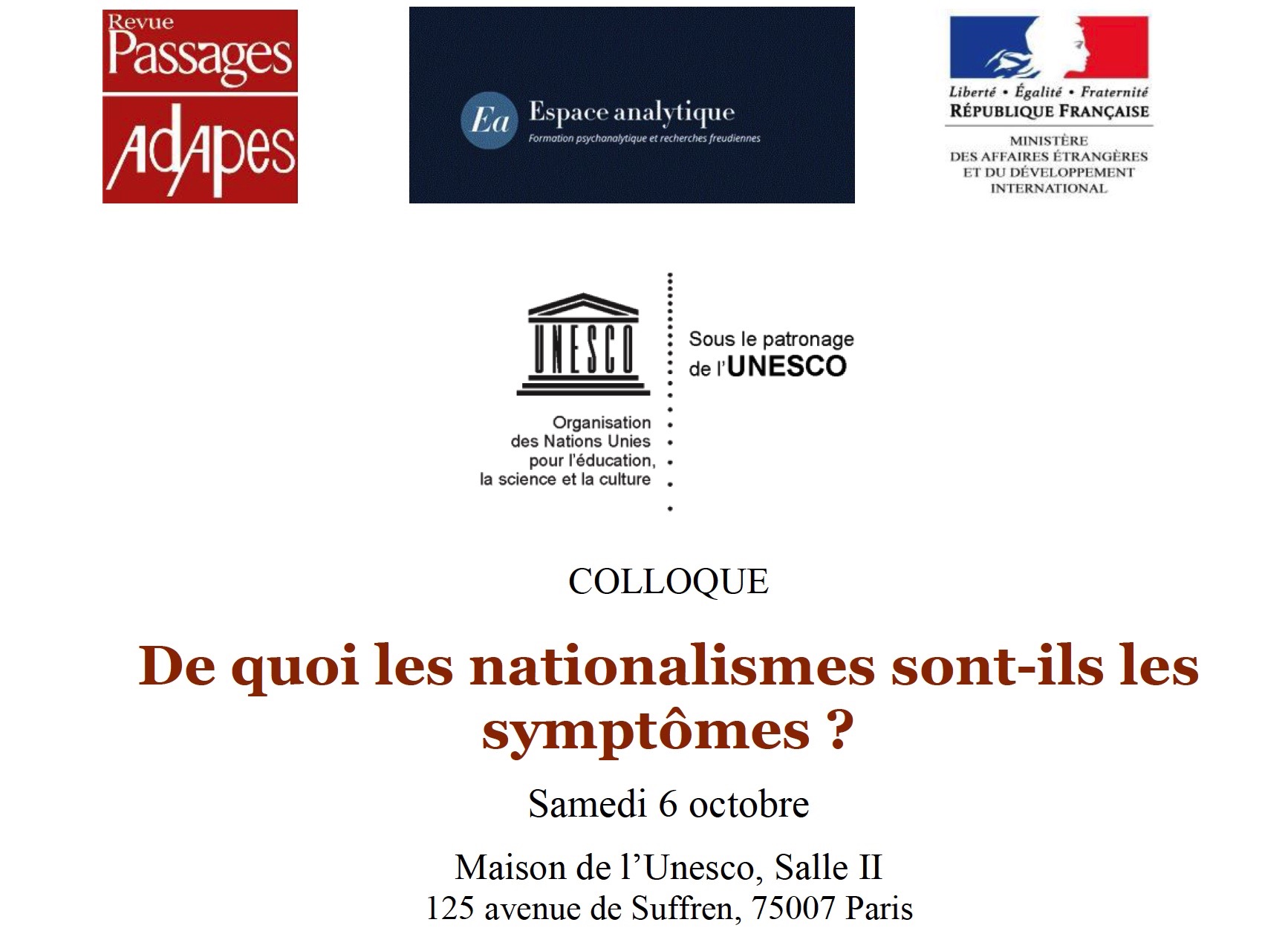|
|
Colloque à l’UNESCO
De quoi le nationalisme est-il le symptôme ?
Dire que le nationalisme est le symptôme implique
qu'on y entende une idéologie qui fait de l'identité nationale une crispation
identitaire, une bombe à retardement, menace mortifère et guerrière.
Comme tous les symptômes, les nationalismes
(au pluriel) expriment des souffrances innommées qui sous-tendent la
vertigineuse question de l'identité aussi
bien que les évolutions historiques, juridique et politique de l'Etat-nation.
Sans ignorer cette histoire, j'essaierai d'aborder les nationalismes tels que je les vis dans un contexte actuel sans précédent, fait de dépressions
nationales, de flux de migrations, de poussées intégristes religieuses, d'escalades
nationalistes défensives et agressives, le tout amplifié par l'hyperconnexion.
Et je prends le risque de simplifier, consciente d'ouvrir une boîte de pandore
que l'idéologie nationaliste ne parvient plus (pas?) à dissimuler.
Je vous propose donc de penser que les
nationalismes sont les symptômes de l'échec de l'humanisme face à deux
réalités de la globalisation numérisée que sont l'étranger et le transcendance, dont elle profite, qu'elle dénie
mais qui la menacent. Immense problématique, et je ne saurai que
l'esquisser rapidement. Les étrangers que le nationalisme craint pour de
vrai ou utilise en bouc émissaire de ses défaillances internes. La transcendance que la gestion technique de l'Etat-nation a du mal à traduire, et échoue en
conséquence à accompagner efficacement pour former les citoyens-internautes
dans leur besoin d'idéaux et leur besoin de croire, qui demeurent un
constituant du anthropologique universel.
1. L'étranger hante
la globalisation
En effet, nous le constatons
tous : l'étranger hante la globalisation : Italie, Hongrie,
Venezuela... Rien à voir avec un spectre, comme ce fut le cas du spectre du
communisme qui hantait la Sainte Alliance européenne (selon le Manifeste du parti communiste) il y a plus d'un siècle et demi.
L'insoutenable présence des étrangers est autrement plus disruptive et réelle, de
l'extérieur et de l'intérieur de nos frontières, bien que lourdement
chargée, aussi, de fantasmes imaginaires. A peine ont-ils levé les yeux de
leurs selfies hyperconnectés, les tweetos natifs se réveillent étrangers dans
leurs propres pays. Les uns, terrifiés par la déferlante migratoire, ce
« grand remplacement » ; les autres, sonnés de se reconnaître
étrangers eux-mêmes, parce que provisoires auto-entrepreneurs de l'uberisation
trans-frontalière ; chômeurs ou agriculteurs des territoires
désertifiés ; enfants qui ne petit-déjeunent pas avant la classe ; et
autres « diversités » parmi les laissés-pour-compte du
« système ». Sortis de la Toile, les likers et les followers perdent l'illusion virtuelle de « vivre ensemble », ils n'y croient
plus, ils sont étrangers en quête d'un pays qui n'existe pas. L'hyperconnexion
jouxte le dépaysement, la post-vérité et les fake news provoquent
et attisent le sentiment – le ressentiment – d'étrangeté.
En 1988, il y a plus de trente ans,
j'ai écrit Étrangers à nous-mêmes qu'on a pris pour un livre. C'était un
cri. Et je voudrais aujourd'hui en faire entendre quelques accents, persuadée
que nos réflexions ne pourraient atteindre leur sens qu'à condition de rester à
l'écoute de cette condition humaine qui met en question l'Etat-nation et peine
à croire en la raison politique elle-même.
« Étranger : rage étranglée au
fond de ma gorge, ange noir troublant la transparence, trace opaque,
insondable. Figure de la haine et de l'autre, l'étranger n'est ni la victime
romantique de notre paresse familiale, ni l'intrus responsable de tous les maux
de la cité. Ni la révélation en marche, ni l'adversaire immédiat à éliminer
pour pacifier le groupe. Étrangement, l'étranger nous habite: il est la face
cachée de notre identité, l'espace qui ruine notre demeure, le temps où
s'abîment l'entente et la sympathie. De le reconnaître en nous, nous nous
épargnons de le détester en lui-même. Symptôme qui rend précisément le «nous»
problématique, peut-être impossible, l'étranger commence lorsque surgit la
conscience de ma différence et s'achève lorsque nous nous reconnaissons tous
étrangers, rebelles aux liens et aux communautés.
L'«étranger », qui fut l'«ennemi»
dans les sociétés primitives, peut-il disparaître dans les sociétés modernes
? »
Cette étrangeté essentielle, que les
diverses variantes de la sédentarisation - en alternant
« ensouchement » et exils -, avaient plus ou moins cicatrisée, la
globalisation livrée au virtuel la réveille brutalement. L'Etat-nation est-il
encore le contenant optimal de cette nouvelle humanité aspirée par « un
pays qui n'existe pas » ? Ma réponse est « oui » ; la
nation est un antidépresseur, à condition de se relier, mais à quel
prix ?, aux ensembles supérieurs, régionaux et culturels (l'Europe par
exemple). Un anti-dépresseur qui ne peut plus se passer du « genre
humain ». Mais qui se doit, avec cela, de reprendre, interroger et refonder non seulement des cultures nationales, mais aussi la mémoire
des religions constituées, qui prétendent posséder un « lien
unifiant », un lien transcendant les communautés ethniques et politiques
historiquement constituées. Et de refonder l'humanisme universaliste lui-même, qui s'en est séparé, qui les interroge et s'interroge.
2. Un
anti-dépresseur, la nation
Pourquoi cette non-appartenance au
groupe (famille, clan, tribu, nation, « système ») qui spécifie
l'étranger de l'intérieur et de l'extérieur porte-t-elle atteinte à mon
identité et me menace-t-elle même d'effondrement identitaire ?
Parce que l'identité est une
constituante incertaine, de solidité relative et fragile, c’est bien l’appartenance
au groupe qui la rassure quand elle ne la constitue pas en définitive.
Rappelons-nous le constat de Marcel Proust : en France la maxime de Hamlet, «
Être ou ne pas être » est devenue « en être ou ne pas en être » -
célèbre formule reprise par Hannah Arendt, et qui réplique au sarcasme de
Voltaire : « On se fait dévot de peur de n’être rien »… Pour l’être parlant que
nous sommes, le groupe (famille ou nation) ne nous garantit pas seulement une
continuité biologique (naturelle) et économique (qui consiste à bénéficier des
biens de subsistance), le groupe construit et abrite le sens, cette
dimension constitutive de l'être humain. De mon langage, de mes valeurs, de ma culture historique le
groupe est l’habitat (le mot grec ethos, signifie initialement
« habitat »). Le groupe accomplit l'éthique ! L’être parlant que
je suis habite ses géniteurs, leur tradition et leur langage qui sont mon ethos,
mon éthique.
On comprend donc que d’en être
(d'appartenir à un groupe, une famille, une nation) puisse agir comme un
antidépresseur. Qui comporte des effets secondaires toxiques. La famille et la
nation qui sont mes antidépresseurs dégénèrent - hélas ! - vite en passion
maniaque persécutée/persécutrice et autodestructrice. Mais (à l’étape actuelle
de l’existence de l’Homo Sapiens), mon identité en a structurellement besoin,
or l'étrangeté, les étrangers mettent cette identité en danger et risquent de
la détruire.
En stigmatisant à juste titre les
dérives nationalistes, certaines idéologies progressistes ont sous-estimé,
voire dénié le sens fondateur et la valeur consolidatrice de l'identité
nationale.
Bien sûr, la globalisation effrénée
doit être régulée et optimisée. Ces processus sont en cours, mais elle impose
et imposera des modifications accélérées des identités nationales. Mais quand
nous nous révoltons à juste titre contre le populisme, n'oublions pas les
accents populistes des fondateurs de la nation républicaine elle-même dès ses
commencements. Ainsi, Sieyès « Le peuple toujours malheureux ».
Robespierre : « Les malheureux m'applaudissent ». Gare,
donc, au déni qui brutalise cet anti-dépresseur qu'est la nation, et
dont Giraudoux disait : « Les nations comme les hommes meurent
d'imperceptibles impolitesses ». Nos dénis ont souvent été bien plus
que des impolitesses.
Nous sommes appelés, par la force de
l'économie, des médias, de l'histoire, à cohabiter avec et entre étrangers dans
un pays, la France, elle-même en voie d'intégration dans l'Europe menacée de
désintégration. S'achemine-t-on
vers une nation-puzzle faite de diverses particularités, dont la dominante
démographique est pour l'instant française - mais jusqu'à quand ?
Pour la première fois dans l'histoire,
nous sommes amenés à vivre avec des « diversités », en misant en priorité sinon uniquement sur des codes moraux personnels, sans
qu'aucun ensemble embrassant nos particularités ne puisse les contenir,
orienter, transcender.
3. Le national et
l'universel
Le cosmopolitisme étant né dans
l'ensemble culturel européen, rappelons-nous quelques-uns de ces moments. Il
fut d'abord panhellénnique, confronté à un brassage de populations sans
précédent et qui cherchait déjà une universalité élargie. « Je
suis homme et rien de ce qui est humain ne m’est étranger » (affirmait
Ménandre, repris par Térence), et les stoïciens (Zénon de Citium et Chrysippe)
préconisaient une « conciliation universelle », l'oïkéïosis, qui se traduit comme « toucher intérieur », mettant l'humain
en contact avec lui-même et avec les autres. Nous en avons hérité des termes
comme conciliatio, commendatio (utilisés par Cicéron), comitto (Sénèque), la caritas generis romani (Cicéron aussi).
Le judaïsme insiste sur une autre
logique, transcendant celle de la conciliation : c'est la logique de l'élection (de « élire » : bahar, jeter un regard) mais qui va
se cristalliser en alliance, c'est-à-dire en engagement, responsabilité
et fidélité, dans l'épreuve. L'élection comme épreuve, l'épreuve comme élection.
L'Ecclésia de Paul de Tarse,
puis chez saint Augustin, vise une synthèse entre le toucher intérieur des stoïciens et l'élection selon la Torah, qui pousse au-delà de soi
vers l'Altérité absolue. Elle s'appose plus qu'elle ne s'oppose au « peuple » (laos) et prône la communion, une
« nouvelle alliance » des étrangers.
D'autres religions, d'autres cultures
tentent d'autres ajustements du même, de l'autre, de l'universel, qui seront
évoqués aujourd'hui, et en particulier concernant l'Islam qui focalise les
passions et les conflits aujourd'hui et dont va vous parler Fethi Benslama.
Vous le voyez, dès que l'homme se révèle
étranger, c'est-à-dire en quête d'un pays qui n'existe pas, se pose la question
inéluctable de l'universalité transcendante à travers ou par-delà la
famille, le clan, le groupe, le « système », la nation. Garde-fou
contre l'absolutisme nationaliste, et prophétie des temps modernes ?
Ainsi, et dès la naissance de la pensée politique moderne elle-même (avec
Montesquieu notamment), se met en place un réseau de sécurité qui devait
empêcher que le social et le politique ne se confondent en un ensemble
totalisant et totalitaire qui risque de liquider toute possibilité de liberté,
posée comme consubstantielle au « genre humain ». Font partie de ce
réseau de sécurité la séparation des pouvoirs, et la juridiction raisonnable du politique, du social, du privé, du secret même,
assurant ainsi la coordination des personnes dans leurs singularités. C'est à
partir de sa position d'étranger (ne critique-t-il pas la monarchie à
partir des Lettres qu'il appelle « persanes ») que
Montesquieu pose les bases d'une philosophie politique de « la totalité
de l'espèce », dont je vous rappelle cette phrase inoubliable qui
empile les cercles concentriques des groupes humains, communautés
identificatoires, protectrices et perméables : « Si je savais
quelque chose qui me fût utile [à moi, à ma famille, à la nation, à l'Europe]
mais qii fût préjudiciable au genre humain, je la regarderais comme un crime ».
Avec la Révolution française cependant,
et déjà dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (votée
en août 1789), il apparaît évident combien cet horizon universaliste demeure un horizon... que la gestion politique abandonne subrepticement. Ainsi,
la notion universelle de « genre humain » - « les hommes »,
cède sa place à ce que la Déclaration appelle l'« association
politique » historiquement « essentielle » : c'est-à-dire
la nation. D'emblée, l'humanisme politique universaliste repose sur un
paradoxe :
- Art. 1. « Les hommes naissent
libres et égaux en droits... ». -
Art. 6. « La loi est l'expression de la volonté générale, tous les
citoyens ont le droit de concourir... à sa formulation (de la loi)... ».
Pas « tous les hommes » : mais « tous les citoyens » !
De fait, l'homme naturel a beau être
universel, dès qu'on le pense comme politique, il est national. Ce
glissement du raisonnement va conduire, avec le développement des sociétés
occidentales, à la création des Etats-nations et, par dérivation ou déviation,
à sacraliser la nation, dans la flambée des nationalismes au XIXe, XXe siècles
et aujourd'hui au XXIe siècle. (Les ténors du post-communiste illibéral et
nationaliste en Europe de l'Est attaquent la chancelière Merkel pour avoir
« oublié que le passeport allemand est sacré ».)
Kant lui-même, qui prônait la Société
des nations (« une force unie et une décision légale de volonté
unifiée ») mettait en garde contre « l'insociable sociabilité
des humains », et prévoyait déjà ces dérives. Il ne maintenait son
pari sur une possible « hospitalité » et « générosité
volontaire », qu'à partir d'un constat naïf : elles
s'imposeraient « tout simplement parce que la terre est ronde ».
Et je traduis : parce qu'il nous faut sauver la terre, par l'écologie,
dirait-on aujourd'hui, puisque notre planète reste l'ultime bien unifiant du
« genre humain », et combien fragile aujourd'hui encore.
***
La Shoah et les guerres
inter-communautaires, qui continuent de plus belle au XXIe siècle témoignent en
effet du fait que, malgré les avancées considérables (qu'il ne faudrait pas
nier) de « l'impératif moral », ni la finitude ni le dérèglement
climatique de la planète, et encore moins les ajustements politico-juridiques
du droit international, ne parviennent à résoudre les difficultés
socio-politiques des étrangers que nous sommes.
Nous sommes plus impuissants encore
face à la poussée vers l'Au-delà, qui s'empare de chacun, et plus
dramatiquement encore pour ceux qui, exposés aux échecs de l'intégration,
lâchent la bride à la pulsion de mort et basculent dans le totalitarisme.
Loin aussi de la volonté unifiée de
Kant, pensons aux difficultés, voire au délitement des institutions
internationales universalistes (Onu, Unesco, OMC, etc.) qui manquent de moyens
pour assumer l'éducation (entre autres) et peinent aussi à freiner les
manœuvres des nations belliqueuses.
Face à cette crise de la « connivence »
et de la « conciliation », au sein des nations diversifiées et
entre les Etats globalisés, le philosophe Habermas, et le juriste Bökendorf ont
fait appel, avec le pape Ratzinger (Benoît XVI), à un retour à la foi
(« Les fondements pré-politiques de l'Etat démocratique », 2004). Mais
quelle foi ? Le dialogue entre les religions ne semble pas capable de
mettre fin aux massacres entre croyants, fussent-ils ceux des trois
monothéismes, et peut-être encore moins entre eux, mais aussi des
non-croyants ; et la sérénité bouddhiste elle-même n'est pas exempte
d'explosions contre les adversaires étrangers.
Les seuls universalismes que la
globalisation propose ou plutôt impose sont ceux du marketing et de la
financiarisation de l'économie, qui au contraire creusent les dichotomies
riches/pauvres, aggravent les endettements et mondialisent l'instabilité.
4. Laïcité et
cohésion républicain
Quelques mots pour finir sur cette
modalité de la nation qu'est la cohésion républicaine. La Laïcité française
conserve la dissociation entre d'une part l'homme universel naturel (c'est-à-dire par essence « divine », comme le veut la Déclaration
américaine) et d'autre part, le citoyen national ; mais elle
réduit progressivement ce dualisme en garantissant la diversité des expériences
religieuses dans la sphère privée, en développant et actualisant les Droits
de l'homme, basés sur le triptyque : liberté, égalité, fraternité.
De longues luttes ont fini par y
inscrire l'égalité – voire la parité entre hommes et femmes, et plus récemment
la reconnaissance des genres et du mariage pour tous.
Mais il ne suffit pas de faire de
« nos valeurs » une liste de prescriptions morales. Il importe de les
étayer par les récits des combats qui ont été menés dans l'histoire
d'une nation en mutation perpétuelle, pour que la liberté, l'égalité et
la fraternité aient un sens pour ceux qui en manquent. Le récit de ces combats doit être connu, enseigné et discuté ? Et ce n'est que le
premier pas. Pour refonder l'ambition universelle de l'humanisme, il
importe que ces valeurs s'incarnent dans l'accompagnement personnalisé des
étrangetés globalisées de chacun.
***
L'histoire de la pensée nous révèle
qu'elle se fait fort de transcender la transcendance en posant un grand point
d'interrogation à l'endroit du plus grand sérieux. L'identité, la nation, le
sens et Dieu lui-même.
Dans le sillage de cette inquiétude
métaphysique, Simone de Beauvoir a appris aux femmes que la liberté n'est pas
un choix, comme on aime à le dire, trop facilement, mais qu'elle réside
dans la capacité à se transcender dans l'autre, autrement dit de se
dépasser hors de soi vers les autres, qui nous menacent, qui nous sont
étrangers, qui nous appellent et qui nous renouvellent, mais qui sont toujours
dans et avec la condition humaine. Oser l'humanisme laïque consiste à ne
craindre ni le nationalisme ni l'intégrisme, mais à accompagner l'anti-dépresseur qu'est l'identité nationale, pour qu'elle ne s'inverse pas en réaction maniaque
et revancharde ; et à conduire aussi le besoin de croire, cette composante
anthropologique universelle, vers le désir de savoir, afin que
l'aspiration à l'idéal ne s'effondre pas en cette « maladie
d'idéalité » qu'est le nihilisme terroriste.
***
J'ai la faiblesse de croire que le
développement des sciences humaines et notamment de la psychanalyse – qui ne
cessent d'approfondir la connaissance de la vie psychique – contribuent à la
refondation de l'humanisme dans sa visée universaliste.
La psychanalyse (qui soutient ici en
grande partie nos réflexions en ce colloque) n'est pas un substitut de la
religion. Freud ne détient pas la paternité de l'inconscient, la psychanalyse
ne prétend pas non-plus que « tout est sexuel ». Elle ne propose ni
un « lien unifiant » par-delà la nation, ni une « conscience
conservatrice » à l'encontre de la ferveur religieuse, ni une corrélation
entre foi et raison.
En fait, la psychanalyse découvre que
l'étrangeté radicale, constitutive de nos identités, est transférable.
Et elle repère la transcendance dans le besoin de croire qui sous-tend le désir
de savoir. Que veut dire « transférable » ? Le transfert est le
lien qui s'établit entre l'analyste et l'analysant, « grâce auquel nous
apprenons que parfois ce que nous croyons nôtre nous est étranger, et que ce
que nous croyons étranger est nôtre parfois ». C'était la définition
de Dieu par saint Augustin.
En introduisant cette entente entre
altérités exigeantes au plus intime de l'homme et de la femme, du citoyen et de
la citoyenne, la psychanalyse met en mouvement les langages, les identités, les
liens, les idéaux. Ce faisant, elle participe à cette refondation de
l'humanisme dont nous constatons aujourd'hui les échecs.
Je ne suis pas optimiste, vous l'avez entendu, mais, pessimiste énergique, je repère, avec mes analysants, et d'une autre façon dans les thématiques qui seront débattues au cours de nos échanges, que seuls l'analyse des échecs nous permettra d'ancrer le lien unifiant dans l'étrangeté ET dans le besoin de croire, immanent de chacun. Pour contribuer à faire vivre cette actualité pratique de la nation qu'est la cohésion républicaine. Je vous remercie de votre attention et je vous présenterai maintenant les participants à cette table ronde.
Julia Kristeva |
 |
|---|