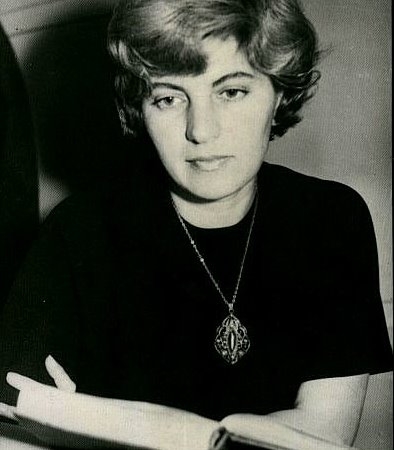|
|
RENCONTRES AVEC JULIA KRISTEVA À LA
CROISÉE DES CHEMINS
par BLAGA DIMITROVA
Simeon Radev, diplomate,
écrivain, journaliste et personnalité publique, qui a eu la chance de connaître le monde comme peu de nos concitoyens ont pu le faire, m’a dit, lors d’une entrevue vers la fin de sa vie, d’un air
rêveur inusité chez lui :
Lorsqu’une Bulgare intelligente, très instruite, talentueuse, parlant des langues étrangères, et belle de
surcroît, va à l’étranger, elle est absolument irrésistible
et sans égale.
Ce grand et fin
intellectuelpensait
aux femmes de sa génération : à la première diplomate bulgare Anna Stancioff, à sa propre épouse, Bistra, qui était peintre et
dont Paul Claudel appréciait particulièrement l’amitié, et aux plus
jeunes : Dora Vallier, historienne et théoricienne de l’art, et la
poétesse Vessela Vassileva trop tôt disparue.
La pertinence de cette observation
s’est vérifiée pour Julia
Kristeva : non seulement en raison de sa notoriété de structuraliste, sémioticienne,
écrivaine, psychanalyste – une notoriété qui nous parvenait en Bulgarie comme un coup de tonnerre et une musique céleste – mais
surtout j’ai pu le vérifier lors de nos rencontres personnelles.
Je me souviens d’une conférence, en 1991 à Vienne, qui a réuni
des intellectuels de l’Est comme de l’Ouest. Julia Kristeva, première
intervenante, allait présenter l’exposé inaugural sous la forme d’un essai
intitulé Étrangers à nous-mêmes.
La salle était pleine à
craquer, intellectuels, étudiants, journalistes attendaient avec
impatience la conférencière, qui, si je ne m’abuse, venait d’un autre colloque en Suède. L’heure était déjà dépassée. La tension commençait à
monter.
Soudain, l’air de la salle
fut comme embrasé par une étincelle électrique. Une jeune femme au port altier, vêtue
d’un tailleur élégant, a fait son entrée. Un murmure s’est répandu
aussitôt : Julia Kristeva ! On l’a invitée à gagner le podium sur
lequel était installée la table où devait se dérouler la discussion. Chacun a pu admirer ses jambes exquises qui font aujourd’hui encore soupirer bon nombre
de ses admirateurs fréquentant les cafés intellectuels de Sofia. Une allure qui
a conquis Paris puis le monde entier ; sa grâce et sa beauté ont séduit mais aussi son talent, sa volonté de forger sa propre
image, et son énergie phénoménale. C’est d’un pas aussi léger
que celui avec lequel elle a escaladé les quelques marches de l’estrade qu’elle a gravi comme d’une traite les hautes marches vers le
sommet de la réussite intellectuelle. Elle a pris sa place avec aisance, et l’on a posé devant elle un carton avec son nom : Julia
Kristeva. Que cela résonnait fièrement ! Mais moi, perdue dans les rangs
du public, j’ai ressenti la charge terrible de ce nom de Kristeva, la lourde
croix « christique » que cette femme portait sur ses épaules
fragiles vers son Golgotha. Et comme nous
l’envions, nous ses
admiratrices bulgares, sans mesurer les efforts qu'elle a inlassablement fournis.
On lui a donné la parole.
Une liasse de feuillets à la main, elle s’est mise à parler sans lire, tournant
de temps en temps les pages, et poursuivant, réfléchissant à haute voix,
complétant en même temps le sujet bien connu, mais passionnant pour le public
comme pour elle : Étrangers à
nous-mêmes. Plutôt qu’un thème, un destin.
… Or, lorsque j’ai décidé d’adhérer au cosmopolitisme, cela
signifiait que ma décision allait à l’encontre des origines et en faveur d’une
position transnationale et internationale, d’un point où se croisent les
frontières...
J’écoutais la confession
d’un destin à la croisée des chemins, comme prédéterminé par ce nom
« christique » de Kristeva. La mélodie de la langue française à travers sa
voix me ramenait à la jeune fille peu loquace que m’avait présentée chez moi
l’inoubliable Tzvetan Stoyanov,
peut-être amoureux d’elle. Une étudiante taciturne, jusqu’au mutisme, des yeux grands ouverts absorbant tout. A l’époque, j’avais frissonné devant l’intensité de ce regard scrutant l’avenir à bout portant. Les années
avaient passé, et j’entendais la
maturité savoureuse de sa voix, acquise
dans cet avenir qui lui était
prédestiné par ses propres ambitions :
… Les premiers étrangers qu’évoque la mythologie grecque sont des
femmes, les Danéennes, dont Eschyle narre les
aventures... Elles sont étrangères dans un double sens : elles ne parlent
pas la langue du pays qu’elles ont fui (l’Égypte) et elles s’opposent à leurs
origines grecques comme au mariage...
J’écoutais et je revoyais
le vieux rédacteur de la revue Zlatorog, le critique Vladimir Vassilev,
qui me demandait avec l’enthousiasme des découvreurs : « Qui est cette Julia
Kristeva ? » après avoir lu sa première publication dans la revue Septemvri alors
qu’elle était encore étudiante. Et ma propre surprise devant l’originalité de
cet article consacré à mes débuts de versificatrice. J’ignorais si je pouvais
me fier à l’intuition de cette jeune fille qui soutenait que mes poèmes
contenaient la prémonition d’une belle prose à venir. C’est peut-être sa prédiction qui m’a poussée à accomplir le saut périlleux vers la rive opposée,
de passer d’un discours rythmé à un discours non rythmé. Je me dois de l’en remercier avec un retard de près de quatre décennies.
Pendant ce temps, son improvisation inspirée devant le public
viennois approfondissait le tragique de
l’étrangeté :
… Après les guerres gréco-perses, après celle du Péloponnèse, à
mesure que le commerce reprend, s’élargissent les contacts des Grecs anciens
avec le monde non grec... Ainsi, Aristote, dans Politique,
applique à la cité-État le terme stoïcien de cosmopolitisme...
J’écoutais et je me
rappelais mes adieux à Julia la veille de son départ pour Paris, la
ville de ses rêves. Tout entière contenue dans ses yeux
étonnés : elle n’arrivait toujours pas à croire qu’on l’avait autorisée à faire une
brève spécialisation sur la recommandation de l’Université de Sofia, où elle
venait de terminer avec brio ses études de lettres françaises. Dans cette époque d’isolement total, derrière le Rideau de fer, permettre à une jeune Bulgare de faire ses études à l’Ouest
tenait du miracle. Je lui ai donné l’adresse d’une de mes amies à Paris,
première escale dans cette ville étrangère, avant de mettre le cap vers
l’immensité de l’aliénation.
… Inconscients, détachés, autres : ainsi créés, nous devions
nous connaître nous-mêmes pour mieux pouvoir embrasser l’altérité universelle
des étrangers que nous sommes...
J’écoutais et j’imaginais
les embûches que doit affronter une étrangère en France. Je la revoyais durant
nos rencontres furtives à Paris – elle, bien
d’aplomb sur ses hauts talons arpentant le pavé parisien, moi, voyageuse inquiète –, en transit vers la
liberté, à travers la langue étrangère, à travers la culture contemporaine.
Julia, organiquement fondue dans l’élégance française, personnifiait à mes yeux
une contemporanéité vibrante. Une femme moderne et indépendante, chercheuse, écrivaine,
flamme du Sud dans le foyer même de l’esprit créateur français :
Barthes, Sartre, Simone de Beauvoir, Philippe Sollers...
Julia continuait à
investiguer les aléas de l’Histoire qui ont des répercussions sur
l’étranger : … Au temps des
persécutions barbares, les gens
étaient loin de la mentalité moderne du droit à la différence...
Et moi, je me rappelais le
récit émouvant de sa propre participation aux événements de 1968, dans
l’agitation des étudiants et des grands intellectuels parisiens. Je la voyais
aux premiers rangs, bras dessus bras dessous avec les émeutiers, surplombés par
le slogan « L’imagination au pouvoir ! ». Au milieu du luxe de
la Closerie, son café préféré, elle me décrivait ces jours tempétueux.
Je tiens toujours à souligner, affirmait Julia avec une inflexion particulière dans la voix, que la terreur révolutionnaire s’en prend
d’abord aux étrangers, que bon nombre de décrets républicains prônent des
répressions brutales contre les étrangers au nom d’un nationalisme égalitaire
qui mène à un totalitarisme potentiel...
Je la voyais m’accueillant
– l’étrangère, c’était elle ? c’était moi ? – dans un appartement d’artiste
douillet situé aux étages supérieurs d’un immeuble de la Rive gauche, me
servant un dîner savoureux préparé à la minute après une journée de travail intensif à la bibliothèque, à l’université, à la rédaction de la revue Tel Quel. J’avais l’impression qu’elle
obtenait tout à la minute avec un talent souple : carrière brillante,
contacts personnels avec les créateurs de l’époque, livre après livre, chacun
devenant un événement, changement après changement dans les remous de la
contemporanéité indomptée...
La conférencière est arrivée au terme de son intervention sans le crescendo
optimiste de service, typique de la plupart des intervenants dans les
innombrables symposiums, colloques, conférences et autres parlottes
d’aujourd’hui. Au contraire, elle a
terminé avec une mise en garde :
L’esprit critique des Français verse ces derniers temps dans la
dévaluation et la haine de soi... Et une flèche finale en forme d’issue
possible : Aux nationalismes
agressifs de l’Est, on pourrait opposer une quête de nouvelles formes de
communauté entre individus différents et libres.
J’ai ressenti de tout mon
être que Julia Kristeva créait autour d’elle un puissant champ énergétique qui,
de près et de loin, injectait au sein de plusieurs générations au fil du temps
et à travers le Rideau de fer, des impulsions de créativité, malgré les
obstacles, malgré l’impossible. Julia a atteint l’impossible. Elle,
l’étrangère, qui plus est face à l’esprit français critique et implacable, a
transformé l’abrupt terrain étranger en un voyage pour s'accomplir. Et le plus
surprenant, c’est qu’elle a le courage de se renier elle-même, de rayer ses
succès, de surmonter ses engouements et de se jeter la tête la première dans de
nouvelles entreprises risquées. La force du dépassement de soi évoqué par
Sartre.
Après son exposé, Julia a
été submergée de questions auxquelles elle a répondu, vive,
fraîche, inlassable. Quelques intellectuels et hôtes viennois l’ont invitée à
dîner afin de poursuivre la discussion passionnante. Elle m’y a emmenée en tant
que compatriote. Bien entendu, préférant rester auprès d’elle, j’ai annulé une
invitation au concert à la Maison Wittgenstein. La présence de Julia, la
musique de sa voix m’étaient indispensables pour me combler de cette énergie
spirituelle universelle qui avait été si cruellement réprimée dans notre milieu
national. L’interdiction qui frappait nos contacts avec le monde nous y incitait
insatiablement.
Au cours du dîner, j’ai eu l’occasion
encore plus frappante de me convaincre de la justesse du propos de Simeon Radev : Lorsqu’une Bulgare intelligente... Nos illustres convives fixaient Julia avec admiration, ne
cessaient de lui poser des questions,
de la relancer pour provoquer ses réflexions captivantes. Ils ont été
particulièrement intrigués par une de ses thèses : La femme est une étrangère toujours et partout – dans les rôles que lui
impose le mariage, dans sa profession, au sein de la société. Pas un
instant elle n’a fait montre de fatigue.
Pas un instant son
attention n’a faibli. Visiblement,
elle était rodée, une acuité et une endurance intellectuelles très enviables. Jusque tard dans la nuit, j’ai profité de
cette fête qui me faisait témoin de
l’existence d’une personnalité
accomplie, après tant de tristes exemples d’élans entravés et brisés, féminins
en particulier.
Toutes deux nous avons souhaité rentrer à l’hôtel
à pied par les rues silencieuses de la
capitale viennoise. Il faisait
nuit. Johannes Schlebrügge, excellent traducteur des
livres de Julia en allemand, nous accompagnait. Nous marchions lentement, plongés dans l’harmonieuse sérénité intérieure que
l’on obtient dans la communication spirituelle. J’écoutais Julia expliquer à
son traducteur telles tournures originales de son discours, telles
particularités individuelles de ses textes. Et je me disais in petto : « Combien notre littérature nationale a
perdu en laissant une telle intellectuelle offrir son talent à la culture française ! »
Et je pensais à ce qu’aurait gagné la Bulgarie si elle avait gardé une
personnalité aussi exceptionnelle en son
sein. Mais n’aurait-elle pas été hélas réprimée, noyée dans la grisaille,
empoisonnée par la médiocrité...
Ses livres sont traduits et
cités dans le monde entier sauf dans son pays natal. Mais est-ce la seule œuvre
à être restée taboue, quoiqu’ayant fait la gloire de la Bulgarie ?
Aussi pénible qu’il me soit
de le dire, force m’est d’avouer qu’une envergure et un don comme les siens
n’avaient pas d’autre choix que l’exil.
Blaga Dimitrova
(1922-2003)
Poète, Ecrivain, Vice-Président de la
République de Bulgarie (1992-1993)
(Version française par Krassimir
Kavaldjiev)
|
 |
|---|