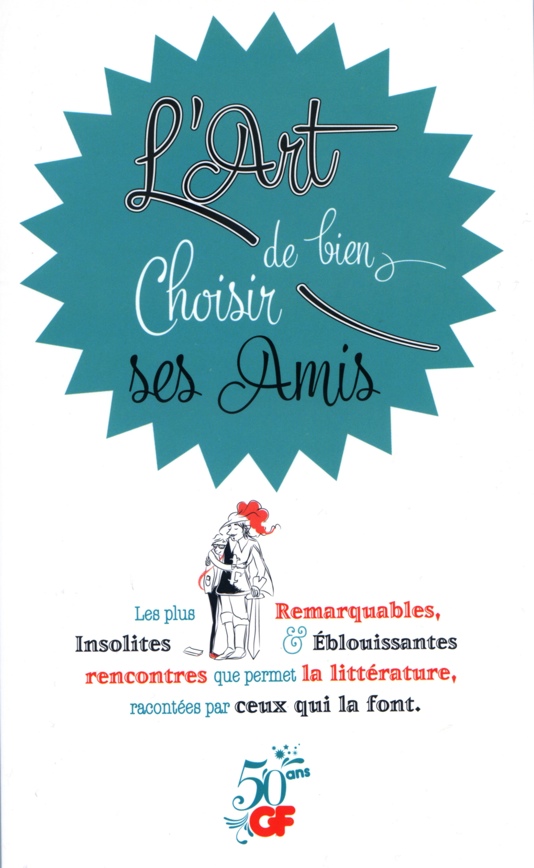|
|
L’art de bien choisir ses amis
50 ans de la GF
TENIR TÊTE À
LA PENSÉE UNIQUE
Quel fut votre premier grand choc littéraire ? Que
pouvez-vous nous en dire ?
JULIA
KRISTEVA : Le français n'étant
pas ma langue maternelle, mon premier grand choc littéraire ne fut pas
français, mais russe : Les Démons de
Dostoïevski, et dans la foulée Crime et
Châtiment, L’Idiot, Humiliés et Offensés. La criminalité passionnelle,
l'idiotisme infantile, la haute intelligence de la souffrance avaient placé
l'adolescente que j'étais dans un culte absolu du prince Mychkine,
qui n'est idiot que parce qu'il est sans rancune. Le crime gratuit de Raskolnikov m'est apparu comme une défense maniaque contre
l'incapacité d'aimer ; je comprenais que Kirilov hissait la liberté humaine à la hauteur de Dieu dont il était persuadé qu'il
n'existe pas ; une seule sortie de la folie semblait possible : le pardon
amoureux de Sonia dans un décor paradisiaque qui rappelle l'Âge d'or selon Acis et Galatée de Claude Lorrain, rêvé
par Stavroguine... Et j'étais prête à croire
Nietzsche, qui constate : « Dostoïevski est le seul psychologue qui ait eu
quelque chose à m'apprendre » avec ces personnages du type criminel. Ces êtres
forts placés dans des conditions défavorables, voués à la peur, aux déshonneurs,
à la dépression suicidaire, dont ils se sauvent et nous sauvent par la grâce
d'un carnaval christique.
C'était avant
que je sois capable de lire les classiques français. Est-ce parce qu'un
perfectionnement dans la seconde langue remet le néophyte dans sa situation
infantile ? Est-ce le hasard de la pédagogie à laquelle j'ai eu droit dans mon
pays natal, la Bulgarie ? Mes premières rencontres avec les classiques français
m'ont plongée dans l'univers de l'enfant. Victor Hugo avec Gavroche et Cosette,
les barricades de la Commune de Paris.
Le français
me ramenait donc à l'enfance, mais une enfance héroïque et mythique, fabuleuse,
visionnaire. À côté du surhomme Dostoïevski, Gavroche me paraissait légendaire
et cependant accessible ; et je trouvais normal de monter avec deux petits
garçons, dans le ventre de l'éléphant de la Bastille, « rude, trapu, pesant,
âpre, austère, presque difforme, mais à coup sûr majestueux et empreint d'une
sorte de gravité magnifique et sauvage », bien qu'il ait été remplacé par une
espèce de poêle gigantesque orné de son tuyau : « comme la bourgeoisie remplace
la féodalité... ». Et j'enviais la rencontre de Marius et Cosette au jardin du
Luxembourg : « Marius avait ouvert toute son âme à la nature, il ne pensait à
rien, il vivait et il respirait, il passa près de ce banc, la jeune fille leva
les yeux sur lui, leurs deux regards se rencontrèrent. Qu'y avait-il cette fois
dans le regard de la jeune fille ? Marius n'eut pu le dire. Il n'y avait rien
et il y avait tout. Ce fut un étrange éclair. »
Beaucoup plus
tard, quand je suis arrivée à Paris pour une nouvelle vie, j'avais beau savoir
qu'il n'y a plus de monument éléphantesque à la Bastille, je ne pouvais pas ne
pas apercevoir Gavroche auprès du colosse disparu, et ressentir « l'effet que
l'infiniment grand peut produire sur l'infiniment petit ». Et je cherchais le
banc au Luxembourg où s'était assise Cosette, avec à son côté Jean Valjean.
Définitivement
réaliste, tout compte fait, le premier poème que j'ai appris à mon fils David fut,
de Victor Hugo : « Sur une barricade, au milieu des pavés... » Il récite
encore, mi-pathétique, mi-comédien : « l'enfant pâle/ Brusquement reparu, fier comme Viala,/ Vint s'adosser au mur
et leur dit : me voilà./ La mort stupide eut honte et l'officier fit grâce. »
Quant à moi, je me sens définitivement française, mais je ne serai jamais un
bloc taillé d'une seule pièce, tant mes « grands classiques » étaient et
restent des ingrédients d'un puzzle multiforme où chacun fait son jeu. J'ai
acquis la conviction qu'il n'y a pas une littérature, mais une expérience imaginaire qui se décline dans une pluralité
de styles, de genres et de goûts, dont la seule raison d'être est de tenir tête
à la pensée unique dans laquelle se rejoignent les totalitarismes en tout
genre.
Quel classique aimiez-vous à vingt ans ?
À vingt
ans, incontestablement Proust. La phrase d'abord, sinueuse, essoufflée,
angoisse ornée de plaisir sensuel, interminables volutes de subordonnées qui
brisent en éclats le temps sensible et, sous l'omnipotence de l'opinion,
débusque le maître des temps modernes : le sadomasochisme des hommes et des
femmes. Deux personnages préférés, qui hantent le narrateur, deux doubles dont
il doit à tout prix se protéger, par l'écriture : Swann, bien sûr, le « célibataire de l'art », amant imaginaire
d'Odette qui le rend malade avant qu'il comprenne qu'elle « n'était pas son
genre », le Juif esthète dont le narrateur est « inopérable » - car lui, le
narrateur, ne succombe pas à la « jalousie, cette fantaisie bornée, « lutte
inutile, épuisante, enserrée de toutes parts par les limites de l'imagination
», mais préfère « imaginer une intrigue » pour capter et refaire le monde si
vaste et si secret, en commençant par « le temps plus fort qu'eux ». Et Albertine, autre double du narrateur,
connaisseur du féminin du fond de sa féminité impérieuse et affolante : la «
profonde » et « innombrable Albertine », qu'il n'arrive pas à embrasser dans
cette schizophrénique scène du baiser où « c'est dix Albertines que je vis »,
une « déesse à plusieurs têtes », un « abîme inaccessible»... pour lequel il « manque
cependant encore d'un certain nombre d'organes essentiels, et notamment n'en
possède aucun qui serve au baiser ». La guerre des sexes est déclarée, seuls
ceux qui ne lisent pas Proust ne sont pas encore au courant.
Celui que vous gardez toujours à portée de main ?
C'est À la recherche du temps perdu que je
garde toujours à portée de main. Il suffit d'ouvrir à n'importe quelle page, au
hasard, de pointer le doigt sur un nom propre ou un nom de fleur, de les suivre
au fil du flot syntaxique ou de les isoler, et un monde insolite se déploie.
Comme ces papiers japonais qui prennent forme quand on les plonge dans l'eau, à
la fin de l'épisode de la madeleine, ils infusent en vous une philosophie
insolite : « Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère.
Sous chaque mot, chacun de nous met son sens ou du moins son image qui est
souvent un contresens ». Ou une trouvaille psychologique : « mon imagination,
qui était mon seul organe pour jouir de la beauté ». Ou encore une foi : « Si
la réalité était cette espèce de déchet de l'expérience, à peu près identique
pour chacun, [...] une sorte de film cinématographique [...] suffirait [...].
Mais était-ce bien cela, la réalité ? » Et d'opposer au cinéma des choses « ce
livre essentiel, le seul livre vrai » : « un grand écrivain n'a pas, dans le
sens courant, à l'inventer puisqu'il existe déjà en chacun de nous, mais à le
traduire. Le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur ».
Avez-vous un souvenir de franche rigolade - ou de
désespoir intense - associé à la lecture d'un classique ?
La franche
rigolade, oui, spontanée, hilare, infantile, au bord de la bêtise car à ce
degré d'évidence elle côtoie la raison, elle équivaut à la raison, elle singe
la raison, à moins que la raison ne soit une bêtise démontrée : seul Molière y
parvient. Prenez Le Malade imaginaire,
et Toinette dans le rôle du médecin :
Je suis médecin passager, qui vais de ville en ville, de province en
province, de royaume en royaume [...]. Je dédaigne de m'amuser à ce menus
fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatismes et de fluxions,
à ces fièvrottes, à ces vapeurs et à ces migraines.
Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues, avec des
transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes
hydropisies formées, [...] pour vous montrer l'excellence de mes remèdes, et
l'envie que j'aurais de vous rendre service.
Ici, Argan
rappelle les diagnostics des grands médecins sur son mal. Et Toinette reprend :
TOINETTE. — Qui est votre médecin ?
ARGAN. — Monsieur Purgon. [...] Il dit
que c'est du foie, et d'autres disent que c'est de la rate.
TOINETTE. — Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous
êtes malade.
ARGAN. — Du poumon ?
TOINETTE. — Oui. Que sentez-vous ?
ARGAN. — Je sens de temps en temps des douleurs de tête.
TOINETTE. — Justement, le poumon.
ARGAN. — Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux.
TOINETTE. — Le poumon.
Etc. Enfin,
TOINETTE. — Ignorantus, ignoranta, ignorantum.
La langue
française a inventé la raison de Descartes et le poumon de Toinette/Molière. La
science et l'absurde : la science est l'absurde, et vice versa. Ionesco et Beckett devaient écrire en français, c'était
prévisible, obligatoire, il fallait s'y attendre. Et jusqu'à Sartre, ce Molière
sérieux, philosophe de l'absurde. La comédie française est grandiose, elle rit
du néant.
Le désespoir
intense ne m'a jamais paru aussi poignant et sans issue que chez Kafka, dans La Métamorphose surtout. « Un matin, au
sortir d'un rêve agité, Grégoire Samsa s'éveilla
transformé dans son lit en une véritable vermine. » Cela commence comme un
conte fantastique, façon humour gothique anglais, côtoie la satire de la domesticité
mesquine, de l'étroitesse petite-bourgeoise, façon Mitteleuropa, avant de me
plonger en plein cauchemar. L'horreur me prend à la gorge quand le père de
Grégoire lui jette des pommes ; l’une d'elles le frappe au dos et le paralyse.
La mère coud, le père s'endort, la sœur Grete apprend la sténo et l'anglais.
Grégoire la vermine meurt, la famille décide de prendre congé à la campagne.
J'ai beau convoquer le savoir freudien qui sait sonder les régressions
psychotiques, j'ai beau essayer de rire de ce Goya noir de l'univers
déshumanisé, l'explication n'apaise pas la terreur de cet enfer.
Thérèse d'Ávila
écrivait que le ressenti le plus infernal est celui d'un corps comprimé dans un
espace sans espace. Elle était épileptique, broyée par ses spasmes électriques.
Grégoire Samsa vit un enfer encore plus impensable.
Quand Samsa (la racine sam, dans les langues slaves,
notamment le tchèque dans lequel vivait la famille yiddish de Joseph Kafka, qui
écrivait en allemand, signifie « seul », « solitude ») se métamorphose en sale
bête à exterminer, c'est l'horreur du mal
radical qui lui broie la colonne vertébrale et réduit la vie psychique en
vers parasites : ce mal radical qu'est la destruction d'un homme par ses semblables, ses frères. La monstrueuse
normalité de cette angoisse, il fallait être Kafka pour s'en faire le prophète.
L’incipit que vous placez au-dessus de tous les autres
?
Le plus
insolite, plus encore que celui de Jacques
le Fataliste de Diderot, c'est l'incipit des Chants de Maldoror de Lautréamont. Le
voici : un « classique », Isidore Ducasse, comte de Lautréamont ? Pour moi,
sans aucune réserve.
Plût au ciel que le lecteur, enhardi et devenu momentanément féroce comme
ce qu'il lit, trouve, sans se désorienter, son chemin abrupt et sauvage, à
travers les marécages désolés de ces pages sombres et pleines de poison ; car,
à moins qu'il n'apporte dans sa lecture une logique rigoureuse et une tension
d'esprit égale au moins à sa défiance, les émanations mortelles de ce livre
imbiberont son âme comme l'eau le sucre. Il n'est pas bon que tout le monde
lise les pages qui vont suivre ; quelques-uns seuls savoureront ce fruit amer
sans danger. Par conséquent, âme timide, avant de pénétrer plus loin dans de
pareilles landes inexplorées, dirige tes talons en arrière et non en avant.
Écoute bien ce que je te dis : dirige tes talons en arrière et non en avant,
comme les yeux d'un fils qui se détourne respectueusement de la contemplation
auguste de la face maternelle ; ou, plutôt, comme un angle à perte de vue de
grues frileuses méditant beaucoup, qui, pendant l'hiver, vole puissamment à
travers le silence, toutes voiles tendues, vers un point déterminé de
l'horizon, d'où tout à coup part un vent étrange et fort, précurseur de la
tempête. La grue la plus vieille et qui forme à elle seule l'avant-garde,
voyant cela, branle la tête comme une personne raisonnable, [...] et,
manœuvrant avec des ailes qui ne paraissent pas plus grandes que celles d'un
moineau, parce qu'elle n'est pas bête, elle prend ainsi un autre chemin
philosophique et plus sûr.
Encyclopédie
de l'humour noir, remise à nu des classiques et des moralistes, impitoyable
saccage de la religion et de ces oiseaux énamourés : ce jeune homme ose
s'approprier Dante dans un rire à mort qui n'a d'égal que le suicide, et
l'horreur du mal, comme seul paradis possible. Lautréamont, ce révolutionnaire
sans credo, ce philosophe sans
maître, ce fou de la négation, ce surréaliste sans manifeste, cet
avant-gardiste sans postérité, fut enseveli dans une fosse commune avec les
communards.
Celui que vous aimeriez préfacer, traduire ou réécrire
un jour ?
Il est
impossible de traduire sans réécrire, et je n'aimerais pas réécrire
spécialement. Toute écriture est en soi une réécriture. Mais préfacer, oui. Un
jour, plus tard, éventuellement Les
Exercices spirituels d'Ignace de Loyola, ou encore Le Héros de Baltasar Gracián. Parce qu'ils annoncent l'âge baroque,
qui annonce les Lumières.
Quel roman paru ces dernières années pourrait devenir,
selon vous, un classique ?
Le roman qui
pourrait devenir un classique ? Femmes,
de Sollers (Gallimard, 1983). Intense osmose avec le désir féminin ; parité
moléculaire des amoureux ; impitoyable dissection des passions fausses, des
escroqueries à mort, innocentes ou vénéneuses, démolition des idoles, des
cheftaines, des directrices, des ovules, du sperme, des langues, des
rédactions, des médias, des pouvoirs. Femmes prophétise l'avenir de l'emprise féminine sur la gestion des corps, de la
globalisation, de tout, de rien. Tendre apocalypse, un futur classique qui
éveille.
Votre premier GF... et les suivants ?
Il me semble
que le premier GF que j'ai consulté, au début des années 1960, fut La Naissance du jour de Colette. Un
journaliste ami l'avait apporté de Paris ; était-ce l'édition de 1957 ? Je ne
prêtais pas attention à l'éditeur, en général, mais ce jour-là le double
patronyme « Garnier-Flammarion » m'a frappé parce qu'il m'était inconnu, plus
que Colette dont, enfant, je lisais pendant les vacances des extraits, tirés de Claudine à l’école ou de Dialogues de bêtes. Cachée tout en haut,
dans les branches des pruniers du verger de ma grand-mère, je dégustais les
savoureux mots français, à peine découverts, encore à apprendre. Mais cette Naissance du jour était désormais la
découverte d'un auteur. « Est-ce ma dernière maison ? Je la mesure, je
l'écoute, pendant que s'écoule la brève nuit intérieure [...]. Car rêver, puis
rentrer dans la réalité, ce n'est que changer la place et la gravité d'un
scrupule... » Les volumes d’À la recherche
du temps perdu présentés par Jean Milly (La Prisonnière) ou par Bernard Brun (Du côté de chez Swann) m'ont aussi beaucoup impressionnée. Je suis
redevable aux travaux d'inspiration linguistique de Jean Milly sur la phrase
proustienne, ainsi qu'à la délicate et très éclairante utilisation des
manuscrits par Bernard Brun, pour l'écriture de mon Temps sensible. Proust et l’expérience
littéraire (Gallimard, 1994). Je serais heureuse de me procurer un jour la
totalité de cet ensemble sous la direction de Jean Milly.
Aujourd'hui, la GF a cinquante ans : que lui
souhaitez-vous ?
Qu'elle
persévère dans sa voie de fidélité aux textes mais aussi d'interprétations innovantes, dont témoigne son Proust.
JULIA
KRISTEVA
|
 |
|---|