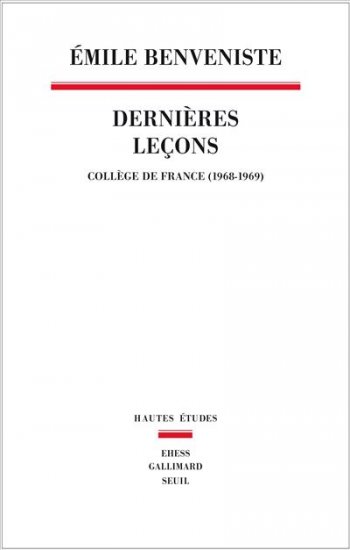Emile Benveniste, un linguiste qui ne dit ni ne cache, mais signifie
Qu’est-ce qu’un grand
linguiste ? Les grands
linguistes se distinguent en ceci que, connaissant et analysant les langues, ils découvrent des
propriétés du langage au travers
desquelles ils interprètent et innovent
l’« être au monde » des sujets parlants. Je risque cette définition
pour mettre en perspective l’œuvre d’Emile Benveniste (1902-1976) avec celles de certains de ces
prédécesseurs qui, quoique méticuleuses et froides en apparence, n’en ont pas moins accompagné et accéléré certaines
étapes les plus décisives de l’aventure humaine. Pensons aux humanistes et grammairiens du XVIe siècle tels Scaliger et Ramus, dont l’analyse du rapport entre le langage et la pensée, du latin
aux langues modernes, a favorisé la constitution et le développement des
langues nationales ; à Lancelot et Arnauld dont la Grammaire générale et raisonnée (1660),
davantage que la Logique de Port-Royal (1662),
en introduisant la notion de « signe », en tentant de déterminer
« ce que la langue a de spirituel » et en appuyant le jugement sur
l’ « usage grammatical », inscrivit le sujet cartésien dans la
syntaxe de la langue ; à
l’ « historicisme » du XIXe siècle et à la philologie comparée de Franz Bopp et Rasmus Rask puis Humboldt, enfin, qui, mettant
en évidence après Hegel et Herder la parenté du sanscrit avec les langues indoeuropéennes,
confirma le poids de l’histoire dans l’activité évolutive du langage.
Les conflits tragiques du XXe siècle tendent à faire oublier qu’il fut aussi le temps d’une
exceptionnelle exploration du langage mis au cœur de la condition humaine : activité centrale, c’est la
langue qui conditionne, contient et éclaire toutes les expériences humaines. La
phénoménologie, la logique formelle, la philosophie analytique, le
structuralisme, la grammaire générative, les sciences de l’homme interrogeant dans
le langage le sens des comportements et des institutions, sans oublier la
psychanalyse qui annexe le sexe et
empiète sur la biologie, se sont développés alors même qu’une explosion sans
précédent des formes littéraires, des avant-gardes artistiques et des singularités
stylistiques bouleversait le domaine des lettres. Lucide aventure qui, observée
avec recul, semble annoncer l’éclatement des systèmes de signes conventionnels
et la marée des nouvelles et virtuelles hyperconnexions qui promettent autant
de liberté que de chaos.
Au sein de ce
foisonnement dans lequel elle s’inscrit pleinement, l’œuvre d’Emile Benveniste
– si toutefois nous nous donnons la peine de mettre en résonance
la complexité de sa pensée avec les
avancées de la philosophie et des sciences humaines et avec les nouvelles
formes de l’art et de la
littérature – « contacte » les difficultés de notre siècle. Car elle éclaire en profondeur les
propriétés universelles de la langue sous-jacentes à cette liberté créatrice de l’esprit humain qu’elle ne
cesse d’ausculter. Le lecteur
attentif à la trajectoire de Benveniste, et qui ne
laissera pas son attention se détourner vers une linguistique pressée
d’urgences techniques dans une société en perte de sens et cerclée par la
« com », découvrira dans ses Derniers
cours que ses « théories
générales » contribuent à sonder des logiques profondes qui
traversent jusqu’à nos écritures numériques. Sont-elles des chats en manque de
« subjectivité », ou au contraire des voies
d’ « engendrement » de nouvelles « signifiances » ?
Emile Benveniste fut un savant austère, un
très grand connaisseur des langues anciennes, expert en grammaire comparée,
autorité en linguistique générale. Il
connaissait le sanscrit, le
hittite, le tokharien, l’indien, l’iranien, le grec, le latin, toutes les
langues indo-europénnes, et, à la cinquantaine passée, s’est plongé dans les langues
amérindiennes. Pourtant son œuvre, d’une audace impressionnante, toute en
retenue et d’une modestie apparente, demeure relativement méconnue et peu
visible de nos jours.
Né à Alep en Syrie en 1902 au sein
d’une famille juive et polyglotte
[1]
,
Ezra Benveniste émigre en France dès 1913 où il devient élève au « petit
séminaire
[2]
»
de l’École rabbinique de France. Ses prédispositions exceptionnelles pour les
langues attirent l’attention de Sylvain Lévi, qui le présente au grand Antoine
Meillet (à moins que le lien ne soit fait par Salomon Reinach
[3]
). Ezra
Benveniste intègre l’Ecole pratique des hautes études (EPHE) en 1918, devient
licencié ès lettres l’année suivante, obtient l’agrégation de grammaire en 1922,
après quoi, pur produit de l’enseignement laïque de la République française, il
est naturalisé français en 1924 et
choisit le nom de Emile Benveniste. Durant ces années de formation, il noue des
liens étroits avec de jeunes philosophes et linguistes, normaliens plus ou
moins révoltés, libertaires, antimilitaristes, voire
sympathisants communistes, et croise
notamment les surréalistes. Il part en Inde en 1924 comme précepteur dans une
famille de grands industriels, avant de remplir bon gré mal gré ses obligations
militaires au Maroc en 1926. De
retour en France, il devient l’élève d’Antoine Meillet auquel il succède comme
Directeur d’études (Chaire de grammaire comparée) à l’Ecole pratique des hautes
études, où il exerce une forte influence sur ses collègues. Il intègre le Collège de France en 1937,
succédant au même Antoine Meillet à la Chaire de grammaire comparée. Il est
fait prisonnier de guerre en 1940-41, parvient à s’évader et se réfugie en
Suisse, à Fribourg (où résident également Balthus, Giacometti, Pierre
Emmanuel et Pierre Jean Jouve), échappe ainsi aux persécutions nazies, mais
son appartement est pillé et son
frère Henri arrêté puis déporté à
Auschwitz, où il meurt en 1942. Avec les plus grands noms de l’intelligentsia israélite (Benjamin
Crémieux, Georges Friedmann, Henri Lévy-Bruhl, etc.), il signe la lettre collective organisée
par Marc Bloch, et adressée le 31 mars 1942 à l’UGIF, pour attitrer
l’attention sur la ghétoïsation des
juifs en France qui préludait à la
déportation
[4]
.Après la
Libération, Benveniste reprend son enseignement à l’EPHE et au Collège de
France, formant plusieurs générations d’étudiants, mène des enquêtes
linguistiques « sur le
terrain » en Iran, en Afghanistan puis en Alaska, et participe à de
nombreux colloques internationaux de linguistique. Il devient membre de
l’Institut (Académie des inscriptions des belles lettres) en 1960, Directeur de
l’Institut d’études iraniennes en 1963, et Président de l’Association internationale
de sémiotique en 1969. Survenu le 6 décembre, un accident cérébral, qui le
laisse handicapé sept ans durant, jusqu’à sa mort, met un terme à sa carrière.
Cette
biographie concise d’un « israélite agnostique », d’un
français nomade, est avant tout
celle d’un homme qui fit du langage le chemin d’une vie, et nous transmit
par son œuvre la pensée de cette expérience.
Benveniste laisse une « œuvre
inachevée », dit-on parfois, dans une formule qui risque de minorer la
portée des textes. Inachevée, certes, l’attaque ayant laissé l’homme dans
l’insoutenable situation d’un grand
linguiste privé de parole et paralysé. Mais « inachevée » aussi dans un sens absolument nécessaire, parce que telle
est l’expérience du langage qu’il a faite et théorisée en un siècle
où la diversité des courants de pensée, multipliant les pistes et les
interrogations tant épistémologiques qu’esthétiques, imposait à l’homme ancré
dans son temps qu’il fut le refus héraclitéen de « dire », de construire un « message » fermé, clos,
donné définitivement en système achevé. Au sein de cette diversité foisonnante
à laquelle il fut toujours attentif (de la philologie comparée à Saussure, du
structuralisme à la syntaxe chomskyenne, du surréalisme à l’ « après-nouveau
roman »), il pratiqua ce qu’il faut bien appeler un style de pensée benvenistien, où le détail morphosyntaxique rejoint l’interrogation permanente des catégories fondamentales,
linguistiques et/ou philosophiques
[5]
,
et qui se caractérise, outre par le refus de « dire », par un évitement de l’esthétisme qui
« cache » (quoiqu’il y fut sensible un temps, comme en témoigne son
autoanalyse littéraire, Eau virile
[6]
),
par la volonté de « signifier » (ouvrir à la pensée, problématiser,
questionner) et de déterminer comment signifier s’engendre dans l’appareil formel du
langage.
Qu’est-ce donc que
« signifier » ? La
question métaphysique conduit Benveniste
à la recherche d’une solution « matérielle », dans le fonctionnement
même du langage : « ça signifie » est synonyme pour lui de
« ça parle », et c’est donc sans le recours à quelque « réalité
externe » ou « transcendantale », mais dans les
« propriétés » du langage même, qu’il prospecte et analyse les possibilités de faire sens, spécifiques de cet
« organisme signifiant » qu’est l’humanité parlante.
Le jeune homme né au cœur de
l’Empire ottoman, boursier de l’Alliance israélite universelle, ne devint donc pas rabbin
[7]
.
A un moment de l’histoire où la guerre
des Six-Jours (1967) et celle du Kippour (1973) n’avaient pas encore suscité
chez maints Israélites agnostiques
le désir d’un retour au Dieu des Pères, c’est par la devise d’Héraclite, oute légei, oute kryptei, alla sémainei « οὔτε λέγει οὔτε κρύπτει ἀλλὰ σημαίνει
[8]
»
(à moins qu’elle ne traduise l’imprononçable tétragramme YHWH : l’être identifié
à ce qui est et sera, à la « signifiance ») qu’il résume son ambition d’étudier le « pouvoir signifiant » dans
les propriétés mêmes du langage. Un chemin, précisément, qui « ne
dit ni ne cache, mais signifie », et qui le mène de l’étude de la Grèce présocratique
(explicitement), de la Bible et des Evangiles (implicitement) à celle des savoirs modernes issus de la sécularisation, et tout
spécialement de la linguistique générale, qu’il se propose de moduler de telle manière qu’elle puisse analyser comment s’organise la langue pour créer du sens (Cours 1).
La double signifiance
Benveniste
appréhende donc le « sens » en faisant abstraction de sa
« valeur » philosophique, morale ou religieuse. C’est la recherche du sens dans sa spécificité
linguistique qui « commande le discours sur la langue » des Derniers cours ici réunis par les soins et avec l’Introduction de
Jean-Claude Coquet et Irène Fenoglio. « Nous posons quant à nous [c’est moi qui souligne JK] que la langue,
dans sa nature essentielle qui commande toutes les fonctions qu’elle peut assumer, est sa nature signifiante. » La
« signifiance » qui «informe » la langue ainsi posée, est
une propriété qui « transcende » « toute utilisation particulière ou générale », ou encore une
« caractéristique que nous mettrons au premier plan : la langue
signifie ».
Nous sommes le 2
décembre 1968, sept mois après le fameux Mai 68.) Le lecteur naïf, à ce moment
comme aujourd’hui, s’étonne : est-ce si original ? à quoi bon une langue si
elle ne signifie pas quelque chose ? Certes.
Mais savez-vous ce que vous entendez au juste par « signifier » ?
Et si « communiquer », « vouloir dire », « porter un
message » ne se confondaient pas avec « signifier » ?
Central en philosophie du langage, mais en tant que porteur de
« vérité », le sens n’est
pas vraiment le problème des linguistes, rappelle Benveniste. Le sens est laissé « hors de la
linguistique » (PLG2, 1967, p. 216) : soit « écarté » car suspecté
d’être trop subjectiviste, fuyant, indescriptible sous les aspects de la forme
linguistique ; soit reconnu mais « réduit » (Bloomfield, Harris)
à des invariants structuraux morphosyntaxiques, « distributionnels »,
dans un « corpus donné ». Selon Benveniste, au contraire, « signifier » constitue un
« principe interne » du langage (Cours
3). Avec cette « idée neuve », souligne-t-il,
« nous sommes jetés dans un
problème majeur, qui embrasse la linguistique et au-delà ». Si quelques
précurseurs (Locke, Saussure et Pierce) ont démontré que nous
« vivons dans un univers de
signes » dont la langue est le premier, suivi des signes d’écriture, de
reconnaissance, de ralliement, etc. (Cours
1), Benveniste entend montrer comment l’appareil formel de la langue la
rend capable non seulement de « dénommer » des objets et des
situations, mais surtout de « générer » des discours aux
significations originales, aussi individuelles que partageables dans les
échanges avec autrui. Mieux même, comment,
non content de s’autogénérer, l’organisme de la langue génère aussi d’autres systèmes de signes qui lui ressemblent ou augmentent ses capacités, mais dont elle est le seul système
signifiant capable de fournir une interprétation.
Les travaux de Benveniste recueillis dans
le tome 1 de ses Problèmes de
linguistique générale (1966), tout en s’appuyant sur l’étude des langues
anciennes et sur la linguistique comparée, répondaient déjà à ces questions
théoriques. Un second Benveniste,
éclairant et déplaçant les principales interrogations de sa première
linguistique générale, apparaît dans le tome 2 des Problèmes de linguistique générale (1974), publié après qu’il eut
subi son attaque et qui réunit des articles écrits de 1965 à 1972. La lecture attentive de ces deux volumes permet de distinguer deux étapes
majeures dans l’évolution de sa pensée,
dont le lecteur du présent ouvrage doit être averti afin de saisir toute la
portée innovante des Derniers cours.
Dès le premier tome de son œuvre
maîtresse, le théoricien propose une linguistique
générale qui s’écarte de la linguistique structurale mais aussi de la grammaire
générative qui dominent le paysage linguistique de l’époque, et avance une
linguistique du discours, basée sur l’allocution et le dialogue, ouvrant
l’énoncé vers le processus d’énonciation,
la subjectivité et l’intersubjectivité. Dans le sillage de
la philosophie analytique (les énoncés performatifs) mais aussi de la
psychanalyse freudienne, Benveniste conçoit la subjectivité dans
l’énonciation comme un émetteur bien plus complexe que le sujet cartésien, car il l’élargit
à l’ « intentionnel » (emprunté à la phénoménologie
existentielle). De surcroît, et sans y paraître, il esquisse une ouverture vers le sujet de
l’ « inconscient ». Pas vraiment « structuré comme un
langage », mais travaillé par une
« force anarchique » (pulsionnelle ?) que le langage « refrène
et sublime », bien que par « déchirures » elle puisse
introduire en lui un « nouveau
contenu, celui de la motivation
inconsciente et un symbolisme spécifique », « quand le pouvoir de la
censure est suspendu
[9]
».
Une
nouvelle dimension de la linguistique générale selon Benveniste se révèle cependant
dans le second tome. En discussion avec Saussure et sa conception des éléments
distinctifs du système linguistique que sont les signes, Benveniste propose deux types dans la signifiance du langage : « le » sémiotique et « le » sémantique.
Le sémiotique (de « semeion », ou « signe »,
caractérisé par son lien « arbitraire »
– résultat d’une convention sociale – entre « signifiant » et
« signifié ») est un sens clos, générique, binaire, intralinguistique, systématisant et institutionnel, qui se
définit par une relation de « paradigme » et de « substitution ».
Le sémantique s’exprime dans la
phrase qui articule le
« signifié » du signe, ou l’ « intenté » (fréquente allusion
à l’ « intention » phénoménologique de Husserl, dont la pensée influence certains
linguistes comme H.J. Pos). Il se définit par une relation de « connection » ou
de « syntagme », où le
« signe » (le sémiotique)
devient « mot » par l’ « activité du locuteur ».
Celle-ci met en action la langue dans la situation du discours adressé par la « première
personne » (Je) à la « deuxième personne » (Tu), la troisième (Il)
se situant hors discours. « Sur
le fondement sémiotique, la langue comme discours construit une sémantique propre : la signification de l’intenté produit par la syntagmation des mots où chacun
d’entre eux ne retient qu’une partie de la valeur qu’il a en tant que
signe » (PLG t. 2, p. 60 sq., et p. 229).
Formulée en
1967/1968 (PLG2, p. 63 sq. et p. 215 sq.) devant le Congrès de la Société de Philosophie
de langue française, puis devant le Congrès de Varsovie fondateur de l’AIS en
1968 (PLG2, p. 43 sq.), cette conception duelle de la signifiance ouvre un nouveau champ de recherche. Benveniste insiste sur le dépassement de
la notion saussurienne du signe et du langage comme système, et souligne son importance, à la fois intralinguistique : ouvrir une nouvelle dimension de la
signifiance, celle du discours (le sémantique), distincte de celle du signe (le
sémiotique
[10]
); et translinguistique :
élaborer une métasémiotique des
textes et des œuvres, sur la base de la sémantique de l’énonciation (PLG2, p. 66). Et donne une idée plus précise des perspectives immenses qui s’ouvrent ainsi
: « Nous sommes tout à fait au commencement », aussi est-il encore
« impossible de définir de
manière générale » où mènera cette orientation qui, traversant la linguistique,
« obligera à réorganiser l’appareil des sciences de l’homme » (PLG2, p.
238).
Les Derniers cours de Benveniste poursuivent cette réflexion en s’adossant sur un nouveau continent, celui du langage poétique, comme en témoignent les notes de son Baudelaire
[11]
, qui développent en les déplaçant des notions clés des leçons.
Entre le second tome des Problèmes de linguistique générale et
le Baudelaire, les Derniers Cours se proposent dans
un premier temps de démontrer que « signifier »,
qui constitue la « propriété initiale, essentielle et spécifique de la
langue », ne s’enferme pas
dans les unités-signes (telles que le concevait Saussure), mais
« transcende » les fonctions communicative et pragmatique de la
langue ; et, dans un second temps, de spécifier les termes et les
stratégies de cette « signifiance » en tant qu’elle est une
« expérience » à proprement
parler vitale (comme il l’avait annoncé dans PLG2, p. 217 : « Bien avant de servir à communiquer, le langage sert à vivre »).
Fort logiquement, Benveniste
introduit cette réflexion par un hommage à Saussure et Charles Sanders Pierce. Du premier il
reconnaît « l’importance particulière » et définit l’œuvre comme un
« nouveau moment de l’analyse », une « démarche fondamentale
dans l’histoire de la pensée (Leçon du 1.12.1969) où, pour la première fois, « se forme la notion de signe » et de
« science des signes » (Cours 3).
Du second, il mentionne la « notion universelle » du signe divisée en
trois « classes » et détaillée en multiples « catégories »,
basées sur « une triade » elle aussi « universelle » (Cours 2). Mais cette lucide
reconnaissance de dette envers ses prédécesseurs lui donne l’occasion de
montrer avec fermeté leurs limites.
Ainsi Ferdinand de Saussure « ne prend pas appui sur le signe » ; laisse ouverte une possible
« extériorité » du signe ; n’aborde pas la question des rapports entre les systèmes de signes
et la « spécificité de la langue », laquelle « produit » (« engendre »)
de nouveaux systèmes de signes, en tant qu’elle en est le seul
« interprétant » ; ou encore « ne s’applique pas à la langue comme production » (Dernière
leçon). Pierce quant à lui ne fonde pas sa théorie sur la langue, mais seulement
sur le mot ; sa théorie excelle dans la description des nombreuses diversités
de signes, mais elle ignore la
langue, et il manque à sa logique une organisation systématique des différents types
de signes (Cours 3)
[12]
.
Cet inventaire contribue à clarifier de
nouveau l’enjeu de la nouvelle linguistique
générale selon Benveniste : « Nous devons prolonger cette réflexion au-delà du
point indiqué par Saussure » (Cours
4). Et ceci, notamment, en
développant un « nouveau rapport », inexistant chez Saussure :
le « rapport d’interprétation entre systèmes ». La langue,
précisément – unique au sein de la diversité des systèmes signifiants en
ceci qu’elle possède la capacité de
s’auto-interpréter et d’interpréter les autres (musique, image, parenté)
– est « le système interprétant » : elle « fournit la
base des relations permettant
à l’interprété de se développer comme système ». La langue est, de ce
point de vue, hiérarchiquement le premier des systèmes signifiants, qui
entretiennent entre eux une relation d’engendrement (Cours 5, 13.1.1969).
L’écriture : centre et
relais
La « double
signifiance » de la langue, précédemment esquissée, est développée par le
levier de l’écriture, qui réalise et révèle sa capacité de
« production » et d’ « engendrement ». Toutefois, et bien que le terme
d’ « écriture » soit alors au centre de la création philosophique et littéraire en France
[13]
,
le linguiste ne s’y réfère pas explicitement, mais il en construit le concept dans
le cadre de sa théorie générale de la signifiance de la langue.
Pour prendre ses distances
avec la sémiologie saussurienne qui, en « confondant l’écriture avec l’alphabet, et la langue avec
une langue moderne », postule que l’écriture est « subordonnée à la
langue » (Cours 8), Benveniste interroge l’acte d’écrire, l’apprentissage de
l’écriture et les types constitués au cours de l’histoire. En prenant soin cependant
de souligner qu’il ne cherche pas
l’« origine de l’écriture », mais les diverses solutions de la « représentation
graphique » de la signifiance (Cour
9).
Il s’agira d’abord de mettre en question
le rapport « on ne peut plus intime » qu’a élaboré la civilisation du
livre entre l’écriture, la langue, la
parole et la pensée, c’est-à-dire de dissocier celles-ci afin d’envisager « en soi et pour soi »
l’écriture comme un « système sémiotique » particulier. Ainsi découplée
de la parole, l’écriture apparaît comme une « abstraction de haut
degré » : le locuteur écrivant s’extrait de l’activité verbale
« vivante » (gestuelle, phono-acoustique, reliant soi à autrui dans
un dialogue) et la « convertit » en « images », en
« signes tracés à la main ». Avec des pertes conséquentes, certes, l’image
se substituant à la parole comme outil d’ « extériorisation » et
de « communication ».
De subtils bénéfices, toutefois, suppléent
à ces pertes, abstraction faite même de la fonction « utilitaire » de
l’écriture (mémoriser, transmettre, communiquer le message). « Première
grande abstraction », l’écriture, en faisant de la langue une
« réalité distincte », détachée de sa richesse contextuelle
et circonstancielle, permet au locuteur-écrivain de réaliser que la
langue ou la pensée sont faites des
« mots » représentés en
signes matériels, en images. Plus encore, cette « iconisation de la
pensée » (Cours 8) est la source
d’une « expérience unique » du « locuteur avec
lui-même » : ce dernier « prend conscience » que ce « n’est pas de la parole
prononcée, du langage en action » que procède l’écriture.
« Global », « schématique », « non grammatical »,
« allusif », « rapide », « incohérent »,
ce langage intérieur,
« intelligible pour le parlant et pour lui seul », confronte celui-ci
à la tâche considérable de réaliser une « opération de conversion de
sa pensée » dans une forme intelligible à d’autres.
Ainsi comprise, la « représentation
iconique » construit ensemble la
parole et l’écriture : elle « va de pair avec l’élaboration de la
parole et l’acquisition de l’écriture ». A cette étape de sa théorisation, et à l’encontre de
Saussure, Benveniste remarque que, loin d’être « subordonné », le
signe iconique associe la pensée parallèlement au graphisme et à la verbalisation : « La
représentation iconique se développerait parallèlement à la représentation
linguistique », ce qui laisse entrevoir une autre relation entre pensée et icône, « moins littérale » et « plus
globale » que la relation
entre pensée et parole (Cours 8).
Cette hypothèse associant l’écriture au
« langage intérieur », qui sera modifiée plus loin, renoue avec les
interrogations antérieures de Benveniste sur la « force anarchique » de l’inconscient
freudien (PLG1, p. 78). Le « langage intérieur » que l’écriture
cherche à « représenter » serait-il lié aux
« défaillances », « jeux », « libres
divagations » dont Benveniste, lecteur de Freud et des surréalistes,
découvrait l’origine dans l’inconscient ? Les notes concises des Cours sur
l’écriture rappellent l’œuvre antérieure du linguiste, et complètent l’intenté phénoménologique qu’il insère dans le sémantique du
discours par une « motivation » d’un autre
ordre. Le « langage
intérieur » du parlant-écrivant
ne se limiterait pas à la
propositionnalité de l’ego transcendantal de la conscience et à son « intention », mais pourrait dessiner en creux, dans sa
théorie de la subjectivité, une diversité d’espaces subjectifs : des typologies ou topologies des
subjectivités dans l’engendrement de la signifiance. L’ « expérience
poétique » de Baudelaire, nous le verrons, confirme et précise cette
avancée.
Quant à l’histoire de
l’écriture, elle apporte un nouvel ajustement du rapport langue/écriture, et constitue
une nouvelle étape dans la théorie
de la signifiance chez Benveniste.
L’écriture pictographique, signe de la
réalité extérieure, « récite » un message déjà constitué par la « langue d’un autre » (Cours 9) : elle « ne parle
pas » au sens où la langue parlante est une « création ». Aussi
loin que l’on remonte dans sa préhistoire, l’écriture
« décrit » des « événements » : si elle est
« parallèle » au langage,
elle n’est pas son « décalque ». Ce constat ouvre une question qui reste en suspens : la spécificité du
pictogramme, qui
« récite » (re-produit) mais ne « crée » pas (ne produit
pas), demeure-t-elle sourdement
latente dans toute iconisation du langage ? Cette particularité n’est-elle pas plus
marquée encore dans certaines écritures modernes (numériques, par exemple) ?
Et si oui, à quelles conditions ? Avec quelles conséquences pour le sujet de
l’énonciation ?
Deux révolutions marquantes dans
l’histoire de l’écriture éclairent la double signifiance de la langue. La
première réside dans la découverte
d’une graphie reproduisant la phonè en un nombre limité de signes, ce qui revient à reproduire non plus le contenu du message porteur
d’événements mais la forme linguistique de ce message. La « chance » en revient à la Chine : moins parce
que dans la langue chinoise, monosyllabique, chaque unité
sémiotique est une unité formelle et non décomposable (un mot = une
syllabe) que par le génie inventif de ceux qui l’ont conçue, qui ont
réussi à attribuer à chaque « signifiant » (phonè) un signe (graphè :
caractère) – avec des « clés » pour désambiguïser les homophones (Cours 11).
Prendre conscience du flux de la parole,
décomposer les mots, réaliser qu’ils sont polysyllabiques : ce processus entraîne une
segmentation supérieure. Pour les
langues polysyllabiques, ce sera la segmentation
en syllabes, avec des variantes : le sumérien et l’écriture cunéiforme où « la
filiation est claire entre l’image
et le référent » ; son adaptation à l’akkadien (sémitique) ; la
méthode du « rébus » dans les hiéroglyphes égyptiens (un dessin = une
syllabe : « chat » + « pot »= chapeau) (Cours 10).
Une « étape décisive » dans l’histoire des
« représentations graphiques » de la langue est franchie dans les
écritures sémitiques alphabétiques. L’hébreu en est un exemple majeur, que Benveniste
ici ne développe pas en particulier, quoi qu’il en rappelle
l’organisation spécifique : le schéma
consonantique porte le sens (le
sémantique), tandis que la fonction
grammaticale revient à la vocalisation.
L’alphabet grec en revanche décompose la syllabe elle-même et donne
le même statut aux consonnes qu’aux voyelles. Ce changement qui révèle le rôle de la voix dans toute articulation verbale («l’unité de décomposition de la
parole sera une voyelle ou un
segment incluant une voyelle (CV ou VC). Du reste, pour le linguiste aussi, la
syllabe est une « unité sui generis » »(Cours 11) qui
permet de reproduire par l’écriture l’ « articulation naturelle de la langue » et de
matérialiser les relations grammaticales avec lesquelles cette langue explicite
les positions subjectives dans l’acte de l’énonciation.
Deux types de langues se dégagent à
partir de ce traitement métasémiotique du rapport qu’elles entretiennent à
l’écriture : celles ou prédominent l’étymologie ou le sémantique (l’hébreu, et déjà chez les
Phéniciens) ; celles, ensuite, où la vocalisation distingue voyelles et
consonnes, et où les
variations grammaticales, qui détruisent souvent les relations étymologiques, conduisent à un
affinement du système flexionnel (modifications morphologiques par affixation
exprimant les catégories grammaticales).
Une relation
« consubstantielle » entre écriture et langue se dégage ainsi et
peut être exprimée dans ces termes : les types d’écritures accomplissent l’autosémiotisation,
c’est-à-dire la prise de conscience des types de langues auxquelles elles
correspondent (« L’écriture a toujours et partout été l’instrument qui a permis à la langue de se
sémiotiser elle-même », Cours 12). Ensemble, écriture et langue
constituent différents types de signifiance. Et puisque les langues comprises
comme des expériences d’énonciation « contiennent » le référent
tout autant que les expériences subjectives des locuteurs dans leurs actes et leurs échanges
discursifs (Cours 1 à 7), ce sont bien différentes manières d’être au monde que ces types
d’écritures révèlent, consolident et recréent. Ainsi se dessine une « ligne de partage » assez nette : à l’est (en Mésopotamie, en Egypte et jusqu’en
Chine) prédominent des « civilisations de l’écrit » caractérisées par
le primat de l’écriture, où le scribe (le « sage calligraphe » en
Chine) joue un rôle central dans l’organisation de la société ; tandis
qu’à l’ouest dans le monde indo-européen, une dévalorisation, voire un
certain « mépris » de l’écriture (chez Homère, grapho ne signifie que « gratter »), prévalent (Cours 14).
A peine esquissée, cette typologie des
signifiances à travers les types d’écritures paraît déjà riche de potentialités
pour la recherche en sémantique et en sémiologie de l’énonciation. On pourrait envisager ainsi (Cours 14), parmi d’autres pistes, de
déterminer les spécificités sémiotiques et sémantiques des textes de la Bible, et
de sonder la subjectivité de ses
locuteurs comme de ses destinataires. Ou encore d’interroger l’opposition faite par saint Paul
entre « lettre » et « esprit » : doit-on l’entendre comme une dyade réunissant, d’une part, le sémiotique biblique ( la
« lettre ») qui est toujours déjà sémantique dans les mots hébreux (par
l’empreinte polysémique du graphisme mémorisant le message ou l’histoire de la
tradition) et, d’autre part, le discours d’une subjectivité évangélique qui
s’actualise dans le temps de l’expression, du paraître et de la communication
discursive (manifestés et clarifiés par les catégories et les modalités de la
grammaire grecque)? Comment
comprendre qu’avec « les notions nouvelles attachées à l’écrit /alphabétique/»
apparaisse la
« civilisation laïque » (Cours
14) ? Doit-on en déduire que la diversité des écritures (notamment par le
truchement de la traduction du latin
dans les langues vernaculaires) et d’autres systèmes de signes qui élargissent l’auto-sémiotisation de
la langue dans une civilisation sécularisée favorisent sa capacité d’engendrer du sens, et prédisposent les
subjectivités présentes en elle à créer de nouvelles expériences
signifiantes ? Ou, au
contraire, qu’une certaine « laïcité »
succédant au christianisme pourrait privilégier le sémantique d’un discours pour communicants, au détriment du sémiotique du langage
intérieur?
Sans explorer
plus loin ces programmes à peine esquissés, et sans aller non plus dans la
direction du relativisme linguistique, mais en ouvrant des perspectives
complémentaires de celles proposées par Edward Sapir, Benveniste s’en tient strictement au
plan de la linguistique générale et marque une nouvelle étape de sa pensée. A la lumière de cette participation des diverses écritures à la révélation et au développement de la double signifiance des
langues, l’auteur soutient que
l’écriture est non seulement parallèle à la langue (et aux types de langues), mais qu’elle les prolonge. L’iconisation
déclenche et affine la formalisation de la langue, de sorte que progressivement
l’écriture se littéralise. « Elle sémiotise tout » : l’écriture
est un système de signes qui « ressemble beaucoup plus au langage
intérieur qu’à la chaîne du discours » (Cours 12).
Une
nouvelle caractéristique du « langage intérieur » se précise ici :
« avant » même le scribe sacré (qui sémantise d’emblée la langue, par
le graphisme sémantique des écritures syllabiques sémitiques ;
ou par l’invention des caractères chinois où chaque signifié a son image),
c’est logiquement le langage intérieur qui « sacre » en formulant le
« mythe ». Et cette narrativité
« intérieure », ce
« train d’idées », telle
une écriture de la « globalité », raconte une « histoire entière ». S’agit-il
d’une sorte de « fiction », dont Husserl disait qu’elle constitue
l’ « élément vital de la phénoménologie » ? Ou est-ce une
variante benvenistienne du « fantasme originaire » de Freud, qui se
livre et se délivre en « associations libres » ? Ou encore,
s’agit-il de ces « enveloppes narratives » (bien plus que des
« compétences syntaxiques ») que les cognitivistes supposent être les
premières holophrases de l’enfant
qui commence à parler ? Certainement,
quoi qu’il en soit, le langage poétique – « intérieur au langage »,
« créé par le choix et l’alliance des mots » (22, f8/f260)
[14]
,
et qui s’écrit en récits métaphoriques
condensés (on songe aux vers de Baudelaire et Rimbaud : « Mère des
souvenirs, maîtresse des maîtresses ; « Vaste comme la nuit et comme
la clarté» ; « Voilà la Cité sainte, assise à l’Occident »)
– en est-il une manifestation.
Benveniste évoque succinctement cette piste de recherche, pour revenir
toujours à la linguistique générale et à la fonction de signifier qu’exerce le
langage. « Tout comportement social », relations de production et de reproduction comprises, ne préexiste pas au langage, mais « consiste dans sa détermination ». « Encerclant »
ou « contenant » le référent, la langue « opère sur elle-même
une réduction » et se « sémiotise » elle-même : l’écriture étant le
« relais » explicitant cette faculté. En somme, l’écriture explicite et renforce de façon
définitive le caractère non instrumental et non utilitaire de la langue, laquelle,
de ce fait et plus que jamais, n’est ni outil, ni communication, ni lettre
morte, mais « organisme signifiant » (Aristote, Cours
12), générateur et auto-générateur.
Arrivé à ce point, Benveniste inverse
l’hypothèse initiale au sujet de
l’écriture. En tant
qu’ « opération » dans le « procès linguistique », l’écriture est « l’acte fondateur » qui a
« transformé la figure des civilisations », « la révolution
la plus profonde que l’humanité a connue » (Cours 14). Cette
particularité de l’écriture dans son rapport à la langue renforce aussi
une ultime constatation : la
langue et l’écriture « signifient exactement de la même manière ».
L’écriture transfère la signifiance
de l’ouïe à la vue, c’est une « parole dans une forme secondaire ». La
parole étant la première, « l’écriture est une parole
transférée ». « La main
et la parole se tiennent dans l’invention de l’écriture », écrit
Benveniste. Le rapport écriture/parole est l’équivalent du rapport parole entendue/parole énoncée. L’écriture se réapproprie la parole pour
transmettre, communiquer, mais aussi reconnaître (c’est le sémiotique) et
comprendre (c’est le sémantique). L’écriture est partie prenante de l’interprétance de la langue. Ce relais de la parole fixée dans un système de
signes reste un système de la
parole, à condition d’entendre cette dernière comme une signifiance susceptible
d’engendrements ultérieurs d’autres systèmes de signes. Jusqu’aux numériques
blogs et Twitter…
Ce n’est certainement pas un hasard si, au cœur de ce work in progress sur les modalités de la
signifiance spécifique du langage, intervient un rappel du Philèbe de Platon : au sein de
la diversité des sensations et des plaisirs
humains , tout Un est Infini, et le seul moyen de s’opposer à l’absence de limites dans l’état de nature
est de recourir aux nombres, grâce
auxquels il devient possible de délimiter les unités dans un ordre
hiérarchique, de dissocier et d’identifier. Comme les « notes » en
musique, les lettres en grammaire (grammatike techne) sont des
« nombres » : en ce sens l’activité du grammairien, qui dénombre
et organise le sémiotique du langage, au-dessous de
la signification, est «
divine » (Cours 13). En rappelant ce parallèle entre l’analyse
du langage et l’œuvre de l’Egyptien Teuth (Toth en grec) qui fut le premier à
percevoir que les voyelles sont « multiples dans l’infini », Benveniste s’approprie l’idée du « nombre » pour articuler
celle de limite, incontournable en linguistique (où il s’agit de « dissocier et
identifier les unités de plusieurs échelons », d’« arriver à des
nombres/à une limite), et celle de la création du monde par la Parole. Mais il déplace
l’onto-théologie du sens transcendant et retisse les connotations de cette « transcendance » (annoncée
dès le Cours 1), toujours infléchie à l’intérieur du langage, et qui continue à
se construire sous les yeux du lecteur de ses leçons : « L’homme instruit
des lettres, le /grammatikos/ c’est l’homme instruit de la structure du
langage » . « La relation de l’unité et du multiple est
celle qui se trouve à la fois dans
la connaissance (épistémé) et dans
l’expérience des sensations » (Cours
13).
Pas à pas, la théorie de Benveniste intègre donc tout référent et, implicitement, l’infini de la Res divina –par définition
extérieure au monde humain –
dans et par la signifiance du
langage. Il s’appuie pour cela sur Socrate, comme on a vu, auquel on
pourrait ajouter le quatrième tome
du Pentateuque, le Livre des Nombres, ou la Kabbale qui construit du sens en dénombrant. Mais plus que tout autre, c’est au
quatrième Evangile, celui de Jean, que semble remonter cette signifiance duelle de la langue, englobant
la représentation graphique, l’acte d’écrire et les variantes des écritures, ainsi
que l’intersubjectivité et le
référent : « Au commencement était la Parole. » A cette différence près que, sans « commencement »,
le « divin » se résorbe dans l’engendrement des « plis »
(Leibniz) de la signifiance
[15]
:
dans les éléments et
catégories de ce
« donné » qu’est le langage. Donné dont le linguiste ne
cherche ni les conditions de « vérité », ni les infinies configurations
translinguistiques, potentielles et à venir, mais dont il se contente d’« essayer de reconnaitre les lois » (PLG2, p. 238).
Signifiance
et expérience
Prise à son niveau « fondamental » (distinguée des
langues empiriques « contingentes »), la langue devenue
« signifiance » n’est pas un simple complément ajouté à la théorie du signe saussurien coextensif
au « contrat social ». En reprenant l’idée que les structures
linguistiques et les structures sociales sont « anisomorphes », Benveniste tend à démontrer que l’acte de signifier
est irréductible à la communication
et aux institutions, et qu’il ne transcende le « sens donné » que par
l’ « activité du locuteur mise au centre ». La notion d’ « énonciation »
comprise comme une « expérience » modifie considérablement l’objet de
la signifiance et/ou du langage (PLG2, p. 67 sq. et p. 79 sq.).
Loin d’abandonner le « signe »,
la signifiance inclue ce dernier dans le « discours » comme acte illocutoire
intersubjectif qui transmet des « idées ». La signifiance est une organisation
syntagmatique comprenant les divers types de constructions syntaxiques, et
« contient » de ce fait le « référent » de la linguistique
saussurienne, à la condition de l’enrichir par la « situation unique », l’ « événement » de
l’énonciation qui implique « un certain positionnement du locuteur ».
C’est l’ « expérience » du sujet
de l’énonciation dans la situation intersubjective qui intéresse le linguiste, mais à travers l’« appareil formel » de l’ « intenté » : c’est-à-dire
les « instruments de son accomplissement » tout autant que les « procédés par lesquels les formes linguistiques se diversifient et
s’engendrent ». La
« dialectique singulière de la subjectivité », « indépendante de toute
détermination culturelle », était certes déjà annoncée précédemment (PLG2, p. 68). Mais par le truchement de l’écriture, les Dernières leçons approfondissent l’ « engendrement » de la
signifiance en déplaçant
l’expérience subjective d’un échange dialogique je/tu vers une topologie du sujet de l’énonciation qui déroge aussi bien à l’ego cogito de
Descartes qu’à l’ego transcendantal husserlien.
Les termes désignant cette dynamique du langage varient
: «engendrement », mais aussi « fonctionnement »,
« conversion » de la langue en écriture et de la langue en discours,
« diversification » ; la langue étant définie comme « production », « paysage mouvant »,
« lieu de transformations ». Mais contrairement aux « transformations » qui intéressent les
grammaires génératives et pour lesquelles les catégories
syntaxiques sont d’emblée données, l’ « engendrement » de la
signifiance selon Benveniste s’engage
profondément dans le processus d’un avènement de la signification pré- et
translinguistique, et vise trois
types de relations d’engendrement : relation d’interprétance
(propriété fondamentale, la langue étant « le seul système qui peut tout
interpréter ») ; relation d’engendrement (entre systèmes de signes : de l’écriture alphabétique au braille) ;
relation d’homologie (en référence
aux « correspondances » de Baudelaire). La Dernière leçon reprend chacune d’entre elles, en rappelant la nécessité de revoir les « catégories formelles » (« cas »,
« temps », modes »), et pose que « tout le système
flexionnel est ici en question ».
Le sujet de l’énonciation lui-même
devait se ressentir de cette
mobilité. Dans ce paysage mouvant
de la langue, et au regard de l’écriture qui a contribué à le faire apparaître,
une réflexion sur l’expérience spécifique de l’écriture que représente le « langage poétique »
s’imposait. De fait, Benveniste, en
contrepoint de la lecture structuraliste des « Chats » de Baudelaire
par Roman Jakobson et Claude Lévi-Strauss,
et en écho aux indications des Derniers cours, aborde le sujet dans ses Notes
manuscrites sur Baudelaire
[16]
,
de la même période (de 1967 à 1969).
Plus proche du
« langage intérieur » que du discours, le langage poétique exige de
l’analyste qu’il « change d’instruments », comme le voulait Rilke
[17]
(commenté, nous l’avons vu, par le jeune Benveniste). Cette « langue différente » que serait la poésie nécessite donc une
« translinguistique », car la « signifiance de l’art » est
« non conventionnelle » et parce que ses « termes », provenant des
singularités spécifiques de chaque sujet écrivain, sont « illimités en nombre ». D’emblée,
Benveniste établit quelles sont les singularités de cette « translinguistique » :
le message poétique, « tout à
l’envers des propriétés de la communication » (20, f10/f204), parle une émotion que le langage
« transmet » mais ne « décrit » pas (12, f4/f56). De même, le référent du langage poétique est « à l’intérieur de l’expression », tandis que dans le
langage usuel l’objet est hors langage.
Il « procède du corps du poète »,
« ce sont des impressions musculaires », précise Benveniste. Le langage poétique,
« sensitif », « ne
s’adresse qu’aux entités qui participent à cette nouvelle communauté :
l’âme du poète, Dieu/la nature, l’absente/la créature de souvenirs et de
fiction » (23, F33/ f356). Pourquoi Benveniste choisit-il Baudelaire pour
illustrer son propos ? Parce que ce
dernier opéra la « première fissure entre le langage poétique et le langage
non poétique », tandis que chez Mallarmé cette rupture est déjà consommée
(23, F35/f358).
Contemporaines des Dernières
leçons, ces notes sur
l’expérience poétique de Baudelaire rejoignent les réflexions sur la « force anarchique » à
l’œuvre dans l’inconscient et que la langue « refrène et sublime »
(PLG1, p. 77). Expression d’une
« subjectivité instante et élusive qui forme la condition du
dialogue », cette expérience participe de l’infra- et du supra-linguistique (Ibid., p. 86), ou plutôt du translinguistique (PLG2, p. 66).
Consacrée aux œuvres, la translinguistique sera basée sur la sémantique de
l’énonciation.
Faites à l’écoute de la
poétique de l’Inde ancienne telle qu’elle apparaît dans les textes sacrés que
le sanscritiste Benveniste maîtrise à fond, ces dernières réflexions entrent en
résonance avec la fin de ces années 1960, où les révoltes sociales et
générationnelles, appelant à mettre l’ « imagination au
pouvoir », cherchaient dans l’expérience de l’écriture (d’avant-garde ou féminine) les logiques secrètes et innovantes du
sens et de l’existence.
Avec le recul, et dans l’absence de toute
référence explicite à la psychosexualité, ce n’est pas à la théorie freudienne
de la sublimation que fait penser cette linguistique générale de l’expérience et de la subjectivité, mais au cheminement – innommé – de Martin Heidegger. En effet, le langage selon Etre et Temps (1927) est discours (Rede) ou parole, les mots n’ayant pas de signification en dehors du Mittsein du dialogue. Il est du
ressort du Dasein d’interpréter : c’est sa
localisation dans l’analytique
existentiale qui est prise en considération, au détriment du langage comme tel. On surpend certaines résonances
entre cette première conception du langage chez Heidegger et la première
linguistique générale de Benveniste (PLG1, 1966) qui proposait de placer l’appareil formel de ce régime de
langage – « discours » et « interprétant » – dans
la société et la nature. L’approche heideggérienne change dans Acheminement vers la parole (1959), où le langage est envisagé comme « la dite », Sage, « ce qui est parlé ». Le
dialogue devient monologue, sans pour autant être solipsiste, mais, en tant
qu’il est « discours intérieur », jamais propositionnel, sans
« son » ni « communication », sa « pensée
intérieure » réalise dans le silence la production mentale d’un « venir à la langue ».
Pour Benveniste, l’écriture comme graphisme et comme expérience poétique
– de Baudelaire au surréalisme – semble croiser la définition par Heidegger du
« langage qui parle uniquement et solitairement avec soi-même », et
rend possible la sonorité. Mais pour s’en écarter aussitôt, car à ce
« laisser-aller » qui serait l’essence du langage, sourdement menacé
de devenir « insensé », chez le deuxième Heidegger, les remarques
allusives des Dernières leçons et du Baudelaire apposent, plus qu’elles
n’opposent, la vigilance du linguiste pour lequel « le discours comporte à la fois la limite et
l’illimité », « l’unité et la diversité » (Cours 13)
En effet, Benveniste ne manque jamais
d’insister sur « syntagmation » – probablement « reflétant une
nécessité de notre organisation cérébrale » (PLG2, p. 226) – qui
confère à l’ « instrument du langage » sa capacité de coder en
codifiant, de limiter en se limitant, et d’assurer ainsi la sémantique d’un
discours intelligible, communicatif, en prise sur la réalité. Il ajoute
cependant que, parallèle à la langue
et son relais, l’écriture comme représentation graphique et comme expérience poétique,
bien que plus proche du « langage intérieur » que du « discours »,
n’élimine pas ses vertus
pragmatiques. Mais qu’elle se
risque à déplacer les limites de la langue par l’engendrement de systèmes
signifiants singuliers (le poème) et néanmoins partageables dans l’ « interprétance »
de la langue elle-même. Ni tyrannie
institutionnelle ni hymne rêveur, la signifiance qu’esquisse ce dernier
Benveniste est un espace de liberté.
« La linguistique est universelle
[18]
»
Tout le monde communique
aujourd’hui, mais rares sont ceux qui perçoivent la consistance et toute l’étendue du
langage. A l’époque où Benveniste donnait ses Derniers cours, l’idée selon laquelle le langage détermine les humains d’une autre façon et plus profondément
que ne le font les rapports sociaux commençait à devenir une pensée dangereuse : une véritable révolte contre les conventions, l’ « ordre établi », l’ « Etat
policier », le marxisme doctrinaire et les régimes communistes. A
Varsovie, en Italie, en Tchécoslovaquie, dans les Républiques baltes alors
soviétiques et ailleurs, la sémiologie était synonyme de liberté de penser. Assez
logiquement, c’est à Paris (où la recherche française montrait un grand
dynamisme, que ce soit à travers la Section
de sémiologie du Laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de France,
la revue Communications ou les
publications d’Emile Benveniste, Roland Barthes et Algirdas Greimas, parmi
d’autres) que naquit l’idée de réunir ces courants mondiaux. Et c’est tout
aussi logiquement que, sous l’autorité inspirée de Roman Jakobson, la présidence
de Benveniste s’imposa à tous. Le Symposium
international de sémiotique créé
en août 1968 devait constituer les bases de l’Association Internationale de sémiotique (AIS) dont Emile Benveniste devint officiellement le
Président en 1969.
Jeune étudiante bulgare bénéficiant
d’une bourse du gouvernement français, j’ai eu le privilège – avec la
linguiste Josette Rey-Debove – d’être chargée du secrétariat scientifique
de la publication « Recherches sémiotiques » de Social Science Information (UNESCO) d’abord, puis de l’AIS. Ce
contexte, alors que j’avais déjà lu avec passion le tome 1 des Problèmes de linguistique générale, me
donna l’opportunité de nouer un lien personnel exceptionnel avec Emile
Benveniste. Les rencontres avaient lieu à son domicile, rue Monticelli, près de la porte d’Orléans. Aujourd’hui
encore je me remémore son bureau comme un lieu « sacré » (il
apparaissait tel à la jeune fille timide que j’étais alors), où le grand savant, au sourire d’une vive
intelligence parfaitement saisie par la photographie reproduite ici, paraissait
conserver les secrets des mondes immémoriaux indo-européen et
iranien. C’était un cabinet de travail assez sombre, où des livres tapissaient les murs et jonchaient
le sol, vieux fonds de bibliothèques dont le parfum, se mêlant à la fumée du
thé qu’accompagnaient des biscuits secs auxquels nous ne touchions jamais,
m’évoquait d’antiques parchemins. Les détails administratifs vite expédiés, le professeur s’enquérait de mon
travail
[19]
.
D’une curiosité jamais satisfaite, il s’intéressait aussi bien aux débats linguistiques
et philosophiques en Europe de l’Est (le « dialogisme » de Bakhtine) qu’aux
innovations de la littérature (alors en pleine effervescence, avec le
« Groupe théorique » de la revue Tel
Quel de Philippe Sollers qui se réunissait au 44, rue de Rennes). Au cours de tous ces
entretiens, où Benveniste se montrait aussi pédagogue et protecteur qu’attentif,
je me rappelle, entre autre, lui avoir demandé si l’écriture était un processus
« infra-» et « supra -» linguistique (comme
il l’écrivait à propos du rêve) ou plutôt translinguistique ;
lui avoir soumis l’idée que l’écriture de Raymond Roussel pourrait être définie comme une « productivité »
défiant le « produit » ; ou avoir découvert chez Jakobson dont
il me parlait la notion de « spotha » ( à la fois « son »
et « sens » et toujours «activité », selon les grammairiens
indiens). Je me rappelle que le professeur me conseilla de lire à ce sujet le récent livre de Madeleine Biardeau sur
le langage dans le brahmanisme classique ; qu’il exprima le regret, un
autre jour, qu’Harris et Chomsky eussent fondé une syntaxe générale sans tenir
compte de la diversité des langues (« C’est regrettable de ne connaître
qu’une seule langue », avait-il écrit à un linguiste de renom). Le plus
souvent, il répondait à mes questions par des propos lapidaires, passablement
provocateurs : « Vous comprenez, moi je ne m’intéresse qu’aux petites
choses. Le verbe “êtreˮ, par exemple. » Et de me conseiller de
consulter, après ses Problèmes de linguistique générale une récente publication sur ce sujet
immense dans un récent numéro de la
très sérieuse revue Foundations in Language…
[20]
Ou bien, en guise de réponse à mes interrogations, il ouvrait le texte sanscrit du Rigveda, pour me traduire directement en
français des passages appropriés. Puis, après quelques remarques sémantiques ou
grammaticales, il revenait au contenu du « récit » et aux « personnages »
de cette grande collection d’hymnes de l’Inde antique, toujours d’un ton allusif
et un brin ironique (à l’adresse d’Aragon, par exemple) : « Croyez-vous,
Madame, que la femme est l’avenir de l’homme ? »
Un autre jour, alors que je venais
de découvrir le terme de « sénéfiance » dans le « voyage de
l’âme vers Dieu » cher aux théoriciens médiévaux du « modi significandi », je lui
demandai ce qu’il en pensait. « Vous lisez beaucoup pour votre âge, me répondit-il.
Je crois que, plus près de nous, le
père de Jean Paulhan se servait de ce terme. On lit toujours, en Bulgarie ? Et
en Europe de l’Est en général, n’est-ce pas ? Vous savez que “citatiˮ, la racine slave pour
“lireˮ, remonte au sens de “compterˮ, de “respecterˮ
aussi. » Je n’y avais pas pensé, c’était évident, je ne savais pas grand-chose.
Il ne m’a jamais dit que ses
parents avaient été enseignants à Samokov, en Bulgarie. Seulement que je lui
rappelais sa mère : une lointaine ressemblance, je suppose.
La phénoménologie de Husserl
l’intéressait beaucoup et il semblait étonné que je puisse avoir quelques modestes
connaissances de ses Ideen. Mais nous n’avons jamais
mentionné Heidegger, que je venais seulement de découvrir.
A Varsovie, j’avais apporté
les Lettres de Rodez d’Antonin
Artaud. « Vous voudriez bien me le prêter ? » me demanda-t-il.
Emile Benveniste cacha le petit livre sous les polycopiés du Symposium et je vis que, un sourire
timide aux lèvres, il s’autorisait à le lire quand le conférencier ou le débat
piétinait trop. Encouragée par ce témoignage de liberté, et ayant repéré
récemment son nom aux côtés de ceux d’Artaud, Aragon, Breton, Eluard
, Leiris et toute une pléiade d’intellectuels, artistes et écrivains qui
avaient signé le Manifeste surréaliste « La Révolution d’abord et
toujours » (1925), je me suis adressée, pendant la pause, à notre futur
Président :
« Monsieur, quelle joie de découvrir votre nom parmi
les signataires d’un Manifeste surréaliste.
-
Fâcheuse coïncidence, Madame. »
Le sourire avait disparu, un regard vide et froid
me cloua au plancher, et je m’effondrai de honte devant le groupe de congressistes
qui nous entourait. Quelque heures plus tard et sans témoins, le Professeur me
chuchota à l’oreille :
« Bien sûr que c’est moi, mais il ne faut pas le dire.
Voyez-vous, maintenant je suis au Collège de France. »
A notre retour à Paris, il m’invita
à prendre le thé, cette fois-ci à
la Closerie des lilas.
« C’est ici que nous nous réunissions. Une époque
violente, la guerre. Mais le sang coulait ici aussi, dans le groupe même. »
Me voyant surprise, il ajouta : « Non, la métaphore n’est pas trop forte. J’ai vite compris que ce n’était pas ma
place. »
Je
relis aujourd’hui ce Manifeste
[21]
.
En effet. Benveniste avait fui les
appels à l’insoumission, abandonné la révolte sanglante trotsko-stalinienne
(Breton et Aragon), ignoré l’expérience affolante de l’infini poétique – qui, dégagé
du contrat social, emporte l’ordre du langage (Mallarmé : « Une seule
garantie, la syntaxe. ») dans une explosion vocale
(les glossolalies d’Artaud) – pour se consacrer dans une sorte de sacerdoce à la signifiance dans les logiques du
langage. La convention académique constituait pour ce nomade tenté par
l’embrasement, « pauvre linguiste écartelé dans l’univers », une
protection et forcément un
freinage. Mais elle ne l’a pas
empêché de tendre la main à la pensée dissidente sous le communisme – dont
il n’a pu voir la fin marquée par la chute du Mur de Berlin, et dont le Symposium de Varsovie apparaît avec le
temps comme un des signes avant-coureurs. Pas plus qu’elle ne l’a découragé d’ausculter la trace de la subjectivité
libre et créatrice dans la dualité
de la signifiance : entre l’expérience sans nom de « langage
intérieur » et le sémantique du discours qui s’emploie à communiquer et à
ordonner.
Je me souviens de notre dernière conversation, fin novembre ou début
décembre 1969. Il avait reçu mon livre, Semeiotikè,
recherche pour une sémanalyse, dont, toujours bienveillant, il espérait finir la lecture et me parler
en détail avant les vacances. Mais bientôt, soudain, ce fut le choc :
l’annonce de l’accident, la paralysie, l’aphasie. L’administration du Collège
de France et ses collègues prenaient en charge toutes les formalités d’usage,
auprès de sa sœur Carmélia, héroïque de dévotion et de délicatesse, que j’ai découverte à l’hôpital et qui
l’a accompagné jour après jour et jusqu’à la fin dans des conditions
misérables. Elle me parlait surtout du Père Jean de Menasce, que
je n’ai pas connu, dont l’ancienne amitié avec Benveniste et l’expérience
personnelle d’une attaque similaire, dont il s’était heureusement rétabli, inspiraient toute confiance à la sœur du grand linguiste.
La situation était déplorable : le
malade était hospitalisé dans une chambre commune, où il subissait chaque jour les
visites importunes des familles, la promiscuité malsaine, dans l’absence de
soins rééducatifs. « On » avait l’impression que le malade ne comprenait plus la
parole. « Mais il ne réagissait pas davantage aux histoires familiales qu’on lui
racontait avant son accident, ça l’ennuyait trop », tempérait Carmélia
Benveniste. Nous parvînmes à faire venir pour expertise le grand spécialiste de
l’aphasie, François Lhermitte, qui lui demanda de dessiner une maison. Aucune réaction.
Terrifiée à l’idée que l’expertise tourne court, je fis l’effort de solliciter
moi-même le malade. Il dessina la maison. Un programme de rééducation de la parole fut alors mis en place. Le résultat ne fut pas jugé probant. Avec Mohammad
Djafar Moïnfar, son fidèle disciple, nous avons bientôt compris qu’il
était impossible de trouver une meilleure place dans un établissement privé
– le savant distrait n’ayant pas cotisé à son assurance de la MGEN, ai-je
cru comprendre. Nous avons envisagé de lancer une cotisation auprès de tous ses amis, pour régulariser rétroactivement l’assurance, mais diverses
difficultés administratives s’y opposèrent. Aujourd’hui encore, je me reproche
de n’avoir pas accompagné ses séances de rééducation : l’affection qu’il
me portait, peut-être, l’aurait rendu plus coopératif. Une illusion, sans doute, mais à laquelle je pense toujours.
Souvent il m’avait semblé que ses élèves et amis étrangers étaient les plus
motivés, les plus conscients de sa détresse et de l’ampleur de son œuvre.
J’étais persuadée qu’il était toujours intellectuellement
présent. Ainsi un jour je lui ai demandé de me dédicacer son premier livre, The Persian
Religion According to the Chief Greek Texts (1929), que j’avais trouvé en
anglais chez un antiquaire orientaliste. D’une écriture tremblée, en lettres
capitales d’imprimerie, il écrivit son nom, E. BENVENISTE, en ajoutant la date
23-9-1971, qu’il corrigea aussitôt en 24- 9-1971 : il demeurait donc présent
dans l’acte de l’interlocution, et conservait la notion du temps chronologique. En 1971, le numéro spécial de la
revue Langages sur
« L’Epistémologie de la linguistique », dirigé par moi, lui fut
dédié : « Hommage à Emile
Benveniste » – ce dont il s’est réjoui. Avec Pierre Nora (directeur de la Bibliothèque des Sciences humaines chez
Gallimard), nous lui apportâmes aussi l’édition du deuxième volume de
ses Problèmes de linguistique générale. En 1975, un recueil conçu par Nicolas
Ruwet, Jean-Claude Milner et
moi-même sous le titre Langue, discours, société. Pour Emile
Benveniste lui fut consacré au Seuil. Il l’accueillit avec plaisir. Bien
sûr ces lectures étaient fatigantes, et sans doute en appréciait-il davantage
l’existence même plus que les détails. Par la suite, hélas, les neufs
transferts hospitaliers dont il fut l’objet en sept ans, ma thèse d’État, puis la maternité me
firent raréfier mes visites. Mais il ne m’oubliait pas et en novembre 1975 une
lettre de Carmélia Benveniste m’informait que le Professeur demandait expressément
à me voir. Il arrivait encore à exprimer ses désirs, et se rappelait ceux qu’il souhaitait revoir.
Au cours d’une de ces
rencontres, c’était à l’hôpital de Créteil, il me demanda de m’approcher de son lit, se redressa, tendit l’index
comme sur la photo reproduite ici et, très timidement, avec ce même sourire
adolescent, se mit à « écrire » sur le chemisier qui recouvrait ma
poitrine. Surprise, bouleversée
autant que gênée, je n’osai bouger et
ne pus deviner ce qu’il souhaitait
écrire ou dessiner dans ce geste étrange. Je lui demandai s’il voulait quelque
chose à boire, lire ou entendre. Il secoua la tête en signe de négation et
recommença à tracer sur ma poitrine
ces signes aussi troublants qu’indéchiffrables. Je finis par lui tendre une
feuille de papier et un stylo Bic. Alors, de la même écriture en lettres capitales d’imprimerie qu’il avait
choisie pour me dédicacer son livre, il traça : THEO.
Je ne savais guère à
cette époque – était-ce en 1972 ou 1973 ? – que Benveniste
était arrivé en France comme élève
de l’Ecole rabbinique. Il ne m’avait pas parlé non plus de la Shoah. Je n’avais
pas une vision globale de ses travaux en linguistique générale, le deuxième
volume de ses Problèmes de linguistique générale n’étant pas
encore réuni, et de toute façon mes connaissances insuffisantes ne m’auraient pas permis de l’assimiler. Mais j’étais persuadée que la paralysie
verbale n’avait pas détruit complètement son intelligence. Ce « THEO »
avait un sens.
Aujourd’hui, en lisant ses derniers
écrits au regard de son œuvre publiée, je ne prétends pas vous proposer une
interprétation : « THEO » me restera à jamais énigmatique.
J’esquisse seulement une lecture.
Les hasards de nos histoires
personnelles respectives m’avaient mise sur sa route, afin qu’il me rappelle,
avant de s’éteindre, un message qu’il tenait à tracer dans un corps :
Quel
que soit « le sémantique » de notre discours (tel que nous le
communiquons par dialogues dans nos
existences temporelles), la diversité de nos langues et la langue
elle-même engendrent cette « capacité
sémiotique » (dont l’imprononçable graphisme /YHWH/ porte témoignage, mais que le professeur avait
entrepris d’analyser avec les outils de l’onto-théologie grecque /THEO/ et grâce à ses suites scientifiques) dans
la rencontre entre les « langages
intérieurs » de nos subjectivités.
Cette « force originelle à l’œuvre »
(Cours 7) « transcende » /THEO/
toute autre propriété du langage, et « on ne conçoit pas » que
« son principe se trouve ailleurs que dans la langue ». « Je », toute personne
parlante, consiste en cette
dualité, se tient à ce carrefour. « Je », toute personne,
expérimente cette « SIGNIFIANCE»
qui enserre et interprète l’histoire.
Je saurai gré aux lecteurs de ces Dernières Leçons d’ajouter leur propre
chemin à ce carrefour, à cette écriture.
Julia Kristeva
Articles d’Emile Benveniste cités :
Problèmes de linguistique générale, t. 1, Gallimard, 1966 (PLG1)
1.
« Catégories de la pensée et catégories de la langue », p. 53-74
2.
« Remarques sur la fonction du langage dans la découverte
freudienne », p. 75-87
3.
« De la subjectivité dans le langage », p.258-266
4.
« La philosophie analytique du langage », p.267-276
Problèmes de linguistique générale, t. 2, Gallimard, 1974 (PLG2)
1.
« Le langage et l’expérience humaine », p. 67-78
2.
« L’appareil formel de l’énonciation », p. 79-88
3.
« Structure de la langue et structure de la société », p. 91-102
4.
« La forme et le sens dans le langage », p.215-240
[1]
Sa
mère, Marie Benveniste (née à Vilna, aujourd’hui en Lituanie), enseigne l’hébreu, le
français et le russe à l’école de l’AIU à Samokov (Bulgarie) ; son père,
Mathatias Benveniste (né à Smyrne), parle sans doute le ladino ; l’environnement de sa petite enfance est de langue turque,
arabe, grec moderne, slave probablement. Beaucoup de grands linguistes français du début du XXe siècle, d’origine juive, sont
portés à l’étude des langues par le multilinguisme de leur milieu familial (les
frères Darmesteter, Michel Bréal, Sylvain Lévi).
[2]
Un « Talmud Torah » qui devait donner aux élèves
un bagage de culture juive, amener les jeunes au baccalauréat et leur
permettre de se préparer au rabbinat. Les élèves y apprennent le latin, le
grec, l’hébreu, l’allemand et, avec un soin tout particulier, le français.
[3]
Cf. Françoise Bader, « Sylvain
Lévi » in Trois linguistes (trop) oubliés, Anamnèse n°5, 2009, L’Harmattan,
2010, p. 141-170.
[4]
Les signataires adjurent l’UGIF « de maintenir
entre nos frères français et nous une union aussi étroite que possible/…/de ne
rien tenter/…/ qui puisse nous isoler moralement de la communauté nationale
dont, même frappés par la loi, nous restons fidèles. » Cf. Marc Bloch, L’étrange défaite (1946), Gallimard,
Folio, 1990, p.314-319.
[5]
Et
dont l’exemple le plus concret est son Vocabulaire des Institutions indo-européennes (2 vol. Ed.de Minuit, 1969).
[6]
En
écho à Rilke, cet aveu condensé et
allusif exprime la nostalgie du jeune linguiste pour une mère quittée à l’âge
de 11 ans, et qui meurt sans qu’il l’ait revue lorsqu’il a 17 ans. Sensible
à la « violence latente
virile » qui l’attire sous les apparences « superficiellement
féminines » d’un maternel vigoureux et « robuste comme un
homme », Benveniste compose
son autoportrait sous les traits des poètes (des célibataires ?),
depuis Homère (le « Vieux de la mer ») jusqu’à Lautréamont
(« Vieil Océan, ô grand célibataire ! »). Cf. Philosophies I, 15 mars 1924, année de
la parution du Premier manifeste surréaliste.
[7]
L’École
rabbinique de la rue Vauquelin formait en Europe des rabbins pour les communautés en
Orient et en Afrique, « comme on formait des instituteurs pour les écoles
». Dans une lettre d’octobre 1918, la mère de l’élève écrit que la
« situation à l’école » de son fils Ezra est « devenue
intenable » : il est attiré par les langues et fera des études en
Lettres. (Cf. F. Bader, « Une anamnèse littéraire d’E. Benveniste »,
in Incontri Linguistici n°22, Rome,
1999, p. 20).
[8]
Cf. E. Benveniste, PLG2, p. 229.
[9]
« Remarques
sur la fonction du langage dans la découverte freudienne », in PLG1, p.
78 ; 1956.
[10]
C’est Antoine Culioli qui réalise ce
projet dans sa « théorie des opérations
énonciatives », en étudiant l’activité du langage à travers la diversité
des langues nationales.
[11]
Présentation
et transcription de Chloé Laplantine, Ed. Lambert-Lucas, Limoges, 2011.
[12]
Benveniste
emprunte pourtant au philosophe américain le terme
d’ « interprétant », tout en précisant qu’il n’utilise que cette
« dénomination isolée » et, surtout, dans un sens « différent » (Cours 5), qu’on présume
phénoménologique. La « tiercité » de Pierce aurait pu pourtant étayer
la structure du sujet de l’énonciation (structure « œdipienne » pour
Freud) dans le sémantique selon
Benveniste.
[13]
Avec
Roland Barthes, Le Degré zéro de
l’écriture (1953), Eléments de
sémiologie (1965), Jacques Derrida, De la grammatologie (1967), La Voix et le Phénomène (1967), et
dans le domaine littéraire, après
le « Nouveau Roman », avec Philippe Sollers, Drame (1965), Logiques (1968),Nombres (1968), L’écriture et l’expérience des limites (1971).
[14]
Cf. E. Benveniste, Baudelaire, op.cit.
[15]
Cf.
J. Kristeva, « L’engendrement de la formule », in Séméiotikè, Recherches pour une sémanalyse,
Seuil, 1969, p. 290 : « La fonction numérique du signifiant ».
[16]
Cf.
E. Benveniste, Baudelaire, op.cit.
[17]
Cf. Ibid., p.10.
[18]
Lettre
d’E. Benveniste, 17.10.1954 : « La linguistique est universelle, mais
le pauvre linguiste est écartelé dans l’univers », cité par G. Redard,
ici-même, p.64.
[19]
Je
terminais ma thèse de 3e cycle que j’ai soutenue en juin 1968, exceptionnellement, en
tant qu’étudiante étrangère ; et je commençais ma recherche sur le langage
poétique de Mallarmé et Lautréamont en vue d’une thèse d’État.
[20]
Cf. Charles H. Kahn : “The Greek verb "To be" and the concept of being”, in Foundations
of Language, Vol. 2, n° 3,
August 1966, p. 245-265.
[21]
«
Nous considérons la Révolution sanglante comme la vengeance inéluctable de
l’esprit humilié […] nous ne la concevons que sous sa forme sociale [….]
la Révolution est la sauvagerie la meilleure et la plus efficace de
l’individu. »
Voir aussi: Entretien avec Julia Kristeva dans Le Monde des Livres |