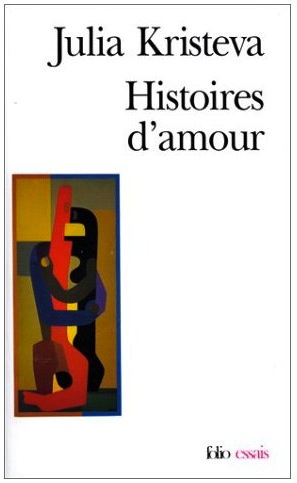|
|
Histoires
d’amour, hier et aujourd’hui
I.
Freud
et l’amour
Vertige d'identité,
vertige des mots : l’amour est, à l’échelle de l’individu, cette révolution
subite, ce cataclysme irrémédiable, dont on ne parle qu’après coup. Sous le coup, on ne parle pas de. On a simplement l’impression de parler enfin, pour la première
fois, pour de vrai. Mais est-ce vraiment pour dire quelque chose ? Pas
nécessairement. Sinon, quoi au juste ? Même la lettre d'amour, cette tentative
innocemment perverse de calmer ou de relancer le jeu, est trop immergée dans le
feu immédiat pour ne parler que de « moi » et de « toi », voire d’un « nous »
sorti de l’alchimie des identifications, mais non de ce qui se joue réellement entre l’un et l’autre. Pas de cet état
de crise, d’effondrement, de folie qui peut emporter tous les barrages de la
raison, comme il peut, telle la dynamique de l’organisme vivant en pleine
croissance, transformer une erreur en renouvellement, remodeler, refaire,
ressusciter un corps, une mentalité, une vie. Voire deux.
Force est d’admettre aussi que,
quelque vivifiant qu’il soit, l’amour ne nous habite jamais sans nous brûler. En
parler, fût-ce après coup, n’est probablement possible qu’à partir de cette
brûlure. Consécutive à l’exorbitant agrandissement du Moi amoureux, aussi
extravagant dans son orgueil que dans son humilité, cette défaillance exquise
est au cœur de l’expérience. Blessure
narcissique ? Epreuve de la castration ? Mort à soi ? Dans l’amour, « je » a été un autre. Cette formule, qui nous conduit à
la poésie ou à l’hallucination délirante, suggère un état d'instabilité où
l'individu cesse d'être indivisible et accepte de se perdre dans l'autre, pour
l'autre. Avec l'amour, ce risque, qui peut être tragique, est admis, normalisé,
sécurisé au maximum. Et la douleur qui demeure cependant est le témoin de cette
aventure, en effet miraculeuse, d’avoir pu exister pour, à travers, en vue d'un
autre. Quand on rêve d'une société heureuse, harmonieuse, utopique, on
l'imagine bâtie sur l'amour, puisqu'il m'exalte en même temps qu'il me dépasse
ou m'excède. Cependant, loin d'être une entente, l'amour-passion équivaut moins
au calme sommeil des civilisations réconciliées avec elles-mêmes qu'à leurs
délire, déliaison, rupture. Crête fragile où mort et régénérescence se
disputent le pouvoir.
Nous avons
perdu la force et la sécurité relative que les vieux codes moraux
garantissaient à nos amours en les interdisant ou en en fixant les limites.
Sous les feux croisés des salles de chirurgie gynécologique et des écrans de télévision,
nous avons enfoui l'amour dans
l'inavouable, au profit du plaisir,
du désir, quand ce n'est pas de la révolution, l'évolution, l'aménagement, la gestion, donc au profit de la politique. Avant de découvrir, sous les décombres, que ces constructions idéologiques étaient
des tentatives démesurées ou timides d’assouvir une soif d'amour… L'amour est le temps et l'espace où « je »
se donne le droit d'être extraordinaire. Souverain, égal aux espaces infinis
d'un psychisme surhumain. Paranoïaque ? Je suis, dans l'amour, au zénith de la
subjectivité.
Les délices
et les affres de cette expérience s'aggravent aujourd'hui du fait que nous
n'avons pas de codes amoureux : pas
de miroirs stables pour les amours d'une époque, d'un groupe, d'une classe. Le
divan de l'analyste est le seul lieu où le contrat social autorise
explicitement une recherche — mais privée — d'amour.
1. Narcissisme et idéalisation
Tous les
discours sur l’amour ont traité de l’égotisme, et se sont constitués en codes
de valeurs positives, idéales. Théologies et littérature, par-delà le péché et
les personnages démoniaques, nous convient à cerner dans l'amour notre
territoire propre, à nous ériger comme propres, pour nous dépasser dans un
Autre sublime, métaphore ou métonymie du souverain Bien, du sublime Beau.
Les
philosophies de la pensée qui visent, de Platon à Descartes, Kant et Hegel, à
assurer à l’expérience amoureuse une prise sur la réalité l’élaguent de son
trouble, pour la réduire à un voyage initiatique aspiré par le suprême Bien ou
l'Esprit absolu. Seule la théologie – et encore, dans ses égarements
mystiques – se laisse entraîner dans le piège de la sainte folie
amoureuse, du Cantique des cantiques à saint Bernard ou Abélard...
Premier des
modernes, et postromantique, Sigmund Freud s'avise de faire de l'amour une cure. D'aller droit à la
confusion que l'amour révèle (plus que n'induit) chez l'être parlant, avec son
cortège d'erreurs, de leurres et d'hallucinations, et jusqu'aux maux physiques.
Pour espérer remettre les choses à leur place, ce qui revient à dire :
réimplanter la réalité, peut-être pas toute, mais tant soit peu... On notera deux leviers dans ce jeu avec le feu
amoureux que l'analyse-transfert réhabilite, déculpabilise, mais aussi apaise
(certains disent : détruit).
D'abord, il
s'agit en analyse de donner au sexe ce qui revient au sexe. Dans
l'angoisse, dans le symptôme ou dans l'hallucination, l'interprétation débusque
la part refoulée du désir ou du traumatisme sexuel. En l'amenant à la connaissance
du sujet, elle dépossède celui-ci d'une partie de ses fantasmes pour lui
indiquer une part de réalité. La réalité, c'est le sexe : à partir de
votre désir ainsi reconnu, vous êtes libre de construire votre réalité comme
bordure plus ou moins fragile de votre vie amoureuse.
D'autre part,
et en même temps, l'analyste attire sur lui sans le vouloir (du moins en
principe), par la simple adresse de la parole à ses oreilles plutôt qu'à ses
yeux, les foudres de l'amour dit « amour de transfert ». Qu'il soit particulier,
en ce sens qu'il est destiné à un « sujet supposé savoir » (Lacan), n'implique
en rien qu'il se distingue de l'amour tout court. C'est que l'amour contient
sans doute toujours un amour du pouvoir. L'amour de transfert est pour cela
même la voie royale vers l'état amoureux ; quel qu'il soit, l'amour nous fait
frôler la souveraineté.
L'absurde
sartrien ravageait le monde de la pensée autant par l'éclat des bombes de la
Seconde Guerre que par l'explosion sexuelle. On n'a pas assez dit que le silence dans lequel l'analyste accueille
la parole amoureuse, toute parole en définitive amoureuse, révèle à celui qui
l'entend l'absurdité de son désir. Sa qualité d'insensé. L'amour de transfert,
comme l'amour de contre-transfert, est tissé d'un absurde cependant rejoué,
relancé, relevé. Est-ce à dire que l'analyste a « surmonté sa libido », comme
Freud l'écrit bizarrement à Jung, en envisageant, bien entendu ironiquement et
hypothétiquement, un moment lointain, à venir : « Quand j'aurai tout à fait
surmonté ma libido (au sens ordinaire), je me mettrai à une “vie amoureuse des
hommes” » (lettre à Jung du 19 septembre 1907)?
Au pays de
l'amour, Freud arrive chez Narcisse après avoir traversé l'espace dissocié de
l'hystérie. Celui-ci l’a conduit à constituer l’« espace psychique » qu'il
fera éclater, par Narcisse d'abord et, pour finir, par la pulsion de mort, en espaces
impossibles, ceux de l'« hainamoration », c'est-à-dire du transfert infini.
2. Le narcissisme : un écran du vide
Freud lie, on
le sait, l'état amoureux au narcissisme : le choix de l'objet d'amour, qu'il
soit « narcissique » ou « par étayage », s'avère de toute façon satisfaisant si
et seulement si il assure une relation au narcissisme du sujet selon deux
modalités : soit par gratification narcissique personnelle (dans ce cas,
Narcisse est le sujet), soit par délégation narcissique (Narcisse est l'autre,
pour Freud la femme). Un destin
narcissique serait en quelque sorte sous-jacent à tous nos choix objectaux,
destin que la société, d'une part, et la rigueur morale de Freud, de l'autre, souhaitent écarter au profit d'un « vrai » choix objectal.
Mais à y regarder de près, même l'idéal du Moi, qui assure le transfert de nos
demandes vers un objet véritable chargé de tous les attirails du « bien »
et du « beau » conforme aux codes parental et social, est une reprise
du narcissisme, sa relève, sa conciliation, sa consolation.
Par ailleurs,
l'omniprésence de la notion de « narcissisme » va de pair avec le fait qu'elle
est loin d'être originaire. Résultat d'un ajout, Freud nous indique qu'elle est
le produit d'une « action nouvelle », entendons d'une instance tierce
supplémentaire à l'auto-érotisme de la dyade mère-enfant : « Quelque
chose, une nouvelle action psychique,
doit donc venir s'ajouter à l'auto-érotisme pour donner forme au narcissisme
[1]
. »
3. L’identification primaire
Cette
remarque confère au narcissisme le statut d'une formation intra-symbolique,
dépendante d’une tiercéité, mais
d'une modalité antérieure (chronologiquement et logiquement) à celle du Moi
œdipien. Elle incite à penser une modalité archaïque de la fonction paternelle,
antérieure au Nom, au Symbolique, mais aussi au « miroir » dont elle recèlerait
la potentialité logique : une modalité qu'on peut appeler celle du Père imaginaire
(j’y reviens souvent dans mes Histoires
d’amour publiées en 1983). Lacan reprend l'observation de Freud sans s'y
attarder autrement que pour insister sur la nécessité de poser le « stade du
miroir » : « Le moi humain se constitue sur le fondement de la relation imaginaire
», précise-t-il.
Le narcissisme
serait-il la défense du vide ? Plus exactement, mon expérience clinique me fait
dire que le narcissisme protège le
vide, le fait exister et ainsi, comme envers de ce vide, il assure une séparation élémentaire avec l’objet
maternel, lorsque l’ « identification
primaire » est fragile ou carencée. Sans cette solidarité entre le vide et le narcissisme
[2]
, le chaos emporterait toute possibilité
de distinction, de trace et de symbolisation, entraînant la confusion des
limites du corps, des mots, du réel et du symbolique.
Nous voilà,
cependant, arrivés au seuil d'une autre question : qu'est-ce qui permet le
maintien de ce vide — source de plainte mais aussi nécessité absolue des
structures dites narcissiques ? C'est ici qu'il faudrait revenir à la
notion d'« identification ».
L'identification
amoureuse, l’Einfühlung (assimilation
des sentiments d'autrui), apparaît à la lucidité caustique de Freud comme une
folie : ferment de l’hystérie collective des foules qui abdiquent leur jugement
propre, hypnose qui nous fait perdre la perception de la réalité puisque nous
la déléguons à l’idéal du Moi. L'objet dans l'hypnose dévore ou absorbe
le Moi, la voix de la conscience s'estompe, « dans l'aveuglement amoureux on
devient criminel sans remords » — l'objet a pris la place de ce qui
était l'idéal du Moi
[3]
.
L'identification fournissant le socle de cet état hypnotique qu'est la folie
amoureuse repose sur un étrange objet : propre à la phase orale de
l'organisation de la libido (Ferenczi différencie l’« introjection »
de l’« incorporation ») où ce que j'incorpore, donc, est ce que je deviens, où l’avoir sert pour l’être, cette identification
archaïque n'est pas à vrai dire objectale. Je m'identifie non pas à un objet,
mais à ce qui se propose à moi comme modèle. Cette énigmatique
appréhension d'un schème à imiter, qui n'est pas encore un objet à
investir libidinalement, pose la question de l'état amoureux comme état sans objet, et nous renvoie à une
archaïque reduplication (plutôt qu'imitation)
« possible avant tout choix d'objet
[4]
».
Cette Identifizierung n'est pas de
l'ordre de l'« avoir », mais se situe d'emblée dans l'« être-comme ». Sur quel
terrain, dans quelle matière l’avoir vire-t-il à l’être ?
C'est en cherchant la réponse à cette question que l'oralité incorporante et introjectrice nous apparaît dans sa
fonction de substrat essentiel à ce qui constitue l'être de l'homme, à savoir
le langage. Lorsque l'objet que j'incorpore est la parole de l'autre
— un non-objet précisément, un schème, un modèle —, je me lie à lui
dans une première fusion, communion, unification. Identification. Pour que je sois capable d'une telle opération, il
aura fallu un frein à ma libido : ma
soif de dévorer a dû être différée et déplacée à un niveau qu'on peut bien
appeler « psychique » ; à condition d'ajouter que si refoulement il y a,
il est très primaire, et qu'il laisse perdurer la joie de la mastication, de
l'ingurgitation, de la nutrition avec... des mots. De pouvoir recevoir les mots
de l'autre, de les assimiler, répéter, reproduire, je
deviens comme lui : Un. Un sujet de renonciation. Par identification-osmose
psychique. Par amour.
Freud
a décrit cet Un avec lequel j'accomplis l'identification (cette « forme la
plus primitive de l'attachement affectif à un objet
[5]
»)
comme un Père. En approfondissant sa notion, il est vrai peu développée,
d'« identification primaire », il précise que ce père est un « père de la
préhistoire individuelle », ayant les qualités des deux parents.
4. Entre hystérie et incapacité d'aimer
L'amoureux
est un narcissique doté d’un objet. C'est d'une relève considérable du
narcissisme qu'il s'agit dans l'amour, de sorte que le rapport établi par Freud
entre amour et narcissisme ne doit pas nous faire oublier leur différence
essentielle. N'est-il pas vrai que le narcissique, tel quel, est précisément incapable d'amour ?
L'amoureux
concilie, en fait, narcissisme et
hystérie. Pour lui, il y a un autre
idéalisable, qui lui renvoie sa propre image idéale (c'est là le moment
narcissique), mais qui est cependant un
autre : il/elle peut s’échapper.
Il est essentiel pour l'amoureux de maintenir l'existence de cet autre idéal,
et de pouvoir s'imaginer semblable à lui, fusionnant avec lui, voire indistinct
de lui. Dans l'hystérie amoureuse, l'Autre idéal est une réalité, et non pas
une métaphore. L'archéologie de cette possibilité identificatoire avec un autre
est donnée par la place massive qu'occupe dans la structure narcissique le pôle
d'identification primaire avec ce que Freud a appelé un « père de la
préhistoire individuelle
[6]
».
Doué des attributs sexuels des deux
parents, figure par là même totalisante et phallique, pourvoyeuse de
satisfactions déjà psychiques et non simplement des demandes existentielles
immédiates, ce pôle archaïque de l'idéalisation est immédiatement un autre qui
suscite puissamment le transfert déjà psychique du corps pulsionnel-sémiotique en voie de devenir un Moi narcissique.
Qu'il existe, et que je puisse me prendre pour lui — voilà ce qui nous éloigne
déjà de la satisfaction maternelle primaire, et nous situe dans l'univers
hystérique de l'idéalisation amoureuse.
5. Dynamique de l'idéal
Parce qu'il
n'est pas un objet de besoin ni de
désir, mais un « pôle
d’identification », l’idéal du Moi inclut le Moi par l'amour (reconnaissance,
élection) qu’il lui porte (et vice
versa). Il l'unifie, freine ses pulsions ou les exalte mais, en les encadrant,
leur donne sens et fait du Moi un sujet. En d’autres termes, l’amour est
une différAnce (avec un A) du Moi, comprenant une mise
à mort masochique, et/ou une exaltation illimitée.
L'identification
du sujet à son idéal du Moi passe par une absorption narcissique de l'objet du
besoin qu'est la mère, absorption constitutive du Moi idéal. L'amoureux connaît
cette régression qui, de l'adoration d'un fantôme idéal, le conduit au
gonflement extatique ou à l’évidement douloureux de sa propre image et de son
propre corps.
Cette
non-objectalité de l'identification dévoile comment le sujet qui s'y risque
peut se retrouver en définitive en position de maître hypnotisant, ou
symétriquement d’esclave hypnotisé par son maître : comment il peut s'avérer
être un non-sujet, ombre d'un non-objet. Cependant et d'autre part, lorsque ces
états non-objectaux du psychisme constituant l’Einfühlung, le devenir Un avec l’autre, se trouvent mobilisés dans
la cure, et qu’ils sont interprétés dans le transfert, l’analyse de l’amour de transfert peut avoir prise sur d’autres états non-objectaux
tels que les « faux self », les états « borderline », et jusqu'aux
symptômes psychosomatiques. Il est vrai, en effet, qu'on est malade quand on
n'est pas aimé, entendons : c'est parce qu’elle manque d'idéalisation
identificatoire qu'une structure psychique a tendance à la remplacer par une
métaphore-condensation identificatoire dans ce non-objet incarné qu'est le
symptôme somatique, la maladie. Les personnalités psychosomatiques ne sont pas
des individus qui ne verbalisent pas, mais des sujets qui manquent ou ratent
cette dynamique de la métaphoricité qui constitue l'idéalisation en tant que
processus amoureux complexe.
II. Une
sainte folie : elle et lui
L'homme ne connaît ni l'amour ni la
haine : tout est devant lui.
(L'Ecclésiaste, IX)
Irreprésentable Loi d’amour
Qu'il soit
passionnel, voire vil, quand il lie l'homme et la femme, ou sacré comme celui que
voue l'homme à Dieu, et vice versa, l’amour biblique se dit le plus souvent par
la racine 'ahav, « accepter », « adopter
», « reconnaître » (et peut-être permuté avec « rejeter », « désavouer »,
« répudier », pour la haine). Sur l'axe de l'absorption et du rejet,
l'amour assimile, apprivoise, abrite, comportant ainsi une connotation
maternelle, voire utérine ; mais aussi il s'allie, reconnaît, légalise, avec une
connotation paternelle. Ainsi, riham,
de rehem, « utérus »,
indique le sentiment familial ; hafez signifie « plaisir de », « plaisir pour » ; razah, « se sentir bien avec »,
« accepter » ; plus intellectuels seraient les termes de hashak, exprimant l'attachement
personnel ; hanan, suggérant une
faveur concrète plutôt qu'une affection ; et enfin hased, signifiant « loyauté » mais aussi « amour
vrai », « alliance » (Gen. 20:13 ; 47:39). Les premiers textes
de la Bible ne font que deux mentions, très elliptiques, de l'amour de Dieu
pour l'homme : Dieu aime David et Bethsabée, en conséquence de quoi David aime son
fils (2 Sam. 12:24) ; la reine de Saba (une étrangère) constate que Yahvé
aime son peuple (1 Rois 10:9).
En revanche,
le thème de l'amour divin sera amplement développé par le Deutéronome (4 :37
; 7:8 et 7:13 ; 10:15 et 10:18 ; 23:6). Au seuil de l'exil, Ezéchiel reprend
l'énoncé de l'amour de Dieu pour son peuple (Ez. 34 :11-16) : « Me voici
moi-même ! Je me soucierai de mes brebis et veillerai sur elles... » De même,
Jérémie (2:2-3) : « Je me souviens, pour toi, de la piété de ta jeunesse, de
l'amour de tes fiançailles... Israël était une chose sainte pour Yahvé... »
Mais c'est
comme une loi d'amour, comme un
devoir du fidèle vis-à-vis de son Dieu et de son frère, que s'énonce la version
la plus remarquée de l'amour biblique. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir » (Deut. 6:5), et « Tu
aimeras ton prochain comme toi-même » (Lév. 19:18). Toutefois, cet amour-loi
fait souvent oublier la dynamique complexe de l'amour biblique, que le Cantique
des cantiques reprend, met en évidence et amplifie.
Le texte serait composé par Salomon lui-même, fils
de David vers 915-913 avant notre ère. D'autres considèrent qu’il est plus
récent, faisant référence à des événements antérieurs.
Passionnel, sensuel, fuyant, impossible,
le dialogue du Cantique n'est cependant ni tragique ni philosophique. Tout en opposant
radicalement les sexes, il établit fermement leur communauté réelle et symbolique. Le
dialogue amoureux est tension et jouissance, répétition et infini ; non pas
communication mais incantation.
Dialogue-chant. Invocation. Cette
dynamique indique, au cœur même du monothéisme, au moins deux mouvements. Le
premier consiste en ceci qu'à travers l'amour, je me pose comme sujet à la
parole de celui qui me subjugue — le Maître. L'assujettissement est
amoureux, il suppose une réciprocité, voire une priorité de l'amour du
souverain. L’autorité est aimable, l’autorité m’aime. En même temps, et c'est
le second mouvement, dans le dialogue amoureux « je » m'ouvre à
l'autre, « je » l'accueille dans ma défaillance amoureuse, ou bien « je »
l'absorbe dans mon exaltation, « je » m'identifie à lui. Par ces deux
mouvements, les prémisses de l’extase (de la sortie hors de soi) et de l’incarnation, en tant que devenir-corps de l'idéal, sont posées avec force dans l'incantation
amoureuse du Cantique. Dès lors, et plus explicitement encore, l'espace d'une intériorité psychique s'esquisse ici,
inséparable de l'espace amoureux. Cette intériorité demeure bien entendu
scénique, d'une théâtralité polyvalente, ne serait-ce que par sa consistance
vocale, gestuelle, visuelle autant que verbale. Et pourtant, de par
l'aspiration amoureuse qui unifie et totalise, par-delà la séparation
irrémédiable soulignée par le topos de la fugue, l'amour selon le Cantique est déjà un réceptacle de la vie intérieure. « Je
suis malade d'amour », chante la Sulamite (chap. V, 8) et cette ambiguïté, cet
éloge du paradoxe préfigurent les méandres psychologiques à venir, des expériences
mystiques au lyrisme romantique.
Un chant — un corps
En raison de
sa thématique corporelle et sexuelle (« Mon bien-aimé a retiré sa main du trou /
et mes entrailles se sont émues pour lui », chap. V, 4), indissolublement mêlée
au thème dominant de l'absence, de l'aspiration fusionnelle et de
l'idéalisation des amants, la sensualité du Cantique légitime l’amour sexuel comme un acte génital entre un homme et une femme : entre la Sulamite et son Roi ou berger, son
Dieu. L'aimé n'est pas là, mais j'éprouve son corps dans le mien; et mon intériorité psychique s’unit à lui,
sensuellement et idéalement. L'interprétation rabbinique allégorique, voyant
dans l'aimé Dieu lui-même, favorise en fait cette potentialité « incarniste »
du Cantique.
Sexe et Dieu
Compte tenu
de la composante érotique disséminée dans la totalité du texte biblique, comme la
confirmation de la présence absolue, bien qu’insaisissable, d’un Dieu exigeant
autant qu'aimant, le Cantique n'est pas un élément étranger de la Bible : il ne
fait que mettre les points sur les « i ». Désir sexuel et Dieu aimant ont
toujours été là, il s'agit maintenant de les intégrer ensemble dans les plis de
l'expérience psychique individuelle. Le terme d'amour consacre leur réunion :
amour sensuel et différé ; corps et pouvoir ; passion et idéal.
Le couple légitime
Qu'il
s'agisse d'un amour conjugal est de toute évidence une condition primordiale
pour que les mentalités religieuses ou sexuelles des peuples environnants
s'intègrent dans le corps de l'écriture biblique. L'amour du couple consacré par la Loi est le pilier
de la société juive, et dépeindre les amants sous l'image d'un couple d'époux
dévoués, où l’homme jaloux assure la sécurité de la femme, intègre
incontestablement un trait de mœurs populaires qui légitime et ainsi seulement
sanctifie l'amour. Notons que ces particularités distinguent radicalement le Cantique aussi bien des amours platoniciennes, dont il n'a
ni le psychodrame ni l'abstraction idéelle, que de la mystique pathétique et
enthousiaste des amours orgiaques propre aux cultes païens, dont il ne partage
pas l'illusion de plénitude. À égale distance des deux, scellé par la loi
autant que fondé sur une distance, une fuite, voire un impossible, l'amour du
Cantique ouvre une page toute neuve dans l'expérience de la subjectivité
occidentale. Unique en son genre, en ceci que c'est la parole d'une loi
inscrite dans le désir qui, par-delà les influences étrangères, se recueille
merveilleusement dans ce Cantique empreint d'un amour novateur. Ni quête
philosophique ni enthousiasme mystique, l'amour biblique chante, et par là même
opère la bascule de la religion (qui est en définitive une célébration du
secret de la reproduction, secret du plaisir, de la vie et de la mort) dans
l'esthétique et dans la morale. Fait majeur : pour la première fois dans
l’écriture mondiale, le sujet de l’énonciation est une femme, la Sulamite.
Elle me
servira de transition pour aborder l’amour sous l’angle du « faire
l’amour », ou de l’acte sexuel
amoureux, qui nous conduira aux métamorphoses actuelles des identités sexuelles
et de la parentalité.
III.
« Faire l’amour » et
métamorphoses de la parentalité
Freud fonde sa théorie du processus
psychique sur deux actes : le
meurtre du père (aux origines de la religiosité et du pacte social) et la scène
primitive (foyer des fantasmes originaires). Je ne discuterai pas les
fondements historiques et cliniques sur lesquels il construit cette
théorisation. J’essaierai seulement d’en tirer quelques implications pour le thème qui nous réunit
aujourd’hui, l’amour, et plus spécialement pour ce qu’on appelle « faire
l’amour », l’acte sexuel amoureux.
Je ne reprendrai pas la thématique
complexe du « meurtre du père », sa légitimité scientifique ou
fantasmatique, etc. Je rappellerai seulement que le passage de la horde
primitive à la famille qui en résulte suppose l’installation de l’homoérotisme au cœur du lien
social, comme le confirment les mutations sociétales en cours.
Des
millénaires ont été nécessaires pour que la famille comme alliance de deux
personnes de sexes différents puisse être pensée et revendiquée par les
hommes et par les femmes. Il a fallu pour cela passer par l’introduction de l’amour dans l’espace familial : dèjà présent dans l’Odyssée, puisque au cours de son périple Ulysse n’a de cesse de
retrouver sa femme Pénélope et son fils Télémaque, il est comme j’ai dit
sublimé dans le Cantique des cantiques des Hébreux, qui met en valeur la parole de l’amoureuse Sulamite se languissant
de son berger-roi. Ceci avant que la grande littérature amoureuse de l’Occident
chrétien ne se saisisse du sujet, dans un premier temps par les romans courtois
(greffés d’influences taoïstes transmises, paraît-il, par les Arabes
musulmans), puis libertins, modernes et postmodernes enfin.
Un autre fait marquant de ce long
processus réside dans celui de la libération des femmes. Si celle-ci fut dans
un premier temps l’expression d’un refus de la famille et de la maternité, le
phénomène prit une tournure tout autre lorsque fut reconnu à la femme un
érotisme spécifique dans la reliance de l’amante devenue mère avec ce
premier autre, l’enfant, au carrefour de la biologie et du sens.
Le couple hétérosexuel marié continue de
fasciner les imaginaires. Non seulement le mariage comme institution le normalise, mais toute une industrie de fiction
télévisuelle nous l’impose jusqu’à la nausée comme le modèle à suivre. Est-il donc
énigmatique, scandaleux, et par là même désirable, parce qu’il rappelle à
chacun l’accouplement de papa et maman, cette impensable « origyne » de
l’origine? Ou bien est-ce l’amour de
l’homme et de la femme qui fascine les imaginaires ? Dans faire l’amour, amour et accouplement se
rejoignent. Serait-ce cette
intimité entre deux incommensurables qui « rompt la liaison de masse propre
à la race, à la partition en nations
et à l’organisation en classes de la société », accomplissant « de ce fait des opérations culturellement
importantes »
[7]
, pour
citer Freud? Le même ajoute : « Il semble assuré que l’amour homosexuel [entendons
l’homoérotisme] se concilie beaucoup mieux avec les liaisons de masse, même là
où il survit comme tendance sexuelle inhibée quant au but ; fait remarquable,
dont l’élucidation ne manquerait pas de mener loin
[8]
. »
Ou encore : « L’origine homosexuelle de ce qui constitue la plus
grande partie de la civilisation est assez évidente, puisque nos sentiments
sociaux sont aussi de nature homosexuelle (c’est la femme qui rend l’homme
asocial)
[9]
. »
Essayons
d’entendre ces constats dans le contexte d’aujourd’hui.
2. Guerre et paix des sexes
La domination
des hommes sur les femmes, confortée par le pouvoir du langage et de la
capacité symbolique, a longtemps réservé à celles-ci la place du foyer, de la
reproduction et de l’intime. Sur les résidus historiques ou fantasmatiques de cette
séparation, les sciences de l’homme et de la société ont retracé le tableau complexe des compromis qui ont rendu vivables la guerre et la paix
entre les sexes à travers les âges. Ce fragile équilibre paraît aujourd’hui
menacé dans la civilisation occidentale, par l'affranchissement sans précédent des
désirs singuliers d’une part, par le développement prodigieux des techniques,
notamment reproductives, d’une autre. Ces deux facteurs semblent désormais
ouvrir la voie à une remise en question radicale de l'immémoriale différence des sexes elle-même, quelles
qu'aient pu être ses variantes antérieures. Apocalyptique ou prométhéenne,
cette tendance s’oppose aux anciens codes moraux consacrés par la religion,
bouleverse les compromis antérieurs fondés entre les sexes, et suscite logiquement
la désapprobation de ceux qui veulent les conserver tels quels, qui dénoncent
une nouvelle décadence, suicidaire.
J’ai
développé ailleurs ma réflexion sur ces nouvelles « guerres et paix des
sexes » (dans Seule une femme, paru aux Éditions de l'Aube,
2013), et ne rappellerai ici que succinctement deux aspects de la mutation de
la différence sexuelle qui s’ensuit.
D’une part,
l’émancipation des femmes et leurs performances sociales accentuent la
bisexualité psychique des mères et des amantes, perturbant par là les hommes, qui
ressentent auprès d’elles un « danger d’homosexualité » (pour reprendre
une expression de Colette) – à moins que ce ne soit un espoir.
D’autre part,
le « roc de la castration » expose la sexualité masculine à une épreuve plus radicale et plus
complexe. La clinique psychanalytique en témoigne : terrible en même temps
que jubilatoire, la peur de la castration mène l'histoire des hommes. Et nul
mieux que Georges Bataille n'a su attester ses abîmes et ses triomphes
extatiques. La décapitation, pratiquée aujourd’hui par les djihadistes fous de
Dieu, renoue avec ces fantasmes qui attisent l’abjection fanatique mortifère et
mobilisent industries militaires, trafics mafieux, tractations politiques
durables. L'homme n'a-t-il d'autre choix que de la dénier ou d'y succomber?
Le déni de la castration impose, au
mieux, sa stratégie au séducteur éternel (mais n'est pas Casanova qui veut).
Plus mystique que physique, ce dernier invente la transcendance, l'« au-delà »,
il s'en remet à Dieu ou au Verbe, puis se fait chair, entraînant sa compagne
dans le paradis de cette culture, où elle ne subsiste que comme objet, au mieux
comme signe de son désir à lui. Quand
l’homme s'arrange au contraire avec la castration, trois voies s’offrent à lui.
Le plus souvent, il se condamne à être l’esclave du lien social, un rouage de
l'ordre établi : « Je pratique l’efficastration », m’a confié lucidement
un analysant, qui savait n’être efficace qu’au prix de la castration. Au pire, lorsqu’il
emprunte la deuxième voie, l’homme s'abîme dans la psychose mélancolique, ou se
pétrifie dans la paranoïa. Reste la
troisième voie, épuisante mais grosse de bénéfices : la perversion, que Lacan décrit
comme une version érotique adressée au père, père-version, qui se soutient
d'une mère-version (selon l’expression d’Ilse Barande), dans une identification
masochique et non moins exaltée avec la mère. Mais l'issue sublimatoire est
elle-même fréquemment pavée de ces passages à l'acte père-vers ou mère-vers.
Nous l’entendons dans notre entourage, et forcément dans la parole de nos analysants.
Elle conduit l'homme – les grandes œuvres de la culture en témoignent
– à cette fabuleuse pulvérisation-dissémination identitaire, à cet
extravagant dépassement de soi qui culmine dans quelque chose de semblable au bonheur
(« something like happiness », m'a dit quelqu'un), où le rire éclate dans
la sérénité du néant. Non plus le néant mélancolique, mais l'être lové dans le
non-être, détaché parce que désexué, plutôt qu'asexué, neutre, innocent, «
pneumologique » – l’homme se fait « spirituel », il se prépare des
« cocktails de spiritualité » pour se désennuyer. Une grappe d'anges
dans les tableaux de Giotto ou de Mantegna. Cette sorte d'enfance retrouvée et
l'aptitude à se pardonner, pardonnant dans le même élan les désirs forcément
guerriers, signent en définitive la sublimation du sujet masculin, lorsqu'il a
brûlé l'angoisse de castration en même temps que la défense contre elle érigée
par la pose phallique. Au contraire, la sublimation féminine, nécessairement
déployée dans la maternité choisie, est insatisfaisante pour la mère et pour
l'enfant, souvent menacée par la mélancolie, quand elle ne se durcit pas dans
la parade de la virago ou dans une insoluble compétition phallique, inlassable
vengeance contre le père abusif ou frustrant que tout homme est supposé être.
3.
Crise du couple hétérosexuel?
Mais revenons, à travers ces acteurs dont
j’ai esquissé le portrait à larges traits, à cette génitalité qui
« rompt la liaison de masse » (Freud).
Derrière le
rideau du mariage et de la manif pour tous, on cherche en vain où sont passées les
« valeurs ». Et si le couple hétérosexuel et sa famille en étaient le
point de mire, précisément, en lieu et place de « la valeur » (qu’on espère trouver pour pallier la
solitude, pour se prolonger et transmettre). La morale conventionnelle a beau
banaliser le couple et la famille, et nos programmes télévisuels globalisés les
représenter jusqu’à la caricature, nos fantasmes convergent dans leur direction. Eprouvettes, congélations d’ovocytes, dons de sperme,
jusqu’à ces ventres féminins, que l’on achète le temps d’une grossesse… : tous nos artifices en sont hantés. Les « tradis »
comme les « modernes » savent bien que « l’amour, ce n’est pas ça », « ce
n’est jamais ça » : rien n’y fait, c’est bien l’héritage archaïque de la
parentalité qui s’invite dans les inconscients, à l’ombre des débats, quand on
légitime le mariage pour tous. Avec les deux apothéoses de ce théâtre de
l’imaginaire pour tous que sont la « scène primitive » de la génitalité et
l’«enfant-roi», antidépresseur souverain.
Au symptôme français – qui ne se
contente pas de gérer, mais s’emporte, enthousiaste ou angoissé –, il
manquait une analyse, une défense et une illustration de l’hétérosexualité.
Cette dernière ne réside pas dans la seule différence anatomique entre le mâle
et la femelle. L’hétérosexualité ne peut pas non plus être invoquée comme le
plus sûr et le seul moyen de transmettre la vie ou de garantir la mémoire des
générations. Elle révèle l’extrême
intensité de l’érotisme et recèle de ce fait une insoutenable fragilité.
Il fallait le
génie de Freud pour formuler ce que tous savaient intimement : la
procréation qui hante les humains n’est pas un acte naturel et encore moins un
acte souverain. Nous comprenons que le meurtre du père est un acte ; mais
nous avons tendance à oublier que l’amour aussi est un acte : la scène
primitive. N’est-ce pas par la psychisation de cet acte amoureux que la
différence sexuelle s’affirme dans une cascade de fantasmes, qui sont des
foyers constituant la psychisation. Lesquels?
‒ Une
fragilité habite la furie de la scène primitive, fantasme originel et universel
s’il en est : fusion et confusion de l’homme et de la femme, perte exubérante
d’énergies et d’identités, affinité de la vie avec la mort. L’hétérosexualité
n’est pas seulement une discontinuité (« je suis autre, seul/e face à l’autre
»), normalisée par la continuité (fusion pour « donner » la vie).
L’hétérosexualité est une transgression des identités et des codes, qui ne
procède pas de l’effroi, mais plus radicalement de l’angoisse et du désir à
mort, portés par la promesse de vie à travers la mort. Assomption phallique,
violence et exil de soi, le duo hétérosexuel est comme la tauromachie: un des
beaux-arts (Michel Leiris en fit la métaphore du sien, l’écriture). Mais au sommet
de la dépense, le plaisir récompense la castration, l’angoisse de mort s’élève
en jouissance et s’annule : en prenant forme dans le temps par la conception possible
d’un être nouveau, étranger et éphémère. Tel est le sens insensé de la scène
primitive. Et de tous les érotismes qui s’ombiliquent à elle.
‒ En effet, quelles que soient les variantes de la « norme
hétérosexuelle » dans la psychosexualité de chacun, et par-delà les
acceptations ou les rejets des couples diversement composés, le mirage de la
« scène primitive » comme fantasme originel, qui structure les
inconscients, relie immanquablement la diversité des érotismes, qu’ils soient
profanes ou sacrés, « au zénith de la procréation », comme
l’explicite Georges Bataille (L’Erotisme, 1957). Le « principe processuel » de la parentalité elle-même n’est
donc ni une abstraction, ni un bricolage de « substituts » ou de « fonctions ».
Il s’incarne au contraire dans la dyade hétérosexuelle des deux parents.
‒ Dans la formule de Lacan « il n’y a pas de rapport sexuel », j’entends
que la peur du féminin hante la désirance du père ; que la peur du
prédateur paralyse et frigorifie le plaisir de la femme ; que le couple sexuel en panne se perpétue à l’aide du tiers : «
amours contingents » (Sartre et Beauvoir), sublimations (œuvre d’art, vocation,
engagement, métier, sport, hobby,
communauté, église...), et au sommet, le Créateur, troisième personne, « Il »
majuscule et impersonnel, éternel et hors dialogue, qui résume, soutient et
perpétue la tiercéité parentale et sa signifiance. Deux fois deux
homosexuels en miroir attendent l’Au-delà à la façon de Godot chez Beckett. En
revanche, le couple hétérosexuel (croyant ou non) espère un tiers qu’il aura
engendré, et, faute d’éternité, se pense dans l’horizontalité du temps qui
passe. Car l’enfant, acteur majeur de l’amour – objet et sujet – renoue
la chaîne des générations : dans notre existence amoureuse, il est le signe aussi bien que le réel de la transcendance symbolique, devenue
transmission transgénérationnelle par sa présence à lui, l’enfant lui-même. La parentalité n’est
pas seulement une fabrique de citoyens plus ou moins surmoïques, ni seulement
un pari risqué sur d’éventuelles réalisations de l’idéal du Moi. Dans
l’insoutenable fantasme infantile de la scène primitive, la parentalité
constitue le pivot de la subjectivation qu’elle menace par une éclipse du Temps
(dans la jouissance) et qu’elle relance dans le Temps (par l’engendrement d’une
nouvelle vie).
4. Corpus mysticum
Je suis en
train de vous dire qu’il y a du rapport
sexuel, mais que c’est sa fragilité
précisément qui garantit l’indécidable de la vie psychique, celle des
parents et celle des enfants. L’amour et plus encore le « faire
l’amour » installent l’indécidable – cette fragilité – comme
la condition sine qua non de la
psychisation en tant que processus ouvert, libre, innovant, créateur.
Cette
humanité libre, pensante, improvisante, que Freud a mise sur le divan pour
l’aider à traverser sans fin les malaises dans la civilisation, serait-elle
menacée de disparaître par les mutations sociétales en cours ? Je n’oublie
pas la prophétie d’Alfred de Vigny, relayée par Marcel Proust : « Les
deux sexes mourront chacun de son côté. » Mais je n’ai pas l’esprit
apocalyptique, des décennies de pratique analytique me conduisent à me définir
comme une pessimiste énergique. Je constate seulement qu’après et avec la
guerre des sexes, il nous faudra
inventer un nouveau monde amoureux.
Non pas
l'Amour avec un grand A, substitut narcissique et supposément laïc des
illusions religieuses. Il nous faudra réinventer le fondement de cet acte
difficile entre tous consistant à croire
en pensant l'autre sujet sexué. « Croire », des racines latine et sanscrite credo- kredh- se dit en
psychanalyse : investir. Investissement (Besetzung,
Cathexis). Je t’investis : ma subjectivation s’investit en toi, en toute lucidité ; je ne suis pas forcément d'accord, mais je
me cherche en toi comme tu te cherches en moi, différemment et ensemble. Une
sorte d’amour qui advient dans l’ombre même de l’amour, et auquel l’amour n’a
pas forcément accès.
Il manque un fondement à ces temps
troubles que nous promet l'accélération de la technique. Je ne pense pas qu'un
code moral ou religieux, nouveau ou ancien, soit capable de nous le procurer.
Je suis persuadée cependant que l'ontothéologie dont nous sommes issus nous a
légué un projet possible : c’est la singularité du sujet parlant, capable de liens, à laquelle la
psychanalyse freudienne a restitué le dualisme psychosexuel, sa construction
par les deux sexes dans le triangle œdipien.
À la fin de
la Critique de la raison pure (1781),
Kant rêvait d'un corpus mysticum des
« êtres raisonnables », pour fonder un monde moral, autrement irréalisable. Il
entendait sous ce terme une « unité systématique » établie par l'empire des
lois morales sur le libre arbitre, l’unité du « libre arbitre avec lui-même »
et « avec la liberté de tout autre ». Nous savons maintenant que la liberté du
désir est folle, et que la guerre des sexes continue. Le corpus mysticum nous manque ; peut-être nous manquera-t-il
toujours; peut-être est-il, par définition, manquant. Je prends le risque de
penser qu'il nous manque parce que nous n'osons pas le chercher dans cette
lucidité amoureuse qui constitue, à travers guerre et paix, la singularité d’un
homme et d’une femme. Les incompatibles libertés, les identités sexuelles
recomposées et les risques des néoréalités rendent, en effet, rarissime la rencontre d'un homme et d'une femme. Périmée
quand elle n'est pas scandaleuse ? Innommable quand elle n'est pas
outrageusement médiatisée? Ou bien insensée, forcément insensée et donc
clandestine? Certainement, et pas seulement. C'est bien parce qu'elle est
impossible qu'elle vaut la peine d'être tentée. Aussi
ne mérite-t-elle pas d'autre nom que celui de cette utopie rêvée par Kant et
qu'il appelle corpus mysticum :
le point précis où la massification
se « rompt » (Freud : « c’est le lien érotique de l’homme
avec la femme qui rend l’homme asocial
[10]
» pour « accomplir des opérations
culturelles importantes
[11]
».
Je prétends que si la refondation du pacte social ne comprend pas cette
lucidité qui réunit les deux sexes malgré et au travers de la guerre qu'ils se
livrent à mort, elle n'existera pas, pas plus que le monde moral. Pourtant,
c'est bel et bien cet impossible que vise l'expérience freudienne. Sans fin,
indéfiniment.
JULIA
KRISTEVA
Colloque du
groupe lyonnais de la SPP, le 17 janvier 2015
[1]
S. Freud, « Pour introduire le
narcissisme », in La vie sexuelle, PUF, 1969, et GW, t. X, p.142
[2]
Cf. A. Green, Narcissisme de vie, narcissisme de mort, Ed. de Minuit, 1983.
[3]
Cf. « Etat amoureux
et hypnose », in Psychologie
collective et analyse du moi (1921), GW XIII, p.125, tr.fr. Essais de psychanalyse, PUF, 1963, p.137.
[4]
« L’identification », ibid.
p.127 ; GW t. XIII, p.116.
[5]
Le Moi et le Ça (1923), in Essais de psychanalyse, op.cit. p.129, GW, p.118.
[6]
Ibid, p. 259 ; GW, p. 200.
[7] S. Freud, Psychologie collective et analyse du moi (1921), PUF, 1991, p. 81 [8] Ibid, p.81 [9] Minutes de la Société psychanalytique de Vienne, 11 décembre 1912, Gallimard, 1984, p. 162.
[10]
Minutes de la Société psychanalytique de Vienne, 11 décembre 1912, Gallimard, 1984, p.162.
[11]
Psychologie collective et analyse du moi, op.cit., p. 81.
|
 |
|---|