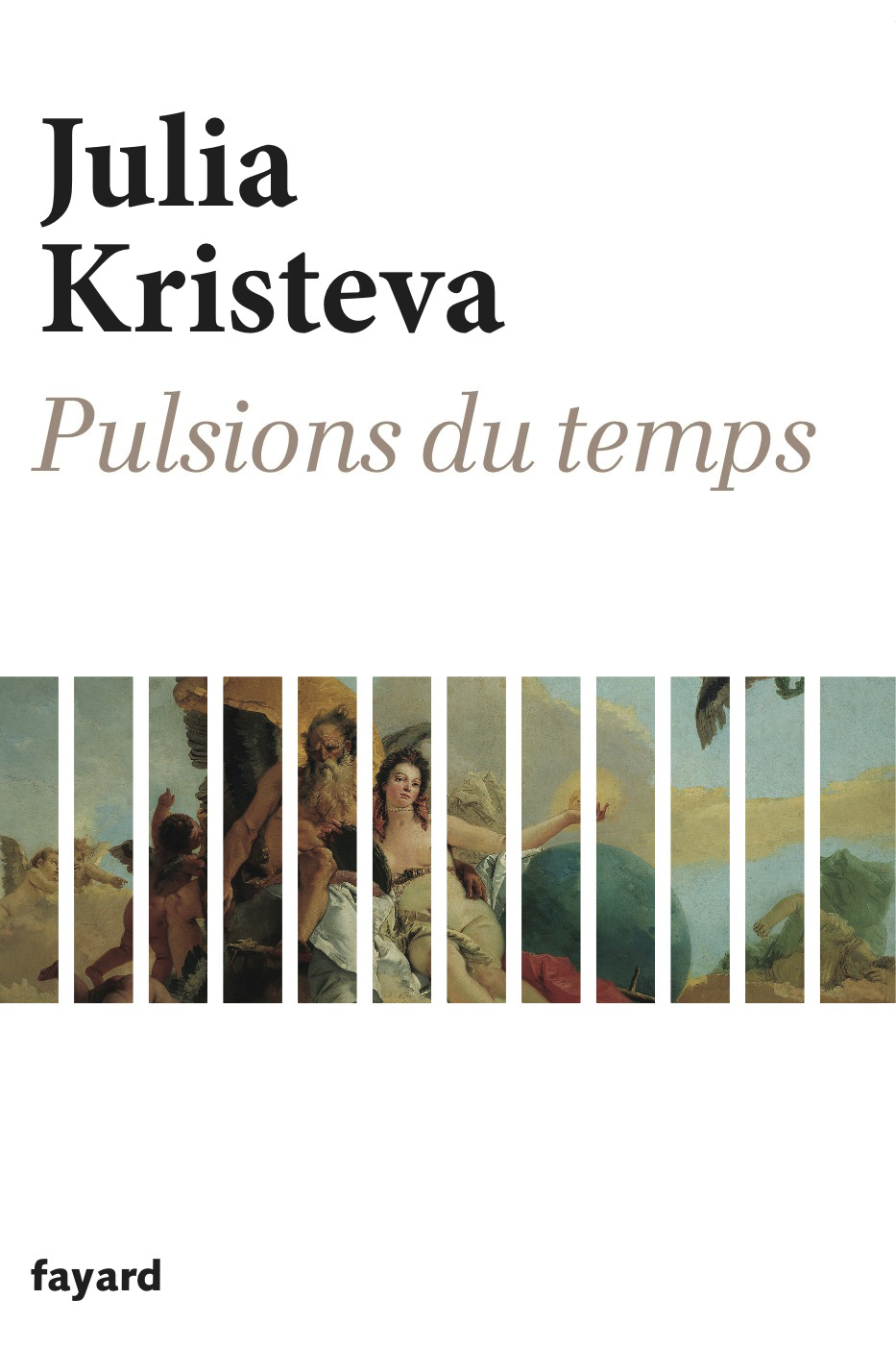|
|
Entretien dans Humanité Dimanche
Humanité Dimanche. Votre
dernier livre, « Pulsions du temps », est organisé comme un almanach
marquant les grands moments de votre biographie intellectuelle. Est-ce déjà
l’heure des bilans ?
Julia Kristeva. La plupart des textes qui composent
ce livre ont été écrits ces cinq dernières années, publiés dans des revues ou
prononcés en conférences. Serait-ce
la pratique de la psychanalyse, celle de l’écriture, ou bien ce que j’appelle
dans ce livre un « érotisme maternel », je ne suis pas encore à
l’heure du bilan. Mais le temps est mon personnage principal. Pourquoi ?
Jamais le temps n’a été aussi
fermé, sans alternative et sans projet, comme il est aujourd’hui, en ce monde d’austérité et de mensonge.
Et jamais il n’a été aussi disponible : ouvert à l’infini de la
mémoire humaine par un click sur la
toile, photographié de la naissance à la mort des étoiles par
des télescopes géants. A moins que le temps n’existe pas, comme l’avance
l’astrophysique actuelle. Pourtant, il suffit qu’un événement rencontre notre
expérience intérieure, et qu’une initiative
singulière surgisse, pour que le renouvellement advienne. Ces maintenants où l’anamnèse rejoint l’actualité nous
placent dans les pulsations du temps, ils incarnent la pulsion du temps. Le
livre s’ouvre par un récit où je
raconte comment je suis devenue une lettre. La Nouvelle revue française a invité des écrivains dont le français est une langue
d’adoption à réfléchir sur un mot
français ou de leur langue maternelle.
J’ai choisi le mot « Alphabet », « Azbouka » en bulgare, et
le souvenir des fêtes de l’alphabet
slave où, enfant, je manifestais en
arborant une lettre, je devenais cette lettre, me perdais dans la liesse, et me retrouvais
cependant dans la discipline de l’écriture qui guérit de tout, y compris du
communisme. Cette invitation éditoriale et mon texte ne pouvaient prendre tout leur sens qu’à l’heure de la
globalisation, en 2012. Mais le souvenir d’enfance m’a renvoyé au rôle de l’étranger aujourd’hui, à
l’écriture comme traduction, au citoyen européen comme sujet multilingue pour
lequel l’identité n’est pas un culte mais une question. Ni fin de l’histoire apocalyptique, ni
almanach nostalgique. Mes pulsions du temps habitent tous les thèmes du
recueil : femmes, psychanalyse, religions, humanisme, France/Europe/Chine.
Et traversent quelques singulières
libertés parmi mes hommes et femmes préférés : Freud et Rousseau, Beauvoir et
Thérèse d’Avila, Jackson Pollock et Emile Benveniste, Jacques Lacan et Philippe
Sollers, Antigone et Louise Bourgeois ou Colette.
HD. Vous
êtes, comme vous venez de le rappeler, de naissance et de première culture bulgare.
Et c’est à travers la littérature que vous avez découvert la France. Littérature que vous associez à notre « identité
nationale ». On est loin de la définition politique de la nation, telle
que léguée par la Révolution. Comment articulez-vous cette définition politique
de la nation et votre conception de l’identité nationale ?
Julia Kristeva. Le Conseil Economique, social et environnemental m’a confié en 2008 la
rédaction d’un Avis sur le « message culturel de la France et la vocation
interculturelle de la francophonie ». Ma compréhension de l’identité
française m’a été transmise par le mouvement des Lumières qui ne se réduit pas
à la Révolution. L’universalisme abstrait avec le nationalisme jacobin tendent à la faire oublier, mais comment ne pas
reconnaître que la philosophie des Lumières s’enracine dans une érotique de la littérature, la pensée se
faisant chair dans la langue française ! Dans sa polyphonie, dans sa
« diversité » : « Diversité, c’est ma devise », écrit…
La Fontaine, que je cite dans mon intervention devant les dirigeants des pays « réformistes
progressistes » (Clinton, Blair, Jospin...) La
refondation de l’humanisme qui nous manque aujourd’hui, ne sera qu’une réévaluation permanente de cette diversité,
et elle nécessite des langages capables d’échapper à la banalisation
pour tous… Les enquêtes que j’ai dû mener ensuite aux Etats-Unis, en Chine, en
Israël, en Tchéquie devaient donc confirmer cette vision de
l’ « identité nationale » culminant dans l’esprit des Lumières.
En effet, la culture littéraire est en France un lieu
privilégié de la pensée, domaine relevant en général de la philosophie et de la
théologie. Les débats sur la langue et le foisonnement des expériences
littéraires sont devenus aussi un laboratoire de cette « exception
française » qu’est la laïcité. Cet alliage, qui fait de la langue et de la
littérature un équivalent du sacré en France est unique au monde. La
philosophie française - de Diderot,
Rousseau, Voltaire, et je n’oublie pas les femmes épistolières et philosophes,
de Mme de Sévigné à Mme du Châtelet et à Mme du Deffand, - s’écrit dans des textes littéraires. Aujourd’hui encore, la « french theory », ce corpus de recherches théoriques au
croisement de la philosophie, la psychanalyse et les sciences humaines, et auquel on associe mon nom, puise
aussi dans cette
tradition-là : l’identité de pensée, pour être immédiatement politique et
éthique (Barthes, Deleuze, Derrida, Foucault...), se cherche dans un style où le
concept côtoie la narration, l’imaginaire, la littérature.
Dans cet esprit, mes enquêtes m’ont appris que le désir pour
la langue française persiste, malgré le déclin bien connu de l’influence
française, comme un désir de notre manière d’être au monde :
expérience subjective, goût, modèle social et politique, etc . Le sens critique,
cette « impudence d’énoncer » que Hegel saluait dans le Neveu de Rameau comme un trait distinctif
de la « culture » en général et de la culture française en
particulier, le droit de mettre en question les conventions tout autant que la
mode « tendance » ou « politically correct », de gauche ou de droite, séduit les classes aisées dans les pays
émergents. Savez-vous qu’en Chine par exemple, si les enfants de ces nouvelles
couches sociales vont dans des écoles où l’on parle l’anglais, ils vont dans
des maternelles où l’on apprend le français.
Plus encore, l’audace qui conduit à aborder le continent religieux
lui-même avec des interprétations
d’inspiration psychanalytique, éveille aussi leur intérêt. L’Ecole
Polytechnique de Shanghai envisage la création d’un Institution des cultures et
des spiritualités européennes et chinoises, s’inspirant de nos travaux.
« Pour que nos étudiants ne deviennent pas des kamikazes, lorsqu’ils
rencontrent des conflits personnels et sociaux, dit le Président de cette
Polytechnique, il ne suffit pas de
calculer, il faut problématiser, et
c’est seulement chez vous qu’ils peuvent apprendre cet art de vivre. »
HD. Pour rester sur le
terrain politique, comment la sémioticienne que vous êtes, analyse l’apparition
assez récente de l’expression « éléments de langage » pour désigner
les « argumentaires », base de la communication publique ?
Julia Kristeva. Ce qui menace dans les symboles du
langage - écrivait Roland Barthes, un autre acteur de ces « pulsions du
temps ». Ce n’est pas l’ « unicité
du sens », mais sa pluralité qui
appelle une infinie capacité
d’interprétation, et grâce à laquelle la vie psychique vit, revit, se
révolte contre les dogmes, refonde
les liens. Contre le « sens
unique », nous avons demandé, en mai 68, l’ « imagination au
pouvoir ». Aujourd’hui, c’est
une véritable « asymbolie » qui s’affirme et, sous l’apparence d’une croyance à l’image, c’est l’espace
d la « conscience de la
parole » qui est en train de se fermer. Fermer cet espace revient à condamner la personne et le lien
social à une virtualité in-signifiante, que débouche sur deux abîmes : le nihilisme désabusé d’un côté, le transcendantalisme intégriste de
l’autre. Ce qui gêne le communicant utilitaire dans le virtuel hyperconnecté, ce n’est pas de trouver une
« info », il en est friand et addict, il
copie et colle et restitue au « cloud » de
formules « choc » et indiscutables… Ils lui manquent cependant le
temps et l’espace intérieur, l’agilité psychique de penser du point de vue de
l’autre et dans une culture intégrée faite de mémoires, de singularités, de
mondes. L’extension du marché à tous les domaines de la vie, la réduction,
l’étranglement des réseaux familiaux, mais aussi l’hyperconnexion et la simplification des communications ont tendance à réduire n’importe quel
discours à l’univocité, le message devient unidimensionnel. On communique par
pauvreté de langage. Et les « éléments de langage » donnent un
certain nombre de codes utilitaires supposés faire impression, calmer les
angoisses, faire diversion mais ne donner ni solution ni espoir. Car les
solutions sont nécessairement plurielles, l’espoir n’est concevable qu’à long
terme et tout cela est risqué. La politique devenue management ne se risque pas
à la pluralité du sens, qui pourrait susciter des initiatives pour échapper au
contrôle.
HD. Mais
avant de nous voir, ici chez vous, nous avons échangé plusieurs courriers
électroniques, si j’étais arrivé en retard, je vous aurai prévenue par sms…
Julia Kristeva. Je ne diabolise pas l’hyperconnection, fabuleux outil d’information, rapidité,
réactivité. Je dis seulement qu’elle n’est pas le miracle qui accouche du supposé
nouveau citoyen surinformé, ultra-actif et surdoué de solidarité. Je souligne
les risques d’asymbolie que comporte
l’humanité unidimensionnelle, qui bricole même des croyances en survolant le
supermarché des spiritualités, sans les intégrer et encore moins les interroger. J’attire l’attention sur
l’aplatissement de l’expérience intérieure, l’amenuisement de la polysémie du monde contemporain,
de cette polyphonie qui fait de chacun et chacune d’entre nous non pas un univers
mais un « multivers ». Ce multivers s’était construit dans le cadre
du triangle familial et de la tiercéité propre aux sociétés pyramidales, avec leur principe hiérarchique et d’autorité, qui sont exposés aujourd’hui la poussée des démocraties « normalisées ». Le
triangle et la com’ unidimensionnelles sont-il
conciliable ? Un profond changement anthropologique est en cours, dans lequel le « for
intérieur » a de moins en moins de chances de se construire et de
s’exprimer. Or, quand il ne peut pas s’exprimer, il tombe malade, il passe à
l’acte, il devient violent ou, plus banalement, se robotise. La cure
analytique, certaines formes d’art, l’écriture sont des lieux où les
« multivers » peuvent encore se construire. Et aussi la réévaluation
de la tradition religieuse, du besoin de croire et du désir de savoir, qui
séduisent et reviennent par intermittence, quand ils ne se crispent pas en revanches intégristes. C’est d’ailleurs
au continent religieux, plus qu’au discours politique, que s’adressent ces
pulsions du temps, par delà le « fil coupé de la tradition » que nous
lèguent les Lumières françaises.
HD. L’origine
du langage, écrivez-vous, se situe « au moment exquis où un mammifère
bipède a su témoigner de son sommeil et de ses rêves ». Qu’est-ce à dire ?
Julia Kristeva. Vous citez un texte que j’ai écrit
pour une exposition de mon amie commissaire d’art moderne Marie Shek au Passage de Retz à Paris en 2008 et qui
s’intitulait : « Promenades insomniaques, Dormir et rêver l’art
contemporain ». Entre la veille et
le sommeil, dans les états oniriques et dans l’insomnie, une excitation plaisante ou angoissante
nous submerge, sans sens, insensée, qui cherche à se dire. Nous n’y parvenons en fait qu’en
acceptant de perdre – pour l’exprimer - l’intensité de l’excitation. Ce
moment précis, celui de la perte et de son acceptation, le moment de la
déception, du renoncement au trop-plein de la passion, est une sorte de deuil
indispensable. Un vide transitoire est nécessaire pour que la passion accède à sa « psychisation », à la possibilité de la représentation
psychique et progressivement au langage et la pensée. Parvenir à cette
représentation psychique, à prendre de la distance par rapport au tourbillon de
la passion, c’est la condition sine qua non du sens. La psychanalyse mise à
part, qui s’y attarde ? La « tendance » est à une « idéologie
dominante » qui exalte la satisfaction et l’action, tandis que les états de frustration, de vide et de limites qui
constituent l’être parlant sont dévalorisés, déniés… Ou laissés à la psychanalyse, à l’art moderne, à Marie Shek, à mes pulsions du temps…
HD. Vous
intervenez assez régulièrement dans le débat politique. Non pas dans le débat
politicien mais sur le fond. Sur ce fond-là, comment analysez ce qui se passe
autour de l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe ?
Julia Kristeva. Le climat qui s’est créé autour de l’ouverture du mariage aux homosexuels n’est pas propice à une prise de parole sereine et au dialogue. Je pense que le débat n’a pas été mené suffisamment en amont. Il aurait fallu des années peut-être de réflexion dans les écoles, dans les médias, dans les associations de parents, etc. Cela dit et quoi qu’il en soit, cette loi est sur le point d’être votée. Il reste donc un gros travail à venir pour ressouder le corps social, ce que l’on espère d’un gouvernement socialiste, et surtout pour penser la mutation anthropologique dont l’ouverture du mariage est une des pièces. Deux pistes de réflexion. Si l’on en croit les sondages, la majorité des Français est favorable aux mariages gay, ce qui veut dire que l’on a désormais bien compris et intégré que l’homosexualité ne ressortit ni de la criminalité ni de la perversion. Mais plus encore, cela signifie que si nous ne sommes pas « tous homosexuels », au sens du passage à l’acte homosexuel, chacun de nous reconnait son propre homo-érotisme. Plus profondément que le principe d’égalité ou la compassion pour les discriminés, le citoyen du XXIe siècle connaît son homo-érotisme et vote pour. En revanche, reste la grande question de la filiation et de la parentalité. Être père et mère, ce ne sont pas seulement des fonctions ou des principes, mais des expériences psychosexuelles. Il manque une vaste réflexion, personnelle et sociale, sur le sens et les métamorphoses de la parentalité.
Comment je me situe dans la différence
sexuelle et par rapport à ces deux expériences psychosexuelles très complexes que
sont la paternité et la maternité ? Dans une famille recomposée par exemple,
les substitutions-délégations-incarnations de la paternité et de la maternité
deviennent multiples. La nouvelle humanité que nous sommes en train de créer sera peut-être meilleure que la précédente. Peut-être
pas. Essayons d’analyser sérieusement et dans la durée les avantages et les inconvénients des
métamorphoses en cours. Et, dans la période de transition qui s’ouvre,
d’envisager des étayages pour permettre
aux enfants une vie optimale, créative et innovante. La dramatisation française
de cette situation n’est pas forcément une impasse : et si nos angoisses
exprimées étaient en avance sur la tolérance de certaines autres nations qui
s’adaptent plus facilement? Je
parie sur l’apport des sciences humaines, de la psychanalyse, de la
psychologie, de l’anthropologie, de la sociologie pour ouvrir ces
questions. Ne les laissons pas aux
politiques qui « gèrent la situation » mais ne se soucient pas
vraiment du sens qu’entraînent les lois. On croit savoir ce que sont une mère
et un père juif, les catholiques ont Marie et le Pape, les musulmans suivent leur Coran… La sécularisation est
la seule civilisation qui ne sait pas, ne veut pas savoir, ce qu’est une mère,
ce qu’est un père. Et l’enfant ? Un antidépresseur de papa et de maman, à
bricoler avec l’aide du pharmacien, du pédiatre, du pédopsychiatre, de l’école,
de la police, du « pôle emploi »… En attente d’une morale laïque à la
hauteur du mariage pour tous, la transvaluation des religions n’a pas encore
commencé…
Entretien réalisé par
Jérôme-Alexandre Nielsberg
Humanité Dimanche du 1 mai 2013
|
 |
|---|