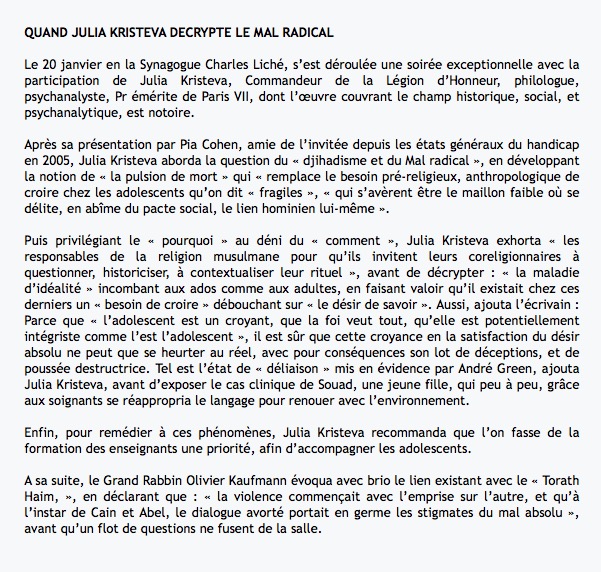|
|
CONTRE QUI
LES FRANCAIS SONT-ILS EN GUERRE ?
(Conférence-débat, Temple des Vosges, le 20 janvier 2016)
La guerre est en France, mais contre qui les Français sont-ils en guerre ? D’un côté : les prétentions totalitaires du djihadisme sanguinaire ; de l’autre : un nous qui est en train de rassembler les « enfants de la Patrie » autour de La Marseillaise. De quel « nous » s’agit-il ? Les Français de confession juive sont la cible la plus exposée des assassins ; la laïcité française est le pôle le plus affirmé de la culture des Lumières que les terroristes visent à abattre. Je fais donc mienne l’expression de Manuel Valls déclarant que « la flamme du judaïsme est l’âme de la République ». Mais puisque je suis moins optimiste qu’un Premier ministre – je me considère comme une pessimiste énergique- je comprends l’angoisse de ceux qui préfèrent quitter le pays pour protéger leur vie : la « vie » n’est-elle pas LA valeur qui nous reste dans la crise de « nos valeurs » ? Et je me demande : peut-on encore ressouder le pacte social ? Telle est pourtant l’urgence rude et de longue haleine. Pourquoi ? Si le terroriste-assassin « court toujours » en effet, c’est parce qu’il est plus insidieux que le « heurt des religions ». NOUS (la flamme du judaïsme ET l’âme de la République), - nous sommes menacés par une nouvelle version du nihilisme dont la brutalité et l’ampleur, sans précédent en France, sont en train de mondialiser le mal radical et la pulsion de mort. (J’y reviendrai) Plus encore, portée par les prouesses techniques de l’hyperconnexion, cette version aggravée du nihilisme nous oblige à repenser et à réévaluer nos modèles de penser, d’éduquer, de gouverner que nous avons hérités des Lumières, car ils ont sous-estimé le mal radical et la pulsion de mort, en s’efforçant, depuis plus de deux siècles, de rompre le fil avec la tradition religieuse pour fonder les valeurs d’une morale universelle. - Repenser le « mal radical » - Revenir sur nos certitudes, sans les rejeter, pour nous inviter à les affiner. Tels sont les enjeux
globaux que je voudrais vous soumettre, à partir de mon expérience personnelle
et mon domaine spécifique, forcément restreint, d’enseignante, de psychanalyste
et d’écrivain. Je reprendrai l’essentiel de mon intervention sur le site Slate.fr que certains de vous connaissent déjà, et
qui me vaut l’honneur d’être invitée ce soir, ici.
INTERPRETER LE MAL RADICAL
Qu’est-ce que le « mal radical » ? Emmanuel Kant avait employé l’expression pour nommer le désastre de certains humains qui considèrent d’autres humains superflus, et les exterminent froidement. Hannah Arendt avait dénoncé ce mal absolu dans la Shoah. Freud nous a appris qu’il existe un « besoin de croire » pré-religieux, constitutif de la vie psychique. Pourquoi « la pulsion de mort » remplace-t-elle ce besoin pré-religieux, anthropologique de croire chez les adolescents qu’on dit « fragiles » ? Aujourd’hui, les adolescents de nos quartiers, issus pour moitié de familles musulmanes, et pour moitié de familles chrétiennes, juives ou sans religion, s’avèrent être le maillon faible où se délite, en abîme du pacte social, le lien hominien lui-même (le conatus de Hobbes et de Spinoza). Et la reliance entre les vivants parlants explose dans un monstrueux déchaînement de la pulsion de mort.
Comment et pourquoi Je ne saurais développer les causes géopolitiques et théologiques de ce phénomène : la responsabilité du post-colonialisme, les failles de l’intégration et de la scolarisation, la faiblesse de « nos valeurs » qui gèrent la globalisation à coups de pétrodollars appuyés sur des frappes chirurgicales, le rétrécissement du politique en serviteur de l’économie par une juridiction plus ou moins soft ou hard…. Des responsables de la religion musulmane eux-mêmes appellent désormais à sanctionner fermement ceux qui prêchent la « guerre sainte », mais aussi à abandonner les discours prétendument « quiétistes » qui se contentent, paraît-il, de dresser humblement la listes de nos « impuretés » et, ce faisant, désignent implicitement tout « infidèle » ou « mécréant », où qu’il soit de par le monde, à la vindicte des « purs ». Certains ont aussi le courage d’interroger l’Islam dans son rôle de législateur absolu (code de procédures régulatrices : comment s’organiser entre nous ?) et invitent leurs coreligionnaires à questionner leur rituel contraignant, à l’historiciser, à le contextualiser : pourquoi ? quand ? avec qui ? Serait-ce parce qu’Allah rappelle, davantage que le Dieu de la Bible et des Évangiles, le « Premier Moteur immobile » qu’Aristote avait placé à la périphérie de l’Univers, et que par conséquent ce divin-là n’entretient pas de rapport paternel avec le fidèle ? Il manquerait, dit-on, à l’Islam un approfondissement du « meurtre du père » dont les conséquences ont transformé, dans l’histoire de l’humanité, la « horde primitive » en « pacte social ». Cette élucidation du parricide sous-jacent à la réglementation, du meurtre en doublure de la Loi, qui s’est produite dans le judaïsme et le christianisme, a ouvert la voie à l’infini retour rétrospectif sur l’hainamoration constitutive du lien anthropologique ; pourtant, en s’épargnant le renvoi définitif à un Au-delà inaccessible, et sans sanctifier tout acte guerrier, cette élucidation n’a pas empêché les croisades, les guerres de Religion et les pogromes. Quelque mécanique et inabordable que puisse apparaître l’Absolu coranique ainsi perçu, force est de reconnaître qu’il n’a pas interdit que se développent dans l’Islam une grande école « rationaliste » de savants et de philosophes, et un puissant courant mystique de poètes, qui devaient féconder la culture européenne… De tels mouvements interprétatifs, moins minoritaires que dans le passé, reprennent de la vigueur aujourd’hui au sein de l’Islam, sous le choc des tueries à Charlie Hebdo et à Hyper Cacher et, plus fortement encore, confrontés aux kamikazes du 13 novembre. Ils n’annoncent pas nécessairement l’avènement d’un Islam des Lumières. Certes, Diderot fut un chanoine avant de devenir déiste et en définitive athée, mais le débat philosophique avait déjà infiltré la théologie catholique dès saint Augustin, illuminé le XIIe siècle et n’avait pas cessé jusqu’aux querelles intestines des Encyclopédistes. Les crises endémiques de la globalisation en cours, et l’impuissance de l’Europe en elle, ne facilitent pas non plus ce processus de réévaluation des valeurs. Mais elles rendent nécessaire une refondation nouvelle, spécifique, à réinventer, sans suivre aucun modèle préalable, fut-il celui des Lumières. La pensée procédurale de la modernité entrepreneuriale, le comment à la place du pourquoi, l’assujettissement au calcul technique, le retrait des individus interconnectés, avec mort à soi et exaltation virtuelle, ne sont pas en contradiction avec des comportements rituels d’un autre âge : nos barbaries modernes se reconnaissent dans les anciennes et vice versa, leurs logiques sont compatibles. Au contraire, si la sécularisation qui a « rompu le fil avec la tradition religieuse » (selon Tocqueville et Arendt) est une réalité irréversible, et si elle demeure un combat de longue haleine, l’assaut du gangstéro-intégrisme islamiste nous oblige à regarder sans indulgence nos blessures et nos ratages, au même titre que nos potentialités, leur endurance et leur avenir. Trop longtemps, l’humanisme sécularisé s’est contenté de cibler les abus des religions liberticides, et cette vigilance est plus que jamais d’actualité. Mais une nouvelle urgence s’impose : la séduction que les religions exercent sur les personnes et les communautés humaines, ainsi que leur rôle de consolateur, éducateur, régulateur et manipulateur des angoisses et des destructivités attendent d’être élucidés. Plus précise que la philosophie, et en prise clinique immédiate avec l’expérience singulière, c’est la psychanalyse freudienne qui, depuis seulement cent cinquante ans, aborde l’héritage religieux avec cette ambition. Difficilement, à travers avancées et errances, adulée ou honnie, la psychanalyse a su reprendre l’investigation du « besoin de croire » et du « désir de savoir », pour sonder les nouvelles maladies de l’âme et les nouveaux messagers du nihilisme. J’entends l’effroi de cette passante qui dépose des fleurs au Bataclan et interroge le micro tendu : « Comment peut-on être djihadiste ? Quels sont leurs états d’âme ? Peut-on faire quelque chose ? » Ces dimensions de l’état de guerre ne sont pas secondaires. Elles participent du volet préventif de l’état de guerre : en amont des mesures punitives, sécuritaires ou militaires, il ne suffit pas de repérer comment procèdent les djihadistes pour recruter leurs exécuteurs du djihad. Il importe d’accompagne les candidats au djihad en voie de radicalisation, avant qu’ils ne rejoignent les camps de Daesh, pour revenir en kamikazes ou, éventuellement, en repentis plus ou moins sincères, pour une éventuelle déradicalisation. Depuis deux décennies déjà, mon expérience de psychanalyste m’a fait rencontrer le mal-être des adolescents. Dès 2005, à l’occasion d’un Forum européen, j’ai attiré l’attention sur la « maladie d’idéalité » spécifique à toute cette classe d’âge mais qui se poursuit comme une « structure adolescente » chez des personnes adultes, et tout particulièrement dans les sociétés sécularisées et multiculturelles [1] . Depuis trois ans, et à l’invitation du Prof. Marie-Rose Moro, directrice de la Maison de l’Adolescent (Maison de Solenn), à l’hôpital Cochin, ma réflexion se poursuit dans ce cadre hospitalier [2] . Le séminaire « Besoin de croire » s’adresse désormais aux personnels soignants (psychiatres, psychanalystes, psychologues, infirmiers, divers thérapeutes, éducateurs, assistants sociaux, etc.) qui accompagnent le mal-être adolescent. Besoin de croire Les théologiens distinguent la coyance/confianace juive, de la foi chrétienne ; mais n’oublions pas leur source commune. Prenons le Psaume 116 :10.: « He' emanti ki adaber... » ; « J’avais foi même quand je disais: /"Je suis vraiment bien malheureux"/ Moi qui disais dans mon trouble: "Tout homme est menteur!" » Puisque le psalmiste évoque, quelques lignes avant cet énoncé, l’écoute miséricordieuse de Yahvé aimant, et en rassemblant les diverses interprétations de l’hébreu « ki » ( «et », « parce que », « malgré » ) , j’entends le verset ainsi : « Puisque Tu me parles et m’écoutes, je crois et je parle malgré l’innommable. » La foi (« emuna », où l'on entend la racine « amen », foi ou croyance) affirme la préexistence d’un LIEN (« il y a de l’Autre ») qui détient la clé de ma parole. Le Nouveau testament reprend en écho ce Psaume/ Tehilim 116: « J’ai cru et j’ai parlé » (Seconde lettre au Corinthiens, 4 :13) Le credo latin remonte au sanscrit kredh-dh/srad-dh_, qui dénote un acte de « confiance » en un dieu, impliquant restitution sous forme de faveur divine accordée au fidèle : investissement et récompense ; c'est de cette racine que découle, laïcisé, le crédit financier: je dépose un bien en attendant récompense (Emile Benveniste a minutieusement argumenté ce développement). Freud a mis en évidence l’investissement (Besetzung(all.) ; Cathexis(ang))comme propriété princeps de la cellule neuronale et de la psychisation.
Deux expériences psychiques confrontent le clinicien à cette composante anthropologique universelle qu’est le besoin de croire pré-religieux. La première renvoie à ce que Freud, répondant à la sollicitation de Romain Rolland, décrit non sans réticences, comme le « sentiment océanique » avec le contenant maternel (Malaise dans la civilisation). La seconde concerne l’« investissement » ou l’ « identification primaire » avec le « père de la préhistoire individuelle » : amorce de l’Idéal du moi, ce « père aimant », antérieur au père œdipien qui sépare et qui juge, aurait les « qualité des deux parents » (Le Moi et le Ça). La croyance dont il s’agit n’est pas une supposition mais, au sens fort, une certitude inébranlable : plénitude sensorielle et vérité ultime que le sujet éprouve comme une sur-vie exorbitante, indistinctement sensorielle et mentale, à proprement parler ek-statique (dans le « sentiment océanique ») et dépassement de soi dans la « transcendance » de ce premier tiers qu’est le père (l’« unification » avec la paternité aimante). Le besoin de croire satisfait et offrant les conditions optimales pour le développement du langage apparaît comme le fondement, sur lequel pourra se développer une autre capacité, corrosive et libératrice : le désir de savoir.
L'adolescent est un croyant La curiosité insatiable de l'enfant-roi, qui sommeille dans « l'infantile » de chacun de nous (S. Freud, Trois Essais sur la théorie de la sexualité, 1905) fait de lui un « chercheur en laboratoire » qui, avec tous ses sens éveillés, veut découvrir « d’où viennent les enfants ». En revanche, l’éveil de la puberté chez l’adolescent implique une réorganisation psychique sous-tendue par la quête d’un idéal : dépasser les parents, la société, le monde, se dépasser, s’unir à une altérité idéale, ouvrir le temps dans l’instant, l’éternité maintenant. L’adolescent est un « croyant » qui surplombe le « chercheur en laboratoire » et parfois l’empêche d’être. Il croit dur comme fer que la satisfaction absolue des désirs existe, que l’objet d’amour idéal est à sa portée ; le paradis est une création d’adolescents amoureux : Adam et Ève, Dante et Béatrice, Roméo et Juliette… Croire, au sens de la foi, implique une passion pour la relation d'objet : la foi veut tout, elle est potentiellement intégriste, comme l'est l'adolescent. Nous sommes tous des adolescents quand nous sommes des passionnés de l'absolu, ou de fervents amoureux. Freud ne s'est pas occupé suffisamment des adolescents parce qu'il était lui-même le plus incroyant, le plus irréligieux des humains qui n’aient jamais existé. Cependant, cette croyance que le monde idéal existe est continûment menacée, voire mise en échec, car nos pulsions et désirs sont ambivalents, sado-masochiques, et la réalité impose frustrations et contraintes. L’adolescent, qui croit à la relation d'objet idéale, en éprouve cruellement l'impossibilité. Alors, l’échec de la passion en quête d'objet s'inverse en punition et autopunition, avec le cortège de souffrances que connaît l'adolescence passionnée : la déception-dépression-suicide ; la poussée destructrice de soi-avec-1'autre : le vandalisme de la petite délinquance ; la toxicomanie qui abolit la conscience, mais réalise la croyance en l'absolu de la régression orgasmique dans une jouissance hallucinatoire ; les adolescentes anorexiques qui attaquent la lignée maternelle et révèlent le combat de la jeune fille contre la féminité, au profit d'un surinvestissement de la pureté-et-dureté du corps, dans le fantasme d'une spiritualité, elle aussi absolue, où le corps tout entier disparaît dans un au-delà à forte connotation paternelle.
Croyance et nihilisme : les maladies de l'âme Structurée par l'idéalisation, l'adolescence est une maladie de l'idéalité : soit l'idéalité lui manque ; soit celle dont elle dispose ne s'adapte pas à la pulsion pubertaire et à son besoin de partage avec un objet absolument satisfaisant. Nécessairement exigeante et hantée par l’impossible, la croyance adolescente côtoie inexorablement le nihilisme adolescent : le génie de Dostoïevski fut le premier à sonder ces nihilistes possédés. Puisque le paradis existe (pour l'inconscient), mais « il » ou « elle » me déçoit (dans la réalité), je ne peux que « leur » en vouloir et me venger : la délinquance s'ensuit. Ou bien : puisque ça existe (dans l'inconscient), mais « il » ou « elle » me déçoivent ou me manquent, je ne peux que m'en vouloir et me venger sur moi-même contre eux : les mutilations et les attitudes autodestructrices s'ensuivent. La déliaison Endémique et sous-jacente à toute adolescence, la maladie d’idéalité risque d’aboutir à en une désorganisation psychique profonde, si le contexte traumatique, personnel ou socio-historique s’y prête. L’avidité de satisfaction absolue se résout en destruction de tout ce qui n’est pas cette satisfaction, abolissant la frontière entre moi et l’autre, le dedans et le dehors, entre bien et mal. Aucun lien à aucun « objet » ne subsiste pour ces « sujets » qui n’en sont pas, en proie à ce qu’André Green appelle la déliaison (Cf. André Green, La Déliaison, 1971-1992), avec ses deux versants : la désubjectivation et la désobjectalisation. Où seule triomphe la pulsion de mort, la malignité du mal. Déni ou ignorance, notre civilisation sécularisée n’a plus de rites d’initiation pour les adolescents. Epreuves ou joutes, jeûnes et mortifications mis en récits et dotés de valeurs symboliques, ces pratiques culturelles et cultuelles, connues depuis la préhistoire et qui demeurent dans les religions constituées, authentifiaient le syndrome d’idéalité des adolescents et aménageaient des passerelles avec la réalité communautaire. La littérature, en particulier le roman dès qu’il apparaît à la Renaissance, savait narrer les aventures initiatiques de héros adolescents : le roman européen est un roman adolescent. L’absence de ces rites laisse un vide symbolique, et la littérature- marchandise ou spectacle est loin de satisfaire aujourd’hui les angoisses de ce croyant nihiliste qu’est l’adolescent internaute qui préfère les jeux vidéo aux livres. Aux XIXe et XXe siècles, l’enthousiasme idéologique révolutionnaire, qui « du passé faisait table rase », avait pris le relais de la foi : la « Révolution » a résorbé le besoin de se transcender, et le temps idéal de la promesse s’est ouvert, avec l’espoir que l’ « homme nouveau », femme comprise, saurait jouir enfin d’une satisfaction totale. Avant que le totalitarisme ne mette fin à cette utopie mécanique, à ce messianisme laïc, qui avait expulsé la pulsion de mort dans l’ « ennemi de classe », et réprimé la liberté de croire et de savoir. En dessous du heurt des religions Prise au dépourvu par le malaise des adolescents, la morale laïque semble incapable de satisfaire leur maladie d’idéalité. Comment faire face à cet intense retour du besoin de croire et du religieux qui s’observe partout dans le monde ? La résurgence de jeunes catholiques très « engagés » contre le mariage pour tous a beaucoup surpris. Le plus souvent, ce sont des « bricolages spirituels » que les jeunes se fabriquent, en glanant sur Internet de-ci de-là de vagues notions spirituelles, ou bien ils adhérent à des formes abâtardies de telle ou telle religion (les sectes), quand ils ne s’enrôlent dans des groupes intégristes (qui encouragent au nom de l'idéal une explosion de la destructivité). Plus insoluble encore : serait-ce possible d’arrêter la déliaison qui lâche, en roue libre, la pulsion de mort dans le gangstéro-intégrisme adolescent de nos quartiers ? Cette délinquance prête à se radicaliser, le plus souvent en prison (avant, les « radicalisables » préfèrent la jouissance immédiate de l’argent facile et du « passage à l’acte »), fait apparaître que désormais le traitement religieux de la révolte se trouve lui-même déconsidéré. Il ne suffit pas à assurer l'aspiration paradisiaque de ce croyant paradoxal, de ce croyant nihiliste, forcément nihiliste, parce que pathétiquement idéaliste, qu'est l'adolescent désintégré, désocialisé dans l'impitoyable migration mondialisée imposée par l’ultralibéralisme, impitoyable lui aussi, quand il marchandise et arase toute « valeur » avec la capacité de problématiser les images et la publicité. Il existe également des « fausses » personnalités, « clivées », « comme si » : chez ces adolescents ( ou jeunes adultes) en apparence bien socialisés, et dotés de performances techniques plus ou moins appréciables (conformité au « comment »), les crises affectives inabordables (soustraites au « pourquoi » du langage et de la pensée) se manifestent brusquement dans des conduites destructrices, au grand étonnement des proches qui ne se doutaient de rien... En dessous du « heurt de religions », la déliaison nihiliste est plus grave que les conflits interreligieux, parce qu'elle saisit plus en profondeur les ressorts de la civilisation, mettant en évidence la destruction du besoin de croire pré-religieux, constitutif de la vie psychique avec et pour autrui. Il nous faut ici faire une distinction. Oui, il existe, d’une part, un mal qui résulte des heurts entre valeurs, elles-mêmes résultant d’intérêts libidinaux divergents ou concurrents, et qui sous-tendent nos conceptions du bien et du mal élaborées dans les divers codes moraux historiquement formés, dans des aires culturelles variées. L’Homme religieux et l’Homme moral en sont constitués : plus ou moins coupables et révoltés, ils en vivent, s’en préoccupent et espèrent les élucider pour éventuellement s’entendre au lieu de s’entre-tuer. A côté de ce mal, il en existe un autre, le mal extrême, qui balaie le sens de la distinction elle-même entre bien et mal, et de ce fait détruit la possibilité d’accéder au sens de soi-même et à l’existence d’autrui. Ces états limites ne se refugient pas dans les hôpitaux ni sur les divans, mais déferlent dans les catastrophes sociopolitiques, telle l’abjection de l’extermination que fut la Shoah, une horreur qui défie la raison. De nouvelles formes de mal extrême se répandent aujourd’hui dans le monde globalisé, dans la foulée des maladies d’idéalité. Seraient-elles « sans pourquoi » ? La mystique et la littérature le disent. L’expérience psychanalytique, quant à elle, ne se contente pas non plus d’être un « moralisme compréhensif ». Dans l’intimité du transfert-contretransfert, elle cherche à affiner l’interprétation de cette malignité potentielle de l’appareil psychique qui se révèle dans les maladies d’idéalité. La psy se réinvente Souad a été hospitalisée pour anorexie grave, froide passion mortifère, accès de boulimie et vomissements épuisants : la déliaison est en marche. Ce lent suicide, adressé à sa famille et au monde avait aboli le temps, avant de se métamorphoser en radicalisation. Le jeans troué et le gros pull flottant avaient disparu sous la burqa, Souad s’emmurait dans le silence et ne décollait pas d’Internet où, avec des complices inconnus, elle échangeait des mails coléreux contre sa famille d’ « apostats, pires que les mécréants », et préparait son voyage « là-bas », pour se faire épouse occasionnelle de combattants polygames, mère prolifique de martyrs ou kamikaze elle-même. Méfiante et taiseuse, rétive à la psychothérapie comme beaucoup d’ados, Souad s’est cependant laissée surprendre par la consultation de « psychothérapie analytique multiculturelle » faite avec une dizaine d’hommes et de femmes de toutes les origines et de diverses compétences, qui n’interrogeaient pas, ne diagnostiquaient pas ni ne jugeaient. Ils affinent la diversité empathique de leur équipe : identifications disséminées et plurielles, famille recomposée, communauté réparatrice. Proximité maximale avec les affects, sensations et excitations frustrés, humiliés, mortifiés. Et mise en mots de l’effondrement, pour accompagner cette personne qui s’agrippe à la barbarie pour ne pas tomber en morceaux mais jouir à mort. La jeune fille qui provoquait en se décrivant comme un « esprit scientifique », forte en maths et physique-chimie, mais « nulle en français et en philo », commence à trouver du plaisir à se raconter, à jouer avec l’équipe, à rire avec les autres et d’elle-même. Renouer avec le français, apprivoiser avec le langage les pulsions et sensations en souffrance, trouver les mots pour les faire exister, défaire et refaire, les partager : la langue, la littérature, la poésie, le théâtre piègent le manque de sens et déjouent le nihilisme. Roland Barthes, que nous commémorons actuellement, n’écrivait-il pas que, si vous retrouvez la signification dans la plénitude d’une langue, « le vide divin ne peut plus menacer » ? Souad n’en est pas encore là. Elle a remis son jean. Ce sera une longue marche. Mais combien de jeunes filles n’auront pas la chance de Souad d’être reconnues, entendues, soutenues ? L’accompagnement des adolescents « radicalisables » fait partie de cette guerre virale qui se répand dans le monde, et dont les attentats ourdis par le terrorisme islamiste et nos bombardements aériens ne sont que la version militaire. Guerre virale, parce qu’elle opère, invisible et invasive, avec des formations aussi (sinon plus) anciennes et résistantes, aussi inhérentes et destructrices de l’humanité que le sont les virus pour nos cellules : la guerre virale opère avec la pulsion de mort et le mal radical, qui cohabitent avec nos organismes vivants et nos identités psychiques, et qui, dans certaines circonstances, détruisent leurs hôtes et répandent la malignité à travers le monde. Un défi historique Nous découvrons alors que, suite à des désintégrations familiales et défaillances sociales, certaines personnes, notamment des adolescents, sombrent dans des états limites qui en font des proies faciles, livrées à la propagande de la « guerre sainte » qui érotise leur destructivité (décapitations, bombes humaines, tueries indifférenciées), les attirent dans des camps de maltraitance et d’asservissement, et les intoxiquent par le fantasme d’un paradis garant d’éternité et de salut : hors-temps et hors-monde. Le suivi des adolescents en proie à la radicalisation ou radicalisés place l’analyste au croisement insoutenable où cette désubjectivation-désobjectalisation s’exerce et menace, quand l’être humain, devenu incapable d’investir et d’établir des liens, dépossédé de « soi » et dépourvu du sens de l’autre, erre dans une absence de « monde », dans un non-monde, sans « bien » ni « mal » ni « valeur » quelconque. Aux frontières de l’humain peut s’amorcer une restructuration de la personne : tel est notre pari, celui de la psychanalyse, avertie de la pulsion de mort. La République se trouve devant un défi historique : est-elle capable d'affronter cette crise que le couvercle de la religion ne retient plus, et qui touche au fondement du lien entre les humains ? De détecter et d’empêcher la radicalisation ? L'angoisse qui fige le pays en ce temps de carnage, sur fond de crise économique et sociale, exprime notre incertitude devant cet enjeu colossal. Sommes-nous capables de mobiliser tous les moyens, policiers comme économiques, sans oublier ceux que nous donne la connaissance des âmes, pour accompagner avec la délicatesse de l'écoute nécessaire, avec une éducation adaptée et avec la générosité qui s'impose, cette poignante maladie d'idéalité qui déferle sur nous avec l’atrocité des radicalisés ? Ainsi interprétée, la barbarie des djihadistes en proie à la malignité du mal, concerne « nos valeurs » fondamentales, notre culture humaniste sécularisée et notre modèle de civilisation où la rationalité n’est pas sans recours face au mal radical sous couvert de révélation divine. La guerre contre le mal radical nous demande de prendre au sérieux le projet de Nietzsche : « Poser un grand point d’interrogation à l’endroit du plus grand sérieux », entendons : à l’endroit de Dieu, des idéaux, et de leur absence. Pour les faire connaître, les transmettre aux jeunes générations, et les réévaluer, les problématiser, les repenser sans fin, les réinventer. Interpréter l’horreur et lutter concrètement contre elle par tous les moyens. Ne pas démissionner devant le mal, ni même devant le mal extrême. Mais poursuivre patiemment la recherche, certainement pas d’on ne sait quel équilibre utopique et sécuritaire, mais de ce point fragile que Pascal définit comme un « mouvement perpétuel », en écrivant : « Qui a trouvé le secret de se réjouir du bien sans se fâcher du mal contraire aurait trouvé le point. C’est le mouvement perpétuel. » Et si la vision qui nous manque aujourd’hui était précisément ce « point », ce « mouvement perpétuel », vers le « secret de se réjouir du bien sans se fâcher du mal. » Une certaine expérience intérieure très exigeante que les barbares ont désertée… Il ne suffit pas de bombarder Daesh, d’incarcérer les djihadistes, ou de promettre voire de trouver du travail aux jeunes chômeurs des quartiers. Il est urgent d’organiser, avec les parents, dès le plus jeune âge, un suivi attentif aux failles chez les éventuelles proies des fous de Dieu, qui se tapissent, souvent inaperçues, dans les marges sociales ou dans les pathologies latentes. Il est plus qu’urgent aussi de forger et de partager de nouveaux idéaux civiques attractifs pour une jeunesse vécue comme une ressource, et non plus comme un danger. Ses qualités de générosité, de créativité et d’engagement pourraient se déployer dans des métiers à vocation sociale, éducative, culturelle, humanitaire ; des ONG, des institutions de coopération, d’entraide, etc. ; reconstruire l’Afrique est parmi ces chantiers qui peuvent passionner les jeunes Européens ; mais aussi l’éducation des jeunes filles ; le développement des énergies durables… Qui pourrait éveiller, guider, faire aboutir ces désirs ? Faisons une priorité de la formation, assortie d’une valorisation conséquente, d’un « corps enseignant et formateur » ; ce dispositif serait voué à l’accompagnement personnalisé du mal-être psycho-sexuel, du besoin de croire et du désir de savoir des adolescents. Les éducateurs, enseignants, professeurs, auxiliaires de vies, psychologues, mais aussi managers en ressources humaines, entrepreneurs… pourraient créer une véritable passerelle au-dessus l’abîme qui se creuse et de l’état de guerre qui menace. C’est cela, la priorité mondiale de notre globalisation hyperconnectée. La seule qui pourrait protéger – à travers la diversité culturelle devenue partageable – l’humanité elle-même.
Julia Kristeva Le 29.11.2015
[1] J. Kristeva « L’adolescence, un syndrome d’idéalité » (2005), in La Haine et le Pardon, Fayard, 2005, p. 447-460. [2] Cf. J. Kristeva, Cet incroyable besoin de croire, Bayard, 2007
|
 |
|---|